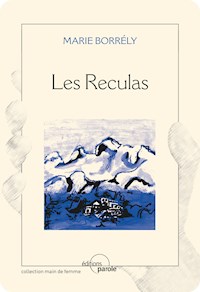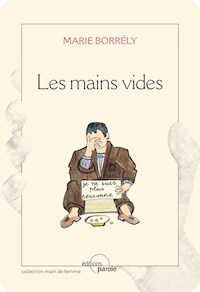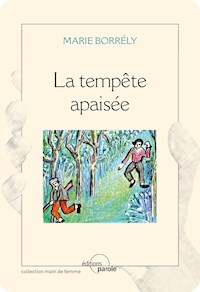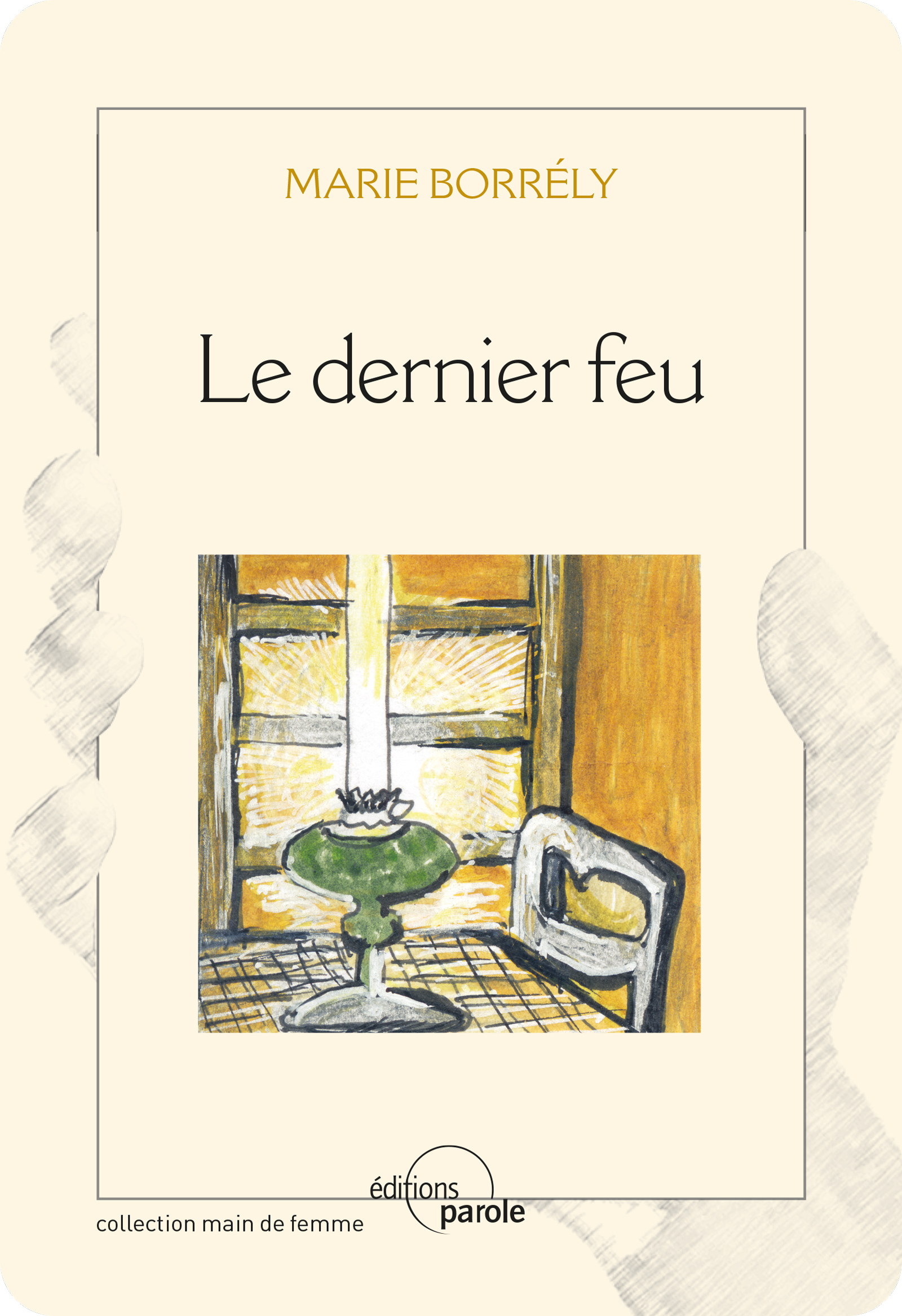
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editions Parole
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
- Veröffentlichungsjahr: 2020
L’un après l’autre, ils quittent le vieux village pour descendre dans la vallée, là où gronde la rivière mais où la terre est plus généreuse. Si le chant de l’Asse attire famille après famille, il rappelle également que la rivière sait se mettre en colère et emporter bêtes et champs. Pélagie s’y refuse. « Raide comme un vieux tronc, maigre comme une pioche », elle reste plantée dans son vieux pays de rocailles, desséché par le soleil et le vent, et y fait sa soupe avec les herbes sauvages ramassées dans son tablier. C’est le quotidien d’un village du début de xxe siècle dont Maria Borrély fait le portrait. De toute la force poétique qui caractérise son œuvre, elle mélange gens, bêtes, saisons, travaux, soleil, eau et vent : « Dominant le concert de l’Asse, cors claironnant, clairons sonnant, s’élançait, par delà les montagnes au dos blanc, la troupe du grand vent dans le galop effréné de ses cavaliers. »
À PROPOS DE L'AUTEURE
Maria Borrély est la grande autrice de Provence qui parle de la vie et du travail dans le monde rural. Amie de Jean Giono, éditée par André Gide, pacifiste après la guerre de 14, résistante pendant celle de 40, elle nous a laissé peu de romans mais chacun contient une force et une poésie étonnante qui forment un des trésors de la littérature de haute Provence. Préfacé par Jean Giono et publié par la Nouvelle Revue Française (NRF / Gallimard) en 1931,
Le dernier feu a reçu, à l’époque, des critiques chaleureuses. Aujourd’hui encore, il enchante le lecteur.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 152
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
◦◦◦
ISBN : 978-2-37586-072-4
© 2020, Éditions Parole
Groupe AlterMondo 83500 La Seyne-sur-Mer
Courriel : [email protected]
www.editions-parole.net
Tous droits réservés pour tous pays
◦◦◦
Maria Borrély
Le dernier feu
Préface
Nous avions fait le grand détour. Il nous avait fallu suivre un troupeau qui charriait, dessous les amandiers, des cornes, de la poussière, des abeilles et de longs bergers calmes mais pleins de sifflets plantés debout dans le flot des bêtes. Ainsi, l’enivrement de l’odeur et du son nous avait déportés loin dans le nord sur le grand détour et on ne savait plus vouloir, sauf de la volonté de ces béliers de devant qui, d’un lent museau, fendaient l’air vers les montagnes. Cependant, on arriva premiers au carrefour de Telle. On s’était dégagé. On n’entendait même plus, par là-bas derrière, la cloche des mulets et le sifflet du baïle. Il y avait seulement le ronflement de l’Asse qui doucement, en bas, écartait ses limons, et le bruit du vent paresseux qui se balançait sur l’air mou de dix heures. Un homme était là à la source de cette route biblique qui s’appelle « la route des troupeaux » : une érosion de fleuve sur le dos sauvage de la colline. Il était près du poteau.
– Vous n’avez pas vu un troupeau ? Il nous dit.
– Si.
– Il est loin ?
On tourna la tête. Il nous semblait tout près mais on ne voyait pas de poussière et c’est seulement le vent qui grondait.
– Quatre kilomètres.
– Il est gros ?
– Quinze cents à deux mille.
– Alors on en a pour une bonne heure, il dit.
Il continua :
– Parce que c’est moi qui lui ai vendu la pâture et je l’attends.
Il était tout petit, tout rôti, tout calciné par le soleil. Ça avait tordu de longs muscles noirs autour de ses bras d’argile. Une petite poitrine d’oiseau toute en fer respirait de solides coups dessous un gilet en poils de chèvre. On ne pouvait pas savoir si ses pieds s’allongeaient jusqu’au bout de ses souliers mais on voyait très bien ses jambes maigres comme des hampes de lavande, et de chaque côté de son front qui éclairait tout net le poil de maïs de son visage, il y avait deux petites bosses comme la naissance de cornes.
– Je l’attends (il nous parlait du troupeau). Il sera doux ; j’ai de belles herbes ; je suis de là (il nous montra une ferme) ma terre est là ; j’ai un petit qui est parti à bicyclette jusqu’à la fête de Valensole. Et vous, où c’est que vous allez ?
– On va à Puimoisson, chez les Borrély.
– Vous les connaissez ? il dit en se reculant d’un pas.
– Diable !
On dit tous ensemble en levant les bras :
– Si on les connaît, c’est des amis !
– Moi aussi, dit l’homme.
Il resta un moment sans rien dire, à regarder ce magnifique pays des premiers âges du monde, ces monts vierges aux arbres neufs, cette herbe épaisse de tout le suc caché des granits, ce lourd océan du plateau avec les forêts flottantes d’amandiers et de rouvres ; il regarda tout ça – on venait de dire : « C’est si beau qu’on ne peut plus s’en arracher, et quand le troupeau sera là. »
Il regarda tout ça et il dit :
– Alors, dépêchez-vous, filez vite ; et il soupira : moi qu’est-ce que vous voulez, je suis obligé de rester ici.
N’est-ce pas Rose Celli, qu’il a dit ça ? N’est-ce pas, Hugues ?
Et, un peu après, quand Lucien Jacques et moi on est entrés les premiers dans la maison et que vous avez eu sur vous tout de suite la parole et le regard des Borrély, n’est-ce pas que vous avez compris ce triste « obligé » du loueur de pâtures et que vous avez entendu pourquoi il nous avait dit « filez vite, dépêchez-vous » et ses yeux étaient tout allumés dessous son front aux cornes naissantes.
« Les Borrély » ! Je plains ceux qui n’ont pas en eux ce mot maître de l’espérance, cette source et ce soleil.
Puimoisson est au milieu du sauvage plateau, à l’endroit juste où le vent qui a sauté les Alpes retombe à pieds joints. Il s’est déchiré les jambes à toutes les montagnes, il est irrité de neiges, il est gonflé d’une ire qui a tordu et retordu ses muscles, il s’est tendu dans le grand saut. Puimoisson, c’est l’aire où il foule rageusement le grain de sa colère. Du côté du plateau, le village a avancé son petit cimetière et il s’est barricadé derrière des tombes ; du côté de la montagne, il a fait la part du vent, il a abandonné ses granges et ses maisons et il les laisse déchirer par l’air fou. Lui, il se fait son petit chaud à côté du clocher, derrière cent petites fenêtres lutées de papier journal. Il est toujours propre et sans fumées, lavé au fond du vent comme un galet de Durance. Et, été comme hiver, le temps écrase là-dessus sa vendange d’orage.
« Les Borrély » sont dans ce village comme dans la vie : à l’extrême pointe, en dehors de tous les abris. Il y a Borrély-chef, le petit Pierre et Maria. Jacques, l’aîné, a déjà quitté le nid et vole, au-delà, sur l’effort de ses bras roux.
– Le vent me troue les vitres, se plaint doucement Maria.
Borrély-chef prend sa colle de pâte et le journal du jour. Au bout d’un moment, il arrive :
– C’est arrangé.
C’est vrai. Dans le couloir, le vent n’est plus là à se tortiller. Il y a seulement un peu plus d’ombre et il faudra que Pierrot invente de nouveaux dessins avec ses pastels pour remplacer ce jour qui ne passe plus à travers le papier collé à la fenêtre.
Combien de fois, troué par tous les vents, suis-je venu me faire arranger par Borrély-chef ! Et avec quel soin il a choisi pour moi les papiers qui laissent passer la lumière !
Le propre de Borrély est de ne pas inventer ceux qu’il aime. Il n’y a pas au monde d’œil plus clair, il n’y a pas, derrière l’œil, de mécanique mieux huilée. Du premier coup il vous connaît comme s’il vous avait fait, et il vous aime tel que vous êtes, avec votre somme de défauts. Bien plus, un beau jour vous vous sentez allégé et bondissant comme si saint François d’Assise, vous ayant ceinturé du bras, vous emmenait en promenade ; vous vous souvenez avoir entendu une petite voix qui chuchotait : « Donne un peu, je vais t’aider. » Vous regardez : c’est Borrély qui porte votre peine, là à côté de vous. Il a mis son épaule sous le poids, il a accordé son pas au vôtre, et en avant, vogue la vie ! N’est-ce pas compagnon, que c’est plus léger comme ça ! Il jette à pleines mains l’effroyable dépense de lui-même.
On est là bien tranquille et puis on reçoit dans les jambes un ange ailé de cheveux blonds, un de ceux-là qui font de la musique rien qu’en soufflant le souffle de leur vie entre leurs joues gonflées. C’est Pierrot. Il a des yeux qui n’ont rien de la terre. Des trous sur du ciel. Si on regarde dans ces yeux au bleu pur, on est perdu. Entendons-nous, perdu pour la terre, perdu pour les soucis, perdu pour le cancer et le dragon, on est à l’abri, on est entré dans cette petite tête ronde où sonne, comme un grain de grelot, Bételgeuse et sa poussière du monde.
Ah ! Celui-là, quand il sera grand, ça va être un fameux professeur d’espérance.
Maria avait les cheveux longs. Il n’y a pas longtemps. Elle les lovait en deux coquilles dessus ses oreilles. Elle s’en allait comme ça en pleins champs, et la vie dansait toute seule entre ces molles cymbales. Maintenant, elle a coupé ses cheveux.
– Oh ! Maria, je lui dis, on dirait la femme-sauvage.
C’est autour de son visage comme la mousse des arbres montagnards.
– Eh ! Elle me dit, ils ne veulent pas rester plats.
– Eh, je lui dis, c’est le vent qui sort de votre tête, comment voulez-vous ?..
Il n’y a pas, chez Maria, de boudoir, de bureau, de table avec l’encrier, le porte-plume de malachite, la rame de papier du Japon. Non. Il y a la table de la cuisine et la table de la salle à manger. La première est un rectangle, la deuxième un cercle. Sur le rectangle, on sacrifie les herbes crues, les viandes et les œufs ; autour du cercle, on range les amis. La table de Maria, c’est ses genoux, c’est ce talus d’herbe rousse près du bassin où la fille est venue se noyer, ivre d’amour et de vent, c’est le feutre des aiguilles de pin sur la colline de Saint-Pancrace, c’est le sol tanné de l’aire ; le papier, Maria l’achète chez l’épicier.
– Un cahier de cent pages, s’il vous plaît !
Au dos, il y a la table de multiplication (ah ! Maria, pour notre bien, pour notre joie et notre sauvetage, multipliez ces enfants de papier et ces enfants de chair que vous savez si bien faire).
Le porte-plume, c’est le porte-plume d’un sou du premier venu de ses écoliers.
– Petit Jules, prête-moi ton porte-plume, je te le rendrai après la récréation.
Pas plus, pour écrire ? Pas plus. Si, en plus, le vent qui souffle de cette tête.
En plus : la fermière a fait un mauvais accouchement. Maria rentre ce matin, saoule de veille, les bras rompus, les doigts brûlés par les tisanes, les jambes en corde molle.
– Je me couche, elle dit.
Borrély est parti avec juste sa veste sur la chemise, au plein de l’hiver, pour aller à la défense d’un ami, juste la veste sur sa chemise et juste la chemise sur son cœur.
En plus la vie et la bonne façon de vivre.
Je sens à des tremblements de l’air que le temps vient où je serai comme Job assis au milieu des tessons, où tout aura coulé entre mes doigts pourris, et je prépare déjà au milieu de ma gorge le cri vers vous, oh ! Borrély ! Mais, si je parle de votre charité et de votre bon enthousiasme, si je vous ai associés tous dans mon affection : Borrély-chef, Maria, les enfants, c’est que, dans cette charité et dans cette union, il y a le secret de vos livres. C’est Maria qui les écrit avec le porte-plume d’un sou, à la table de ses genoux, sur le papier mou de l’épicier, mais c’est d’à travers la belle terre filtrante que vous êtes tous, que suinte l’eau pure alourdie de soleil comme d’un tronc de cèdre. Les balances qui sont là-haut dans les étoiles pèsent la misère et la joie, et nous sommes tous sur la route avec notre part, dans le baluchon de toile. Celui qui avait grand-faim, il restera sans nourriture, avec juste un peu de saumure à lécher au creux de sa main. Celui qui portait l’espérance, comme une flamme de résine, le voilà seul et sans lumière sur la colline des grands buis. Ce qui vous donne autorité, Maria, c’est ce beau verger de cœurs mûrs, pleins de jus pour les soifs et pour les colères, c’est cette charrue que vous traînez et qui bouleverse la terre, et nous ne savons plus, nous, poser les pieds autour de vous sur un endroit qui ne soit prêt à naître en graine, c’est cette moisson de bonté si haute qu’elle vous efface, avec à peine un tourbillon d’épis, à la place où vous respirez.
Ce qui vous donne autorité, ce sont vos lèvres charitables avec leur troupeau de mots sages et bien en paix qui viennent doucement lécher du museau la clenche de notre âme, comme les bonnes brebis demandent l’ouverture de l’étable.
C’est cette science de l’amour et du devoir, et cet entendement des choses orageuses, vous, la si calme et sans nuages.
C’est tout ce poids de bonne volonté que vous portez dans votre peau et qui fera plier la barque du soleil quand vous partirez pour votre repos, dans bien longtemps, bien longtemps, Maria, et que nous serons morts, nous autres, souhaitons-le.
Ce livre qui est là derrière la page comme un gros sac de menthe, à quoi bon en parler ? Il est assez grand, il bouche l’œil. Si je disais : « Regardez-le » on me répondrait : « On a des yeux, nous le voyons ». Non, moi je suis le petit enfant qui joue mal à cachette, je ne connais pas les règles du jeu : il faut faire semblant de chercher celle qui se cache et puis dire « je ne la trouve pas, qui sait où elle est ? » Non, moi je ne sais pas jouer, j’écarte tout d’un coup l’herbe et je crie : « La voilà ! »
Jean Giono
Saint-Julien-en-Beauchêne, août 1931
1
Ce village, là-haut, sur l’échine galeuse de la colline et confondu dans la pierraille, c’est Orpierre-d’Asse. On y arrive Dieu sait comme. Surtout les charrettes.
Les bêtes ne perdent pas le collier !
L’André le convoyeur qui, pour une fois par quinzaine, monte pourvoyer l’Anna, l’épicière, en sait quelque chose. On peut lui en parler. Si c’est pour le plaisir de l’entendre jurer… Le cheval a son compte avant les premières maisons. Il s’est arrêté plusieurs fois pour reprendre le souffle.
Sous le village sont les deux plus mauvais pas : le tournant de l’oratoire, avec le cyprès coupé par le vent, et celui du sorbier, en haut du précipice.
Arrivé sous le plus bas, l’André, deux doigts dans la bouche, siffle le Clermond Gilly qui s’amène avec deux bêtes de renfort glissant et faisant du feu des quatre fers sur les roches luisantes comme un rebord de bénitier.
Quelque chose qui ne doit pas plaire au petit saint Roch poussiéreux de la niche, sous la grille rouillée, c’est la bordée de blasphèmes, les coups de fouet, de taravelle1 assaillant l’attelage. C’est un tremblement. Ça semble une décharge de pierres dans la ravine, et l’écho le répercute… De la pointe de son couteau qu’il maintient d’un pouce ensanglanté, l’André, les dents serrées, pique la cuisse du timonier, bourre de coups de poing la belle tête, frappe du pied au boulet, puis se rend à l’oreille qu’il mord, alors le cheval en met un coup si énergique qu’on franchit tout en tournant au trot et l’homme suit en courant, crachant du sang et des poils.
Collier dans la chair, croupes noires ruisselantes toutes blanches d’écume, les trois chevaux bavant du mors, les yeux travirés et exorbités, trébuchent, s’agenouillent.
Le Clermond est derrière avec une grosse pierre pour caler la roue en cas de besoin.
Et sans compter qu’il est impossible de les faire tirer droit, les bêtes : elles vont et viennent de biais, d’un bord extrême du chemin à l’autre. Près du sorbier, à l’endroit où pend le ravin, les deux hommes, tous muscles bandés et les joues en feu, les tiennent au mors comme des forcenés. Elles ont tout le poitrail dans le vide. Il semble qu’elles vont sauter cent mètres… À l’André et au Clermond il leur en vient chaque fois sueur d’agonie…
Dans la petite rue l’air n’a pas si bon goût que dans le chemin de la colline.
Devant la vitrine basse troublée des souillures des mouches où l’on voit toujours, près du géranium, les paquets de lacets noirs, le carton-réclame du cirage Éclipse, le sucrier de pâte de verre en forme de pomme de pin, le pot à eau en forme de coq, s’arrête l’André.
– Vous y êtes, ou vous y êtes pas ? crie-t-il de toutes ses forces.
Il est en nage et d’une humeur de massacre.
Toute empressée s’amène l’Anna, vieille, étriquée. On voit sous son corsage les reliefs du corset. Elle a le teint sale des boutiquiers, sourit comme elle peut, avec seulement trois dents.
De dessus la charrette, l’André lance dans la boutique savon, sucre, figues sèches, paquets de morues. La caisse des oranges est partagée. Les fruits roulent aux quatre coins du magasin.
L’Anna va et vient de la charrette à la porte, dépose les paquets, ne peut que répéter :
– André ! André !
Il vocifère :
– Et alors ? Vous croyez que ça va durer, un métier pareil ? Vous vous figurez que je vais encore y monter longtemps, à votre pays de chien ?
Il en a à la Sainte Vierge, jure, bouillonne comme un torrent. Les femmes qui passent ont l’air pressées.
Quand c’est fini, l’Anna le calme avec son vieux marc qu’elle lui sert dans l’arrière-cuisine au bord de la table, dans le petit verre bleu au pied ébréché qu’elle emplit deux fois.
Régulièrement chaque fois elle avance la boîte de sucre pour qu’il fasse le canard dont régulièrement il ne veut pas.
Dans le coin près du fenestron, assise et accoudée au pétrin luisant qui sert de coffre, il y a la Pélagie Arnaud, la sœur de l’Anna, et sa petite fille, la Berthe, qui a quatre ans. Serrée dans les jambes de la Pélagie, la Berthe n’a pas l’air trop rassurée au sujet de l’André.
L’Anna tire derrière elle la porte vitrée communiquant avec le magasin, par discrétion et pour le courant d’air : l’homme est en bras de chemise, la touffe de poils roux de la poitrine à l’air. Il a le sang à la tête, nage encore de sueur. Le verre tremble dans sa main.
1. Outil à manche et à étrier dont se servent les viticulteurs pour foncer des trous profonds afin d’y planter des racines de vignes.
2
Dans la sauvage odeur des buis, sous le village et partant de plus haut, lové comme un serpent, il y a cette horreur de val des Terres-Rompues, avec le Riou-Sec qui a mangé toutes les terres de ceux d’Orpierre-d’Asse.
Le Riou-Sec ? Le torrent pourrait tout aussi bien s’appeler le Loup, ou le Vautour…
Nul n’y habite et nul n’y passe. Sauf les chasseurs. Le vent et l’Asse y accordent leurs souffles unis. Parfois, encore, le roulement sourd comme un tonnerre d’un quartier qui descend…
Au milieu, la ruine lourde avec ses pierres roulées brûlantes sous le soleil et qui se sont arrêtées de rouler. Depuis des lunes et des lunes, les roseaux et les joncs ont séché. Nul tremble d’argent n’y miroite.
Quatre peupliers dominant les chênes nains achèvent de jaunir et de mourir. Un gros chêne encore droit, mais aux trois quarts déraciné, arrondit comme des bras cinq racines maîtresses qui n’étreignent plus que l’air vide.