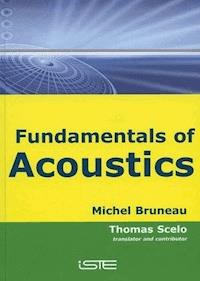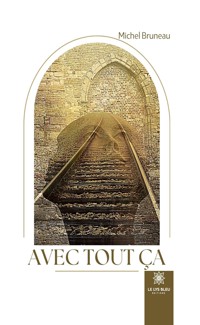
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Le Lys Bleu Éditions
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
1968. Rémi, un lycéen timide, ose entamer une correspondance scolaire avec une étudiante hispano-belge. D’abord platonique, leur relation évoluera rapidement lorsqu’ils se rencontreront. Cependant, un troisième personnage viendra bouleverser les sentiments et la vie des deux jeunes gens, les entraînant à une perte totale de la maîtrise d’eux-mêmes et de la situation. Alors, avec tout ça, qu’adviendra-t-il de Rémi et de son amante ?
À PROPOS DE L'AUTEUR
Ancien instituteur devenu conseiller pédagogique en arts plastiques,
Michel Bruneau a toujours côtoyé la créativité. Il a publié plusieurs recueils de poèmes et depuis peu s’adonne au roman, en s’attachant principalement à ses personnages pour en dégager toute la complexité. Pour lui, l’écriture transfigure le réel pour en montrer des horizons que l’on n’avait pas imaginé exister.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 346
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Couverture
Page de titre
Michel Bruneau
Avec tout ça
Roman
Copyright
© Lys Bleu Éditions – Michel Bruneau
ISBN : 979-10-422-3716-5
Le code de la propriété intellectuelle n’autorisant aux termes des paragraphes 2 et 3 de l’article L.122- 5, d’une part, que les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective et, d’autre part, sous réserve du nom de l’auteur et de la source, que les analyses et les courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite (article L.122- 4). Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335- 2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
Aux premières fois
Il était seul à savoir alors que son cœur plein de vertiges était à jamais condamné à l’incertitude.
Gabriel Garcia Marquez
Prologue
Tout a mal commencé. Enfin, surtout pour moi. Pour ma mère un peu moins, pas tellement pour mon père. Disons qu’il y a dix-neuf ans, tout n’a pas commencé au mieux.
Je suis arrivé en avance et dans le cas précis d’une naissance, ce n’est pas l’idéal. Il vaut mieux être ponctuel et ne pas se faire remarquer par une présence intempestive. Être à l’heure, voilà tout, ça évite les complications, mais quand on est pressé et, pour on ne sait quelle raison, impatient de pointer son nez, voilà ce qui arrive : un prématuré de sept mois. Poussin tombé du nid. À peine deux kilos. Pas même un poids plume.
Prématuré soit, mais mauvaise blague en prime, j’ai le cordon ombilical enroulé autour du cou et cette saleté de boyau s’est resserré au moment où j’ai essayé de passer la tête et les épaules au-dehors. Sacrément resserré même et, bon sang, que le passage a été long ! Maman, qu’est-ce que t’attends ? Dépêche-toi ! J’ai le sang qui s’arrête, j’étouffe !
Je suis quand même arrivé. En avance et à temps et tout bleu. On a dû me secouer, me tapoter partout, peut-être même me donner ma première claque et tout a repris son cours, mon sang, mon cœur et, comme si de rien n’était, j’ai pu alors prendre ma première, et bien méritée, bouffée d’air terrestre.
Le poussin bleu tombé du nid s’est bien sûr illico retrouvé au chaud d’une couveuse avec un tube pour l’aider à respirer et une sonde gastrique pour lui donner la becquée. J’en ai bavé, mais à bonne température et au bout de quelques semaines, l’oiseau fragile a repris de la plume de la bête et du poids. Le poussin bleu est alors devenu un bébé rose, sans dommages ni dégâts, tout du moins apparents.
Ma mère s’est bien remise de l’accouchement malgré son âge tardif pour être enceinte. Elle a quarante ans, je suis son septième enfant, elle en a perdu trois mort-nés et on est en 1949. À se demander si tout ça est bien raisonnable. Mon père a dû une fois de plus oublier de se retirer, lui, le psychorigide qui ne s’écarte jamais, même d’un spermatozoïde, de ses principes. Heureusement, le médecin de famille a ordonné un accouchement à l’hôpital à cause des possibles, voire certaines complications.
Évidemment et malgré son état satisfaisant, tout n’a pas été sans inquiétude pour ma mère avec ce marmot en état quasi végétatif. Par contre, ma naissance précoce et entortillée n’a pas plus dérangé mon père qu’une naissance normale, sauf une fois où il s’est senti obligé de venir me voir à travers la vitre de la salle des couveuses. Ce n’était pas, à mon avis, pour m’admirer et s’extasier devant le tout mignon bébé à son papa, mais plutôt pour vérifier si je n’étais pas difforme, hideux, repoussant ou je ne sais quoi de mieux encore.
Tout a mal commencé, certes, mais prématuré avec circulaire de cordon, ça finit, dit-on, par se résoudre, par ne plus se voir, s’oublier peut-être. Ce n’est rien par rapport à la suite. En effet et comme beaucoup, je suis né avec un nom, un nom et un prénom et ça c’est pour la vie, ça ne lâche pas d’une semelle, ça fait partie de soi, c’est presque soi en somme.
Coup du sort, tous les vents mauvais de la terre ont dû se retourner contre moi pour me jeter en pâture aux quolibets. Coup fatal, je vous le donne en mille, mon nom est Lacroute. Je m’appelle Lacroute. Rémi Lacroute.
Un nom comme ça est un problème qui ne se résout pas, ne s’oublie pas, on le traîne comme un boulet, pour le pire et jamais le meilleur. Un fardeau, une sangsue de deux syllabes qui vous colle à la peau, un jeu avec les mots, jeu à faire mal, offert à l’acharnement de mes chers et bien intentionnés congénères.
C’est donc à cœur joie, tout au long de mon enfance et de mon adolescence que j’ai enduré et que j’endure encore aujourd’hui, tout jeune adulte, la rengaine des mêmes sarcasmes sans cesse répétée, futile bien sûr et sans conséquences dramatiques en soi, mais tellement tenace.
J’ai eu droit à tout, mais principalement à du gras, du lourd, du pas fin, du vulgaire, du méchant, du bref et du plus long. J’en ai entendu de toutes les couleurs, mais surtout des vertes et des pas mûres :
Vieille croûte, croûteux, croûtard, croûton.
Croûte molle, dur de la croûte.
Choucroute, casse-croûte, pâté en croûte.
Croûte de frometon et croûte dans l’nez.
Va te faire dorer la croûte.
Croûte sèche, comment tu gagnes ta croûte ?
Les grands esprits, contrairement à mes parents, n’avaient pas manqué de repérer la deuxième syllabe de mon prénom et de l’atteler à mon patronyme pour partir vers de nouvelles aventures verbales :
Rémi d’pain Lacroute.
La mie et la croûte.
Pain de mie Lacroute.
T’es d’la mie ou d’la croûte ?
T’as d’la mie sous la croûte ?
La mie est molle, la croûte est dure.
Les moins féroces avaient transformé la mie en l’ami et ça donnait l’ami Lacroute. C’était plus supportable et même presque gentil.
On s’habitue à tout, paraît-il, et à la longue tout finit par vous glisser dessus. Pas sûr que ça glisse jusqu’en bas. On vit en faisant avec, sans vraiment s’en apercevoir, avec ces petits pics plantés dans la tête, toutes ces petites humiliations au long cours, bien enfouies et acérées, mais qui font mal à l’occasion quand on remue la carcasse de ses pensées.
Bref, contre lazzis et quolibets, je m’efforce d’espérer que le plus vieil adulte que je vais devenir ne va pas continuer à passer sa vie sous les brocards. Pas dits en face tout du moins. Dans mon dos, sûrement, mais c’est le moindre mal, le dos n’a pas d’oreilles.
1968
Aujourd’hui, 10 juillet 1968, j’ai dix-neuf ans depuis quatre jours et j’attends l’autorail, la clope au bec, sur le quai de la gare de mon patelin. Patelin, pas tant que ça, à vrai dire. Un gros bourg de 4500 habitants posé sur le bord de la ligne de chemin de fer Paris-Brest.
Finie la vapeur et plus de Paris direct. Depuis l’électrification du tronçon Le Mans-Laval il y a quatre ans, l’express du matin de 7 h 45 en direction de Paris et celui du soir de 21 h 10 allant vers Rennes et Brest ne s’arrêtent plus. C’est moins pratique pour aller à Paname, il faut prendre l’autorail jusqu’au Mans et là, choper l’express pour la capitale.
Il est 7 h 05 et j’attends l’omnibus. Un beau matin d’été s’annonce par un ciel parfaitement bleu. La fraîcheur est idéale et ne peut entraîner qu’une humeur légère comme les volutes de ma fumée de cigarette. Je devrais être totalement heureux, mais je ne le suis que relativement, car une sorte de tension un peu collante se cramponne à mon esprit et m’oppresse. À croire que j’ai toujours le cordon autour du cou. Tu devrais pourtant être content, tu viens d’avoir ton bac et t’y croyais à peine, je me dis pour tenter de relâcher la pression.
Avec ce bac 68, mon bourru de père m’a bien sûr couvert de louanges, du genre que j’avais décroché un bac de pochette surprise, un bac au rabais, un bac pour les ânes. Déjà que d’avoir été casé en littéraire, le bac A, un bac par défaut, n’était pas une gloire ni un signe d’intelligence, alors, à plus forte raison, ce bac 68 était une honte. On l’avait donné à tout le monde, plus de 80 % des candidats reçus, les 20 % de recalés devaient avoir des cerveaux de kakapo. Mon brut de père m’a presque accusé et cloué au pilori d’être reçu comme si tout le merdier du mois de mai était de ma faute. Mon paternel, c’est un vieux briscard grincheux, cheminot depuis peu à la retraite, de gauche par principe, mais tout ce chambardement déclenché par les jeunes lui a foutu la trouille.
Lycées bloqués, profs en grève, l’élève de terminale que je suis est bien sagement rentré au bercail quand le surgé l’a ordonné. « Lycée fermé jusqu’à nouvel ordre, rentrez chez vous », il avait dit, sans qu’on sache si l’événement le réjouissait ou pas. Il tenait son rôle, un point c’est tout, et son rôle cuirassait son costume de surveillant général.
Contrairement à moi, beaucoup de lycéens sont descendus dans la rue, fatigués sans doute de se sentir à l’étroit dans les étages et ont complètement abandonné leurs révisions, se disant que les épreuves du bac seraient annulées. Moi, j’ai mis le doigt dessus et les bouchées doubles, alors que les pavés volaient à Paris, que le pays se paralysait à cause de la grève généralisée et que les manifs s’allongeaient partout en France.
Je suis chez moi, tapi dans mon coin, peu concerné par le tumulte et ses enjeux. C’est vrai que question introverti, je suis le premier de la classe. Les foules ou simplement les groupes ne sont pas mon berceau, je ne me sens bien qu’en duo ou en tous petits comités.
En écoutant la chanson de Brassens Le pluriel, j’ai vraiment l’impression d’en avoir écrit les paroles tellement je m’y reconnais :
« Le pluriel ne vaut rien à l’homme et sitôt qu’on
Est plus de quatre on est une bande de cons.
Bande à part, sacrebleu, c’est ma règle et j’y tiens
Dans les noms des partants on verra pas le mien. »
Et Pierre Desproges d’ajouter : « a fortiori, moins de deux, c’est l’idéal » me convient encore mieux.
Je me suis donc agrippé plus que jamais à mes révisions, car en plus de me sentir peu enclin à la pratique de la manifestation de rue, je me sais peu doué. J’ai un an de retard et je suis nul en maths et dans les matières scientifiques. La timidité maladive de l’introverti m’empêche d’aimer les langues vivantes. Déjà que parler en français devant une assemblée me rendrait capable de rentrer sans problème dans un trou de souris, alors baragouiner en anglais ou en allemand, n’en parlons pas, là, c’est dans un trou de fourmi que je pourrais me fourrer.
J’aime bien le français sans pour autant être brillant en la matière, mais les auteurs et les textes m’attirent et me propulsent en même temps. En dehors de la classe, quand je rentre chez moi, dans ma chambre, j’écoute sur mon Teppaz ceux que l’on appelle les auteurs-compositeurs-interprètes et ce que l’on nomme, un peu pompeusement, des chansons à texte. J’ai mis un point final à ma période rock années 60, Salut les copains et les yéyés, pour ensuite rayer de la carte les Beatles, les Rolling Stones et compagnie et ne plus respirer que par Brel, Ferré, Brassens et Félix Leclerc, mon préféré. Il m’offre ses forêts, ses lacs et ses arpents de neige et je les reçois comme des bouts du monde. Sa voix, ses mots et sa musique m’entraînent au plus près de moi-même et des autres, là où c’est à la fois fort et fragile. Comme je gratte un peu la guitare, j’apprends ses chansons et les répète en boucle. Je suis Le roi heureux, l’amoureux fou d’un bal étrange, le bûcheron de La drave. J’ai la liberté du Tzigane et la noblesse de L’ours pris au piège. Je suis Bozo le rêveur d’amour, je cours le monde sur mes souliers ferrés et j’ai Le p’tit bonheur au fond de mon sac.
Tout cela me porte et me fait écrire des chansonnettes sur trois accords de guitare. Mes rares vrais copains m’appellent parfois le poète, ça me change de la croûte. Parmi eux, Jean-Luc le copain d’enfance. C’est vrai que lui s’appelle Legras et qu’il se trouve donc bien mal placé pour infliger aux autres ce que lui-même déteste subir. Il n’est jamais en reste avec les Legras de cochon, Legras du bide, Legras du cul, le gratin ou Legras la gratouille. Il endosse comme moi tous ces bons mots en pliant l’échine. Ils nous blessent, bien sûr, mais peut-être resserrent-ils en même temps notre amitié. En tous les cas, il n’y a jamais de croûte ou de gras entre nous. Il n’y a que Rémi et Jean-Luc.
Pour l’instant, le pas très doué que je suis doit travailler d’arrache-pied, car d’une façon générale, et surtout dans les disciplines qui m’ennuient, il me faut trois fois plus de temps que tout le monde pour apprendre. J’ai un mal de chien à fixer mon attention. Elle ne tient pas longtemps, je pars je ne sais où en pensées ou nulle part et il me faut sans cesse revenir à ce que je fais. Très vite, ce va-et-vient me fatigue et je laisse tomber, j’abandonne. Pire, sachant ce qui m’attend, parfois je ne commence pas du tout.
Depuis l’école primaire, en plus des différentes croûtes qui me collent à la peau, on m’a épinglé à la blouse la caractéristique peu enviable en classe, d’être dans la lune, dans les nuages, sur une autre planète, à l’ouest, d’être une tête de linotte. Tout ça dit avec beaucoup de déférence, en presque ricanant et en foutant la honte avec un fard à la clé. C’est vrai que pour les maîtresses et les maîtres d’école, des élèves comme moi sont durs à traîner, il faut sans cesse être sur leur dos pour les rappeler sur Terre. C’est sûrement déprimant à la longue, alors souvent ils laissent tomber. Que ceux-là se débrouillent.
À la maison, même couplet. Les tu rêves, t’es où, atterris me sont toujours tombés dessus avec leur petit air dédaigneux. Au bout du compte, on finit par ne plus trop exister ici-bas, par être effacé de la carte, appartenir à un autre monde.
Les résultats scolaires des extraterrestres, qu’ils soient de la lune ou d’une autre planète, sont évidemment médiocres.
Durant cette année de terminale, j’ai souvent abandonné, laissé tomber et je ne me sens pas au point. J’ai essayé comme j’ai pu de m’accrocher depuis à peine deux mois, la tête serrée entre mes deux mains pour ne pas qu’elle m’échappe.
Je ne suis pas un élève sérieux au vrai sens du terme, mais je veux avoir mon bac pour faire la nique à mon père qui n’a pas arrêté de me mésestimer tout au long de l’année et de m’assurer avec enthousiasme que je ne réussirai jamais à cet examen. L’oiseau fragile est faible, il le sait, mais sans en être conscient, son père lui donne des ailes. La croûte molle, le dur de la croûte, celui qu’a rien dans la croûte veut lui prouver qu’il est capable de le décrocher ce foutu diplôme même à partir de la lune.
Ce retour imprévu à la maison me permet de travailler beaucoup plus. En me fixant des buts précis dans le temps et en faisant de nombreuses pauses, j’avance. Lentement, mais j’avance et la clope m’assiste.
Les événements de ce mois de mai ne me déconcentrent pas plus que ça. L’alliance des ouvriers avec les étudiants a fini par se faire et m’amène à ne pas oublier que je suis issu de ce monde prolétaire. Alors, bien sûr que je jubile un peu en voyant monter la colère qui veut souffler une fois pour toutes sur la poussière de la vieille France. Mais ce désir de tout changer en profondeur, de balayer ce qui est vieux et dépassé, ce besoin de liberté et d’expression, cette sensation d’être porté par le vent de tous les possibles ne m’atteint pas encore et j’ai l’impression de les avoir déjà un peu en moi avec le tzigane et le roi heureux de Félix Leclerc. Peut-être aussi est-il vrai que dans les patelins comme le mien, en province, tout arrive souvent après. Toujours est-il que ces valeurs de mai 68, je ne les adopterai vraiment qu’un peu plus tard.
Pour l’instant, le bac occupe toute ma tête et mon temps. Dehors, il y a une sacrée polémique. Bac tel quel, impossible. Alors pas bac ou bac autrement ? Peyrefitte, le ministre de l’Éducation nationale a démissionné le 28 mai, son successeur Ortoli annonce le 30 mai que, cette année, le bac ne sera constitué que d’oraux, et sur une seule journée. Chaque candidat disposera de 20 minutes de préparation et de 15 minutes d’entretien avec un professeur pour chaque matière. Pour évaluer, les profs s’appuieront sur les livrets scolaires. Les résultats seront connus le soir même. Une dernière chose, pour ceux qui ont une moyenne inférieure à 10, un oral de rattrapage aura lieu en septembre et là, il faudra avoir 10 de moyenne pour être définitivement reçu. Ceux qui auront entre 8 et 10 se contenteront d’une attestation de fin d’études secondaires, les autres de rien du tout sinon d’un éventuel redoublement comme les précédents ou d’un changement de cap.
À l’annonce de cette directive, je me demande immédiatement, dans un réflexe de défense, si ce genre de bac est à mon avantage. Il est à coup sûr moins contraignant, les heures interminables passées à plancher et à transpirer des méninges n’ont plus cours, seulement une poignée de quarts d’heure et en un tournemain, le bac se retrouve dans la poche. Le problème c’est que tout se passe à l’oral et moi l’oral me liquéfie, me décompose, me consume. Ma timidité de tomate va me faire perdre mes humbles moyens, surtout si je ne maîtrise pas bien le sujet. Je n’entendrai même pas les questions du prof et ce sera du Lacroute intra-muros. Évidemment que ce drôle de bac va faire le bonheur des bagouleurs, mais moi je m’en méfie, malgré ses avantages apparents je le sens fourbe et sournois comme un de ceux qui vous fait bonne mine par devant et vous poignarde par derrière.
Ce bac parlé a lieu fin juin, il reste un mois pour modeler ma modeste matière grise à l’image des sujets et questions qui pourront m’être donnés en pâture. Ça ne va pas être sans mal dans tous les sens de l’expression : effort, ténacité, souffrance. Toujours cette saloperie de concentration qui me fait défaut, cette putain de timidité et cette bon dieu d’angoisse qui m’envahissent et me paralysent. Voilà comme je les qualifie ces handicaps, le plus grossièrement possible pour me défouler, et comme des ennemis, des monstres à abattre.
Je fais des petites crises d’angoisse, pas très violentes, mais assez répétées, avec toujours cette impression qu’un truc s’arrête en moi et qu’un autre me manque, le sang, l’oxygène peut-être, comme si je recommençais ma foutue naissance.
Étrangement et de façon contradictoire par rapport à mes démons, je perçois très sensiblement que je ne manque pas pour autant d’audace. Non, je ne suis pas ce genre de timide, ce « voyageur qui ne cesse de rebrousser chemin. »1
Pour moi, « les timides ont des audaces dont les autres humains sont incapables. »2
Je ressens aussi que « les timides qui se décident à oser, osent tout. »3
Sans jamais avoir croisé ces mots dans mes lectures, certains n’étant pas encore écrits, je les entends comme des voix qui chantent en moi et qui m’animent.
Je suis convoqué le 27 juin pour les oraux. J’ai la trouille et je tremble, mais j’y vais en me disant, une fois de plus, des mots que je n’ai pas encore rencontrés, agencés de la sorte : « Impose ta chance, serre ton bonheur et va vers ton risque. À te regarder, ils s’habitueront. »4
Ce 27 juin est une journée de porte à porte, de prof à prof, de matière à matière, de sujet à sujet et de question à question enfin. On dirait que l’image du prof a déjà changé. Les examinateurs sont souriants, épanouis, indulgents, prêts à aider. Ils sont déjà descendus de leur estrade et semblent libérés des décennies de rigidité qui ont précédé, enclins on dirait à bousculer leur enseignement, à le rendre plus vivant, à prendre en compte leurs élèves. Ils donnent l’impression d’avoir un pied dans le Nouveau Monde tant espéré et réclamé durant le mois de mai qui vient de s’écouler.
Dans toutes les disciplines, on me propose trois sujets au choix. En histoire, l’examinateur, plus affranchi que les autres sans doute, m’offre le cadeau de traiter le sujet que je veux. Je choisis un classique, la guerre 1939-1945, sur lequel j’ai particulièrement bossé pendant mes révisions et je réussis à assembler un tout à peu près cohérent. En tous les cas, on voit que j’ai travaillé et comme par miracle je me sens presque à l’aise, candidat sans peur et sans reproche. Le prof est attentif et acquiesce souvent à ce que je dis. D’accord, il est coulant, mais c’est quand même porteur et sans doute bon signe.
L’épreuve d’histoire se termine par un 15/20 et des compliments. J’ai chaud, je bous, car j’ai explosé à l’intérieur sans bien sûr que cela soit visible au-dehors. J’ai dépassé très nettement la moyenne de mon livret scolaire qui est de 9,5/20.
Pour les autres épreuves, je trouve à chaque fois parmi les trois sujets proposés celui pour lequel j’ai réussi à fixer, tant bien que mal, quelques connaissances. Je ne fais pas aussi bien qu’en histoire, loin de là. Je souffre un peu, surtout en maths.
En langues, je peux choisir des textes que j’avais bien étudiés, mais, évidemment, mon accent est digne de mon manque de pratique orale. De plus, je ne comprends pas toutes les questions qu’on me pose. Et dire qu’on appelle tout ce charabia des langues vivantes, tellement vivantes qu’elles en sont pour moi indomptables. J’ai la bouche sèche et plus de salive. En dehors de mon absence totale de talent linguistique, je sens la panique me plomber la cervelle. Avec ce que j’ai de biceps mentaux, je réussis à la dissimuler en partie, mais malgré cela mes prestations me paraissent d’une qualité limite. Les langues vivantes, moi, dans ma bouche, elles meurent.
Je termine la journée exténué, vide, avec la sensation d’avoir fait une traversée les pieds nus sur le fil d’un rasoir. Je suis presque indifférent aux résultats qui doivent tomber le soir. Advienne que pourra, j’ai fait ce que j’ai pu, moi le diminué je n’ai pas rebroussé chemin, je crois même qu’à ma mesure j’ai imposé ma chance, je suis allé vers mon risque et j’espère qu’à me regarder ils se sont peut-être habitués. En attendant, je grille des clopes.
Ce jour-là du 27 juin 1968, les résultats sont tombés assez tard dans la soirée.
La bienveillance, l’indulgence, le nouveau souffle des professeurs ont été de mise et n’ont pas été pour rien dans les notes généreuses qu’ils ont attribuées aux candidats.
Tout à coup, mes yeux clignent, un choc lumineux me frappe la rétine puis se diffuse aussitôt dans tout mon corps en une décharge de joie. Je suis irradié, je passe d’un état à un autre.
D’un coup, je deviens augmenté. J’ai 10,02 de moyenne, pas d’oral de rattrapage, je suis reçu, j’ai mon bac.
Mon audace, c’est ce 10,02, c’est d’avoir atteint, non pas une mention, mais la limite fatidique du 10 de moyenne, c’est d’avoir marqué un point, ou plus, une victoire sur mon père, c’est de vouloir maintenant mettre en jeu d’autres audaces qui me permettront comme aujourd’hui d’avancer.
C’est décidé, dès la semaine prochaine, je m’inscris en fac de lettres pour la prochaine rentrée. J’ai maintenant des ailes qui me permettent d’aller jusqu’à Rennes. Ça fait longtemps que je ne veux plus être pompier, conducteur de camion ou cow-boy. Pour autant, je ne sais toujours pas ce que je veux faire plus tard, mais aujourd’hui, c’est sûr, je veux aller plus loin.
Je quitte vite le lycée et m’engouffre dans la première cabine téléphonique qui se présente pour annoncer la bonne nouvelle à mes parents. C’est mon père qui décroche comme par hasard, lui qui ne le fait jamais. « Je l’ai papa, je l’ai ! » Je n’en crois pas mes yeux de pleurer et par-dessus mes larmes, je répète un autre « je l’ai ! »
« Ha, quand même qu’il me répond, i’ n’aurait plus manqué qu’ça ! »
Il est 7 h 10, la micheline5 est à l’heure.
La micheline, cette machine au nom de fille qu’on appelle comme ça sans savoir pourquoi. La micheline aux couleurs rouge et crème avec ses vapeurs de gasoil qui chaloupent à chaque fois qu’elle redémarre. La micheline avec ses banquettes en simili croûté et leurs tubulures chromées. La micheline avec sa drôle d’odeur à l’intérieur. Pas répugnante, mais pas très agréable non plus, faite d’un mélange indéfinissable si bien qu’on dit ça sent la micheline.
La micheline redémarre comme prévu en ayant ses vapeurs qu’on devine à l’intérieur.
Comme je l’ai déjà écrit à 7 h 05, je devrais me sentir totalement heureux, mais je suis trop tendu pour l’être. C’est que ma timidité va de nouveau être sollicitée, mise à contribution. Mieux que ça, mise à nu, exposée au grand jour dans tous ses états, exhibée à tout va sans la moindre retenue. Bref, la tomate est revenue. Je pars une semaine en Belgique pour rendre visite à une fille.
Le problème est là, avec les filles j’ai un gros souci. Non que je sois porté sur les mecs, bien au contraire, ce sont elles qui m’attirent depuis que je peux l’être, mais avec les filles je n’ai pas un succès fou et à vrai dire pas de succès du tout. Je n’ose pas. Pour moi, faire la cour, draguer, n’est pas du tout mon style, ce n’est pas une méthode emballante. Trop tout, tout de suite, tout pour le tout. Trop pêche au gros qui racle les bas-fonds des sous-entendus lourdingues. Le dragueur ratisse large avec son filet à possession. Non, je ne me sens pas du tout pêcheur ni au gros ni au petit et encore moins chasseur. Alors, il reste cueilleur. Cueilleur de cœur, pourquoi pas. Mais cueillir sans couper, sans détacher. Cueillir comme accueillir, reconnaître, recevoir, peut-être pressentir. Bref, charmer, séduire au naturel en étant soi-même, presque sans le faire exprès, me ressemblent davantage, mais voilà, je n’y arrive pas ou plutôt je n’ose pas y arriver.
J’ai été amoureux plusieurs fois depuis la sixième, mais en me cachant. Je me souviens m’être toujours débrouillé en classe pour me placer de façon à voir mon amoureuse de trois-quarts arrière.
Capturer d’un coup d’œil la ligne de son visage en même temps que deviner sa nuque sous les cheveux arrangés en queue de cheval. Voir sans être vu, regarder tout son soûl, mettre sous garde ces images, sous bonne garde des pensées et après les rêver, seulement les rêver, c’est ce que j’ai toujours fait.
Et puis, je me suis souvent dit plein de choses sans en avoir les mots ou au contraire m’en être tellement dit, des mots, que les choses ne sont jamais arrivées. Tout ça est un peu tiré par les cheveux, mais ça l’est toujours quand on se prend trop la tête.
Oui donc, amoureux plusieurs fois, mais un amoureux handicapé, grand invalide du verbe, du verbe à haute voix. Pas osé, tout rentré, tout gardé, mes amours de gosse ont, à chaque fois, duré longtemps, mais concrètement… pas une seule fois.
Vers quinze ou seize ans, j’ai quand même connu deux petites aventures charnelles, mais en n’y étant absolument pour rien. C’est elles, les filles, qui ont fait les premiers pas (ceux dans lesquels je m’empêtre) en me prenant la main au détour d’un hasard et d’un éclat de rire. Je me suis laissé faire, l’aubaine était trop belle et j’ai trouvé ça bien ces premières filles aux caresses. Elles sentaient bon la savonnette et puis c’était grisant de pouvoir les toucher, mais pas encore partout. Elles sont magiques, ces minettes qui, pour la première fois après votre mère, vous tiennent à deux mains et ne regardent que vous. Elles n’ont pas froid aux yeux et font de l’œil à tout le monde, alors, très vite elles en trouvent un plus déluré que vous et elles s’en vont, vous quittent. On reste planté là, déçu sans vraiment avoir mal, avec malgré tout, et sans qu’on le veuille, leur souvenir installé à demeure.
Il est 8 h 17 aux horloges de la gare du Mans, le train express en provenance de Brest et à destination de Paris Montparnasse entre en gare.
Je suis maintenant à son bord et plus il roule, plus l’itinéraire s’écourte et plus la tension monte. Il y a de quoi, cette fille que je vais voir, je ne la connais pas sinon par quelques lettres et une photo noir et blanc sur laquelle elle pose en buste, légèrement de trois-quarts avec la tête baissée. De plus et comme moi, elle habite encore chez ses parents, c’est donc toute une famille que je vais devoir affronter. Dans mon esprit et vu mon état fébrile, ce n’est pas de rencontrer ou de faire connaissance dont il s’agit, mais bien d’affronter. Un redoutable affrontement.
Je devrais pourtant être satisfait et même fier de moi. J’ai remis en route mon audace intérieure, mon audace cachée, celle qui dompte autant que faire se peut ma timidité chronique. Je me suis surpassé en me proposant d’aller voir cette fille. Je ne me suis pas dégonflé, je suis dans le train en ce moment, de mon plein gré, il roule vers elle et moi je suis. J’impose ma chance (si ça en est une), je vais vers mon risque (s’il y en a un) sans me freiner, sans me retenir, mais malgré cela je me demande si à me regarder, elle s’habituera. Quels yeux va-t-elle poser sur moi ? Comment va-t-elle me trouver ? Est-ce que je vais lui plaire ? Elle aussi ne me connaît que par une photo et on envoie toujours celle qui arrange. Je n’ai jamais vraiment été à mon goût, j’ai toujours eu un problème avec mon physique, avec mon corps. Un petit boulot, trop grassouillet et trop joufflu.
Ma mère depuis toujours m’a tellement répété de manger, manger pour me fortifier, des tartines avec des matelas de beurre, de confitures, de pâté, de rillettes, des tombereaux de viande dans des piscines de sauce, des Kilimandjaro de purée et de nouilles et encore et encore. Ma mère a toujours dû garder dans sa tête l’oiseau fragile prématuré, à moitié étranglé que j’étais il y a dix-neuf ans. Alors, il a fallu s’empiffrer pour corriger mes faiblesses du début et c’est un peu comme si j’avais passé mon enfance dans une couveuse avec une sonde gastrique pour me gaver.
Pourtant, aujourd’hui dans ce train express en route pour la Belgique, je ne devrais pas m’en faire à ce sujet, car le petit boulot grassouillet n’existe plus, il a fondu d’une douzaine de kilos. De 1,73 m pour 72 kg, il n’a pas rapetissé, mais il est descendu à 60 kg bien pesé. Tout ça durant cette année de terminale 1967/68.
Marre de cette silhouette trop lourde, marre de ne pas capter le regard des filles, assez d’être insignifiant, assez de ne pas me sentir aimé/aimer. Et puis, je ne veux plus m’enfermer dans mes encombrements intérieurs, j’ai l’impression de finir par m’y complaire. Je veux devenir quelqu’un de nouveau, en mieux, au-dehors comme au-dedans. « Je refuse de me laisser contaminer par le venin de cet enfant blessé amoureux de sa blessure / grandir, c’est peut-être cesser de croire qu’une douleur nous ressemble plus qu’un sourire / une blessure est un sol trop fertile. »6
Voilà encore des mots pas encore écrits que je n’ai donc pu lire, mais qui m’habitent sans avoir besoin d’avoir été rencontrés un jour.
Changer mon aspect, modeler mon corps à mon goût, me plaire et mon esprit suivra, mon mental deviendra un sourire.
Les trois derniers mois de cette année de terminale ont donc été traversés par une sorte d’anorexie constructive. Une anorexie pour grandir. À la cantine du lycée, j’ai divisé par deux les quantités de rata. À la maison, j’ai remplacé les tonnes de pommes de terre sautées, de pâtes et les louches de sauce par beaucoup de fruits et légumes, j’ai supprimé les petites mousses enquillées à la sauvette avec mon copain Legras puis j’ai, enfin, ajouté deux fois 10 km de course à pied par semaine. Régime draconien, certainement. Efficace, pour sûr. Dangereux, sans doute. Au début du troisième trimestre de l’année scolaire, j’ai eu un léger malaise en cours de gym. En faisant le poirier, je suis tombé dans les pommes. Tant pis, pas grave, régime volontaire et consenti, résultats conformes aux résultats escomptés.
Me voilà aujourd’hui, 10 juillet 68, bachelier, svelte et beau. De quoi se plaindre ?
Mon blazer noir croisé et cintré, mon futal gris et moulant à pattes d’éph me servent plutôt bien. Mes cheveux longs de quoi couvrir les oreilles suivent la mode en ondulant. Franchement, j’ai la minuscule impression que je m’aime bien comme ça. Je n’en crois pas ma pensée, moi, bien m’aimer ?
Me voilà aujourd’hui avec une silhouette à mon avantage, mais qui pourtant ne suffit pas à complètement me détendre. Ma peur m’immobilise en même temps qu’elle m’emmène dans un train qui avance vers une inconnue. Casse-tête, remue-méninges. « L’angoissé timide constelle les parois de son cœur de points d’interrogation. »7
C’est vrai sans réserve. Alors, on doute et ça tourmente, ça fragilise, mais je me dis que je tiens debout quand même. Différemment, mais je tiens.
Alors, j’y vais, le train roule.
Il est 11 h, je suis à Paris et je viens d’arriver à la Gare du Nord. De Montparnasse, j’ai pris le métro pour me retrouver là, avec un peu d’avance, en attente de mon train pour la Belgique.
Le métro m’a asphyxié, je prends un bol d’air en fumant une cigarette bien méritée devant une des portes d’entrée de la gare. Le bleu du ciel me réconforte, l’odeur de la ville me dépayse. Ce que je vois d’où je suis me fait dire que tout a repris son cours, tout est rentré dans l’ordre établi. Les voitures, les bus, les gens, tout circule pour créer de nouveau le mouvement et le bruit normal de la ville.
On a tellement entendu parler de Paris à la radio durant le mois de mai dernier que même sans télévision à la maison (mes parents ne l’ont pas encore) une marée d’images me submerge : des foules hurlantes, des assauts, des coups, des visages en sang, débâcle, carnage, casse, dévastation.
Bien sûr, je ne me trouve pas dans le Quartier Latin, au cœur du foyer, là où la majeure partie des événements ont pris feu, mais j’imagine que partout où l’on pouvait se trouver dans Paris, tout devait être étrangement différent. Ici aussi sans doute.
Après les images, ce sont maintenant des mots sortis de ma mémoire qui s’entassent et se bousculent. Des mots en vrac, pêle-mêle, dans tous les sens, avec pour lien d’avoir appartenu à ce mois de mai 68 : Nanterre, La Sorbonne, meetings, Cohn-Bendit, Goupil, UNEF, Billancourt, Sauvageot, Decazeville, Montbéliard, Pompidou, pavés, Boulevard Saint-Michel, Occident, Poury, Duteuil, Rouen, Flins, manifestants, Geismar, Clermont-Ferrand, de Gaulle, CRS, émeutes, Sandouville, Schulmann, Castro (pas Fidel, Olivier, je crois), Cléon, Le Mans, Sochaux, Krivine…
Et puis me viennent des mots guerriers : matraques, barricades, grenades lacrymogènes, champ de bataille…
Et puis des mots comme du chinois : maoïstes, cocktails Molotov, Wisco, Unule, trotskistes, Loockheed…
Et encore des mots qui n’en sont pas : JCR, UEC, CAL, UJCml…
Et puis des mots dans des slogans : Sois jeune et tais-toi. Élections piège à con. Pouvoir populaire. Bourgeois, vous n’avez rien compris. Il est interdit d’interdire…
Et puis des mots avec des chiffres : 1 million de manifestants, 200 000, 2 millions, 4, 8, 10 millions de grévistes…
S’enchaînent encore des mots de crise : usines occupées, plus de téléphone, plus de courrier, plus de trains, plus d’essence, futur référendum, dissolution de l’Assemblée nationale, élections législatives.
Enfin, des mots qui prennent de la hauteur, ceux de mon père, ses commentaires éclairés : « Le Cohn-Bendit, qu’est-ce qu’i’ vient foutre le bordel chez nous ! C’est pas un boche qui va nous commander quand même ! Tous ces blancs-becs, i’ n’ont qu’ça à foutre que d’tout bousiller ! I’ f’raient mieux d’aller bosser ! J’t’en foutrai d’leur interdit d’interdire à ces p’tits cons ! L’grand Charles, i’n’a jamais autant branlé du menton ! Haha, l’grand Charles, i’ chie dans son froc ! »
Je suis toujours devant cette porte de la Gare du Nord à Paris et tout paraît assorti à ce ciel bleu de juillet. Le brouhaha de la ville semble apaisé et l’agitation au ralenti. Tout est comme si de rien n’était, comme si rien n’avait été, comme si rien n’avait changé.
Les récentes élections législatives de fin juin ont couronné les gaullistes et leurs alliés d’une large victoire, avec une majorité absolue des sièges à l’assemblée. Comme souvent, la pauvre opposition n’est pas arrivée à l’entente. Du haut de leur ego, Mitterrand et Waldeck Rochet se sont disputé le bout de gras et comme d’habitude la guerre des chefs a fait capoter une possible union de la gauche. La raclée finale a été retentissante et sans appel.
Aujourd’hui, les gens, les voitures, les trains, les bus marchent et roulent et sont repartis pour un tour. Les politiques aussi. La révolution n’a pas eu lieu et certains se demandent déjà si ce mois de mai n’a pas, tout compte fait, servi à rien. D’autres se disent qu’il s’est peut-être produit un quelque chose que l’on ne voit pas encore et qui serait le début d’une vraie mutation. Utile à tous et à chacun.
Il est temps maintenant que je me dirige vers mon quai de départ, les trains n’attendent pas.
À 11 h 20 précises, l’express s’ébranle et quitte lentement la Gare du Nord. Il secoue ses wagons comme pour les dégourdir et leur faire trouver leur position d’équilibre. Dernière ligne droite, Paris Charleroi, en Belgique, c’est là que je vais.
Tout près de la vitre, les murs immobiles des immeubles défilent et me collent aux yeux. Parfois, une ouverture se découpe sur une rue, un quartier, et tout éclate en mouvements. Le bruit métallique des roues emplit le wagon et le soubresaut régulier à chaque jointure de rail accompagne maintenant le voyage.
C’est déjà la banlieue et ses fumées d’usines qui salissent le bleu, ses bouchons et ses bretelles d’autoroutes qui s’entortillent. Le train atteint sa vitesse de croisière et entre bientôt dans le vert, le blond et le brun des grands espaces de la Picardie.
J’arrive à Charleroi à 14 h 10. Je me rapproche d’elle.
Elle, c’est Gloria. Elle s’appelle Gloria Martinez. Ça va sans dire que l’Espagne n’est pas pour rien dans les consonances de ce nom et de ce prénom. Cette fille, je ne l’ai jamais rencontrée de visu, je ne la connais pas physiquement. Gloria, c’est d’abord un contact puis un échange, une correspondance, c’est une relation épistolaire.
Il faut remonter aux premières semaines de cette année de terminale, au mois d’octobre 67. Le prof d’histoire-géo propose un jour à la classe un échange culturel et linguistique avec des élèves étrangers de niveau d’études équivalent au nôtre. Il s’agit d’un échange individuel où chacun peut choisir le sexe, et parmi une liste, le pays de son correspondant. Le reste, c’est un organisme nommé International Youth (Jeunesses internationales) qui s’en occupe. Quèsaco