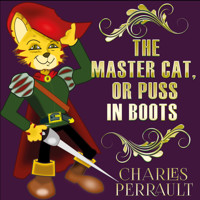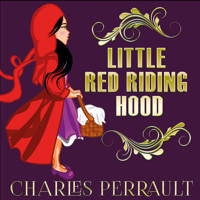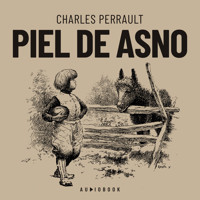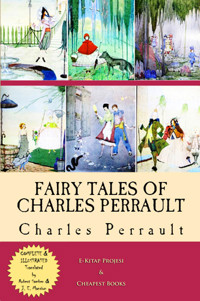Contes de fées tirés de Claude Perrault, de Mme D'Aulnoy et de Mme Leprince de Beaumont E-Book
Charles Perrault
1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: DigiCat
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Französisch
Dans "Contes de fées tirés de Claude Perrault, de Mme D'Aulnoy et de Mme Leprince de Beaumont", Charles Perrault s'inscrit dans un mouvement littéraire fondamental en redéfinissant le genre du conte. Ce recueil réunit des récits enchanteurs qui allient merveilleux et moralisateur, s'adressant principalement aux enfants tout en véhiculant des valeurs sociales et morales. L'écriture de Perrault se distingue par sa simplicité élégante, ses métaphores délicates et son accent sur la féérie, mettant en avant des figures emblématiques telles que Cendrillon et Le Petit Chaperon Rouge, tout en ancrant ces récits dans le contexte socio-historique du XVIIe siècle français, une époque marquée par le classicisme et la recherche de l'éducation des jeunes esprits. Charles Perrault, né en 1628, était non seulement un écrivain, mais également un membre influent de la bourgeoisie parisienne, ce qui lui a permis d'être en contact avec les idées éclairées de son temps. Sa transition vers la littérature pour enfants s'inscrit dans une volonté de transmettre des leçons de vie et des réflexions morales à travers un prisme ludique, inspiré par des traditions orales plus anciennes. Ses expériences personnelles, en tant que père et observateur des mœurs de son époque, l'ont poussé à composer des œuvres qui mêlent la nature humaine avec des leçons éthiques. Ces contes, tout en étant des classiques intemporels, offrent au lecteur une plongée dans un monde de charme et de sagesse. Je recommande vivement ce recueil à quiconque s'intéresse à la littérature, à l'éducation des jeunes esprits ou tout simplement à la beauté des récits enchanteurs. Perrault réussit à capturer l'imagination, tout en transmettant des messages profonds qui résonnent encore dans notre société moderne.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Contes de fées tirés de Claude Perrault, de Mme D'Aulnoy et de Mme Leprince de Beaumont
Table des matières
PRÉFACE.
Charles Perrault est né à Paris le 12 janvier 1628. Il était premier commis de la surintendance des bâtiments, sous l’administration de Colbert.
Son frère, Claude Perrault, d’abord médecin, puis architecte, est l’auteur de la belle colonnade du Louvre.
On doit à Charles Perrault plusieurs poésies d’une importance médiocre. Deux de ses œuvres rendirent son nom célèbre: son Parallèle des anciens et des modernes, et ses Contes.
Son Parallèle des anciens et des modernes est une longue diatribe dialoguée contre les plus beaux génies de l’antiquité. Boyle en faisait le plus grand cas; mais il est probable que la postérité ne la connaîtrait point, si elle n’avait excité la bile de Boileau et donné naissance à la fameuse querelle des anciens et des modernes, qui fit tant de bruit sous Louis XIV.
Les Contes de Perrault sont écrits avec une simplicité élégante et naïve, qui en fait une lecture véritablement attrayante. La Fontaine disait:
Si Peau d’Ane m’était conté J’y prendrais un plaisir extrême.
Il n’est grand ni petit enfant qui ne prenne «un plaisir extrême» à lire Peau d’Ane conté par Charles Perrault.
Perrault mourut à Paris le 16 mai 1703.
Deux femmes, Mme d’Aulnoy et Mme Leprince de Beaumont, partagent avec lui le privilége d’amuser tous les gens d’esprit qui n’ont pas encore quatorze ans.
Mme d’Aulnoy a fait de mauvais romans et des Mémoires historiques détestables; ce qui ne l’empêche pas d’avoir écrit l’Oiseau Bleu et la Biche au Bois....
Mme d’Aulnoy est morte en 1705.
L’auteur de la Belle et la Bête, Mme Leprince de Beaumont, naquit à Rouen le 26 avril 1711, et ne vécut pas moins de soixante-dix ans.
Elle fut malheureuse avec M. de Beaumont, son premier mari, et se remaria, dans un âge déjà assez avancé, à M. Thomas Pichon. Elle passa dix-sept années à Londres, occupée de plusieurs éducations particulières.
Ses œuvres forment soixante-dix volumes. La plupart de ces ouvrages ont de l’intérêt; mais le meilleur, sans contredit, est le Magasin des enfants, que les Anglais et les Allemands ont traduit, et dont personne ne peut parler sans reconnaissance.
Nous citerons aussi, comme un bon livre et une bonne action, le Magasin des pauvres, des artisans, des domestiques et des gens de la campagne.
CONTES DE PERRAULT
Pour cette petite clef-ci. (Page 7.)
LA BARBE BLEUE.
Il était une fois un homme qui avait de belles maisons à la ville et à la campagne, de la vaisselle d’or et d’argent, des meubles en broderie et des carrosses tout dorés. Mais, par malheur, cet homme avait la barbe bleue; cela le rendait si laid et si terrible, qu’il n’était femme ni fille qui ne s’enfuît devant lui.
Une de ses voisines, dame de qualité, avait deux filles parfaitement belles. Il lui en demanda une en mariage, en lui laissant le choix de celle qu’elle voulait lui donner. Elles n’en voulaient point toutes deux, et se le renvoyaient l’une à l’autre, ne pouvant se résoudre à prendre un homme qui eût la barbe bleue. Ce qui les dégoûta encore, c’est qu’il avait déjà épousé plusieurs femmes, et qu’on ne savait ce que ces femmes étaient devenues.
La Barbe Bleue, pour faire connaissance, les mena, avec leur mère et trois ou quatre de leurs meilleures amies, et quelques jeunes gens du voisinage, à une de ses maisons de campagne, où on demeura huit jours entiers. Ce n’étaient que promenades, que parties de chasse et de pêche, que danses et festins, que collations: on ne dormait point, et on passait toute la nuit à se faire des malices les uns aux autres; enfin, tout alla si bien, que la cadette commença à trouver que le maître du logis n’avait plus la barbe si bleue, et que c’était un fort honnête homme. Dès qu’on fut de retour à la ville le mariage se conclut.
Au bout d’un mois, la Barbe Bleue dit à sa femme qu’il était obligé de faire un voyage en province, de six semaines au moins, pour une affaire de conséquence; qu’il la priait de se bien divertir pendant son absence; qu’elle fît venir ses bonnes amies, qu’elle les menât à la campagne si elle voulait; que partout elle fît bonne chère.
«Voilà, lui dit-il, les clefs de deux grands garde-meubles, voilà celle de la vaisselle d’or et d’argent, qui ne sert pas tous les jours; voilà celle de mes coffres-forts, où est mon or et mon argent; celle de mes cassettes, où sont mes pierreries; et voilà le passe-partout de tous les appartements. Pour cette petite clef-ci, c’est la clef du cabinet au bout de la grande galerie de l’appartement bas: ouvrez tout, allez partout, mais pour ce petit cabinet, je vous défends d’y entrer, et je vous le défends de telle sorte, que, s’il vous arrive de l’ouvrir, il n’y a rien que vous ne deviez attendre de ma colère.»
Elle promit d’observer exactement tout ce qui lui venait d’être ordonné ; et lui, après l’avoir embrassée, monte dans son carrosse et part pour son voyage.
Les voisines et les bonnes amies n’attendirent pas qu’on les envoyât querir pour aller chez la jeune mariée, tant elles avaient d’impatience de voir toutes les richesses de sa maison, n’ayant osé y venir pendant que le mari y était, à cause de sa barbe bleue, qui leur faisait peur. Les voilà aussitôt à parcourir les chambres, les cabinets, les garde-robes toutes plus belles les unes que les autres. Elles montèrent ensuite aux garde-meubles, où elles ne pouvaient assez admirer le nombre et la beauté des tapisseries, des lits, des sofas, des cabinets, des guéridons, des tables et des miroirs où l’on se voyait depuis les pieds jusqu’à la tête, et dont les bordures, les unes de glace, les autres d’argent et de vermeil doré, étaient les plus belles et les plus magnifiques qu’on eût jamais vues; elles ne cessaient d’exagérer et d’envier le bonheur de leur amie, qui cependant ne se divertissait point à voir toutes ces richesses, à cause de l’impatience qu’elle avait d’aller voir le cabinet de l’appartement bas.
Elle fut si pressée de sa curiosité, que, sans considérer qu’il était malhonnête de quitter sa compagnie, elle descendit par un escalier dérobé, et avec tant de précipitation, qu’elle pensa se rompre le cou deux ou trois fois. Étant arrivée à la porte du cabinet, elle s’y arrêta quelque temps, songeant à la défense que son mari lui avait faite, et considérant qu’il pourrait lui arriver malheur d’avoir été désobéissante; mais la tentation était si forte, qu’elle ne put la surmonter: elle prit donc la petite clef, et ouvrit en tremblant la porte du cabinet.
D’abord elle ne vit rien, parce que les fenêtres étaient fermées; après quelques moments, elle commença à voir que le plancher était tout couvert de sang caillé, dans lequel se miraient des corps de plusieurs femmes mortes et attachées le long des murs: c’étaient toutes les femmes que la Barbe Bleue avait épousées, et qu’il avait égorgées l’une après l’autre.
Elle pensa mourir de peur, et la clef du cabinet, qu’elle venait de retirer de la serrure, lui tomba de la main.
Après avoir un peu repris ses sens, elle ramassa la clef, referma la porte, et monta à sa chambre pour se remettre un peu; mais elle n’en pouvait venir à bout, tant elle était émue. Ayant remarqué que la clef du cabinet était tachée de sang, elle l’essuya deux ou trois fois; mais le sang ne s’en allait point; elle eut beau la laver, et même la frotter avec du sable et du grès, il y demeura toujours du sang; car la clef était fée, et il n’y avait pas moyen de la nettoyer tout à fait: quand on ôtait le sang d’un côté, il revenait de l’autre.
La Barbe Bleue revint de son voyage dès le soir même, et dit qu’il avait reçu des lettres dans le chemin, qui lui avaient appris que l’affaire pour laquelle il était parti venait d’être terminée à son avantage. Sa femme fit tout ce qu’elle put pour lui témoigner qu’elle était ravie de son prompt retour.
Le lendemain il lui demanda les clefs, et elle les lui donna, mais d’une main si tremblante, qu’il devina sans peine tout ce qui s’était passé.
«D’où vient, lui dit-il, que la clef du cabinet n’est point avec les autres?
— Il faut, dit-elle, que je l’aie laissée là-haut sur ma table.
— Ne manquez pas, dit la Barbe Bleue, de me la donner tantôt.»
Après plusieurs remises, il fallut apporter la clef. La Barbe Bleue, l’ayant considérée, dit à sa femme:
«Pourquoi y a-t-il du sang sur cette clef?
— Je n’en sais rien, répondit la pauvre femme, plus pâle que la mort.
— Vous n’en savez rien? reprit la Barbe Bleue; je le sais bien, moi. Vous avez voulu entrer dans le cabinet! Eh bien! madame, vous y entrerez aussi, et vous irez prendre place auprès des dames que vous y avez vues.»
Elle se jeta aux pieds de son mari, en pleurant et en lui demandant pardon, avec toutes les marques d’un vrai repentir, de n’avoir pas été obéissante. Elle aurait attendri un rocher, belle et affligée comme elle était; mais la Barbe Bleue avait un cœur plus dur qu’un rocher.
«Il faut mourir, madame, lui dit-il, et tout à l’heure.
— Puisqu’il faut mourir, répondit-elle en le regardant, les yeux baignés de larmes, donnez-moi un peu de temps pour prier Dieu.
— Je vous donne un demi-quart d’heure, reprit la Barbe Bleue, mais pas un moment davantage. »
Lorsqu’elle fut seule, elle appela sa sœur et lui dit:
«Ma sœur Anne (car elle s’appelait ainsi), monte, je te prie, sur le haut de la tour, pour voir si mes frères ne viennent point: ils m’ont promis qu’ils viendraient me voir aujourd’hui; et si tu les vois, fais-leur signe de se hâter.»
La sœur Anne monta sur le haut de la tour, et la pauvre affligée lui criait de temps en temps:
«Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir?»
Et la sœur Anne lui répondait:
«Je ne vois rien que le soleil qui poudroie et l’herbe qui verdoie.»
Cependant la Barbe Bleue, tenant un grand coutelas à la main, criait de toute sa force:
«Descends vite, ou je monterai là-haut.
— Encore un moment, s’il vous plaît,» lui répondit sa femme.
Et aussitôt elle criait tout bas:
«Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir?»
Et la sœur Anne lui répondait:
«Je ne vois rien que le soleil qui poudroie et l’herbe qui verdoie.
— Descends donc vite, criait la Barbe Bleue, ou je monterai là-haut.
— Je m’en vais,» répondit sa femme.
Et puis elle criait:
«Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir?
— Je vois, répond la sœur Anne, une grande poussière qui vient de ce côté-ci.
— Sont-ce mes frères?
— Hélas! non, ma sœur, je vois un troupeau de moutons.
— Ne veux-tu pas descendre? criait la Barbe Bleue.
— Encore un petit moment,» répondait sa femme.
Et puis elle criait:
«Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir?
— Je vois, répondit-elle, deux cavaliers qui viennent de ce côté, mais ils sont bien loin encore.
— Dieu soit loué ! s’écria-t-elle un moment après, ce sont mes frères.
— Je leur fais signe tant que je puis de se hâter.»
La Barbe Bleue se mit à crier si fort, que toute la maison en trembla. La pauvre femme descendit, et alla se jeter à ses pieds tout éplorée et tout échevelée.
«Cela ne sert de rien, dit la Barbe Bleue; il faut mourir.»
Dans ce moment, on heurta si fort à la porte que la Barbe Bleue s’arrêta tout court. (Page 15.)
Puis, la prenant d’une main par les cheveux, et de l’autre, levant le coutelas en l’air, il allait lui abattre la tête.
La pauvre femme, se tournant vers lui et le regardant avec des yeux mourants, lui demanda un petit moment pour se recueillir.
«Non! non! dit-il, recommande-toi bien à Dieu;» et levant son bras....
Dans ce moment, on heurta si fort à la porte que la Barbe Bleue s’arrêta tout court: on ouvrit, et aussitôt on vit entrer deux cavaliers qui, mettant l’épée à la main, coururent droit à la Barbe Bleue. Il reconnut que c’étaient les frères de sa femme, l’un dragon, l’autre mousquetaire; de sorte qu’il s’enfuit aussitôt pour se sauver. Mais les deux frères le poursuivirent de si près, qu’ils l’attrapèrent avant qu’il pût gagner le perron. Ils lui passèrent leur épée au travers du corps, et le laissèrent mort. La pauvre femme était presque aussi morte que son mari, et n’avait pas la force de se lever pour embrasser ses frères.
Il se trouva que la Barbe Bleue n’avait point d héritiers, et qu’ainsi sa femme demeura maîtresse de tous ses biens. Elle en employa une partie à marier sa jeune sœur Anne avec un jeune gentilhomme dont elle était aimée depuis longtemps; une autre partie à acheter des charges de capitaine à ses deux frères; et le reste à se marier elle-même à un fort honnête homme, qui lui fit oublier le mauvais temps qu’elle avait passé avec la Barbe Bleue.
MORALITÉ.
La curiosité, malgré tous ses atlraits,
Coûte souvent bien des regrets;
On en voit tous les jours mille exemples paraître.
C’est, n’en déplaise au sexe, un plaisir bien léger:
Dès qu’on le prend il cesse d’être;
Et toujours il coûte trop cher.
AUTRE MORALITÉ.
Pour peu qu’on ait l’esprit sensé,
Et que du monde on sache le grimoire,
On voit bientôt que cette histoire
Est un conte du passé.
Il n’est plus d’époux si terrible,
Ni qui demande l’impossible.
Fût-il malcontent et jaloux,
Près de sa femme on le voit filer doux;
Et, de quelque couleur que sa barbe puisse être,
On a peine à juger qui des deux est le maître.
LE PETIT CHAPERON ROUGE.
Il était une fois une petite fille de village, la plus jolie qu’on eût su voir: sa mère en était folle, et sa mère-grand plus folle encore. Cette bonne femme lui fit faire un petit chaperon rouge qui lui seyait si bien, que partout on l’appelait le Petit Chaperon Rouge.
Un jour sa mère ayant fait et cuit des galettes, lui dit:
«Va voir comment se porte ta mère-grand, car on m’a dit qu’elle était malade. Porte-lui une galette et ce petit pot de beurre.»
Le Petit Chaperon Rouge partit aussitôt pour aller chez sa mère-grand, qui demeurait dans un autre village. En passant dans un bois, elle rencontra compère le Loup, qui eut bien envie de la manger; mais il n’osa, à cause de quelques bûcherons qui étaient dans la forêt. Il lui demanda où elle allait. La pauvre enfant, qui ne savait pas qu’il était dangereux de s’arrêter à écouter un loup, lui dit:
C’est par delà le moulin que vous voyez tout là-bas. (Page 20.)
«Je vais voir ma mère-grand, et lui porter une galette avec un pot de beurre que ma mère lui envoie.
— Demeure-t-elle bien loin? lui dit le Loup.
— Oh! oui, lui dit le Petit Chaperon Rouge; c’est par delà le moulin que vous voyez tout là-bas, là-bas, à la première maison du village.
— Eh bien, dit le Loup, je veux l’aller voir aussi; je m’y en vais par ce chemin-ci et toi par ce chemin-là, et nous verrons à qui plus tôt y sera.»
Le Loup se mit à courir de toute sa force par le chemin qui était le plus court, et la petite fille s’en alla par le chemin le plus long, s’amusant à cueillir des noisettes, à courir après des papillons et à faire des bouquets de petites fleurs qu’elle rencontrait. Le Loup ne fut pas longtemps à arriver à la maison de la mère-grand; il heurta.
Toc, toc.
«Qui est là ?
— C’est votre fille, le Petit Chaperon Rouge, dit le Loup en contrefaisant sa voix, qui vous apporte une galette et un petit pot de beurre que ma mère vous envoie.»
La bonne mère-grand, qui était dans son lit, à cause qu’elle se trouvait un peu mal, lui cria:
«Tire la chevillette, la bobinette cherra.»
Le Loup tira la chevillette, et la porte s’ouvrit. Il se jeta sur la bonne femme, et la dévora en moins de rien; car il y avait plus de trois jours qu’il n’avait mangé.
Ensuite, il ferma la porte et s’alla coucher dans le lit de la mère-grand, en attendant le Petit Chaperon Rouge, qui, quelque temps après, vint heurter à la porte.
Toc, toc.
«Qui est là ?»
Le Petit Chaperon Rouge, qui entendit la grosse voix du Loup, eut peur d’abord; mais, croyant que sa mère-grand était enrhumée, il répondit:
«C’est votre fille, le Petit Chaperon Rouge, qui vous apporte une galette et un petit pot de beurre que ma mère vous envoie.»
Le Loup lui cria, en adoucissant un peu sa voix:
«Tire la chevillette, la bobinette cherra.»
Le Petit Chaperon Rouge tira la chevillette, et la porte s’ouvrit. Le Loup, la voyant entrer, lui dit, en se cachant dans le lit, sous la couverture:
«Mets la galette et le petit pot de beurre sur la huche, et viens te coucher avec moi.»
Le Petit Chaperon se déshabille et va se mettre dans le lit, où elle fut bien étonnée de voir comment sa mère-grand était faite en son déshabillé. Elle lui dit:
«Ma mère-grand, que vous avez de grands bras!
— C’est pour mieux t’embrasser, mon enfant.
— Ma mère-grand, que vous avez de grandes jambes!
— C’est pour mieux courir, mon enfant.
— Ma mère-grand, que vous avez de grandes oreilles!
— C’est pour mieux écouter, mon enfant.
— Ma mère-grand, que vous avez de grands yeux!
— C’est pour mieux voir, mon enfant.
— Ma mère-grand, que vous avez de grandes dents!
— C’est pour mieux te manger.»
Et, en disant ces mots, le méchant Loup se jeta sur le Petit Chaperon Rouge et le mangea.
MORALITÉ.
On voit ici que les jeunes enfants,
Surtout de jeunes filles
Belles, bien faites et gentilles,
Font très-mal d’écouter toute sorte de gens,
Et que ce n’est pas chose étrange
S’il en est tant que le loup mange.
Je dis le loup, car tous les loups
Ne sont pas de la même sorte.
Il en est d’une humeur accorte,
Sans bruit, sans fiel et sans courroux,
Qui, privés, complaisants et doux, Suivent les jeunes demoiselles
Jusque dans les maisons, jusque dans les ruelles,
Mais, hélas! qui ne sait que ces loups doucereux.
De tous les loups sont les plus dangereux.
Le rang de la vieille fée étant venu. (Page 26.)
LA BELLE AU BOIS DORMANT.
Il était une fois un roi et une reine qui étaient si fâchés de n’avoir point d’enfants, si fâchés, qu’on ne saurait le dire. Ils allèrent à toutes les eaux du monde: vœux, pèlerinages, tout fut mis en œuvre, et rien n’y faisait. Enfin, pourtant, la reine devint grosse et accoucha d’une fille.
On fit un beau baptême; on donna pour marraines à la petite princesse toutes les fées qu’on put trouver dans le pays (il s’en trouva sept), afin que chacune d’elles lui faisant un don, comme c’était la coutume des fées en ce temps-là, la princesse eût par ce moyen toutes les perfections imaginables.
Après la cérémonie du baptême, toute la compagnie revint au palais du roi, où il y avait un grand festin pour les fées. On mit devant chacune d’elles un couvert magnifique, avec un étui d’or massif, où il y avait une cuillère, une fourchette et un couteau de fin or, garnis de diamants et de rubis. Mais, comme chacun prenait sa place à table, on vit entrer une vieille fée qu’on n’avait point priée, parce qu’il y avait plus de cinquante ans qu’elle n’était sortie d’une tour, et qu’on la croyait morte ou enchantée.
Le roi lui fit donner un couvert; mais il n’y eut pas moyen de lui donner un étui d’or massif comme aux autres, parce que l’on n’en avait fait faire que sept pour les sept fées. La vieille crut qu’on la méprisait, et grommela quelques menaces entre ses dents.
Une des jeunes fées, qui se trouva auprès d’elle, l’entendit, et, jugeant qu’elle pourrait donner quelque fâcheux don à la petite princesse, alla, dès qu’on fut sorti de table, se cacher derrière la tapisserie, afin de parler la dernière et de pouvoir réparer, autant qu’il serait possible, le mal que la vieille aurait fait.
Cependant les fées commencèrent à faire leur don à la princesse. La plus jeune lui donna pour don qu’elle serait la plus belle personne du monde; celle d’après, qu’elle aurait de l’esprit comme un ange; la troisième, qu’elle aurait une grâce admirable à tout ce qu’elle ferait; la quatrième, qu’elle danserait parfaitement bien; la cinquième, qu’elle chanterait comme un rossignol; et la sixième, qu’elle jouerait de toutes sortes d’instruments dans la dernière perfection.
Le rang de la vieille fée étant venu, elle dit en branlant la tête, encore plus de dépit que de vieillesse, que la princesse se percerait la main d’un fuseau, et qu’elle en mourrait. Ce terrible don fit frémir toute la compagnie, et il n’y eut personne qui ne pleurât.
Dans ce moment la jeune fée sortit de derrière la tapisserie, et dit tout haut ces paroles:
«Rassurez-vous, roi et reine, votre fille n’en mourra pas; il est vrai que je n’ai pas assez de puissance pour défaire entièrement ce que mon ancienne a fait: la princesse se percera la main d’un fuseau; mais au lieu d’en mourir, elle tombera seulement dans un profond sommeil qui durera cent ans, au bout desquels le fils d’un roi viendra la réveiller.»
Le roi, pour tâcher d’éviter le malheur annoncé par la vieille, fit publier aussitôt un édit par lequel il défendait à toutes personnes de filer au fuseau ni d’avoir des fuseaux chez soi, sous peine de la vie.
Au bout de quinze ou seize ans, le roi et la reine étant allés à une de leurs maisons de plaisance, il arriva que la jeune princesse, courant un jour dans le château, et montant de chambre en chambre, alla jusqu’au haut d’un donjon, dans un petit galetas où une bonne vieille était seule à filer sa quenouille. Cette bonne femme n’avait point ouï parler des défenses que le roi avait faites de filer au fuseau.
«Que faites-vous là, ma bonne femme? dit la princesse.
— Je file, ma belle enfant, lui répondit la vieille, qui ne la connaissait pas.
— Ah! que cela est joli! reprit la princesse: comment faites-vous? donnez-moi, que je voie si j’en ferais bien autant.»
Elle n’eut pas plutôt pris le fuseau, que, comme elle était fort vive, un peu étourdie, et que d’ailleurs l’arrêt des fées l’ordonnait ainsi, elle s’en perça la main et tomba évanouie.
La bonne vieille, bien embarrassée, crie au secours: on vient de tous côtés, on jette de l’eau au visage de la princesse; on la délace, on lui frappe dans les mains, on lui frotte les tempes avec de l’eau de la reine de Hongrie: mais rien ne la faisait revenir. Alors le roi, qui était monté au bruit, se souvint de la prédiction des fées; et jugeant bien qu’il fallait que cela arrivât, puisque les fées l’avaient dit, fit mettre la princesse dans le plus bel appartement du palais, sur un lit en broderie d’or et d’argent.
On eût dit un ange, tant elle était belle; car son évanouissement n’avait point ôté les couleurs vives de son teint; ses joues étaient incarnates, et ses lèvres comme du corail; elle avait seulement les yeux fermés, mais on l’entendait respirer doucement, ce qui faisait voir qu’elle n’était pas morte. Le roi ordonna qu’on la laissât dormir en repos, jusqu’à ce que son heure de se réveiller fût venue.
La bonne fée qui lui avait sauvé la vie en la condamnant à dormir cent ans était dans le royaume de Mataquin, à douze mille lieues de là, lorsque l’accident arriva à la princesse; mais elle en fut avertie en un instant par un petit nain qui avait des bottes de sept lieues (c’étaient des bottes avec lesquelles on faisait sept lieues d’une seule enjambée). La fée partit aussitôt, et on la vit, au bout d’une heure, arriver dans un chariot de feu traîné par des dragons.
Le roi lui alla présenter la main à la descente du chariot. Elle approuva tout ce qu’il avait fait; mais, comme elle était grandement prévoyante, elle pensa que, quand la princesse viendrait à se réveiller, elle serait bien embarrassée toute seule dans ce vieux château: voici ce qu’elle fit.
Elle toucha de sa baguette tout ce qui était dans ce château (hors le roi et la reine), gouvernantes, filles d’honneur, femmes de chambre, gentilshommes, officiers, maîtres d’hôtel, cuisiniers, marmitons, galopins, gardes, suisses, pages, valets de pied; elle toucha aussi tous les chevaux qui étaient dans les écuries, avec les palefreniers, les gros mâtins de la basse-cour et la petite Pouffe, petite chienne de la princesse, qui était auprès d’elle sur son lit. Dès qu’elle les eut touchés, ils s’endormirent tous pour ne se réveiller qu’en même temps que leur maîtresse, afin d’être toujours prêts à la servir quand elle en aurait besoin. Les broches mêmes qui étaient au feu, toutes pleines de perdrix et de faisans, s’endormirent, et le feu aussi. Tout cela se fit en un moment: les fées n’étaient pas longues à leur besogne.
Alors le roi et la reine, après avoir baisé leur chère enfant sans qu’elle s’éveillât, sortirent du château, firent publier des défenses à qui que ce fût d’en approcher. Ces défenses n’étaient pas nécessaires; car il crut dans un quart d’heure tout autour du parc une si grande quantité de grands arbres et de petits, de ronces et d’épines entrelacées les unes dans les autres, que bête ni homme n’y aurait pu passer; en outre qu’on ne voyait plus que le haut des tours du château, encore n’était-ce que de bien loin. On ne douta point que la fée n’eût encore fait là un tour de son métier, afin que la princesse, pendant qu’elle dormirait, n’eût rien à craindre des curieux
Au bout de cent ans, le fils du roi, qui régnait alors, et qui était d’une autre famille que la princesse endormie, étant allé à la chasse de ce côté-là, demanda ce que c’était que des tours qu’il voyait au-dessus d’un grand bois fort épais. Chacun lui répondit selon qu’il en avait ouï parler: les uns disaient que c’était un vieux château où il revenait des esprits; les autres, que tous les sorciers de la contrée y faisaient leur sabbat. La plus commune opinion était qu’un ogre y demeurait, et que là il emportait tous les enfants qu’il pouvait attraper, pour pouvoir les manger à son aise et sans qu’on pût le suivre, ayant seul le pouvoir de se faire un passage au travers du bois.
Le prince ne savait qu’en croire, lorsqu’un vieux paysan prit la parole et lui dit:
«Mon prince, il y a plus de cinquante ans que j’ai ouï dire à mon père qu’il y avait dans ce château une princesse, la plus belle qu’on eût su voir; qu’elle y devait dormir cent ans, et qu’elle serait réveillée par le fils d’un roi, à qui elle était réservée.»
Le jeune prince, à ce discours, se sentit tout de feu; il crut, sans balancer, qu’il mettrait fin à une si belle aventure; et, poussé par l’amour et par la gloire, il résolut de voir sur-le-champ ce qu’il en était. A peine s’avança-t-il vers le bois, que tous ces grands arbres, ces ronces et ces épines s’écartèrent d’eux-mêmes pour le laisser passer. Il marcha vers le château, qu’il voyait au bout d’une grande avenue, où il entra; et, ce qui le surprit un peu, il vit que personne de ses gens ne l’avait pu suivre, parce que les arbres s’étaient rapprochés dès qu’il avait été passé. Il ne laissa pas de continuer son chemin: un prince jeune et amoureux est toujours vaillant. Il entra dans une grande avant-cour, où tout ce qu’il vit d’abord était capable de le glacer de crainte. C’était un silence affreux; l’image de la mort s’y présentait partout; et ce n’étaient que des corps étendus d’hommes et d’animaux qui paraissaient morts. Il reconnut pourtant bien, au nez bourgeonné et à la face vermeille des suisses, qu’ils n’étaient qu’endormis; et leurs tasses, où ils avaient encore quelques gouttes de vin, montraient assez qu’ils s’étaient endormis en buvant. Il passe dans une grande cour pavée de marbre; il monte l’escalier; il entre dans la salle des gardes, qui étaient rangés en haie, la carabine sur l’épaule, et ronflant de leur mieux. Il traverse plusieurs chambres pleines de gentilshommes et de dames dormant tous, les uns debout, les autres assis. Il entra dans une chambre toute dorée, et il vit sur un lit, dont les rideaux étaient ouverts de tous côtés, le plus beau spectacle qu’il eût jamais vu, une princesse qui paraissait avoir quinze ou seize ans, et dont l’éclat resplendissant avait quelque chose de lumineux et de divin.
Les gardes rangés en haie, la carabine sur l’épaule, ronflaient de leur mieux. (Page 32.)
Il se mit à genoux auprès d’elle. (Page 34
Il s’approcha en tremblant et en admirant, et se mit à genoux auprès d’elle. Alors, comme la fin de l’enchantement était venue, la princesse s’éveilla; et, le regardant avec des yeux plus tendres qu’une première vue ne semblait le permettre:
«Est-ce vous, mon prince? lui dit-elle; vous vous êtes bien fait attendre.»
Le prince, charmé de ces paroles, et plus encore de la manière dont elles étaient dites, ne savait comment lui témoigner sa joie et sa reconnaissance; il l’assura qu’il l’aimait plus que lui-même. Ses discours furent mal rangés; ils en plurent davantage: peu d’éloquence, beaucoup d’amour. Il était plus embarrassé qu’elle, et l’on ne doit pas s’en étonner: elle avait eu le temps de songer à ce qu’elle aurait à lui dire; car il y a apparence (l’histoire n’en dit pourtant rien) que la bonne fée, pendant un si long sommeil, lui avait procuré le plaisir des songes agréables. Enfin il y avait quatre heures qu’ils se parlaient, et ils ne s’étaient pas encore dit la moitié des choses qu’ils avaient à se dire.
Cependant tout le palais s’était réveillé avec la princesse: chacun songeait à faire sa charge; et, comme ils n’étaient pas tous amoureux, ils mouraient de faim. La dame d’honneur, pressée comme les autres, s’impatienta, et dit tout haut à la princesse que la viande était servie. Le prince aida la princesse à se lever: elle était tout habillée, et fort magnifiquement; mais il se garda bien de lui dire qu’elle était habillée comme ma mère-grand, et qu’elle avait un collet monté : elle n’en était pas moins belle. Ils passèrent dans un salon de miroirs, et y soupèrent, servis par les officiers de la princesse. Les violons et les hautbois jouèrent de vieilles pièces, mais excellentes, quoiqu’il y eût près de cent ans qu’on ne les jouait plus; et après souper, sans perdre de temps, le grand aumônier les maria dans la chapelle du château, et la dame d’honneur leur tira le rideau.