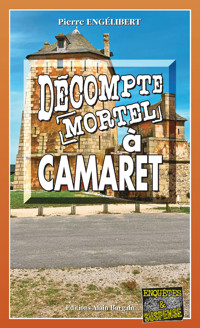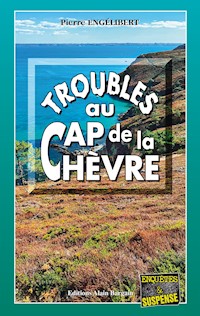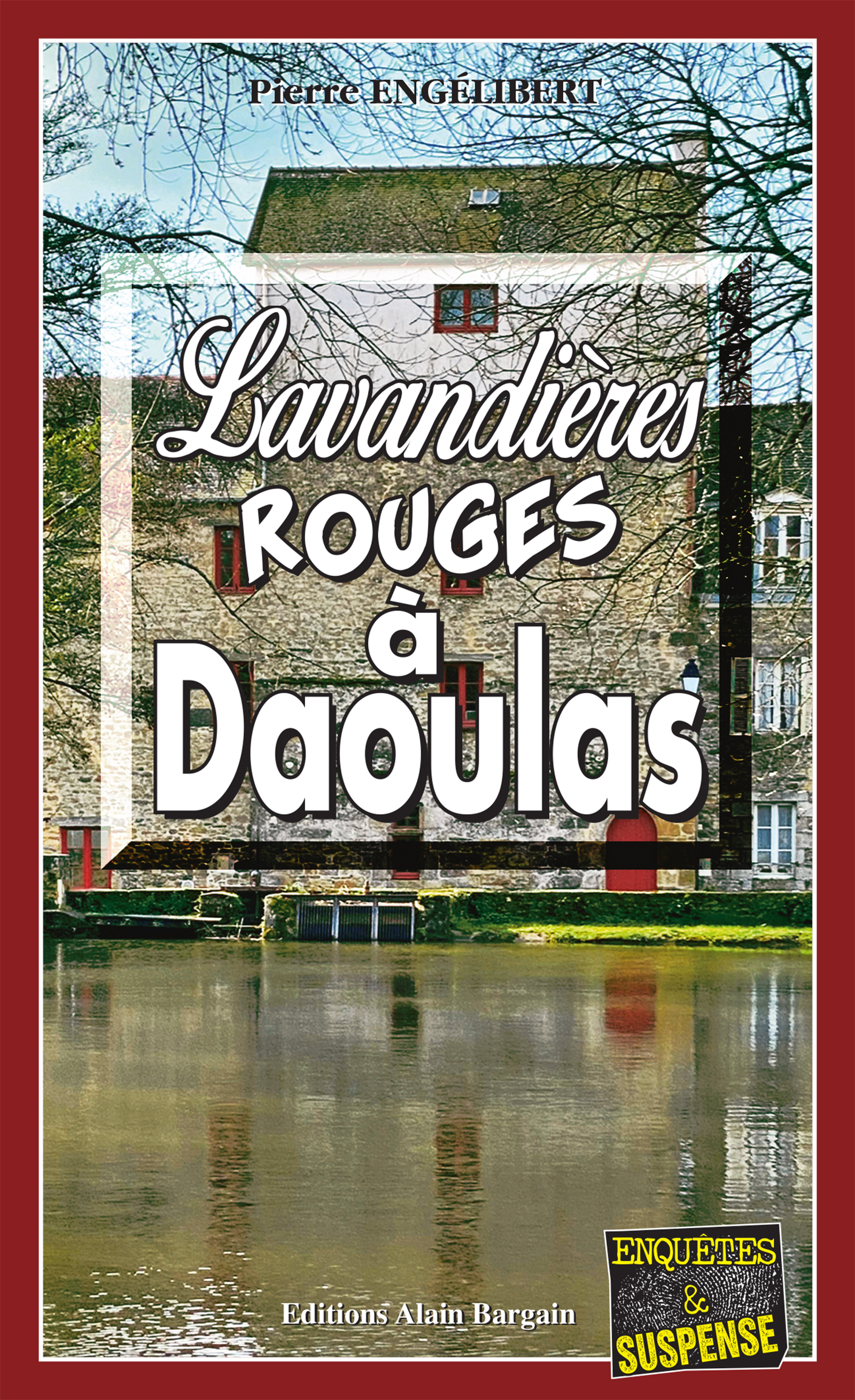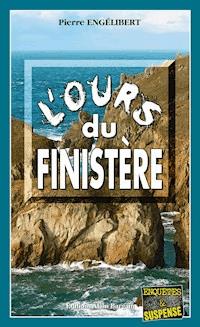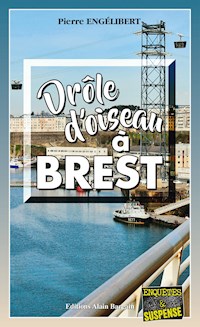
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editions Alain Bargain
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Enor Berigman
- Sprache: Französisch
Quel est le lien entre un bébé abandonné mystérieusement en 1944 et une jeune avocate allemande assassinée en 2018 lors de son arrivée à Brest ?
Brest, août 1944 : un bébé est mystérieusement abandonné à des parents adoptifs par un collaborateur obligé de fuir devant l’avancée américaine.
Brest, avril 2018 : une jeune avocate allemande est assassinée le soir même de son arrivée dans la ville. Elle ignorait que trois jours plus tôt, le président de l’Association du Souvenir Finistérien, l’homme qu’elle venait rencontrer, avait été tué sur un parking de l’anse de Sainte-Anne à Brest.
Rien a priori ne relie ces deux événements mais de nombreuses forces occultes vont entraver l’enquête du commissaire Enor Berigman.
Alors que les cadavres s’accumulent, un Inuit du Groenland, arrivé inopinément, va contribuer à résoudre cette ténébreuse affaire.
Les meurtres s’enchaînent et le commissaire Enor Berigman devra accepter l'aide d'un Inuit du Groenland pour trouver la clé de cette enquête étonnante... Un polar régional captivant en plein cœur de Brest !
EXTRAIT
Dans quelques minutes le bébé aura changé de parents. Évidemment ils ne connaissent pas la vérité, mon histoire est bien plus émouvante et ils ne pouvaient sûrement que fondre en larmes devant la tragédie que je leur ai servie dans mon courrier. La femme est stérile, cet enfant de presque neuf mois leur tombe du ciel et par ces temps de chaos je suis sûr qu’ils n’auront aucun mal à l’adopter. C’est Tilmann, ce médecin militaire allemand que je suspecte de souhaiter la défaite d’Hitler, qui me les a recommandés et a servi d’in termédiaire, j’ignore quels sont ces gens et comment il les connaît mais il ne m’étonnerait pas que ce soient des gaullistes, peut-être même des commu nistes. Des chefs de réseau sûrement. Il est trop tard maintenant pour s’en occuper, l’important est qu’ils ne sachent pas qui je suis. C’est pourquoi j’ai amené Jeanne avec moi, nous formons un beau couple qui prétend faire une bonne action. Je sais que Tilmann ne parlera pas, tellement il est heureux que je me débarrasse de l’enfant. Il est le seul à en connaître l’origine, mais avec un peu de chance il sera mort avant la fin du mois.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 400
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Couverture
Page de titre
Cet ouvrage de pure fiction n’a d’autre ambition que de distraire le lecteur. Les événements relatés ainsi que les propos, les sentiments et les comportements des divers protagonistes n’ont aucun lien, ni de près ni de loin, avec la réalité et ont été imaginés de toutes pièces pour les besoins de l’intrigue. Toute ressemblance avec des personnes ou des situations existant ou ayant existé serait pure coïncidence.
REMERCIEMENTS
À Gildas Priol pour ses informations précieuses sur la Libération de Brest. Toute erreur ne serait que de mon fait.
À mon épouse, Danielle et ma fille, Gwenthalyn pour leur attentive relecture critique… et leur patience.
À mon fils, Yann-Pierrick que je remercie d’être là malgré les milliers de kilomètres qui nous séparent.
À mon éditeur, Carl Bargain qui m’a fait confiance.
À mes lecteurs qui m’ont encouragé à écrire ce deuxième livre après le bon accueil qu’ils ont réservé au premier.
I
Jeudi 3 août 1944
Nous arrivons à Saint-Renan, le parcours depuis Lambezellec s’est bien passé. Il est vrai que c’est plutôt le secteur de Plougonvelin, un peu plus loin, qui n’est plus très sûr. Dans quelques minutes le bébé aura changé de parents. Évidemment ils ne connaissent pas la vérité, mon histoire est bien plus émouvante et ils ne pouvaient sûrement que fondre en larmes devant la tragédie que je leur ai servie dans mon courrier. La femme est stérile, cet enfant de presque neuf mois leur tombe du ciel et par ces temps de chaos je suis sûr qu’ils n’auront aucun mal à l’adopter. C’est Tilmann, ce médecin militaire allemand que je suspecte de souhaiter la défaite d’Hitler, qui me les a recommandés et a servi d’intermédiaire, j’ignore quels sont ces gens et comment il les connaît mais il ne m’étonnerait pas que ce soient des gaullistes, peut-être même des communistes. Des chefs de réseau sûrement. Il est trop tard maintenant pour s’en occuper, l’important est qu’ils ne sachent pas qui je suis. C’est pourquoi j’ai amené Jeanne avec moi, nous formons un beau couple qui prétend faire une bonne action. Je sais que Tilmann ne parlera pas, tellement il est heureux que je me débarrasse de l’enfant. Il est le seul à en connaître l’origine, mais avec un peu de chance il sera mort avant la fin du mois. La ferme de Trelizic est à droite, au bout du chemin de terre que j’emprunte prudemment même si les haies et les prairies gardent encore des traces de la sécheresse du printemps. Tout semble tranquille mais je ne me fais plus d’illusion depuis la percée des Américains à Avranches le 31 juillet. Il ne leur faudra pas longtemps avant d’atteindre Brest, ils sont déjà aux portes de Rennes et de Loudéac et les terroristes ont reçu pour mission de leur préparer le terrain pour le contrôle rapide de toute la Bretagne. Il est vraiment temps d’évacuer les lieux. Le lieutenant Röeder quittera Brest dès la destruction des archives assurée, je ne sais pas s’il emmène sa maîtresse Madeleine, notre agent 327, mais le poste de l’Aussenkommando III à l’école Bonne-Nouvelle à Kerinou est abandonné, et je sais qu’il en est de même de l’Einsatzkommando de Pontivy et du SIPO-SD de Rennes qui évacuent la cité des étudiantes dès aujourd’hui, quelques familles du Bezen dans leurs bagages. Quant aux unités du XXVe corps d’armée du colonel König, elles vont sans doute se replier vers Saint-Nazaire. De toute façon les nouvelles ne sont plus fiables, l’Ouest-Éclair a cessé de paraître depuis hier et les liaisons deviennent difficiles. C’est un peu le sauve-qui-peut, sauf pour les chasseurs-parachutistes d’élite de Ramcke qui vont devoir défendre le port de Brest. C’est stratégique, paraît-il, mais c’est surtout perdu. Tout le monde est de plus en plus nerveux, les soldats sont plus enragés que jamais et les accrochages se multiplient dans les campagnes depuis début juillet, comme à Scrignac et aujourd’hui au Nivot où intervient le Kommando Schaad de Landerneau. Toutes ces manœuvres de retardement ne changeront plus rien, il vaut mieux que nous soyons à Quimper dès demain, je le sens.
La cour de la ferme est déserte, si l’on excepte quelques volailles et un chien souffreteux qui s’approche de nous en remuant la queue alors que je me gare en marche arrière, pour être prêt à repartir très vite si nécessaire. Plus loin dans la grange ouverte j’aperçois une de ces curieuses Peugeot VLV électrique, ce qui me fait penser que l’homme ne doit rouler qu’en ville pour de courtes distances. Est-il médecin lui aussi ? Cela expliquerait bien des choses. Je donne un léger coup de klaxon.
Une demi-heure plus tard c’est fait et nous repartons sans l’enfant. Comme je le pensais l’homme n’était sûrement pas un paysan, ses mains, son visage blanc et lisse, son langage recherché, tout indiquait plutôt le fureteur de bibliothèque qu’un homme de la terre. La femme, aux yeux vifs et intelligents, m’a fait la même impression. Dommage que je n’aie pas eu plus de temps devant moi pour trouver de vrais Français, car ceux-là représentent tout ce que je déteste. Enfin ! Je leur ai dit que je suivrai de près l’évolution de l’enfant, c’est quand même mon fils même s’ils ne le savent pas ! Ils ont eu un hochement de tête sceptique, je les comprends un peu.
Sur le chemin du retour, je me tourne vers Jeanne, de plus en plus inquiète depuis quelques jours :
— Ne t’en fais pas, mon pinson, on s’en sortira. Nous resterons le temps nécessaire à Quimper, puis direction Rennes où l’on m’attend et enfin Paris où j’ai beaucoup d’amis.
II
Lundi 16 avril 2018
Le TGV va bientôt arriver en gare de Brest. Tant mieux parce que le tapage fait par les deux enfants derrière elle l’exaspère depuis Rennes. En fait c’est surtout l’absence d’autorité des parents qui l’énerve. Des parents dépassés, qui aboient sans cesse, faisant ainsi encore plus de bruit, mais incapables de se faire obéir et encore moins de calmer leurs enfants. Le dernier arrêt à Landerneau a été très court, heureusement. Des trois autres personnes assises dans son espace, seule la femme en face d’elle, en âge d’être sa grand-mère, lui a jeté quelques regards complices agacés. À ses côtés la jeune brune qui regarde un film sur son ordinateur, écouteurs sur les oreilles, semble surtout préoccupée par ne pas trop se laisser distraire par les documents professionnels que consulte son voisin d’en face dans un fouillis envahissant. Ce dernier, la quarantaine déjà grisonnante, lève de temps en temps les yeux vers les enfants, les fixant d’un regard inexpressif qui suggère plutôt la concentration sur ce qu’il vient de lire que sur leurs frasques.
Le train roule maintenant dans un paysage bien plus vallonné qu’elle ne l’aurait pensé. L’Élorn fait moins de méandres qu’auparavant, mais il s’élargit de plus en plus, signe que l’on approche de la rade. Les vaches blanches et noires qu’elle aperçoit sur une pente de la rive opposée lui paraissent maintenant toutes petites. Elle est impatiente d’arriver, même si une semaine auparavant il lui a dit, dans un anglais approximatif, qu’il ne pourrait pas la voir avant le mercredi, car il serait en déplacement aux Affaires Culturelles à Rennes où il passerait le week-end. Il partait quelques jours avant son arrivée. Cela lui laissera donc le mardi pour visiter la ville puis la soirée pour refaire le point avant de le rencontrer. Elle appréhende un peu ce moment, il n’est jamais facile d’être la messagère d’un passé honteux, même s’il ne s’agit pas de celui de cet homme. Mais elle a besoin de son aide pour remonter le fil du temps. Il ne refusera certainement pas quand elle lui aura montré les pages du journal qui parlent de son grand-père à lui. Peut-être possède-t-il des documents de famille de cette époque, ou cela éveillera-t-il des souvenirs qui pourront l’orienter dans la bonne direction ?
Cela lui semble étrange, d’être là, plus de soixante-dix ans après son grand-père. À l’approche du but de son voyage, elle repense tristement aux événements des neuf derniers mois : la mort tragique de son père en août, pendant ses vacances, d’une chute du haut de la falaise derrière le fort de l’Aber à Crozon, puis le nettoyage et la vente de sa maison natale, en accord avec Inge, sa belle-mère. Sa mère, journaliste, est décédée alors qu’elle avait deux ans, elle ne s’en souvient qu’à travers les photos, les écrits et les brouillons qu’elle a laissés et par les quelques confidences de son père et des amis du couple. Elle ne sait pas si c’est peu ou déjà beaucoup. Inge ne pouvait lui en dire plus car elle n’avait jamais connu sa mère. C’est dans le grenier qu’elle avait trouvé plusieurs cartons comprenant des objets ayant appartenu à son grand-père Tilmann. Beaucoup de courriers également, des lettres durant la guerre, des journaux de l’époque, mais surtout un journal intime et quelques coupures découpées de ces années terribles. Opa Tilmann est mort depuis plus de quinze ans maintenant. Avait-elle vraiment besoin de savoir ce qu’il y avait dedans ? Pourquoi a-t-il fallu qu’il garde ce journal et ces articles de fin 1944, si longtemps après ? Il n’avait pourtant rien fait de mal, il n’était que médecin de garnison, et tous ces souvenirs, les bons comme les mauvais dans une telle période, méritaient-ils qu’on y revienne ? C’était la guerre, et c’était le chaos à Brest en septembre 44. L’un des documents donnait les noms de deux soldats coupables de plusieurs viols, l’un d’eux avait été fusillé, sans dénoncer son complice. Le général Ramcke, qui avait pourtant besoin de tous ses hommes, avait été impitoyable. Peut-être aurait-il été plus indulgent avec un homme de la 266e ou de la 343e division d’infanterie, mais il ne pouvait accepter qu’un membre de la 2e division parachutiste, “sa” division, ait été coupable. Elle abritait des régiments d’élite qui avaient combattu avec Rommel en Afrique en 1942, et en Italie en 1943, participant au sauvetage de Mussolini, et avaient été héroïques en Crète, avant de venir défendre la poche de Brest.
Grand-père aurait pu dénoncer l’autre soldat de cette division, mais il ne l’avait pas fait. Il avait respecté le secret des confidences de son confrère, un médecin français nommé Guyader. Ce soldat était-il mort dans les combats ? Elle ne le saurait jamais, cela n’avait plus d’importance aujourd’hui. Mais pour l’autre dossier, celui du Français, Roger Norman, ce tueur et violeur gestapiste que la presse de l’époque n’appelait que “l’Oiseleur”, l’un des hommes les plus recherchés dans la région après-guerre, Tilmann avait laissé une indication, un nouveau nom, qui prouvait que durant toutes ces années, il avait été obsédé par ces événements et avait continué à suivre depuis Dinkelsbühl les descendants de son confrère français. Son père avait-il tout relu et décidé d’utiliser les papiers auprès de qui de droit ? Il était troublant en effet que ces documents soient sortis du carton, rangés en partie dans sa serviette en cuir qui n’avait presque pas de poussière, d’autres simplement posés dessus comme s’il s’apprêtait à les prendre avec lui. Dans quel but ? Voulait-il faire ce qu’elle accomplissait aujourd’hui ? En tout cas, il les avait consultés sans doute peu de temps avant sa mort, mais cette dernière l’avait empêché de mener à bien ses projets, s’il en avait. Et ces vacances dans le Finistère n’étaient-elles que des vacances ? Avait-il contacté quelqu’un à Brest ? La coïncidence était curieuse…
C’est cette pensée qui l’avait incitée à prendre rendez-vous avec le descendant de ce médecin qui vivait lui aussi à Brest. Dire qu’il avait été surpris était peu de chose, il avait été stupéfait, et intéressé, du moins au début, jusqu’à ce qu’elle lui dise qu’elle souhaitait le rencontrer. Il était soudainement devenu réticent, doutant de l’exactitude de ses informations. Elle avait alors insisté, sans entrer dans les détails, sur la qualité des documents qu’elle possédait et sur ce qu’ils impliquaient aujourd’hui encore. Après tout n’était-il pas un peu historien amateur ? Et ne souhaitait-il pas clore le dossier de l’Oiseleur ? Et de son enfant ?
Il avait fini par accepter, un peu ébranlé, en l’assurant qu’il la contacterait à son hôtel dès son retour. Il avait ajouté avoir quelqu’un d’autre à contacter sans lui dire qui, précisant juste que cette personne saurait le conseiller et peut-être même accepterait de l’accompagner.
Ses cousins éloignés de Berlin, eux non plus, n’étaient pas très heureux de ce voyage, avec le même argument : ils ne voyaient guère l’intérêt d’une démarche qui ne servirait qu’à rouvrir des plaies refermées depuis si longtemps alors que les acteurs étaient morts maintenant. Sans rien leur révéler du contenu des documents, mais juste de leur importance historique, elle avait vainement tenté de leur expliquer, qu’au nom de son père, il “fallait” qu’elle le fasse. Honnête avec elle-même, quand elle réfléchissait à ses motivations profondes, elle ne se convainquait pas totalement non plus. Car que cherchait-elle ? Accomplir une mission qu’elle se persuadait que son père avait voulu mener, s’insurger face à l’horreur, établir une vérité auprès de descendants qui n’y sont pour rien, soulager les familles des victimes afin de leur rendre justice, ou étancher une simple curiosité personnelle, ou même professionnelle, étant avocate ? Elle ne souhaitait pas approfondir la question même si réveiller le passé risquait d’avoir des conséquences imprévisibles, mais tant pis, elle en acceptait l’augure. Elle se leurrait peut-être, il pouvait tout aussi bien ne rien se passer. Alors qu’elle regarde au large de la plage que le train longe maintenant des véliplanchistes profiter habilement du vent avec le port de plaisance en arrière-plan et qu’elle apprécie la luminosité particulière qui estompe la limite entre la mer et le ciel, elle ne doute pourtant pas qu’elle a eu raison. Mais demain ?
Le train ralentit nettement à présent. La voie surplombe la zone portuaire, elle aperçoit dans la légère courbe le commencement des quais. Dix minutes plus tard, heureuse d’être enfin arrivée, elle sort de la gare, saisie par le vent frais, et se dirige vers l’hôtel de la Rade, avenue Clémenceau, qui n’est qu’à deux cents mètres d’après le plan.
L’hôtel est charmant, la chambre au premier étage est confortable et assez spacieuse, toute en boiseries claires. La porte-fenêtre, qui ouvre sur un petit balcon fleuri semi-circulaire, offre une belle vue sur un parc de l’autre côté de l’avenue. On est en plein centre-ville mais l’ensemble est apaisant en cette fin d’après-midi d’avril. Elle décide de prendre d’abord une douche, pour chasser la fatigue de toutes ces heures passées dans trois trains différents depuis Nördlingen. Puis elle ira se promener un peu avant d’aller manger, son estomac lui rappelle que le mini-sandwich de midi est déjà bien loin. Elle a vu qu’il y avait plusieurs restaurants à quelques mètres de l’hôtel, sur le même trottoir. À moins qu’elle ne se laisse tenter par une crêperie, elle est en Bretagne après tout. Elle ne sait pas combien de temps exactement va durer son séjour ici, elle a réservé pour cinq nuits. On est lundi, le train du retour est samedi matin, très tôt. Elle a bien fait, la journée de mardi étant neutralisée du fait de l’absence de son correspondant, elle n’aura peut-être pas trop des trois jours suivants pour mener à bien sa démarche. Elle espère être comprise. Demain elle fera un peu de tourisme, peut-être jusqu’à l’île de l’Aber voir les lieux où son père est décédé, puis elle se rendra au Fort Montbarey, qui n’est ouvert que l’après-midi, le mémorial des Finistériens qui entretient le souvenir de Brest et du Finistère pendant la guerre, notamment la période de la Libération, en septembre 1944. Elle aimerait que ses documents soient conservés dans ce lieu de mémoire, la question de l’Oiseleur étant encore une plaie vive au sein des descendants de ses victimes. L’affaire n’a jamais été résolue car l’Oiseleur, agent de la mal nommée “Gestapo française” en Bretagne s’est évaporé pendant la confusion d’août-septembre avec de faux papiers et quelques complicités. Il a été condamné à mort par contumace en février 1945. Truand psychopathe originaire de Paris, il avait été un familier de Lafont à “La Carlingue”, le siège de la rue Lauriston, avant de venir à Brest. Elle pense qu’ils seront sûrement intéressés, elle ne voudrait pas avoir fait tout ce voyage pour rien, ni avoir à rapporter ces documents.
La douche lui a fait du bien. En coiffant ses longs cheveux bruns puis en se maquillant discrètement, elle observe son visage et n’y distingue plus de traces de fatigue. À trente-huit ans elle se sent bien, dans son corps comme dans sa tête. Même si ses amies ne comprennent pas qu’elle soit encore célibataire, elle est aussi heureuse qu’elle peut l’être étant donné la période qu’elle traverse. Après quelques grimaces pour étudier ses dents et un sourire pour l’impression générale, elle s’habille puis quitte la salle de bains. Elle regarde sa montre : à peine 19 heures. Elle sait qu’en France cela lui laisse une bonne marge pour aller manger, aussi s’octroie-t-elle quelques minutes avant de sortir pour parcourir une fois de plus le journal de son grand-père qu’elle connaît pourtant presque par cœur. Elle ouvre la serviette de cuir et le sort avec quelques papiers pour les consulter en s’asseyant devant le bureau. Elle y est depuis moins de deux minutes que son téléphone portable sonne. Elle fait un bond, faisant tomber quelques coupures de journaux. Elle ramasse précipitamment l’ensemble et le remet, avec le journal, dans la serviette avant de répondre.
Elle n’a pas vu qu’un des articles de presse avait glissé loin sous le bureau.
Elle est étonnée, n’attendant rien de spécial avant le lendemain. Elle a juste promis à Inge de la tenir au courant dès que possible des résultats de sa démarche.
Qui peut bien appeler ? C’est d’une voix intriguée qu’elle dit :
— Allô ? Dorothéa Hautzenberger.
La réponse la déconcerte.
Elle eut été bien plus troublée si elle avait pu lire le Ouest-France du jour…
III
Trois jours plus tôt, vendredi 13 avril 2018
— Vous savez, il est encore trop tôt pour que nous intervenions. La disparition ne date que de la nuit dernière et votre mari est majeur. Nous ne pouvons encore rien faire, sauf si vous avez des éléments qui indiqueraient qu’un homicide a été commis.
Le brigadier derrière le comptoir semble désolé. La femme en face de lui, qui ne cache pas son inquiétude, a une moue agacée qui lui déforme les lèvres. Elle insiste :
— Écoutez, je vous répète que ce n’est pas normal. Il avait une réunion du bureau de son association hier soir à 18 heures pour caler les derniers réglages d’une exposition puis il devait rentrer directement. D’ailleurs il m’a appelée vers 8 heures et quart pour me dire qu’il arrivait. J’ai contacté les autres membres vers 22 heures et tous m’ont confirmé qu’ils ont fini à 20 heures 15 puis se sont séparés sur le parking. Il était le dernier à fermer à clé avant de monter dans sa voiture. Je suis allée sur place, pensant qu’il pouvait avoir eu un malaise mais sa voiture n’était pas sur le parking. Alors je suis rentrée et j’ai appelé l’hôpital à 23 heures 30 mais ils n’avaient aucun blessé à son nom, pas plus que police secours que j’ai contacté tout de suite après. Ce sont eux qui m’ont dit de passer pour faire un signalement. J’ai laissé passer la matinée, mais toujours rien. Tout ça n’est pas normal, il était attendu à la Direction régionale des affaires culturelles à Rennes à 14 heures aujourd’hui où il n’est jamais arrivé. De toute façon sa valise est à la maison.
Le commissaire Enor Berigman, de l’antenne de Brest du SRPJ de Rennes, qui traverse le hall d’accueil du commissariat central pour rejoindre la rue de Siam et entend ce dialogue, observe la femme : élégante, la cinquantaine, vêtue d’un pantalon droit marron et d’un cardigan bleu sous une veste beige clair, elle paraît sûre d’elle mais à bout de nerfs. Il fait demi-tour et s’approche :
— Que se passe-t-il, brigadier ?
Le brigadier, un flic consciencieux qu’il connaît bien, se redresse un peu :
— Le mari de cette dame, Émile Guyader, n’est pas rentré hier soir, Commissaire. Madame pense qu’il lui est arrivé quelque chose et…
La femme lui coupe la parole :
— Mais il lui est arrivé quelque chose, insiste-t-elle, j’en suis sûre. Il est impossible, vous entendez, impossible, qu’il ait disparu de son plein gré.
Enor observe un court instant son visage ravagé par l’inquiétude. Il demande :
— Que faisait votre mari hier soir ?
— Il était à une réunion du conseil d’administration de l’Association du Souvenir Finistérien, une association qui organise des événements pour le Fort Montbarey, le mémorial de la Libération de Brest et du Finistère. L’association prépare une exposition sur l’aviation durant la seconde guerre mondiale pour cet été, le conseil devait faire le point sur l’avancée des préparatifs.
— Et que fait votre mari dans la vie, car je suppose que ses fonctions en son sein sont bénévoles ?
— Oui, en effet. Il est chef du service d’orthopédie au CHRU. Il est issu d’une famille de médecins, son père et son grand-père l’étaient. – elle pousse un soupir – Écoutez, avec tous les rendez-vous et le travail qui l’attendaient ces prochains jours, il n’avait aucune raison de faire je ne sais quelle fugue, sa disparition est inquiétante.
Enor, joignant quelques secondes ses deux paumes de mains sous le menton avec un léger mouvement circulaire des pouces, prend sa décision.
— Quelle voiture a-t-il ?
— Une Passat noire, dernier modèle, immatriculée PH 508 FE.
Le commissaire se tourne vers le brigadier, qu’un adjoint de sécurité est venu remplacer à l’accueil :
— Lancez un avis de recherche sur cette voiture et prenez la déposition complète de madame. – Il se tourne vers elle – Vous avez une photo de votre mari ?
— Oui, j’y ai pensé, j’en ai apporté plusieurs, fait-elle en sortant une enveloppe de son sac qu’elle lui tend.
Enor esquisse un geste de dénégation :
— Vous les donnerez à mon collègue, pensez à lui donner tous les détails. – il lui fait un sourire qui se veut rassurant – Voilà, la machine est lancée, je suis sûr qu’il y a une explication simple et que nous allons le retrouver très vite. Au revoir Madame.
— Merci d’avoir pris mon inquiétude au sérieux, Commissaire, lui répond-elle d’un sourire un peu forcé.
Enor sort du commissariat, il fait un peu frais et le ciel est couvert. Un détail le tracasse, c’est le coup de téléphone passé par Guyader à 20 heures 15 pour annoncer son retour, si ce coup de fil a bien eu lieu. Quelqu’un qui disparaîtrait volontairement ne ferait pas ça, il n’y croit pas. Ou alors, il aurait argué d’un rendez-vous important de dernière minute, pour s’assurer une marge et inciter son épouse à ne pas l’attendre. Son instinct de flic lui souffle que cette disparition, même s’il est encore tôt pour l’appeler ainsi, risque bien d’être le prélude de quelque chose de plus grave. De plus l’inquiétude de l’épouse ne semblait pas feinte, il en jurerait, et une simple dispute conjugale n’aurait pas justifié un déplacement au commissariat. D’un autre côté, si un accident était survenu, ils auraient en effet déjà dû en être informés. L’homme ne semble pas avoir non plus le profil du fugueur bien qu’il ait déjà vu des choses plus surprenantes. Allez, peut-être exagère-t-il, à vouloir trop prouver on ne prouve rien, lui dirait son ami et mentor à la retraite le commissaire Le Rouzic. On sera sans doute fixé assez vite, se dit-il en regardant défiler sur un panneau municipal une publicité pour le salon du véhicule de loisir du week-end. En attendant c’est vendredi et le week-end s’annonce intéressant.
Ce soir restaurant en tête-à-tête avec Mariannig à la pointe Saint-Mathieu et demain après-midi son voisin Philippe Guillemot l’entraîne au trophée du Finistère de football gaélique au stade du petit Kerzu, rue Lesven. Son fils Yann, qui a 14 ans, est inscrit au club du pays du Léon depuis trois ans et ce sport le passionne. Depuis le temps qu’il avait promis d’aller le voir un jour c’est l’occasion. Quant à dimanche, ce sera repos et un bon bouquin sur sa terrasse à Toulbroc’h !
Les bureaux du SRPJ sont presque vides et le silence qui y règne montre qu’aucune urgence n’est en cours. Le commandant Françoise Ridel, belle brune de cinquante ans aux yeux verts, la seule de son équipe qui le tutoie, est assise à son bureau, l’air pensif.
— Encore là ? Je croyais que tes beaux-parents arrivaient ce soir ? lui dit-il un peu moqueur.
Les parents de sa compagne Dominique, professeurs à la retraite, habitent à Nangis, en Seine-et-Marne. Ils choisissent toujours le printemps pour venir.
— Oui, justement je m’en allais, répond-elle en se levant, ils sont arrivés depuis une heure.
— Qui est de permanence ce week-end ?
— Denis.
— Ah ? Alors pas d’entraînement ce week-end ?
Le lieutenant Denis Bauzin, 35 ans, est un véliplanchiste confirmé. Il s’est inscrit cette année pour la première fois au Raid des Mégalithes, organisé les 23 et 24 juin par le Yacht Club de Carnac. L’épreuve est difficile et il semble que le choix d’y participer, par ses contraintes de préparation, n’aille pas sans quelques tensions passagères avec Mélanie, son épouse infirmière. Le fait que le lendemain, 14 avril, s’il se rappelle bien, est l’anniversaire de Mélanie est une preuve supplémentaire de ces frictions. Leur fille Katell n’a que 8 ans et les horaires professionnels de ses parents ne favorisent guère la vie de famille. Enor en sait aussi quelque chose, même si les parents de Mélanie habitent Brest et gardent volontiers leur petite-fille. Alors de la compétition sportive en plus…
— Non, mais il trouvera bien un autre moment la semaine prochaine. Allez, bon week-end.
— Salut, passez une bonne soirée.
Après un dernier tour dans son bureau pour vérifier qu’il n’y avait pas une affaire de dernière minute, il se décide à quitter les lieux en songeant au bon repas qui l’attend, il y a longtemps qu’un homard sauce sabayon au vin jaune le tente.
Son arrivée chez lui, par la petite route de campagne qui dévoile au détour d’un virage une vue époustouflante sur l’entrée de la rade de Brest, est bercée par la version télé de country roads d’Olivia Newton-John. Oui, Take me home, country roads…
IV
Dimanche 15 avril 2018, 15 heures 13
Enor, paresseusement occupé à l’une de ses habituelles relectures désopilantes d’un album de Gaston Lagaffe dans son canapé, sursaute en entendant la sonnerie de son portable sur la musique explosive de Lucifer Sam du Floyd. Qu’est-ce qui lui avait pris de la programmer, Sam était le chat un peu destructeur de Syd Barrett et le morceau n’était pas vraiment adapté à une sonnerie de téléphone, il aurait dû penser aux dimanches après-midi silencieux ! Mais il comprend tout de suite en voyant l’origine de l’appel que son repos est terminé :
— Oui, Denis ? fait-il dans un léger soupir, espérant encore qu’il ne s’agit que d’une broutille, ce qui est stupide car alors il ne l’appellerait pas.
— Patron, désolé de vous déranger, mais on vient de me signaler un meurtre.
— Un meurtre ? répète-t-il bêtement, se forçant, pour se concentrer, à détacher son œil du chat de Gaston qui a les griffes des quatre pattes plantées dans le dos de De Mesmaeker au moment de la signature des contrats.
— Oui, aucun doute, la patrouille qui a repéré la voiture a retrouvé l’homme enfermé dans le coffre, sans doute poignardé. Le légiste et la police technique sont en route.
Enor est pris d’un pressentiment :
— La voiture, ce ne serait pas une Passat noire ?
— Si, en effet, c’est ce qu’on m’a dit. Mais comment le savez-vous ?
— Une femme a signalé la disparition de son mari dans la nuit de jeudi à vendredi, un avis de recherche a dû être lancé, bien qu’à ce stade ce n’était pas encore pour nous. Mais ça explique la vigilance de la patrouille. Confirme avec eux le numéro de la voiture et demande leur le nom de la victime et son adresse, si c’est bien lui, sinon appelle le commissariat central, ils ont la déclaration de l’épouse.
— OK Patron.
— Bon dis-moi où cela se trouve.
Denis a un petit rire :
— Tout près de chez vous, guère plus de cinq minutes, je dirais. La voiture est sur le parking de la plage de l’anse de Sainte-Anne, rue Jim Sévellec, je suis sur place dans trente secondes.
— Bien, j’arrive très vite, le temps de contacter l’équipe.
Après s’être changé, il monte voir Mariannig qui travaille dans son bureau à sa thèse sur Sartre à laquelle il ne comprend rien, sauf peut-être s’il parvenait à transformer en enquête policière la recherche des liens entre singularité, collectif et rareté dont la dialectique semble le trait d’union. Tout ce travail sera un élément de son dossier d’habilitation à diriger des recherches pour être nommée un jour peut-être au grade de professeur des Universités. Après quelques mots rapides que des bisous closent progressivement, Alexine étant chez les voisins avec son amie Aliona, il rejoint sa voiture, focalisé sur les longues heures à venir, tout en appelant chacun des membres de son groupe d’enquête à qui il donne rendez-vous sur les lieux. Effectivement, il ne lui faut que quelques minutes pour s’y rendre. Sitôt passé l’hôtel-restaurant “de la Forêt”, qui comme son nom ne l’indique pas est en bord de plage, il se dirige vers le parking qui lui semble la proie d’une agitation désordonnée. En réalité ce sont simplement les collègues qui font évacuer toutes les voitures en prenant leur immatriculation ainsi que l’identité de toutes les personnes présentes. Les lieux sont maintenant une scène de crime, une barrière de sécurité a été installée à l’entrée et plus loin une rubalise délimite précisément la zone interdite. Il se gare juste à gauche de l’entrée en faisant un signe de tête à l’adjoint de sécurité qui en contrôle l’accès. Denis s’approche de la voiture quand il en sort. Enor est toujours surpris de le voir conserver ses cheveux blonds très courts malgré ses oreilles légèrement décollées.
— Tout correspond, Patron, la voiture, le signalement de la victime et ses vêtements, c’est probablement votre homme disparu. À confirmer. Le légiste et les services techniques viennent d’arriver. Ah, j’ai l’adresse du couple propriétaire de la voiture, 22 rue de Denver, au 6e étage, vous voyez où c’est ?
— Oui, je situe.
— C’est dommage, ici sur le parking, à trois cents mètres près, nous étions en zone gendarmerie et nous serions encore à la maison.
Enor ne relève pas mais esquisse un léger sourire en songeant à ce qu’il vient de quitter avec regret. Tous les deux se dirigent vers le véhicule tout en enfilant les tenues qu’un technicien leur tend pour ne pas polluer les lieux. Enor aperçoit Yves Cardic, le légiste, penché vers le coffre et Claude Guitton, le chef des services techniques, plié en deux à l’avant de la voiture, portière ouverte côté conducteur.
Deux autres techniciens s’affairent à l’arrière tandis que le photographe œuvre de son côté et que des techniciens ramassent ce qui traîne, tout en faisant des prélèvements minutieux. Enor s’approche du légiste :
— Salut Yves, tu as déjà une première impression ?
Cardic se redresse en évitant de se cogner la tête tout en se massant les reins :
— Oups ! Je me fais vieux, il est temps que la retraite arrive, Enor ! – Enor sait qu’il vient de fêter ses soixante ans – Tu devrais savoir qu’avec les cadavres ce n’est pas la première impression qui compte, mais la dernière, ce n’est pas comme avec ma femme, là aucune impression n’est jamais la même !
Le grand sourire qu’il affiche adoucit son propos, il redevient sérieux et poursuit :
— Bref il est encore un peu tôt mais comme je sais que tu vas insister, voilà ce que je peux te dire : la mort remonte à deux ou trois jours, pas plus, pas moins, elle a été provoquée par des coups de couteau, au moins deux, situés dans le thorax, dont un dans la région du sternum qui a pu atteindre le cœur et être mortel. Par ailleurs je n’ai remarqué aucun geste de défense.
— Il connaissait peut-être son agresseur, l’interrompt Enor.
— C’est ce qu’on se dit dans ces cas, – il hausse les épaules – mais il est étrange qu’on n’ait rien trouvé sur lui, ni papiers ni portefeuille, rien du tout, c’est tout ce que je peux te dire. Mais suis-moi, je vais te montrer quelque chose. – ils font quelques pas vers le talus – Regarde, – il lui montre une zone sombre au sol à deux mètres – c’est sans doute là qu’il a été tué.
— Du sang ?
— Oui, et assez frais. On va faire un prélèvement mais la coïncidence serait trop forte.
— D’accord avec toi.
— Ah, avant que tu ne me le demandes, je ferai l’autopsie demain matin à la première heure, et mon rapport suivra très vite.
— Merci. Notre victime, si c’est bien l’homme auquel je pense, a disparu dans la nuit de jeudi à vendredi, ton estimation correspond mais il faut qu’on confirme son identité le plus vite possible. En fin d’après-midi, vers 18 heures 30, ça ira si je viens avec l’épouse ?
— Pas de problème, le visage n’a rien.
Enor interpelle Claude Guitton alors qu’il aperçoit Françoise et Ronan qui s’approchent :
— Claude ! Vous avez trouvé quelque chose ?
Guitton se redresse, et après un bref salut, secoue la tête :
— Non rien d’intéressant pour le moment, deux jeux d’empreintes sur le volant, d’autres sur les consoles, quelques cheveux et poils, maigre récolte, l’intérieur est propre, la voiture est entretenue. Nous n’avons pas trouvé non plus les clés, ni aucun papier dans ses poches, juste un paquet de gauloises filtre entamé. – il balaie les lieux des yeux – Il va falloir chercher tout autour, jusque sur la plage, ça va être coton !
Enor fait une moue dubitative :
— Oui, d’autant que la marée monte et que les grandes marées commencent. Et puis depuis trois jours, il y a peu d’espoir de trouver quelque chose de ce côté-là. On va quand même fermer la plage pour faire des recherches demain matin au moment de la basse mer.
Tout en parlant, Enor observe en faisant une grimace, les voitures des deux quotidiens locaux qui se garent près de l’entrée, journalistes et photographes sortant de chacun des véhicules :
— Manquait plus qu’eux ! Qui les a prévenus ?
Ronan esquisse un sourire :
— Vous savez, Patron, un dimanche près d’une plage avec un restaurant juste à côté, les candidats ne manquent pas !
— Ouais ! Qu’ils n’approchent pas ! – il se tourne vers son subordonné – Ronan, avec Denis, vous faites comme d’habitude la tournée du voisinage, commencez par le restaurant. La voiture a dû être abandonnée ici dans la nuit de jeudi à vendredi, probablement en première partie de nuit, entre 21 heures et… disons 2 heures du matin, estimation large car il a appelé son épouse vers 20 heures 15. Françoise et moi nous allons discuter avec les bleus qui ont repéré la voiture, puis on ira chez la présumée veuve pour l’informer et aller reconnaître le corps, je vois que l’ambulance approche. On se retrouve tous à la boîte à 20 heures pour faire le point. Aela nous y rejoindra, elle était à Séné chez ses parents aujourd’hui. Pas de question ?
Mais il savait qu’il n’y en aurait pas, l’équipe étant bien rodée. Françoise et lui se dirigent alors vers le brigadier et l’agent qui sont près de leur voiture de patrouille :
— Bonjour les gars, alors, comment avez-vous identifié le véhicule recherché, car je suppose qu’il y avait du monde sur le parking ?
Tous les deux lèvent la main à leur casquette en un rapide salut et le bricard, le plus âgé, un grand costaud d’environ trente-cinq ans, répond :
— Brigadier Thierry Pouliquen, Commissaire. Oui et non, car le restaurant a son propre parking clients – il fait un mouvement du menton en direction du restaurant – et donc finalement quand nous sommes passés vers 14 heures 30, il n’y avait pas tant de monde que cela. La patrouille a toujours pour consigne d’entrer dans les parkings publics, vous le savez, alors nous nous sommes engagés au pas dans celui-là et il se trouve que cette voiture était garée tout au fond un peu à gauche, parallèlement au talus au lieu d’être en épi comme les autres. Et puis elle était un peu isolée, alors on s’est approché et je me suis rappelé l’avis de recherche sur une Passat noire, j’ai appelé une première fois le central pour confirmation, et voilà !
— Et ensuite ?
— J’ai d’abord regardé à travers les vitres l’intérieur du véhicule, qui semblait vide, puis je suis allé au coffre, qui n’était pas fermé, j’ai ouvert et y ai trouvé le cadavre. Je n’ai touché à rien d’autre, il est d’ailleurs à noter que les portières n’étaient pas non plus verrouillées. J’ai simplement suivi la procédure habituelle et donné l’alerte.
— Il était quelle heure ?
— 14 heures 53 exactement au moment du deuxième appel.
Son portable avait sonné vingt minutes plus tard, c’était raisonnable.
— OK, merci. Voilà ce que vous allez faire. Vous lancez une équipe pour rechercher l’arme du crime, sans doute un couteau, dans les talus et fourrés tout autour et vous fermez la plage pour une autre équipe chargée de la fouiller demain, à marée basse.
— Bien Commissaire, je m’en occupe tout de suite.
Enor, suivi par Françoise, s’éloigne en jetant un coup d’œil à sa montre, 16 heures 20, ils n’ont plus de temps à perdre, il lui reste à prévenir la procureure avant d’aller voir l’épouse. Il sort son téléphone et tape son numéro.
La procureure Guylaine Essart, qui vient tout juste d’avoir quarante ans, est à Brest depuis cinq ans, cinq années durant lesquelles ils ont travaillé ensemble en bonne intelligence et avec respect, chacun appréciant l’indépendance d’esprit de l’autre face à leurs supérieurs respectifs, arrimant leur confiance mutuelle à l’épreuve d’enquêtes parfois tendues. Enor ne peut en dire autant du divisionnaire Christian Peyret, avec qui les relations sont exécrables depuis le départ à la retraite de son ami Le Rouzic. Guylaine Essart décroche presque de suite :
— Commissaire ?
— Mes respects, Madame la procureure, je crois que nous avons une nouvelle affaire.
Il lui fait un rapide résumé de la situation. Elle l’écoute sans l’interrompre, puis conclut :
— Bien, on ouvre l’enquête préliminaire, l’urgence est d’identifier la victime, en effet. On se voit ce soir alors, je serai présente à 20 heures, au revoir.
Le téléphone en main, Enor en profite pour passer un coup de fil rapide à Mariannig afin de l’informer de ses contraintes horaires, auxquelles elle s’attendait, puis il prend la direction de la rue de Denver, suivi par Françoise.
*
L’annonce de la mort de son mari n’a pas surpris Gisèle Guyader, tant elle s’y est préparée. Elle ne s’est pas effondrée dans le canapé en cuir de son appartement cossu dont la terrasse offre une vue magnifique, par-delà le port de commerce, sur la rade de Brest. Pendant qu’elle encaisse la nouvelle malgré tout, réconfortée et interrogée par Françoise, Enor a pu déambuler dans le grand salon aux meubles modernes, décoré discrètement de sculptures et de peintures contemporaines. Mais il a surtout établi, pendant que la femme nie que quelqu’un ait pu en vouloir à son mari, que l’homme qu’il voit sur les photos est bien celui qui était dans le coffre de la voiture. C’est pourquoi un peu plus tard l’identification du corps n’a été qu’une formalité, pour Françoise et lui du moins. De fait ils ont appris peu de choses, la vie professionnelle comme les activités associatives du défunt semblant aux yeux de son épouse sans un nuage. Il y a pourtant forcément quelque part une zone de turbulence qui lui a échappé, ou qu’elle a préféré taire.
Françoise la raccompagne avec pour mission d’obtenir un agenda et un répertoire des connaissances de la victime.
Comme il est déjà 19 heures 30 Enor décide de se rendre directement au SRPJ. Il croise Aela dans le couloir :
— Ah, tu es là, c’est bien. Comment vont tes parents ?
— Très bien, Patron, ils auraient aimé me garder plus longtemps, mais c’est comme ça, ils le savent. Le temps de déposer Gilles au Faou, j’arrive direct. Une nouvelle affaire, alors ?
— Oui, j’ai l’impression qu’elle ne va pas être simple, on verra cela dans un instant. Il faut que j’appelle le divisionnaire, il est à Rennes, réunion dans un quart d’heure.
— Ah j’ai pris sur moi de commander quelques pizzas, on réfléchit mieux le ventre plein.
— Tu as bien fait, je pense que personne n’aura mangé, à tout de suite.
La conversation avec son supérieur Peyret, toujours un peu surréaliste aux yeux d’Enor, ne prend que quelques minutes. Il ne lui faut pas longtemps non plus pour jeter sur le papier les tâches à accomplir le lendemain, il les avait déjà bien en tête. Il se dirige alors vers leur salle de réunion, qui porte maintenant le nom de salle Luc Magdelain, du nom de leur collègue assassiné quatre ans plus tôt. Une plaque ornée d’une photo rappelle la mémoire de leur camarade, et Enor ne manque pas d’appeler au moins une fois par an Caroline, sa compagne, qui a ouvert son magasin de surf, leur projet commun, au Cap-Ferret. Elle s’est d’ailleurs mariée là-bas l’année précédente, Enor, qui a assisté au mariage, en était très heureux pour elle, elle n’avait rien oublié, mais elle allait de l’avant.
Lorsqu’il entre, tout le monde est présent, se partageant les parts de pizza : Aela, Françoise, Denis, Ronan et la procureure Guylaine Essart. Tous des gens avec qui il aime travailler, en toute confiance, et il sait que c’est réciproque. Il s’installe et goûte rapidement une très légère part d’une curieuse pizza avec de l’ananas, tout en écoutant distraitement les conversations et plaisanteries habituelles, dernier moment de détente avant ce qui les attend. Une fois le repas achevé et débarrassé, Enor prend la parole et fait un résumé de la journée. Dix minutes plus tard, il précise :
— Avant de vous passer la parole, nom de code de notre assassin : Hadès. Alors, qu’ont donné les enquêtes de voisinage ?
Denis se lance le premier :
— Pas grand-chose, Patron, les maisons riveraines, de chaque côté de la plage, sont éloignées, l’anse n’est pas très grande, en creux, et la route remonte de chaque côté en virages, vous connaissez l’endroit. Il y a peu de maisons dans les côtes et elles n’offrent aucune vue sur les lieux. Bref, personne n’a rien vu, ni entendu. Pourtant nous ne sommes pas vraiment bredouilles, n’est-ce pas, Ronan ?
Le lieutenant Ronan Canu, 33 ans, est le dernier arrivé dans le groupe, et le plus jeune. Originaire d’Isigny-sur-Mer, en Normandie, où vivent toujours ses parents dans le quartier des Hogues, ce brun au visage allongé s’est parfaitement intégré dans l’équipe. Il se racle un peu la gorge avant de prendre la suite :
— Le renseignement intéressant est venu de la femme d’un couple de clients de l’hôtel qui expose au salon du véhicule de tourisme au Parc des Expositions et qui se reposait un peu au troisième jour de salon. Jeudi soir ils se sont offert une soirée restaurant-cinéma, enfin restaurant c’est vite dit, ils sont allés dans une chaîne rapide place de la Liberté parce que le film était à 20 heures. Ils allaient aux Studios voir un film qui s’appelle – il consulte son papier – Handia au festival du cinéma espagnol et latino-américain. C’est une coïncidence, j’avais prévu d’aller le voir également mais j’ai eu un empêchement. Le film durait presque deux heures et ils sont revenus directement pour être opérationnels vendredi matin à l’ouverture du salon, c’est pourquoi leur estimation horaire de 22 heures 30 semble correcte. Le parking de l’hôtel étant complet sans doute à cause du restaurant, ils ont dû se rabattre sur le parking de la plage où ils se sont garés à l’entrée à gauche. Le parking était désert sauf une voiture au fond à gauche, certainement celle de notre victime, et surtout une autre voiture, au fond aussi mais à droite celle-là.
— Et alors ? interroge Enor qui a noté le petit sourire de Ronan et qui comprend que ce n’est pas tout.
— Eh bien ils sont sûrs qu’il y avait quelqu’un dans cette voiture.
— Comment en sont-ils si certains ? demande Françoise.
— Grâce aux phares de leur voiture qui ont éclairé l’habitacle du véhicule, intervient Denis. On a vérifié cet après-midi, c’est très simple : comme ils venaient du centre-ville, ils sont arrivés par la première entrée du parking et ont donc dû faire ensuite le tour pour venir se garer près de la deuxième entrée, celle qui est plus proche de l’hôtel. Forcément ils ont inondé de lumière une seconde ou deux les deux véhicules dans chaque virage, c’est pourquoi ils sont convaincus d’avoir distingué deux silhouettes dans celui de droite.
Un silence accueille cette démonstration, rompu par Aela :
— Mais alors ils se souviennent peut-être du modèle de la voiture ?
— Bingo, oui ! Et c’est suffisamment important pour arriver à la retrouver, sans aucun doute ! Ah, si on avait toujours des témoins comme ça ! Il s’agit d’une Peugeot 5008 blanche, dernière génération, plaque française, et surtout, surtout, avec un dispositif lumineux de taxi sur le toit !
— Un taxi ! s’exclame Françoise, ils sont vraiment sûrs de tout ça ?
— Oui, n’oublions pas qu’ils vendent des camping-cars et des caravanes, ils s’y connaissent bien, d’autant plus qu’ils étaient commerciaux en vente de voitures neuves dans une vie antérieure. Et comme ils sont observateurs, ils ont remarqué sur le côté gauche un autocollant bleu et jaune avec une hermine noire au centre avec un texte autour. J’ai retrouvé cet autocollant sur internet, il est écrit « Breizh da viken ».
— Ça veut dire quoi ? demande Françoise.
— Bretagne pour toujours, quelque chose comme ça, en tout cas c’est l’idée.
— Bien, reprend Enor, il faut retrouver ce taxi, Denis tu t’y mets dès demain matin. C’est une piste intéressante, sauf s’ils sortaient du restaurant et s’apprêtaient à partir. Autre chose ?
Mais Denis réagit à cette dernière réflexion :
— Ils affirment que le temps qu’ils fassent les cent mètres à pied jusqu’à l’hôtel, aucune voiture n’est sortie du parking, d’autant qu’ils sont restés quelques minutes à écouter le bruit des vagues, ils viennent de Poitiers, vous comprenez.
— Oui, l’élément indispensable d’une soirée romantique commencée par un hamburger ou quelque chose comme ça, ironise Françoise.
Tout le monde éclate de rire, mais Aela reprend :
— Le brigadier Pouliquen a appelé vers 19 heures, ses hommes et lui n’ont rien trouvé aux alentours, ni clés ni papiers, ils exploreront la plage demain.
C’est le moment que choisit Guylaine Essart pour intervenir :
— Vous ne croyez pas que ce puisse être un crime de rôdeur ?
Enor fait une grimace :
— Non, à cause du déplacement du véhicule. Si on l’avait trouvé sur le parking du Fort Montbarey, OK, mais là, il a fait environ deux kilomètres et n’oublions pas que selon le légiste, Guyader a sans doute été tué à l’arrivée et non au départ, les taches au sol sont nettes.
— Oui, abonde Françoise, je crois qu’Hadès a voulu nous faire croire à un crime crapuleux en volant les papiers, mais alors comment et pourquoi est-il arrivé là ? Y a-t-il plusieurs assassins ? Yves pense que le meurtre a eu lieu là où on a retrouvé la voiture, on a simplement voulu nous égarer un peu, j’en suis persuadée. Cela implique probablement qu’il connaissait son assassin et qu’il l’a suivi de lui-même, en toute confiance, ou bien qu’il a été attiré là-bas.
— N’empêche, complète Enor, qu’il faut en avoir le cœur net. Aela, tu iras inspecter demain matin le parking du fort, à la recherche de traces de sang. On n’a pas retrouvé son téléphone non plus donc tu vois avec son opérateur s’il a reçu un appel après 20 heures 15. Puis l’après-midi tu files à l’hôpital interroger les collègues de son service sur le bonhomme. Assure-toi de mettre des scellés sur son bureau, il faudra farfouiller un peu dans la pièce. Si tu as le temps, tu peux faire un examen rapide, vois avec la direction.
— Bien, Patron.
— Pour le reste, précise-t-il à l’attention de Françoise, n’allons pas trop vite. Mais revenons à la veuve et aux membres du conseil d’administration de l’association. Françoise, tu as eu les documents sur cette dernière ?