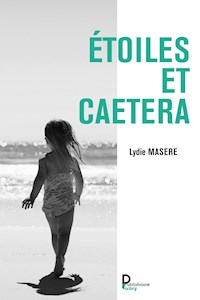
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Publishroom
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Des nouvelles sur la vie de tous les jours, sur des espoirs secrets, sur des drames familiaux ou encore sur la disparition d'un être cher...
Au début, c'était une enfant dans une toute petite nouvelle. Puis au fil des mots, elle a pris corps. Elle a rempli l'espace du livre. Des bouts de vie, séquences, arrêts sur l'image, elle donne d'elle ce qui lui chante. A chaque fois, elle est différente, mais à chaque fois, elle brille de la lumière des étoiles perdues dans l'intervalle d'une vie.
Savourez chacune de ces nouvelles, toutes différentes mais pourtant toutes liées par l'histoire d'une femme, à un moment particulier de sa vie. Ce recueil vous promet un moment d'évasion et de poésie.
EXTRAIT
Ma mère m’avait tuée un soir de mai, au moment du souper, entre le fromage et la pomme. Dès la première gifle, j’avais cherché à protéger mon visage de mes coudes puis devant l’avalanche de coups, je n’avais pas eu d’autre choix que de piquer du nez dans l’assiette et j’avais fait la morte. Elle avait débarrassé les restes du repas, glissé nos serviettes dans leur rond en plastique, passé une éponge sur le Formica de la table. L’eau avait coulé dans l’évier et les assiettes avaient glissé l’une contre l’autre. Elle cherchait la photo que je lui avais volée et je n’avais aucune intention de la lui rendre en dépit de la terreur qui enflait sous mes côtes. Ce soir-là, la chair brûlante, épuisée par mes suppliques, j’avais pris la décision de ne plus vivre en sa compagnie, d’être une fille morte, d’être le fantôme de sa fille. Elle ne voulait pas que je l’appelle Maman, elle ne voulait pas que je la regarde, elle ne voulait pas que je lui parle, elle ne voulait pas que je m’approche à moins d’un mètre d’elle. Être fantôme allait être facile.
A PROPOS DE L'AUTEUR
Je m'appelle
Lydie Masere. Je vis dans le Sud depuis toujours. Je ne connais que la terre ocre, les vignes et la mer. J'ai l'âme et le pied agricoles. Dans la vraie vie, je compte et recompte, ajoute et soustrais. Dans l'autre vie, j'écris... quand les mots veulent bien de moi.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 147
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Lydie MASERE
Étoiles, et cætera
nouvelles
Lapin roux renard agile
Ma mère m’avait tuée un soir de mai, au moment du souper, entre le fromage et la pomme. Dès la première gifle, j’avais cherché à protéger mon visage de mes coudes puis devant l’avalanche de coups, je n’avais pas eu d’autre choix que de piquer du nez dans l’assiette et j’avais fait la morte. Elle avait débarrassé les restes du repas, glissé nos serviettes dans leur rond en plastique, passé une éponge sur le Formica de la table. L’eau avait coulé dans l’évier et les assiettes avaient glissé l’une contre l’autre. Elle cherchait la photo que je lui avais volée et je n’avais aucune intention de la lui rendre en dépit de la terreur qui enflait sous mes côtes. Ce soir-là, la chair brûlante, épuisée par mes suppliques, j’avais pris la décision de ne plus vivre en sa compagnie, d’être une fille morte, d’être le fantôme de sa fille. Elle ne voulait pas que je l’appelle Maman, elle ne voulait pas que je la regarde, elle ne voulait pas que je lui parle, elle ne voulait pas que je m’approche à moins d’un mètre d’elle. Être fantôme allait être facile.
Ma mère était la reine de la raclée qui arrivait sans crier gare. La nuit, ma mère était une louve. J’avais peur de cette femelle qui la possédait, hurlait à la mort, mangeait les siens. Elle aimait l’odeur du sang et des larmes. Elle levait sa truffe en ma direction, toujours. Les nuits sans lune, elle partait en chasse, traversait l’appartement en silence jusqu’à ma chambre et là, au bord du lit, je prenais un aller simple pour l’enfer, mon rêve brisé, mordu jusqu’à l’os. Elle me secouait comme un chien secoue une pantoufle pour jouer. L’épaisse descente de lit amortissait ma chute. L’animal m’achevait à coups de morsures brèves dans l’obscurité la plus profonde, dans le silence assourdissant de notre nuit blanche. Prendre une trempe la journée m’était plus favorable. À la seconde même où son regard se mouillait de larmes et que son corps se crispait comme pris dans un orage sec, je m’agenouillais à ses pieds et sans prier, j’attendais la raclée promise. Les muscles bandés, les mâchoires serrées, la tête rentrée, le menton sur mon torse, je vidais mon cerveau comme le siphon d’un évier emporte l’eau sale de la vaisselle. Elle donnait une raclée comme on donne un cadeau, comme on donne une réponse, comme on donne une récompense. « Je vais t’en mettre une, une qui me fera du bien, une qui va te décoller la tête des épaules. »Je vivais sans respirer, suspendue à ses accès de rage, dans un monde cruel et aveugle, sourd et froid, c’était un monde où la chaleur de l’été ne réparait pas les blessures de l’hiver. C’était un monde inhospitalier, une planète désolée, grise, poussiéreuse, bouffie de volcans morts, trouée de cratères secs. Dehors, dedans, c’était un monde inhospitalier. Je n’avais pas de père, ni de frères, ni de sœurs, j’étais unique, à ses yeux j’étais un monstre, je n’avais qu’elle, pas de grands-parents, pas d’oncles ni de tantes.
Quand ma mère n’était pas une louve affamée, elle était une fleur sauvage, fascinante et carnivore, plantée dans ce milieu hostile, sans racines au bout de sa tige. Elle était une tache de couleur qui collait à ma rétine. Elle était mon centre de gravité, mon gouvernail, ma famille.
Ma mère avait eu une vie avant la mienne, une vie de belle plante, avant que ma vie ne lui eût volé la sienne. Une existence que je ne connaissais pas, un tabou verrouillé. Un jardin d’Eden où, sous un ciel d’un bleu dur et sans nuage, elle s’était épanouie, croissance magique.
Je cherchais à percer son mystère, à connaître l’enfant qu’elle avait dû être. Avait-elle reçu des coups, vécu dans un cagibi ? Avait-elle été mordue par un chien mieux nourri qu’elle ? Avait-elle été choyée, aimée, adorée ? Avait-on pris soin d’elle quand elle était malade ? Lui avait-on préparé de bons petits plats, de la mousse au chocolat, de la tarte au citron ? Avait-on changé ses chaussures quand elles devenaient trop petites ? Lui avait-on acheté ce beau manteau rouge qui lui faisait de l’œil dans la vitrine des Galeries Lafayette ? Ces questions restaient sans réponses, alors je l’imaginais comme la petite fille qui aurait été mon amie, ma meilleure amie, ma complice. Je lui faisais des confidences, je lui pardonnais ses colères et ses caprices. Je la prenais contre moi comme ma poupée préférée et je la berçais jusqu’à la tombée du jour. Je rêvais de nous unir et de nous souder comme les deux doigts de la main.
J’avais cherché pendant des heures, en silence, dans le noir. J’avais échappé à sa vigilance alors que ses démons la terrassaient. J’avais ouvert les tiroirs à la recherche de pistes, d’indices, j’étais en quête de lettres, de bouts de papier, un passeport, une carte d’identité et j’avais fini par mettre la main sur une photo. Il m’avait fallu quelques minutes pour la reconnaître sur le cliché, le temps de faire le point, de retrouver sur ce visage les traits de ma mère. Elle se tenait, la bouche entrouverte, une cigarette calée entre ses doigts fins. Vernis à ongles. Elle était enroulée dans un peignoir éponge et je devinais la naissance de ses seins au creux de l’encolure du vêtement. Elle était là, le ventre appuyé contre le garde-corps d’un balcon accroché à une maison inconnue, à fixer l’objectif noir d’un appareil photo. À qui souriaient ses yeux, à qui ? Le temps avait dissous les couleurs mais pas ses formes, douces, fluides. Son visage, sa beauté miraculeuse, irradiait de bonheur. Elle était comme la mouette qui nage dans l’air, vole, recule devant la masse d’air et puis se laisse emporter par le courant d’air chaud. Pointaient d’autres questions qui s’accrochaient aux précédentes. Que faire alors ? J’avais volé la photo. Je devais m’appuyer sur une réalité pour avancer vers la sortie et la réalité était que ma mère avait été une star de cinéma. La certitude était telle qu’elle tapait à mes tempes et mon cœur secoué ne répondait plus aux appels au calme. Il n’y avait pas de télé dans l’appartement, ni magazines, ni radio, pas de poissons rouges, rien de futile. Nous n’allions pas au cinéma, jamais de divertissements. D’un coup, tout s’éclairait à l’ombre d’une carrière brisée, destin fusillé par l’arrivée précoce d’une enfant non désirée. J’étais sa corvée, son poids lourd, sa gorge nouée, sa plaie, son enfer. Et nous étions condamnées à vivre l’une avec l’autre.
J’avais tenu quelques semaines à nier le vol et à résister aux coups puis j’avais capitulé et dressé le drapeau blanc. J’avais rendu la photo sans appréhension. Le pire était déjà arrivé. Le souvenir du passé avait regagné le tiroir, à l’oubli, loin des regards et des fantômes. Je ne me posais plus de questions, je ne parlais plus, je ne mangeais plus. J’étais bel et bien morte. J’allais à l’école avec soulagement. J’attendais les rentrées, les lundis. Ma mère m’autorisait la lecture de livres triés par ses soins, sans image, écrits serrés mais je les aimais, je les dévorais et ils me remplissaient. Durant ces moments d’intimité, je revenais à moi-même, je ressuscitais, je reprenais corps, volume et densité. Grâce aux livres, je volais hors des murs, hors de la prison, hors du temps, hors d’elle qui continuait à battre mon corps meurtri, tirer mes cheveux mous, pincer mes joues creuses mais je ne ressentais plus rien, je ne ressentais que la mort du petit oiseau terrassé par le gel un matin d’hiver. De lui, il ne restait que les traces superficielles de ses sautillements gravés dans la neige. Il n’y avait pas de demain, il n’y avait pas d’hier, il y avait la seconde à vivre, acide comme une groseille verte, qui sans cesse se renouvelait identique à la précédente. Maintenant que j’étais la fille morte de ma mère, je ne cherchais plus à comprendre sa colère mais je savais en être l’angle saillant. Je frôlais les murs, l’esprit ailleurs, fantôme sans drap. Je savais garder les larmes et les hurlements dans le fond de ma gorge. Je répétais en boucle dans ma tête « lapin roux renard agile » et je n’avais plus mal, je n’avais plus que les marques du mal, elles étaient nombreuses mais personne ne les voyait. Je n’étais plus que l’ombre de moi-même, un spectre bien réel, il ne me restait plus que la peau et les os. Parfois, je me demandais si elle avait tourné dans beaucoup de films, avec quels acteurs connus et dans quels pays ? Mon père était-il un homme célèbre ? Où était-il ? Que s’était-il passé ? J’en avais forcément un. Un avec des yeux bleus parce que c’était la couleur des miens et que ceux de ma mère étaient noirs, de plus en plus noirs avec l’accumulation des colères, un avec des cheveux blonds parce que j’étais blonde et que sa chevelure à elle était brune comme le fond d’un ruisseau. Ces questions me traversaient puis disparaissaient.
Je répète encore une fois à la femme que je m’appelle Madeleine et que je suis née un vingt-deux juillet. Je regarde le bout de mes souliers. Il est usé. Je fais craquer mes phalanges, main gauche puis main droite. Personne ne me répond quand je demande où se trouve ma mère et quand elle va venir me chercher. À travers les grilles, je vois le jour décliner. Je sens l’humidité recouvrir la ville, je sens l’oiseau ouvrir ses ailes et l’ombre se répandre partout. Un médecin m’examine, il palpe mon corps avec ses doigts froids. Je réunis toutes mes forces pour ne pas hurler. Il dit que je suis maigre et que j’ai besoin de soins. Une dame en blanc me dit que là où j’irais, je pourrais lire tous les livres que je souhaite. Je réponds à beaucoup de questions, on m’évalue, on me pèse, on me mesure, on me regarde sous toutes les coutures. On scrute le fond de mon âme. Je passe de mains en mains. Aucune des femmes n’est aussi belle que ma mère et aucun des hommes ne me conviendrait comme père.
À la suite de tous ces interrogatoires, consultations, expertises, j’ai séjourné plusieurs semaines à l’hôpital dans un service pédiatrique puis on m’a placée dans un centre fermé. C’est le sort qui est réservé aux enfants assassins avant d’être jugés.
Trois jours
Ce samedi matin, je vois un champ planté de mouettes. Droites comme des i, immobiles dans l’aurore bleutée, elles semblent suivre du regard la course rapide des nuages à peine levés. J’arrête la voiture sur le bas-côté et je les compte avant de poser ma tête sur le volant et de pleurer. Quand je relève les yeux, elles ne sont plus là, reparties vers le large. Je poursuis ma route. Dès le jour apparu, le ciel a été bleu, sans nuance, de ce bleu d’hiver quand le vent pousse à toute allure les nuages vers l’est. Le froid vient du nord, il prend en tenaille pendant que les tourbillons du vent dégagent le paysage jusqu’à l’horizon, ligne brisée en bout de plaine. Je claque des dents. Le sang ne circule plus dans mes veines depuis deux jours maintenant, les heures se succèdent, je ne sais plus dans quel ordre, des gens se sont penchés sur moi et je n’ai rien retenu de leurs paroles. Les visages se confondent, dilués dans l’eau des larmes, disparaissent lavés. Je me replie comme un escargot, tandis que de solide je deviens liquide, ruisselante, torrentielle, en crue. Le temps lui aussi s’est arrêté. Brutalement à cinq heures du matin, vendredi. Mes mains glacées sur le volant, je cherche mon chemin. Je suis perdue alors que je connais ce coin comme ma poche. C’est mon pays natal, les flancs doux des collines qui se font forêts au fur et à mesure que les versants se font abrupts, les arbres aux feuilles grises qui jamais ne tombent, les mottes de terre ocres qui cicatrisent sur le bord des chemins, les villages, les écoles et les églises, les roches noires, les roches blanches, les cyprès comme les langues vertes de dragons enterrés, les nuits d’été chargées d’étoiles et la rumeur des hommes qui monte de la plaine, c’est mon pays natal, je n’en connais pas d’autres. J’essaie de trouver un repère dans les gravats du séisme qui me secoue, sans cesse, peine perdue, comme dans un film catastrophe, je vois, emporté par une coulée de boue sous une pluie diluvienne, ce qu’il me reste de vivant. Une feuille morte se colle au pare-brise. J’arrête la voiture sur la place du village sous des platanes gris et nus, je suis arrivée. Quand j’entre dans le hall du magasin, je suis saisie par une odeur douce, inconnue et artificielle qui remplit aussitôt ma bouche. Un homme s’approche, il me parle à voix basse, ses yeux dans mes larmes, il a la tête de l’emploi, le costume sombre comme son métier l’exige, lui faire confiance, tout à coup, me soulage. Le moment vient de choisir, à mots délicats, il me guide, il parle d’argent avec beaucoup de retenue, il comprend, le moment vient de choisir la boîte dans laquelle on enfermera ton corps et ton cœur. Un couvercle se posera sur nos vies mêlées, les sentiments qui nous lient, nos disputes, notre amour et tu disparaîtras de la surface de la terre.
Seuls mes souvenirs te ranimeront, ta voix survivra au fond de mon âme et seule ma mort la tuera. L’homme me parle de bois, de veines de bois, comme si c’est du vivant, bois ordinaire ou précieux. Nous voilà dans la pièce des cercueils, arrière-boutique borgne, alignés contre le mur comme des dominos géants, il me dit de toucher, passer ma main sur la surface vernie et de sentir. Sentir quoi ? De nouveau, le torrent de débris que mon corps emprisonne vient taper en surface, et plus rien n’a de sens. Je renonce, je lui dis de faire au mieux avec un capitonnage de couleur crème, des poignées de couleur bronze, pas de croix, pour le bois je vous fais confiance. Il me dit qu’il va se rendre à la morgue, chercher le corps, faire les formalités.
Je quitte le funérarium, je laisse l’homme à son planning, cet homme dont les mains vont être les dernières à toucher le corps de mon père, ce privilège. Je regagne la voiture et je prends la route des plages. L’hiver, c’est l’abandon. Planches déclouées, bouts de bois rejetés par les coups de vent d’est, algues sèches éparpillées, déchets, mais je m’aventure. C’est là que je vais retrouver ta trace, face à la mer, assise au bout du ponton là où tu me rejoins après la baignade. Ce jour-là précisément, tu es satisfait, je sais nager. Un souci de moins. Dans la soirée, tu me débarrasseras du sel sous la douche avec un vieux gant rappé, et tu frotteras fort le dos et le cou, j’adore d’avance ce moment où tu me sècheras avec une serviette encore plus râpeuse que le gant et où tu me coifferas avec le peigne aux dents brisées. La raie qui partagera mes cheveux fera des zigzags comme à chaque fois. On rigole bien tous les deux. Je plonge en apnée et remonte à la surface, grimpe sur le ponton. La mer scintille entre les lattes de bois. Mille reflets de lumière et d’eau, étoiles de plein jour. Tu glisses tes mains sous les cuisses et tes jambes balancent à la surface de la houle. Ton maillot de bain est bleu marine à rayures rouges, je n’ai aucun souvenir du mien. Je marche à ta suite sur la plage, et je place mes pieds dans l’empreinte des tiens, je sautille, petit piaf.
Mon corps est transi de froid. L’eau est haute en cette saison et mes pieds sont trempés par les vagues qui s’écrasent contre les poteaux de bois. Je m’allonge sur le ponton et mon regard se perd dans le ciel. Quitter le monde. Les mouettes traversent le ciel comme des flèches, plongent dans la mer remuante, parfois voguent à la crête des vagues, secouées par une rafale de vent plus forte que les autres. Aucune ne ramène un poisson, mais elles crient et rient sur leur planète. Les larmes coulent dans mes oreilles. L’intensité de la douleur me rend muette, stupéfaite et muette. Plonger dans le grand bain. Hurler sous l’eau, faire fuir les poissons au fond des abysses, les suivre et ne plus remonter.
Jeudi, il neigeait, une neige granuleuse et fine, exceptionnelle, pendant que la vie filait de son corps. La traversée de la forêt pour le rejoindre avait duré une éternité. La neige sous les roues de la voiture crissait. Les arbres aux cernes noirs se découpaient dans un paysage immobile, déserté des animaux. J’avais donné la main à ma mère, la première fois depuis l’enfance, et nous avions longé les grilles de l’hôpital, le cœur battant la même chamade. Quand nous avions franchi le portail d’entrée, elle s’était écroulée de tout son poids dans la cour du bâtiment et je n’étais pas parvenue à la retenir. Les nuages étaient bas, l’air s’était adouci, il neigeait encore un peu. Ses genoux étaient écorchés comme j’écorchais les miens à l’école et que mon père les soignait à l’heure du goûter. Au deuxième étage, le médecin nous attendait. Le cri jeté par ma mère avait recouvert l’univers entier et mon désespoir. Quand j’étais trop triste, mon père tressait une couronne de fleurs pour mes cheveux et il me consolait. J’étais la petite princesse, la princesse des prés et je renaissais.





























