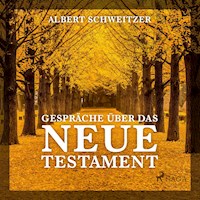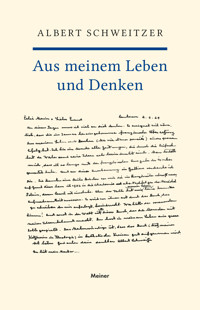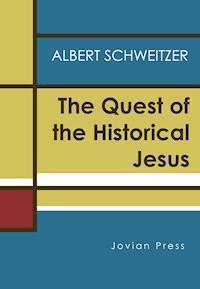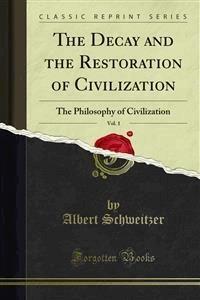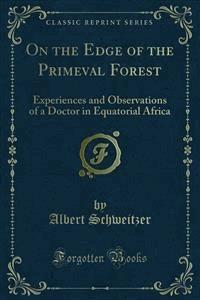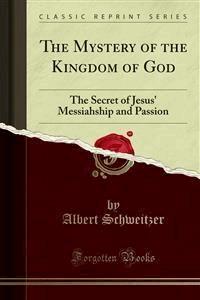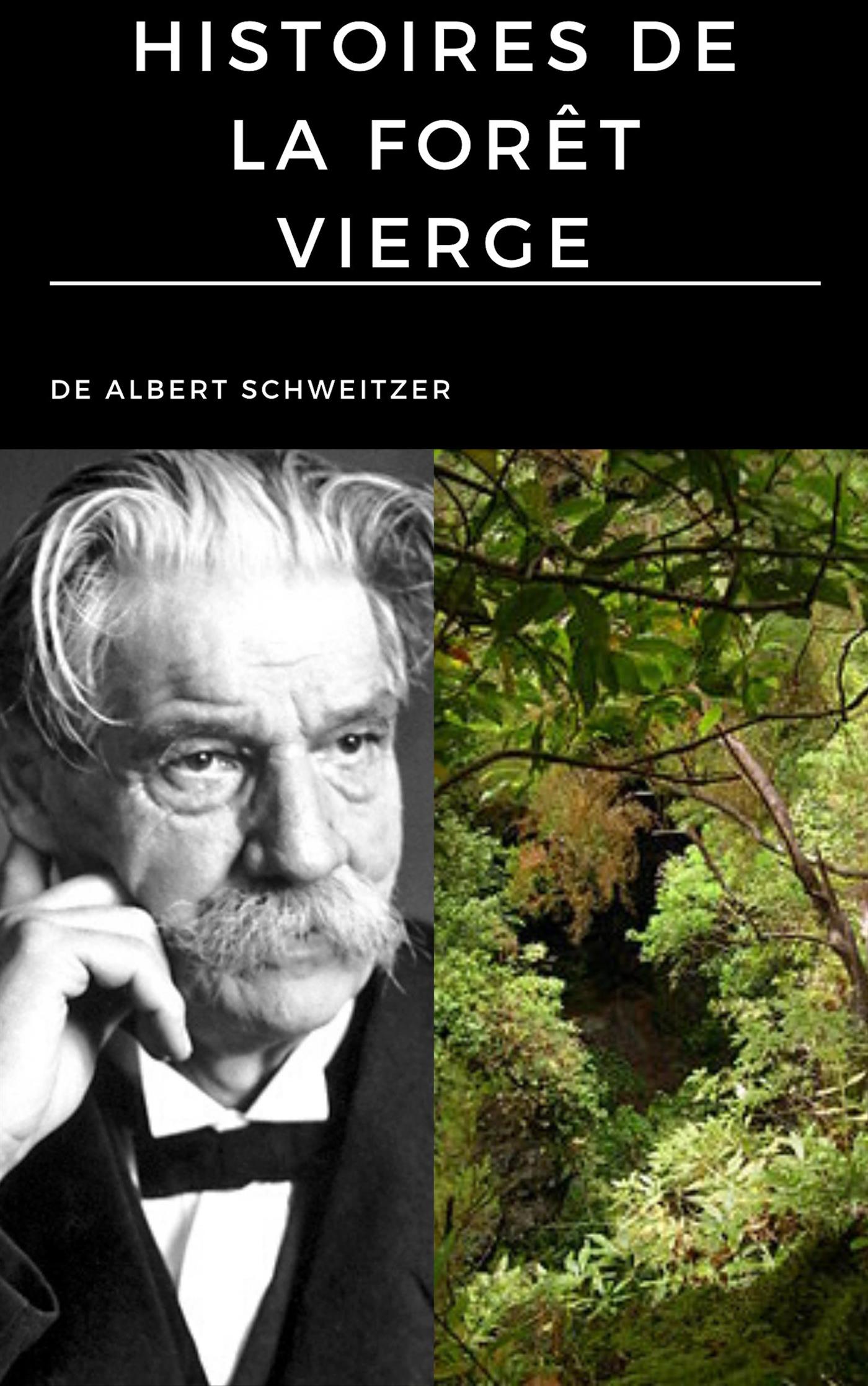
1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Leaf
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Französisch
« Sur la demande de quelques amis, j’ai rédigé les histoires qui suivent les évènements et les impressions de mon premier séjour à Lambaréné, en y ajoutant quelques pages sur la vie à l’hôpital dans la forêt vierge. » Albert Schweitzer, Lambaréné, 1938
« En 1913 j’ai fondé à Lambaréné un hôpital pour apporter aux indigènes de cette région un secours médical. Lambaréné est situé au Gabon (Afrique Équatoriale Française) sur l’Ogooué qui se jette, à environ 280 kilomètres d’ici, dans l’Océan Atlantique. »
Extrait de: Albert Schweitzer.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Albert Schweitzer
HISTOIRES DE LA FORÊT VIERGE
1952
AVANT-PROPOS
En 1913 j’ai fondé à Lambaréné un hôpital pour apporter aux indigènes de cette région un secours médical. Lambaréné est situé au Gabon (Afrique Équatoriale Française) sur l’Ogooué qui se jette, à environ 280 kilomètres d’ici, dans l’Océan Atlantique.
L’hôpital se trouve sur un bras de l’Ogooué, au milieu de la forêt vierge qui recouvre la plus grande partie du Gabon. Elle contient beaucoup de bois d’okoumé qui constitue le principal article d’exportation de la colonie. Réunies en grands radeaux, les billes d’okoumé sont amenées sur le fleuve jusqu’à la baie de Port Gentil, où elles sont embarquées pour l’Europe.
Mon hôpital est une œuvre philanthropique. Les malades y sont soignés gratuitement. Au cours de ses 25 années d’existence, il s’est fait connaître très loin. J’ai continuellement dû ajouter de nouvelles constructions à celles qui existaient déjà. À présent, je suis en état d’hospitaliser 300 malades noirs et 20 malades blancs.
Nous sommes 4 médecins et 10 infirmières européennes, et nous suffisons à peine à la tâche. Cinq infirmières sont affectées au service médical, les cinq autres sont chargées des travaux du ménage, du jardin et de la plantation.
Dans mon livre « À l’orée de la forêt vierge » (Paris, Rieder) j’ai rapporté les événements et les impressions de mon premier séjour ici.
Sur la demande de quelques amis, j’ai rédigé les histoires qui suivent, en y ajoutant quelques pages sur la vie à l’hôpital dans la forêt vierge.
Lambaréné.
ALBERT SCHWEITZER.
ISUR LES TRACES DE TRADER HORN
La maison dans laquelle j’écris ces récits se dresse sur une petite colline au bord de l’Ogooué en amont de Lambaréné, appelée Adolinanongo, ce qui signifie : « Celui qui regarde par delà les tribus. » Elle mérite bien ce nom. D’ici le regard embrasse le fleuve, qui à cet endroit se divise en deux bras, et les îles vertes qu’il entoure de ses eaux. Au delà des villages qui bordent ses rives, s’étend la chaîne de montagnes bleues, que longe, en venant du Sud, son grand affluent, la N’Gounié. Sur cette large colline était situé le grand village du roi des galoas qui s’appelait N’Kombé, ce qui veut dire le soleil. En bas, sur la rive, se trouvait la factorerie de la maison anglaise Hatton et Cookson, qui jouissait alors de la protection de ce roi-soleil.
Tel était Adolinanongo vers 1874, quand la maison Hatton et Cookson envoya comme aide à Mr. Gibson, chef de la factorerie, un jeune homme de Liverpool qui avait travaillé auparavant quelque temps dans la factorerie principale de Libreville.
Retiré à la fin de ses jours à Johannesburg, cet ancien agent de la factorerie d’Adolinanongo, sur les conseils et avec l’aide de Mrs. Ethelreda Lewis, écrivain sud-africain, devait nous donner ses souvenirs de cette époque sous le pseudonyme d’Alfred Aloysius Horn. John Galsworthy, enthousiasmé par ce récit si vivant et par l’attrait des réflexions philosophiques qui l’accompagnaient, écrivit la préface du livre, qui devint bientôt célèbre(1).
Dans sa jeunesse, Trader Horn habitait donc à l’endroit même où s’élève aujourd’hui mon hôpital. C’est d’Adolinanongo qu’il partait pour ses expéditions. C’est ici qu’il se querellait avec son chef, Mr. Gibson, auquel il reprochait son manque d’initiative, et c’est encore ici qu’il rencontra Savorgnan de Brazza au début des années quatre-vingts. Celui-ci le persuada de tenter la création de factoreries dans les territoires en amont, qu’il traversait lui-même dans sa marche vers le Congo.
Dans sa carrière coloniale, Trader Horn a connu diverses contrées de l’Afrique. Il a également séjourné dans d’autres continents. Mais plus tard, le souvenir des années passées parmi les primitifs dans la forêt encore vierge du Gabon effaça celui des époques postérieures. D’autres Africains aussi ont subi le charme particulier du Gabon.
Trader Horn, pour lui laisser son pseudonyme, a vécu ici de 1874 environ jusque vers 1884. Cela ressort des événements et des personnes dont il fait mention.
La région de l’Ogooué fut visitée dans ces temps-là par Alfred Marche et par de Brazza. Marche séjourna ici au cours de deux expéditions (1872 à 1874 et 1875 à 1877) ; de Brazza vint plusieurs fois à Lambaréné entre 1875 et 1887. C’est d’ici qu’il partit à la recherche d’une voie praticable pour accéder au Congo par l’Ogooué.
Des missionnaires protestants d’une société américaine travaillèrent sur les rives de l’Ogooué à partir de 1874. La mission catholique de Lambaréné fut fondée en 1881.
Les notes publiées par Marche, de Brazza et quelques-uns des missionnaires américains, ainsi que les souvenirs de cette époque, qu’on retrouve présents à la mémoire de quelques vieux indigènes, permettent de contrôler l’exactitude des récits de Trader Horn.
Tandis que son chef, Mr. Gibson, a laissé dans le pays un souvenir encore vivant, quelques anciens seulement se rappellent son subordonné de jadis. Le peu qu’ils sachent encore de lui, c’est qu’il était très jeune, qu’il voulait faire des affaires suivant une conception qui lui était personnelle et que cela amenait continuellement des palabres avec Mr. Gibson, qu’il était très vif de tempérament et qu’il faisait largement honneur au rhum et à toutes les bonnes eaux-de-vie.
Dans plusieurs passages de son récit, Trader Horn laisse deviner qu’il a mêlé des fictions à ses souvenirs. C’est ainsi qu’il a inventé le conte de la prêtresse Lola, qui, fille d’européen, vivait dans un sanctuaire indigène, fut enlevée par Trader Horn et épousa un de ses camarades de classe de Liverpool, un richissime péruvien qui, informé par Trader Horn de sa beauté, était venu en Afrique.
Il n’y eut jamais dans ce pays une institution analogue à celle des Vestales. On sent vraiment le malin plaisir que prit le brave vieux à mystifier ses lecteurs crédules par ce récit mélodramatique. L’ensemble de son livre s’en trouve défiguré.
Quand il s’agit de ses rencontres avec les animaux sauvages, Trader Horn semble aussi donner parfois libre cours à sa fantaisie. Des détails qu’il donne sur leurs habitudes et leurs genres de vie ne correspondent pas toujours à la réalité.
Les léopards, les éléphants, les hippopotames, les buffles, les crocodiles, les pythons, les chimpanzés et les gorilles se rencontrent aujourd’hui en aussi grand nombre qu’à cette époque-là. Au fond, ils mènent une existence plus tranquille qu’autrefois, parce que les indigènes les chassent moins. La population a diminué et les noirs n’ont plus autant de loisirs que jadis. Il leur manque aussi l’expérience de leurs ancêtres.
L’opinion, souvent reproduite dans les journaux, que les jours des éléphants et des gorilles sont comptés, ne vaut en tout cas pas pour notre région. Au Gabon, les éléphants sont tellement nombreux que les indigènes ne savent pas comment protéger leurs plantations contre ces géants amateurs de bananes. De même les gorilles abondent dans nos forêts.
Les descriptions du pays et des habitants faites par Trader Horn sont exactes, sauf quelques détails sans importance. Qu’il ait conservé après tant d’années un souvenir si net de la géographie de la contrée, des noms des localités et des personnes, est la preuve d’une mémoire vraiment remarquable.
Il relate ses faits et gestes de traitant d’une manière très objective. Un examen de ses entreprises, quand on connaît le pays et le milieu, révèle qu’il fut non seulement plein d’initiative, mais aussi éminemment capable. Quand par exemple, au retour d’un voyage d’exploration dans le pays de la haute N’Gounié, il essaya de convaincre son chef qu’il fallait transporter les marchandises de cette région vers la mer non par la voie si tentante de l’Ogooué, mais par la route de terre plus directe, il exprima une opinion dont le bien-fondé a toujours été reconnu à nouveau.
Sa clairvoyance se montre aussi dans le fait que dès le moment où, grâce à l’intervention de de Brazza, la domination des blancs sur le pays commença à devenir effective, il songea à libérer le commerce de la dépendance dans laquelle il se trouvait vis-à-vis des chefs indigènes. Il réclama la liberté de navigation sur le fleuve et voulut fonder plus à l’intérieur des factoreries dirigées par des blancs, pour pouvoir acheter les produits directement aux indigènes sans dépendre des traitants noirs qui jusqu’alors pourvoyaient les maisons de commerce de Lambaréné et en tiraient un bénéfice exagéré.
Il réalisa ce plan sur l’île d’Osangué – Trader Horn écrit Isangué – située à 150 kilomètres en amont de Lambaréné en face de l’endroit où s’élève aujourd’hui N’Djolé, et il ne se laissa pas troubler par le conflit avec un chef indigène, conflit dans lequel il fut entraîné à la suite de cette création.
Il semble avoir entrepris cette affaire à ses propres risques. En tout cas, il acheta l’île en son propre nom, et non à celui de sa maison. Une pareille indépendance des agents n’était pas chose rare dans le trafic colonial de jadis. Trader Horn resta néanmoins au service de sa maison. Par elle il se procurait les objets de troc ; il lui vendait les produits obtenus en échange.
Le libre trafic entraînait un danger, auquel Trader Horn, il est vrai, ne fit pas encore attention. Aussi longtemps que les marchandises passaient de tribu en tribu et qu’il n’y avait pas de trafic direct, les indigènes étaient assez bien protégés contre la propagation des maladies. Mais du moment où des porteurs recrutés dans des contrées lointaines pénétrèrent en compagnie des blancs de la côte vers l’intérieur du pays, l’apparition de maladies auparavant inconnues dans la région de l’Ogooué ne fut plus qu’une question de temps. En 1876, donc à l’époque de Trader Horn, la petite vérole fit son apparition dans le Haut-Ogooué comme nous l’apprenons par les récits de Marche. En 1886, après le départ de Trader Horn, une épidémie de petite vérole sur le cours inférieur enleva, d’après ce que les vieillards m’ont raconté, presque la moitié de la population. Plus tard des porteurs, recrutés parmi les tribus qui habitaient sur la côte en direction du Congo, importèrent la maladie du sommeil. Celle-ci malheureusement, ne pouvait pas être combattue par la vaccination de la population, comme la petite vérole.
Trader Horn n’est pas retourné au poste si intéressant de Lambaréné. Les difficultés qui s’étaient élevées entre Mr. Gibson et son agent si entreprenant et si volontaire en étaient probablement la cause.
***
Le Pionnier, un des vapeurs de la maison Hatton et Cookson, avec lequel Trader Horn fit maints voyages sur le fleuve et sur la mer entre Cap Lopez et Libreville, avait appartenu à l’origine, comme il le dit lui-même, à Livingstone. Celui-ci avait reçu ce navire à aubes, de dimensions assez respectables, en 1861, du gouvernement anglais pour ses voyages sur le Zambèze. Mais à cause de son tirant d’eau de plus d’un mètre et demi, il ne put être utilisé sur ce fleuve, et après avoir changé de propriétaire plusieurs fois, et avoir été ramené entre temps à Liverpool, il fut acheté par la maison Hatton et Cookson et envoyé sur l’Ogooué, où il resta en service pendant de longues années. Ce fut sur le Pionnier que le premier missionnaire américain, le docteur Nassau, remonta les fleuves en 1874.
Ainsi un bateau appelé le Pionnier se trouve être le trait d’union entre deux pionniers aussi différents que l’étaient Livingstone et Trader Horn. Quel dut être le chagrin de Livingstone quand il fut obligé de se rendre à l’évidence que le vapeur tant désiré n’était d’aucune utilité pour lui. Je n’ai jamais compris que connaissant les inconvénients du Zambèze et de ses bancs de sable, il n’ait pas insisté davantage pour obtenir un bateau d’un tirant d’eau mieux approprié.
***
À cette époque, le commerce du Gabon était partagé entre les deux firmes mondiales Hatton et Cookson de Liverpool et Karl Woermann de Hambourg. Les autres avaient moins d’importance. Les deux maisons vivaient en bonne intelligence, ce qui n’était pas difficile, si l’on considère que les affaires y étaient aisées. Avant l’arrivée de Trader Horn, la factorerie allemande était aussi établie à Adolinanongo, dans le voisinage de l’anglaise. Plus tard, elle fut transférée sur l’île d’en face, dite la Grande, située entre les deux bras du fleuve. Trader Horn, qui s’était lié avec le chef de l’établissement Woermann, M. Schiff, homme d’un certain âge déjà, s’efforça de maintenir les bonnes relations entre les deux maisons.
Lambaréné était alors le poste le plus avancé pour les deux entreprises. Les principaux articles recherchés à cette époque étaient l’ivoire, le caoutchouc, l’ébène et le padouck (bois de corail).
Le caoutchouc donnait les plus gros bénéfices. C’était aussi le produit le plus demandé. À cette époque, les plantations d’hévéas n’existant pas encore, le caoutchouc était obtenu en saignant les lianes de la forêt vierge. Cette récolte comportait un travail pénible. Pendant des semaines, les indigènes qui s’y adonnaient devaient vivre dans la forêt et ses marécages, souffrir de la faim (parce que, loin de leurs plantations, ils ne pouvaient se procurer des vivres que difficilement) et supporter les tortures que leur infligeaient les insectes de toute espèce. Ils étalaient le suc extrait de la liane sur leur peau pour le faire coaguler. Pour augmenter autant que possible le rendement, ils coupaient les lianes et les saignaient à blanc au lieu de les inciser seulement pour faire écouler le suc, méthode moins productive mais qui eût conservé la plante. C’était une vraie déprédation. Avec le temps, il fallait pénétrer toujours plus en avant dans la forêt pour trouver les précieuses lianes. Et comme la demande de caoutchouc allait en croissant, une pression fut exercée sur la population de l’Afrique équatoriale pour l’amener à en fournir des quantités suffisantes. Ainsi le caoutchouc devint le malheur des indigènes jusqu’au moment où peu à peu les immenses plantations créées dans les Indes Néerlandaises et ailleurs commencèrent à produire.
Lorsque, en 1913 j’arrivai dans le pays, le caoutchouc ne jouait déjà plus le rôle prépondérant qu’il occupait auparavant. De nos jours, le caoutchouc de cueillette est à peine demandé et exporté ; le caoutchouc de plantation l’a complètement remplacé. La jeune génération d’indigènes ne connaît plus que par ouï-dire la misère dans laquelle il avait plongé les noirs il y a quelques dizaines d’années. Les lianes qui ont repoussé entre temps dans la forêt n’ont plus à craindre la serpette.
Quant à l’ivoire, il fallait déjà à cette époque aller le chercher loin à l’intérieur, les réserves des régions maritimes étant épuisées.
Le magnifique bois de padouck, de couleur rouge-vif, qu’on appelle ici Oïngo, est assez commun dans le pays de l’Ogooué ainsi que l’ébène. C’est à grand-peine qu’on transporte les bûches de l’un et l’autre à travers la forêt jusqu’aux pirogues sur lesquelles elles sont chargées. Le padouck n’était alors pas seulement estimé comme bois d’ébénisterie ; on en extrayait aussi un colorant rouge très recherché.
Ici, nous essayons de réduire dans la mesure du possible l’emploi du padouck, qui est payé si cher en Europe, parce qu’il est difficile à travailler. S’il y a beaucoup de padouck dans les charpentes de plusieurs constructions de mon hôpital, la raison en est non dans mon attachement pour des essences précieuses, mais dans l’impossibilité d’avoir pu me procurer d’autres bois durs. Mon ami Mr. Airth, directeur d’une scierie au lac Gomé, auquel j’avais commandé des chevrons en bois dur, me priait avec force excuses de me contenter de padouck, parce que pour le moment il n’avait pas d’autre bois disponible. Il me fit aussi une réduction de prix pour ce bois précieux par rapport au bois dur ordinaire. De mon côté, je dus donner beaucoup de bonnes paroles et une gratification à mon charpentier noir Monenzali pour le dédommager de la peine d’enfoncer des clous et de percer des trous dans ce bois vraiment trop dur et détesté par lui.
L’huile et les noix de palme ne jouaient alors aucun rôle dans le commerce de ce pays. Par contre, à l’embouchure du Niger et dans la baie de Libreville les navires chargeaient déjà de l’huile de palme. Vers la fin du siècle seulement, on commença à établir des plantations de café et de cacao dans la région de l’Ogooué. Le bois d’okoumé, qui constitue aujourd’hui la principale exportation du Gabon (on en charge environ 300.000 tonnes par an) fut coupé seulement à partir de 1905 environ. À l’époque de Trader Horn, on ne fit aucune attention à ce bois demi-dur, dans lequel les indigènes taillaient leurs pirogues. On s’intéressait uniquement au bois précieux.
***
Les administrateurs coloniaux dans ces temps-là ne faisaient que passer dans la région de l’Ogooué. Le pays dépendait de la base navale établie à Libreville. Quand les plaintes au sujet des pillages de bateaux et de factoreries exigeaient l’intervention des autorités, les officiers de marine ne pouvaient guère faire plus qu’envoyer de temps en temps quelques petites canonnières remonter le fleuve, pour bombarder les villages en question. Encore ce moyen n’était applicable que par eaux assez hautes, c’est-à-dire seulement pendant quelques mois de l’année. Pendant la saison sèche, les indigènes n’avaient rien à craindre de ces sanctions.
Un vieillard, qui est en ce moment à mon hôpital, me raconte avoir assisté comme enfant au bombardement de son village par une canonnière.
Au fond, les négociants européens ne pouvaient compter que sur eux-mêmes, ce qui ressort aussi des relations de Trader Horn. Ils avaient à payer des redevances régulières aux chefs indigènes. Dans les guerres perpétuelles entre les tribus, ils devaient essayer de garder la neutralité ou de prendre le parti du vainqueur présumé.
Les missionnaires américains de leur côté nous confirment combien les blancs étaient alors sous la dépendance des chefs indigènes et combien l’insécurité était grande. Avant d’entreprendre une tournée d’évangélisation, ils devaient demander l’autorisation aux chefs dont ils désiraient traverser le territoire, et leur payer ce qu’ils exigeaient. Ils érigèrent leur première station près de Lambaréné sur une colline escarpée pour mieux se garantir d’un pillage par les indigènes. On voit encore aujourd’hui dans la forêt au-dessus de la station actuelle les piliers en béton de cette construction.
Table des matières
AVANT-PROPOS
I SUR LES TRACES DE TRADER HORN
II RÉCITS DE L’ANCIEN TEMPS
III CE QUI DIFFÈRE CHEZ LES UNS ET CHEZ LES AUTRES
IV TABOUS ET SORCELLERIE
V L’HÔPITAL DE LA FORÊT VIERGE
VI DE CHOSES ET D’AUTRES
VII OJEMBO, MAÎTRE D’ÉCOLE DANS LA FORÊT VIERGE
VIII REMARQUES SUR LE CARACTÈRE DES INDIGÈNES
IX BOYS GABONAIS EN EUROPE
À propos de cette édition électronique
Guide
Couverture