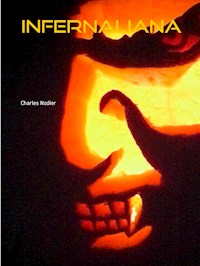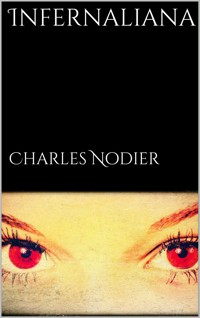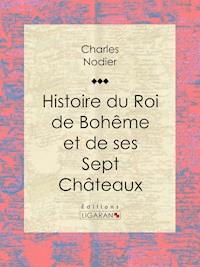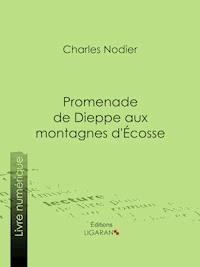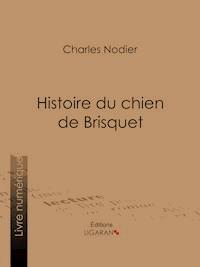Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Extrait : "La vie intime de la province a un charme dont on ne conçoit aucune idée à Paris, et qui se fait surtout sentir dans les premières années de la vie. On peut aimer le séjour de Paris dans l'âge de l'activité, des passions, du besoin des émotions et des succès ; mais c'est en province qu'il faut être enfant, qu'il faut être adolescent, qu'il faut goûter les sentiments d'une âme qui commence à se révéler et se connaître."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN :
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de grands classiques de la littérature ainsi que des livres rares, dans les domaines suivants :
• Fiction : roman, poésie, théâtre, jeunesse, policier, libertin.
• Non fiction : histoire, essais, biographies, pratiques.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 76
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EAN : 9782335097276
©Ligaran 2015
La vie intime de la province a un charme dont on ne conçoit aucune idée à Paris, et qui se fait surtout sentir dans les premières années de la vie. On peut aimer le séjour de Paris dans l’âge de l’activité, des passions, du besoin des émotions et des succès ; mais c’est en province qu’il faut être enfant, qu’il faut être adolescent, qu’il faut goûter les sentiments d’une âme qui commence à se révéler et à se connaître. Ce n’est pas à Paris qu’on éprouvera jamais ces émotions incompréhensibles que réveillent au fond du cœur le son d’une certaine cloche, l’aspect d’un arbre, d’un buisson, le jeu d’un rayon du soleil sur la ferblanterie d’un petit toit solitaire. Ces doux mystères du souvenir n’appartiennent qu’au village. J’entendais l’autre jour une femme de beaucoup d’esprit se plaindre amèrement de n’avoir point de patrie : « Hélas ! ajouta-t-elle en soupirant, je suis née sur la paroisse Saint-Roch. »
Dieu me garde de faire un reproche à Paris de cette légère imperfection. C’est moins un vice qu’un malheur. La grande métropole de la civilisation a d’ailleurs pour se consoler tout ce qu’il est possible d’imaginer de séductions et d’amusements : l’Opéra, le bal Musard, la Bourse, l’association des gens de lettres, l’homéopathie, la phrénologie et le gouvernement représentatif. Je pense seulement que le lot de la province vaut mieux, mais je le pense avec mon esprit de tolérance accoutumé. Il ne faut pas disputer des goûts.
La réminiscence même de ces jeunes et tendres impressions qui ne se remplacent jamais, conserve encore une partie de sa puissance, même quand on s’est éloigné par infortune ou par choix des lieux où on les a reçues, et cela se remarque aisément dans les écrivains qui ont un style et une couleur. La prose de Rousseau se ressent de la majesté des Alpes et de la fraîcheur de leurs vallées. On devinerait que Bernardin de Saint-Pierre a vu le jour sur des rives toutes fleuries, et qu’il a été bercé au bruit des brises de l’Océan. Sous le langage magnifique de Chateaubriand, il y a souvent quelque chose de calme et de champêtre, comme le murmure de son lac et le doux frémissement de ses ombrages. J’ai quelquefois pensé que Virgile ne serait peut-être pas Virgile, s’il n’était né dans un hameau.
À la province elle seule, à la petite ville, aux champs, ces charmantes impressions qui deviennent un jour la gracieuse consolation des ennuis de la vieillesse, et ces pures amours qui ont toute l’innocence des premières amours de l’homme dans son paradis natal, et ces chaudes amitiés qui valent presque l’amour ! Avec un cœur sensible et une imagination mobile, on rêve tous ces biens à Paris. On ne les y goûte jamais. Le Dieu qui parlait à Adam a beau vous crier : « Où es-tu ? » il n’y a plus de voix dans le cœur de l’homme qui lui réponde.
En province, tous les berceaux se touchent, comme des nids placés sur les mêmes rameaux, comme des fleurs écloses sur la même tige, quand, au premier rayon du soleil, tous les gazouillements, tous les parfums se confondent. On naît sous les mêmes regards, on se développe sous les mêmes soins, on grandit ensemble, on se voit tous les jours, à tous les moments ; on s’aime, on se le dit, et il n’y a point de raison pour qu’on finisse de s’aimer et de se le dire. La différence même des sexes qui nous impose ici une réserve prudente et nécessaire, mais sévère et sérieuse, n’exclut que bien tard ces intimités ingénues, ces délicieuses sympathies qui n’ont pas encore changé d’objet. Ce sont les passions qui marquent cette différence, et l’enfant n’en a point. L’abandon familier des premiers rapports de la vie se prolonge sans danger jusques au-delà de cet âge où le moindre abandon devient dangereux, où la moindre familiarité devient suspecte entre les jeunes filles et les jeunes garçons des grandes villes. Les affections les plus ardentes continuent à se ressentir de la tendresse du frère et de la sœur, et celle-ci est mêlée de trop d’égards et de pudeur pour que les mœurs aient rien à en redouter. Bien plus, l’adolescent qui commence à deviner le secret de ses sens exerce encore une espèce de tutelle sur cette faible enfant qu’il aime, et que la nature et l’amour semblent confier à sa garde. Plus il apprend dans la funeste science des passions, plus il se rend attentif à protéger la douce et timide créature dans laquelle il met son bonheur ou ses espérances. Il ne se contente pas de la défendre contre des inspirations étrangères ; il la défend contre lui-même dans l’intérêt d’un avenir qui leur sera commun. Il la respecte, il la craint.
Et combien de voluptés impossibles à décrire cet amour délicat d’une âme qui vient de se connaître, ne laisse-t-il pas à désirer à l’âge qui le suit ? Oh ! le premier signe de la préférence de cet ange de la pensée, le premier regard expressif que la petite amie adresse à son ami entre les deux battants d’une porte qui se ferme, la première articulation de sa voix pénétrante, qui s’est émue, qui s’est attendrie en passant entre ses lèvres, la première impression d’une main livrée à la main qui l’a saisie, la tiède moiteur de son toucher, le frais parfum de son haleine !… et bien moins que cela ! une fleur tombée de ses cheveux, une épingle tombée de son corset, le bruit, le seul bruit de la robe dont elle vous effleure en courant, c’est cela qui est l’amour, c’est cela qui est le bonheur ! Je sais le reste, ou à peu près ; mais c’est cela que je voudrais recommencer, si on recommençait.
On ne recommence plus ; mais se souvenir, c’est presque recommencer.
On goûte à Paris les doux loisirs de l’enfance ; on y connaît la valeur de ses jeux ; on y jouit de ces délicieuses soirées de rien faire qui suivent les jours laborieux de l’étude ; mais ce n’est qu’en province qu’une heureuse habitude prolonge ces innocents plaisirs, sous l’œil attentif des mères, jusque dans l’ardente saison de l’adolescence. On est homme déjà par la pensée, qu’on est encore enfant par les goûts ; on commence à éprouver d’étranges et turbulentes émotions, qu’on subit toujours, à certaines heures d’oubli, des sentiments pleins de grâce et de naïveté. On se demande quelquefois ce qu’il y a de vrai entre le passé que l’on quitte et l’avenir que l’on commence ; mais on devine, en y plongeant un regard inquiet, que l’avenir ne vaudra pas le passé. Il se trouve même des esprits simples et tendres qui seraient volontiers tentés de ne pas aller plus loin, et qui sacrifieraient sans hésiter les voluptés incertaines du lendemain aux pures jouissances de la veille. À dix-huit ans, j’aurais fait ce marché bizarre avec l’ange familier qui préside aux changeantes destinées de l’homme, s’il s’était communiqué à mes prières ; et nous y aurions gagné tous les deux, car j’imagine que mon émancipation insensée pourrait bien lui avoir donné quelque chagrin.
Le 24 janvier 1802, je n’en étais pas encore là. J’aimais ces belles jeunes filles parmi lesquelles je passais les heures les plus douces de la journée, de toute la force d’un cœur accoutumé à les aimer, mais sans fièvre, sans inquiétude et presque sans préférence. Je me trouvais bien parmi elles ; je me trouvais mieux tout seul, parce que mon imagination commençait à se former, dans la solitude, un type qui ne ressemblait à aucune femme, et auquel une seule femme devait complètement ressembler, quoique j’aie cru le retrouver cent fois. C’était mon rêve chéri, et, dans le vague immense où il m’était apparu, il me donnait une idée plus distincte du bonheur que toutes les réalités de la vie. Cependant je ne faisais que l’entrevoir à travers mille formes douteuses ; mais je le cherchais toujours, et le délicieux fantôme ne manquait jamais à mes rêveries. Tantôt il venait me tirer de ma mélancolie en frappant mon oreille de rires malins, et en balançant sur mon front les noirs anneaux de sa chevelure ; tantôt il s’appuyait sur le pied de ma couche d’écolier, en me regardant d’un œil triste, et en cachant sous une touffe de cheveux blonds une larme prête à couler ; et mon cœur gonflé s’élançait vers lui avec des battements à me rompre la poitrine ; car je savais que toute ma félicité consistait dans la possession de cette image insaisissable qui me refusait jusqu’à son nom.
Le 24 janvier 1802, nous étions donc réunis, comme à l’ordinaire, avant l’heure du souper, car on soupait encore, et nous causions en tumulte autour de nos mères, qui causaient plus gravement de matières non moins frivoles : notre conversation roulait sur le choix d’un jeu, question fort indifférente au fond, l’intérêt d’un jeu reposant tout entier dans la pénitence ; et qui ne sait que la pénitence est l’accomplissement du devoir qui rachète un gage