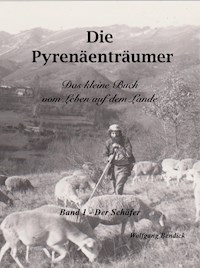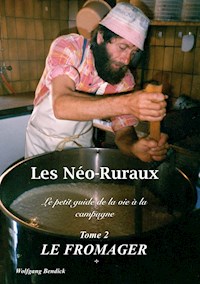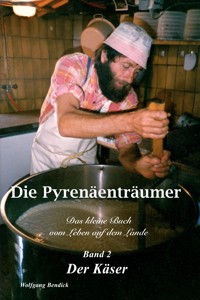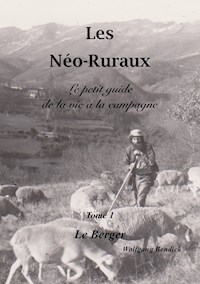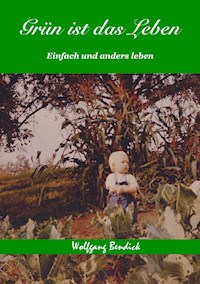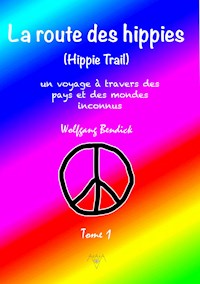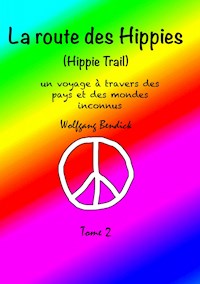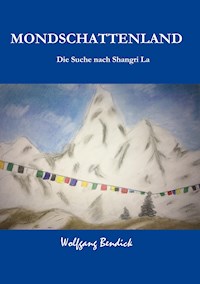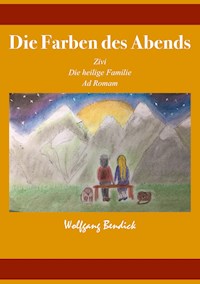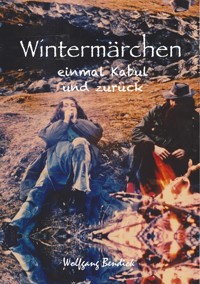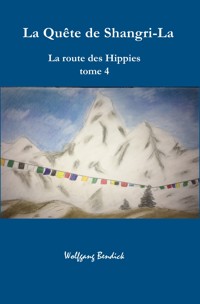
3,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Sur terre et sur mer
- Sprache: Deutsch
Nous voulons aller vers l'est, une sorte de pèlerinage. Après avoir essayé de faire du stop, nous avons acheté un vieux combi VW. En fait, c'est un moyen idéal de voyager. Mais en cas de panne, ça devient plus que compliqué ! Car sans véhicule, il est impossible de quitter le pays. Et soudain, nous nous retrouvons même avec deux véhicules en panne sur les bras ! Trois fois le col de Khyber, et nous nous retrouvons enfin sur la route avec pour seul bagage notre sac à dos. Amritsar, Delhi et d'autres lieux nous rapprochent de l'Himalaya. Là, nous montons notre petite tente à côté d'un monastère lama et parcourons les vallées. Célébration de la pleine lune avec beaucoup de musique et du thé au beurre. Lorsque nous arrivons à Bénarès, on célèbre Divali, la fête de la lumière, on se baigne dans le Gange et on repart doucement. Mais le voyage se change en course !
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 304
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Wolfgang Bendick
La quête de Shangri-La
La route des Hippies, tome 4
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
La quête de Shangri-La
Impressum
Shangri-La
Seul
A deux
Kara Deniz
Mont Ararat
La Perse
Afghanistan
La panne
Kaboul
No man's Land
Pakistan
Le Lac Nectar
Delhi
Pokhara
Pleine Lune
Katmandou
Divali
Mère Ganga
Retour
Post scriptum
Autres œuvres de l'auteur
Impressum neobooks
La quête de Shangri-La
Des voyageurs ont rapporté que quelque part dans l’Himalaya, se trouvait une vallée où les gens vivaient en paix avec eux-mêmes et avec la nature. Les maladies n’existaient pas et les gens vivaient très longtemps.
Mais il n'y avait pas de témoins directs, car ceux qui l’avaient trouvée préféraient apparemment abandonner leurs voyages et y rester …
La Quête de Shangri-La
La Route des Hippies
Tome 4
Wolfgang Bendick
Impressum
Texte : © Copyright by Wolfgang BendickCouverture : © Copyright by Lucia BendickEditeur : Wolfgang Bendick
Las Piassères09800 Augirein (France)[email protected]
wolfgangbendick.com
Première édition en hiver 2017
Deuxième édition (poche), septembre 2019
Version française, automne 2024
Merci à Magali, Perrine et Gérard pour leur relecture
Illustration de couverture : Léa Fernandez
Site internet : wolfgangbendick.com
Shangri-La
Un désir ardent conduit mes pas,
Je veux aller à la contrée de la paix,
Où règnent la joie et le bonheur,
L’endroit du moment éternel,
Où l'amour a vaincu la haine,
Et tout devenir aura trouvé son terme,
Demeurer dans le sens le plus profond,
C'est là où mon désir conduit mes pas…
à Doris, mon âme sœur
qui m'a aidé à trouver l'unité
Seul
Au-dessus de nous paissent des vaches brunes sur une pente en gradins qui s’est formée au cours du temps à cause des animaux qui y marchent. Les bêtes avancent lentement dans la même direction, en jetant parfois la tête en arrière sans doute pour chasser des mouches gênantes. Cela fait résonner bruyamment les cloches accrochées à leur cou. Sinon, le tintement des cloches est plutôt harmonieux, suivant le rythme de leurs museaux broutants. Une odeur sucrée de fumier et d'après-midi d'été emplit comme une brume paisible la vaste vallée.
Un garçon, probablement juste dans l'âge des premières grandes vacances, est assis sur l'escalier en bois de la cabane d’alpage et regarde un papillon onduler dans les airs. Frodon, notre chien, est un peu en avance sur nous. Le grelot de son collier tintinnabule doucement et ramène le garçon à la réalité. Il aperçoit le chien et frappe légèrement ses mains sur ses cuisses vêtuesd'un pantalon en cuir luisant. Frodon, curieux, s'approche et renifle les pieds du garçon. « Qu'est-ce que tu es beau ! », dit-il doucement, « Comment t'appelles-tu ? » « Frodon ! Frodon Baggins ! » répondons-nous à la place du chien. Il le caresse. Frodon semble aimer ça. « Et comment tu t'appelles, toi ? », lui demandons-nous. « Elmar ! », répond-il. « Un beau nom. Il signifie ‘pomme’ en turc ! Tu habites ici ? » « Seulement pendant l'été, quand les vaches sont sur l'alpage. Sinon j'habite à Lingenau, plus bas dans la vallée ! »
Nous continuons à marcher pendant un bon moment et nous nous arrêtons à une cabane d’alpage pour boire un ‘Radler’, un panaché. Autour de nous les pâturages alternent avec les zones boisées, le tintement des cloches emplit la haute vallée. Quelques randonneurs apprécient comme nous la beauté des montagnes de l'Allgäu, comme on appelle cette région du sud de la Bavière.
Nous sommes en visite d'adieu. Bientôt, nous partirons vers l'est, le plus loin possible par voie terrestre, puis par bateau vers l'Australie. Peut-être pour toujours, car dans ce monde avec des guerres partout nous cherchons un endroit pour vivre en paix et heureux. Cette pensée nous rend un peu tristes. « Je crois qu’un si long trajet par voie terrestre, ce n'est pas bon pour un si petit chien ! », réfléchit Doris. « Je le pense aussi. Peut-être que nous pourrionsle placer dansun endroit où il seraitbien ! » « Il a bien plu au petit garçon. Peut-être qu'il l’aimera ? » L'idée de nous séparer de notre compagnon à quatre pattes nous laisse le cœur encore plus lourd. Nous sommes ensemble depuis deux ans et nous avons vécu beaucoup de choses. « On verra cela en rentrant ! », nous mettons-nous d’accord.
Sur le chemin du retour, les paysans font rentrer leurs vaches pour la traite. Le garçon est avec eux et les aide habilement avec son bâton afin que tout le troupeau reste groupé, car à plusieurs reprises, l'une des vaches trouve une friandise quelque part et quitte le troupeau. Dès que le garçon nous voit, il vient vers nous en courant. Frodon court lui aussi à sa rencontre, comme s'il savait que celui-ci serait son nouveau maître. « Il te plaît ? », demande Doris. « Un jour j'aimerais avoir un chien comme lui ! », nous répond-il. « Nous voulons partir pour un long voyage, et Frodon est un peu trop petit pour cela. Si tu le veux et si tes parents n'ont rien contre, nous te le donnons ! » Il nous regarde joyeusement, se retourne et court vers sa mère. Avec Frodon juste derrière. Puis il revient vers nous avec sa maman. Nous nous saluons et lui expliquons la situation. « Il a son carnet de vaccination, est propre dans la maison et ne mange plus de pantoufles. Il vient juste de rentrer d’un pèlerinage à Rome ! », lui expliquons-nous. « Si tu promets de bien prendre soin de lui, tu peux l’avoir ! », dit-elle au petit. Le garçon, heureux, serre son chien dans ses bras, puis part avec lui en courant. Ainsi, la séparation nous est plus facile.
Plus tard, quand nous avons l'alpage derrière nous, nous réalisons que nous sommes tous les deux en larmes. Nous nous asseyons sous un sapin, nous nous prenons dans les bras, tête contre tête et pleurons comme des chiens. Nous n'aurions jamais pensé que dire au revoir pouvait être si dur !
Les jours suivants nous rendons visite à toutes nos connaissances qui se trouvent sur notre route. Bientôt nous nous retrouvons à Geretsried, où nous nous sommes déjà arrêtés avec l'âne il y a trois mois, quand nous avons traversé l’Allemagne à pied. Erna, la petite fille de nos amis, sait déjà marcher et nous donne beaucoup d'occasions de rire. Elle commence tout juste à découvrir le langage et invente des mots que parfois seuls ses parents comprennent, et encore... Ceci nous donne un aperçu de ce que l'on appelle le bonheur familial.
C'est peut-être ce qui a poussé Doris à ne plus vouloir voyager. Elle souhaite prendre une période de réflexion pour pouvoir se réorienter et découvrir ce qu'elle veut vraiment. Elle souffre de ne pas avoir de profession et se sent trop dépendante de moi.
Nous convenons donc de nous séparer pendant un moment. Elle a l'intention de vivre quelques temps avec nos amis. Pour ma part, je suis tellement attiré par l'Est et son aura mystique que je veux partir le plus tôt possible. Nous laissons nos mobylettes, avec lesquelles nous nous déplaçons depuis un moment chez nos amis. Je veux voyager en auto-stop, car le souvenir de mon voyage catastrophique en solo avec le side-car quelques années auparavant (décrit dans ‘La Route des Hippies 1’) est encore trop présent dans ma mémoire. Nos adieux sont encore plus douloureux que la séparation avec Frodon. Se reverra-t-on un jour ? En larmes nous jurons de rester en contact. Je ne prends que le strict minimum dans mon sac à dos, libre comme saint François de ne posséder aucune chemise à changer, et je me dirigevers la route la plus proche.
Pour moi, il est décidé que ce voyage doit être un pèlerinage vers les lieux saints de l'Orient, après en avoir visité quelques-uns en Occident. J'ai également décidé d'abandonner l'alcool et le haschisch lors de ce voyage pour découvrir tous les pays avec les idées claires. Depuis que j'ai quitté l'Inde lors de mon premier voyage, je suis sûr que j'y reviendrai. J'aurais tant aimé faire le voyage avec mon âme sœur. Maintenant, de nouveau seul, je pense que moi aussi je dois me réorienter, et rien n'est mieux pour cela qu'un changement total des lieux. Et comme premier but de mon pèlerinage, j'ai choisi Jérusalem.
Des travailleurs migrants yougoslaves qui rentrent chez eux m'emmènent au début, puis ce sont des ouvriers turcs. L'itinéraire m’est familier mais n'a rien perdu de son attrait. En tant que passager, j’ai davantage l’opportunité de contempler le paysage qu'en tant que conducteur de mon ‘mammouth de malheur’ (mon side-car) de l'époque. A peine trois jours plus tard je me retrouve à Istanbul. Je ne veux pas rester longtemps, mais je visite quand même la Mosquée Bleue et quelques autres monuments. Me voilà de nouveau l'un des ‘voyageurs d'Orient’ (voir Hermann Hesse : ‘Le voyage en Orient’). Je rencontre un peu partout des personnes partageant les mêmes idées, et je me réjouis de la résurrection de cette ancienne ‘alliance’ spirituelle. Je flâne à travers le bazar, je m'assois sur les quais du Bosphore, je rends visite à Tarzan, qui gère toujours son petit restaurant. Celui-ci me reconnaît tout de suite et nous tombons dans les bras l'un de l'autre. Après avoir vécu quelques jours insouciants à Istanbul, je prends l'un des derniers bacs restants et j'arrive en Asie Mineure. La route passe maintenant par le nouveau pont suspendu, long de plus d'un kilomètre, qui traverse le Bosphore à une altitude vertigineuse, et ce depuis quelques mois. Même les géants des océans ressemblent à des jouets lorsqu'ils passent dessous.
Du côté asiatique de la Turquie, l'auto-stop devient difficile. La plupart du temps, seuls les autobus s'arrêtent et veulent bien me prendre - bien sûr, contre paiement. Il est difficile de s'en débarrasser ! Quelques camions européens en transit me couvrent de poussière, les conducteurs ne semblent même pas me voir, derrière leurs lunettes de soleil à verres miroir. Ce qu'on m'avait dit est donc vrai: il est d'usage de payer quelque chose pour faire de l’auto-stop, sinon on peut avoir des ennuis.
Je suis arrivé à Ankara. Là, un camion de charbon vide s'arrête. Le chauffeur veut me faire monter dans la benne bosselée. Après lui avoir fait comprendre que je peux conduire un camion, il me fait signe de rentrer dans la cabine, puis repart en trombe. Il m'explique par des gestes - une autre communication aurait été impossible à cause du bruit du moteur et d'autres cliquetis, même si j'avais parlé turc – le fonctionnement de son véhicule et se dirige bientôt vers le bord de la route. Là, nous changeons de place et je peux montrer ce dont je suis capable. Lui, il s'endort sans tarder.
C’est ainsi que j'arrive à Konya, la ville des derviches. Dans le silence d'une des nombreuses mosquées, je me repose et lis ma traduction du Coran. Cependant, je n'avance pas beaucoup, car bientôt un Turc qui parle l'allemand m'aborde et nous parlons de la révélation d'Allah.
Plus tard, il m'emmène dans une sorte de monastère où des derviches vêtus de jupes et d'un haut bonnet de feutre tournent comme en transe au son d'un chant et d'une musique presque hypnotiques. Il me semble sentir dans l'air un léger parfum de haschisch. De plus en plus vite, de moins en moins volontairement, comme dirigés par un automatisme intérieur, un bras légèrement incliné vers le haut, l'autre tendu sur le côté, ils ‘pirouettent’. Plus ils tournent vite, plus la tête s’incline en arrière, leurs regards ravis ou les yeux fermés. ‘Derviche’ signifie mendiant. Ils appartiennent au mouvement soufi qui a émergé au treizième siècle en réaction à l'Islam riche et établi. Ils vivent dans une pauvreté volontaire et dans des communautés quasi monastiques. Ils essaient d'entrer en extase en tournant rapidement sur eux-mêmes afin qu'Allah puisse entrer en eux.
J'essaie aussi. Cependant, je me sens vite étourdi et dois m'asseoir à terre en chancelant. Je n'ai pas ressenti grand-chose. Pourtant, je peux facilement imaginer que si je réussissais à continuer à tourner malgré mon vertige, cela me procurerait vraiment un ‘high’. Car j'ai brièvement ressenti la sensation d’avoir fumé du haschisch avant de tomber à terre. Je devrais arriver à continuer de tourner... Mais pour le moment je n'ai plus trop envie de le faire, j'ai plutôt le mal de mer. De grands penseurs et poètes sont sortis de cette école, le soufisme, tels que Ibn Al-Roumi, Omar Khayyâm ou mon poète préféré Khalil Gibran.
Le lendemain, une voiture avec des occupants parlant allemand m'emmène. Ils s'étonnent que je ne fume pas de cigarettes. Par contre, je ne refuse pas le thé brûlant qu'ils m'offrent à chaque arrêt. Il est servi dans de petits verres ressemblant à un sablier ouvert sur le dessus, dont le bord élargi vers le haut est tenu du bout des doigts pour ne pas se brûler. Vous le sirotez par petites gorgées pour le refroidir un peu, ou vous videz un peu du liquide brûlant dans la petite soucoupe pour le faire refroidir lorsque vous êtes pressé. Mais c'est rare. Pour un çay - comme on appelle le thé dans tout l’orient - un turc prend toujours le temps !
Quelque part en haut dans la montagne, sur un col, je leur demande de s'arrêter. J'ai envie de calme et de solitude. Ils ne comprennent pas cela et veulent m'inviter à dîner dans la prochaine ville. Ils parlent de loups ici dans les montagnes, et de brigands. Ça me fait rire. « Il n'y a personne d'autre que moi ici ! », leur dis-je. Néanmoins je descends dans une petite vallée latérale pour éviter d'être vu de la route et, sur une légère élévation, j'installe ma tente minuscule. Longtemps après que le soleil se soit couché dans toute sa splendeur, je reste assis devant le ciel en feu et regarde les innombrables chaînes de montagnes qui s'alignent les unes derrière les autres. Un silence total règne autour de moi, un silence presque parfait aussi dans mes pensées, agréablement perturbé par l'image de mon âme sœur. Comme je voudrais l'avoir à mes côtés maintenant et contempler avec elle ce ciel étoilé infini ! Plus je le regarde, plus il devient profond. J'ai l'impression d'être au milieu de l’univers ! Peut-être qu'en ce moment elle lève aussi les yeux et que son esprit me cherche ? J'en suis sûr !
Tard dans la nuit, je me réveille. La tente a bougé. Il y a un bruit dans l'air. Un hurlement lointain se fait entendre, de plus en plus fort, qui s'approche rapidement. Je sors la tête. Nuit noire, plus aucune étoile dans le ciel. La tente se gonfle soudain, et de la poussière me rentre dans les yeux. J'arrive tout juste à refermer la fermeture éclair, et alors ça me tombe dessus. Tout d'abord, juste une tempête. La tente faseye et se plie jusqu'au sol. Je m'allonge du côté du vent pour l'alourdir. De violentes rafales venant de toutes les directions alternent avec des moments de calme. Quelques sardines ont sans doute été arrachées. Je retiens la toile gonflée avec mes mains. Ensuite, quelques premières gouttes tambourinent sur la tente. Elles sonnent plutôt comme de la grêle.
Et puis ça commence vraiment ! Comme jetée àgrands seaux, l'eau tombe et pénètre jusqu'à l'intérieur de la tente sous forme de brume. Des éclairs embrasent l'obscurité à l'extérieur et dans ma tente. J'arrive à regarder dehors à la lueur de la lampe de poche. La pluie forme un mur d'argent, derrière lequel il n'y a plus rien à distinguer. La foudre et le tonnerre coïncident, sonnent comme des explosions. Autour de la petite élévation sur laquelle se trouve la tente, l'eau coule en ruisseaux, dans tous les creux une bouillie brune tourbillonne vers le bas. Quelque part au-delà du mur d'argent, ces ruisseaux s'unissent pour former des rivières et puis des fleuves se précipitant vers la vallée. Je referme l'ouverture, mes cheveux dégoulinent. Je ne peux pas partir d'ici. Espérons que l'eau ne gonfle pas au point d'entraîner la tente ou de creuser ma petite colline !
Par précaution, je retire les piquets de tente et les pose à plat pour que leurs pointes n'attirent pas la foudre. Maintenant, la bâche humide repose entièrement sur moi. Je m'allonge sur le côté pour qu'elle ne touche pas mon visage. Ace moment, je suis content d'être seul ! Avoir juste la responsabilité de moi-même ! Et puis je la transfère à mon destin. Car dans une situation pareille on se sent le jouet de forces plus puissantes. Malgré cela, je ramasse en tâtonnant toutes mes affaires dans la tente et les mets dans mon sac à dos. J’enfile mes chaussures. Je suis prêt à abandonner la tente et à courir. Mais où ? Je préfère alors attendre encore un peu plus... Et puis, tout à coup, tout est fini. Silence. Seule l'eau gargouille autour de moi. Je regarde dehors, comme Noé de son arche : les premières étoiles s'aventurent à travers les derniers fragments de nuages, ça sent la terre. Une légère bande rose apparaît au loin. Puis je m'endors.
Je me réveille en sueur. Le soleil est dans le ciel, mes vêtements et la tente sont fumants. Ma petite île a été bien rongée par l'eau dela nuit, mais elle est debout. Quelle chance d'avoir monté la tente sur une surélévation ! Il n'y a plus d'eau qui s'écoule. Il ne reste que des flaques brunes et troubles dans les creux. La poussière est liée ou emportée sous forme de boue. Et partout, des pousses vertes tendres sortent du sol ! Je remonte ma tente pour la sécher et je mange un petit déjeuner de ma réserve. Puis, retour vers la route. Des bancs de gravier reposent par bandes sur le revêtement de goudron. Le premier véhicule s'arrête et m'emmène. À midi, je suis au bord de la mer.
Des rochers déchiquetés sortent de l'eau, formant de petites criques, bordées de plages de galets, cliquetant légèrement sous les caresses des vagues. Là-bas quelques palmiers. Et cette eau ! Plus bleue que le ciel ! Je cache mon sac à dos avec tout mon bric-à-brac derrière des rochers, jette mes vêtements et cours dans la mer immaculée. Un saut et je plonge et j’avance au-dessus du fond, sur lequel les vagues font scintiller la lumière. C'est presque la mer du sud ! Puis j'étale mes affaires pour les faire sécher au soleil. Je ramasse du bois flotté échoué et, entre quelques rochers, je prépare mon camp de nuit.
Le lendemain, je continue le long de la mer. Je traverse des petits villages, principalement des bourgades de pêcheurs, à proximité desquelles s'étendent d'énormes chantiers de construction. Les travailleurs immigrés turcs revenus au pays construisent-ils icides logements pour leurs grandes familles ? Ou s'agit-il de bâtiments hôteliers pour les touristes allemands ? Plus à l’est, quelques grandes villes avec port. Les installations industrielles tout autour alternent avec de vastes étendues de cultures intensives, de serres et d'orangeraies.
Un semi-remorque hollandais s’arrête et m'emmène, même si je n'ai pas du tout sorti le pouce ! Il a chargé des œufs, pour le Koweït, 32 tonnes. Le conducteur lui-même ne sait pas combien il y en a. Pour nous amuser, nous faisons le calcul : disons qu'un œuf pèse 50 grammes. Vingt œufs donnent donc un kilo. Ensuite, si on enlève quelque chose pour les boîtes en carton, cela fait plus d'un demi-million d'œufs ! Combien de jours faut-il à deux personnes pour les casser ? Au Koweït, raconte le chauffeur, il y a des usines à biscuits, où ces œufs sont transformés en pâtisseries avec de la farine, elle aussi acheminée de loin. Puis à nouveau, pour la plupart au moins, ces biscuits vont retourner en Hollande ! Nous traversons Iskenderun. Le chauffeur ne sait pas si j'ai besoin d'un visa pour la Syrie. Si c'est le cas, il pense que je pourrai aussi l'obtenir à la frontière.
Le soir, nous y arrivons. Malheureusement, un visa est nécessaire pour moi, et le chauffeur continue seul peu de temps après. J'espère que son système de refroidissement ne tombera pas en panne… Sinon, il arrivera au Koweït avec des poussins ! Une fois déjà, la clim avait lâché, m'a-t-il dit. Après cela, sur ordre du transporteur il a jeté tous les œufs dans le désert et a fait demi-tour pour récupérer une autre remorque pleine de nouveaux œufs…
Le douanier à la barrière mobile pense que le fonctionnaire de Damas devrait venir demain avec le timbre du visa. Au plus tard après-demain. Alors je déroule mon sac de couchage non loin de la petite gare frontalière sur le terrain rocheux. Des crevasses s'ouvrent partout dans le sol rocailleux. Il faut faire attention à ne pas y mettre le pied ou même tomber dans les grandes. Comment se sont-elles créées ? Par la pluie ? Pour moi cela semble être la seule explication, bien que la dernière pluie remonte certainement à des années.
Heureusement, il y a un magasin près des douanes et un petit restaurant. Je passe donc les trois jours qui suivent à proximité. Les quelques voyageurs qui passent me disent qu'on peut voyager vers Israël via Alep. Seul l'inverse est difficile, car aucun pays ne veut laisser entrer un voyageur avec un cachet israélien dans son passeport. Il faut soit avoir un deuxième passeport, soit se faire mettre le timbre d'entrée et de sortie d'Israël sur un papier à part. Parfois, ça marche...
700 kilomètres me séparent encore de Jérusalem. Pas grand-chose, en fait, en considérant la route qui se trouve derrière moi. Le soleil tape fort pendant la journée. Chaque véhicule apporte avec lui un nuage de poussière, qui se pose sur tout comme de la farine. Tout ici est poussière. La Bible dit que l'homme a été créé de poussière. Et pas très loin d'ici. Un peu plus vers l'est en Mésopotamie, le pays aux deux fleuves. Et c'est là que le paradis perdu se serait trouvé...
Au moins deux fois par jour, je viens au poste frontalier et discute avec les douaniers. Aujourd'hui, le fonctionnaire avec le tampon pour les visas devrait vraiment venir. En fait, il aurait déjà dû être ici hier… Il n'y a pas que moi qui l’attends. Aussi le nombre de camions dont les chauffeurs ont besoin d'un visa grandit tous les jours. Je suggère aux douaniers de me laisser passer comme ça. De me donner juste le tampon d’entrée. Pourquoi aurais-je besoin d'un visa ? Je n'ai jamais été contrôlé dans aucun pays ! En plus, depuis le temps que je suis là, je suis devenu aussi brun que les autochtones qui vivent ici. Seulement je n'ai pas encore acquis leur patience. A un moment donné je commence à en avoir assez d'attendre. Tant pis pour la Terre Sainte. La terre est sainte ailleurs aussi ! Je me place de l'autre côté de la route et je repars en sens inverse.
Lentement, je me déplace vers le nord. Car dans ce sens il n'y a que du trafic à courte distance. Derrière Gaziantep, un camion avec une benne énorme me prend. Le chauffeur me laisse descendre au bord d'un chantier gigantesque. Ici, l'Euphrate va être endigué, pour la production d'électricité et l'irrigation des champs sur des centaines de kilomètres à la ronde. D'énormes machines sont à l’œuvre. Toutes neuves, pas du tout comparables avec les tas de ferraille avec lesquels les champs sont labourés ailleurs. Ici, une nouvelle époque semble avoir commencé, on fait plus confiance à la technologie avec ses machines gigantesques qu'à la puissance des armées de travailleurs. Au fond, en bas, à peine visible, l'Euphrate a creusé son lit depuis les temps pré-bibliques. Maintenant, sa course est arrêtée par un barrage provisoire et son lit est déplacé. Non loin du chantier, une cimenterie a même été construite. Des grues s'élèvent dans le ciel, des câbles enjambent la vallée pour faire descendre les matériaux et le béton. Mes yeux scrutent le chantier et j'essaye de me faire une image du futur barrage et du lac qui va être ainsi créé. Restera-t-il encore de l'eau pour les pays en aval une fois que la moitié de l'Anatolie sera approvisionnée en électricité et en eau pour l'irrigation ?
Je continue à pied et laisse tout ce progrès derrière moi. Les vallées se rétrécissent, la route se détériore. Le trafic est clairsemé. Des troupeaux courent sur les cailloux des flancs rocheux à la recherche de quelques tiges vertes, parfois une caravane suit le cours de la route, pour ensuite bifurquer quelque part dans une vallée encore plus accidentée.
Des gorges profondes s'ouvrent, leur fond étroit est entièrement rempli par une petite rivière et la route. Il reste peu de place pour les minuscules champs. Les maisons sont construites sur les pentes. Lentement, le cours d'eau se rétrécit, la piste serpente de plus en plus haut en virages serrés jusqu'à ce qu'elle atteigne un col. Mon regard erre un instant sur des chaînes rocheuses stériles qui s'alignent l'une derrière l'autre jusqu'à l'horizon. Des moutons ou des chèvres s'enfuient paniqués lorsque - tel un monstre rouillé - un camion apparaît. Les bergers agitent les mains ou demandent une cigarette lorsqu’un véhicule s'arrête. Et rares sont ceux qui ne s'arrêtent pas. Car il faut faire un petit check-up avant de descendre, mettre de l'eau dans le radiateur, resserrer les cordes qui retiennent la charge, taper avec un caillou contre les pneus pour vérifier leur pression... Puis le chemin replonge dans une autre vallée.
Là où il y a de la place, des villages poussiéreux et misérables bordent la route. Quand un véhicule s'arrête, je dois d’abord négocier le prix du transport. Mais ce sont des montants dérisoires. Presque symboliques... Et cela me permet de continuer à pied au cas où une panne majeure se produirait. Souvent, j'aide les conducteurs à réparer un pneu ou à visser la mécanique huileuse.
Là où il y a plus d'espace, le terrain est cultivé. Les champs verts ou déjà récoltés s'étendent alors en forme de triangle entre le flanc de la montagne et la route, le bord supérieur bordé d'un canal d'irrigation. Lorsque la vallée s'ouvre très largement, elle ressemble alors à une oasis. Des fruits et des légumes en excès sont offerts à côté de la route ou attendent un transporteur pour venir les chercher.
Les verres de thé et les prières des chauffeurs rythment ma routine quotidienne. Quand je suis assis sur mon sac à dos en attendant, je suis souvent observé par des enfants qui gardent des moutons ou des chèvres. Ils sont très timides et s'approchent rarement. C'est plus agréable que près des villes, où les enfants sont rapidement intrusifs et peuvent te causer des ennuis si tu restes trop longtemps.
Les heures passent, parfois une demi-journée, avant que quelqu'un s'arrête. Marcher ne sert à rien. Les distances sont tout simplement trop grandes. Et près d'une agglomération, on trouve toujours à boire et à manger. Parfois, je suis quand-même proche du désespoir. Mais cela ne sert à rien non plus. Faire de l’auto-stop est du Zen pur. Abandonner tout espoir, toute pensée, positive et négative. Vivre le moment présent. C’est maintenant que je vis… Pas seulement quand je suis en voiture. Et puis, à un moment donné, une voiture s'arrête et c'est reparti. C'est la loi de l'auto-stop : plus tu attends, plus tôt quelqu'un s'arrêtera !
Et il en va de même cette fois-ci : un antique camion branlant avec de hautes parois latérales en bois, presque comme une bétaillère mise au rebut approche dans un nuage de poussière. Il s'arrête, quelqu'un saute à terre, attrape mon sac à dos, le jette en haut et m'aide à monter. Alors que je grimpe par-dessus la ridelle, je vois sur le plateau une vingtaine de personnes, des hommes, des femmes et des enfants. Les vieilles femmes et les jeunes enfants sont assis sur les bagages, empilés dans la partie avant. Tous sont habillés de couleurs vives, contrairement aux turcs, chez lesquels le gris et le marron prédominent dans les couleurs des vêtements. Leur peau est plus foncée que celle des autochtones, ce doit-êtredes gitans. Ça risque d'être drôle, pensai-je, surtout prendre bien soin de mon sac à dos ! Les hommes et les garçons sont assis d'un côté, les femmes et les filles de l'autre. Les hommes me scrutent et me posent des questions. Bien sûr, je ne comprends rien. Pas plus qu’eux ne comprennent l'allemand ou l'anglais. La meilleure façon de communiquer est toujours de sourire lorsque les mots font défaut…
Bientôt, quelqu'un sort un instrument à cordes et commence à jouer. Les autres se mettent à chanter. Quand ils font une pause, je prends mon harmonica et joue quelques chansons allemandes. Maintenant, tout le monde veut voir mon harmonica et souffler dedans. Cela donne beaucoup de faux sons et de beaux rires. J'ai du mal à récupérer mon instrument dégoulinant. Puis, ils recommencent à faire de la musique. Le camion saute et dégringole en montant la piste. Quelques gars commencent à danser. Le camion rebondit sur les nids-de-poule ou, en zigzaguant, évite les rochers tombés des falaises. A cause de ces manœuvres, les danseurs trébuchent, tombent sur le plancher ou sur ceux qui sont assis. Cela ne fait qu'augmenter l'hilarité générale.
Quelqu'un me fait comprendre par des signes que je devrais danser aussi. Je fais semblant de ne rien comprendre et je reste assis. Deux gars saisissent alors mes mains et me tirent vers le haut. Maintenant je suis obligé de danser pour ne pas perdre mon équilibre. Les gens hurlent de joie, tapent des mains au rythme de la musique. M'a-t-on poussé exprès ou était-ce une manœuvre de l'homme au volant ? En tout cas je me retrouve par terre du côté des femmes, à moitié sur leurs genoux, à moitié sur le plancher du camion. Les femmes, il me semble, ne crient pas d'indignation et rient. Par contre, quelques-uns des gars prennent ça de travers, m'attrapent et me tirent vers le haut. Ils hurlent quelque chose que je ne comprends pas, mais que je peux néanmoins deviner. Je suppose qu'ils sont agacés que j'aie touché leurs femmes. J'essaie de voir tout ça comme un jeu un peu méchant, et en riant je me libère de leurs mains pour m’assoir de nouveau sur mon sac à dos. Au bout d'un moment, l'agressivité des hommes s'estompe, les femmes sourient encore derrière leurs mains ou leur mince voile. Mais la gaieté d'avant a disparu. Tous les hommes sont assis de leur côté, me regardant en fumant des cigarettes.
Je commence à réfléchir sérieusement à sortir d'ici. Car aller avec eux dans leur camp ou leur village pourrait être risqué. L'opportunité se présente après un certain temps lorsque le camion s'arrête devant une station-service dans une petite ville. Tout le monde, sauf les femmes, saute à terre. Quelqu'un ouvre le capot, un autre négocie probablement le prix de l'essence. Je profite du désordre, attrape mes affaires et saute par terre. Des mains m'attrapent pour me retenir, ils disent ‘arkadesh’, ‘ami’ en turc, accompagné du geste qui va avec. Je dois plus ou moins m'arracher de là pour ensuite disparaître dans la foule des badauds. Pour une fois, je me sens plus en sécurité dans la foule, et quand un Kurde parlant allemand m'invite à boire un çay, j'accepte volontiers et j'écoute son rapport sur l’équipe de foot de Gelsenkirchen, la ville où il travaille.
Après trois jours, j'arrive enfin à Erzurum. Mes pas me mènent au bureau de poste principal, au comptoir ‘poste restante’. Là, une seule lettre m'attend. D'après l'écriture je vois qu'elle vient de ma petite amie. Je regarde le tampon. Il ne lui a fallu que quatre jours pour me joindre ! C'est presque aussi rapide qu'une conversation téléphonique dans ce pays ! Je m'assois sur les marches du bâtiment, à côté des scribes publics et vendeurs d’eau, je déchire l'enveloppe et je me mets à lire. J'en crois à peine mes yeux, car je m'attendais plutôt à ce qu'elle m'écrive de revenir. Mais là il est écrit qu'elle a mûrement réfléchi et qu'elle veut voyager avec moi vers l'Est, et demande où elle pourrait me joindre prochainement. Je suis ravi ! Seulement, je n'ai pas eu une très bonne expérience avec l'auto-stop ici en Orient. Et de plus, les véhicules sont généralement dans un état tellement chaotique qu'il faut être très téméraire pour entrer dans l'un de ces tas de ferraille roulants. Spontanément une idée surgit dans ma tête : rentrer le plus rapidement possible en Allemagne, acheter un vieux VW-Combi et repartir ensemble avec.
La gare routière est juste à côté. J'étudie les tarifs de bus et les heures de départ pour Istanbul. Puis mon regard tombe sur une affiche : il y est écrit qu'après des mois de travaux d'agrandissement et de modernisation, l'aérodrome d'Erzurum sera de nouveau opérationnel à partir de demain et qu'il y aura à cette occasion des vols à prix réduit vers toute la Turquie. Je me rends de suite au bureau de Turkish Airlines et j'achète un billet !
Le lendemain matin, je me retrouve à l'aéroport. Il n'y a qu'un seul avion sur le tarmac, un vieux coucou bimoteur à hélice. Il y a une foule énorme. Mais pas seulement à cause des cérémonies d'ouverture ou à cause des passagers impatients. L'armée est là et a tout verrouillé ! L'état d'urgence a de nouveau été déclaré à cause des Kurdes insurgés qui auraient planifié un attentat. Même l'avion est encerclé par de jeunes soldats trop zélés, des mitraillettes dans les mains pointées vers la foule, une cigarette dans la bouche. D'un côté de l'appareil se trouve un camion-citerne bosselé, relié par un long tuyau à l'aile gauche de la machine, qui a l'air d'une grande sauterelle. Après des contrôles approfondis des bagages et du corps, les passagers peuvent passer un par un par la barrière et grimper la passerelle. Enfin ! Je vois mon sac à dos disparaître dans le ventre de la machine et je monte à bord, rassuré.
Ma place se trouve au-dessus de l'aile gauche. C'est pratique pour sortir, me dis-je, si l'engin doit atterrir d'urgence... Je me laisse tomber dans le fauteuil qui ressemble plutôt à une chaise de jardin ou, au mieux, à un siège d’une ancienne 2 CV et je regarde le pompiste, assis sur l'aile et fumant avec plaisir une cigarette. Il a placé un pied sur l'énorme pistolet à carburant pour le maintenir dans l'ouverture du réservoir intégré dans l'aile. Et là, j’ai un choc ! Car en bas, le chauffeur du camion à côté de la pompe, tient également une cigarette dans ses mains graisseuses, mais oublie de tirer dessus, car il regarde attentivement les jambes de quelques étrangères qui montent la passerelle.
Quand je remarque que le tuyau du réservoir passant sur le sol commence à bouger, je dirige à nouveau mon regard vers l'aile. Horreur ! Probablement parce que le réservoir est plein, le pistolet distributeur a échappé à la bonde et au pied expert du mécanicien, et se déchaîne dans l’air comme un tuyau d'arrosage lâché, aspergeant l'aile, l'avion et le pompiste de son épais jet de kérosène. Celui-ci se reprend vite et cherche à capturer l'extrémité du tuyau. Ce faisant, il glisse sur l'aile lisse comme sur un toboggan, et tombe sur le sol avec le tuyau qui crache toujours. Pendant ce temps, le chauffeur du camion-citerne, qui a également pris sa dose de kérosène, préfère oublier les passagères et éteint vite la pompe.
Leurs cigarettes étaient-elles éteintes ou était-cele jet de carburant qui les avaitéteintes ? En tout cas, l'explosion n'a pas eu lieu. Réveillés par l'agitation derrière l'avion, les militaires sortent de leur léthargie. Ils jettent leurs cigarettes au sol pour pouvoir mieux manipuler leurs armes et les pointent vers l'avion. Les passagers assis de mon côté ont compris ce qui se passe dehors et se ruent avec moi vers la sortie. Avec les bouches des carabines sur notre poitrine, on nous repousse dans l'appareil. Ceux qui étaient encore aux contrôles sont invités en hâte à monter dans l'avion et on verrouille la porte. À travers les traînées de kérosène sur le hublot, je vois le mécanicien grimper sur l'aile et fermer le bouchon du réservoir.
Aucun des soldats, ou du moins de leurs subordonnés, n'a vraiment compris ce qui s’est réellement passé. Ils veulent éviter la panique et se débarrasser de l'avion au plus vite. « C'est la fin ! », pensais-je, quand le premier moteur se met en branle peu après. « Adieu mon beau monde, adieu mon âme sœur, j'aurais tant aimé rester avec toi ! » Puis après plusieurs ratés, le deuxième moteur démarre dans la fumée. Quelqu'un vient en courant avec une échelle, la place contre le nez de l'avion et utilise une poignée de laine de nettoyage pour essuyer le kérosène sur les fenêtres du cockpit. Le vent produit par les moteurs en marche souffle le kérosène qui avait débordé de l'aile de ses entrailles comme un brouillard d'eau, alors que le pilote parcourt la liste de contrôle et fait fonctionner les aérofreins et le reste. L'un des membres du personnel au sol se tient devant l'avion et signale au commandant le bon fonctionnement des différentes parties de l’appareil.