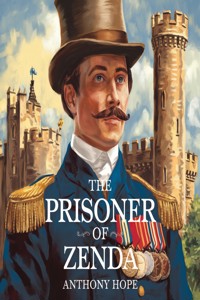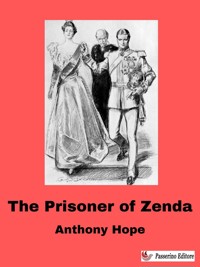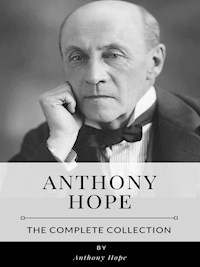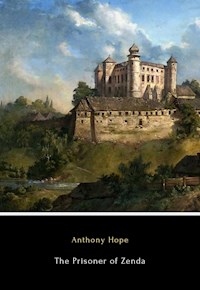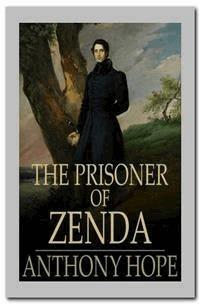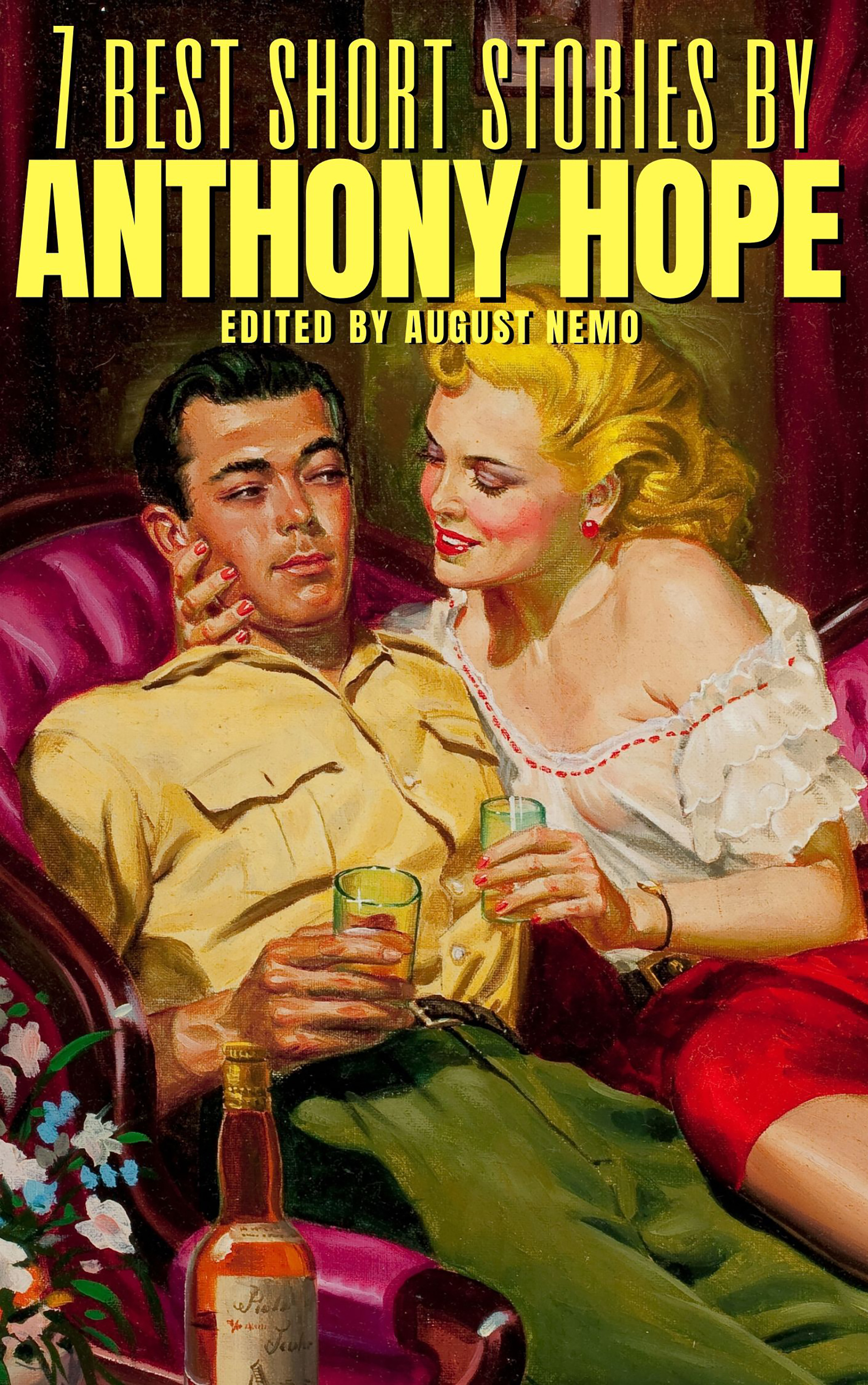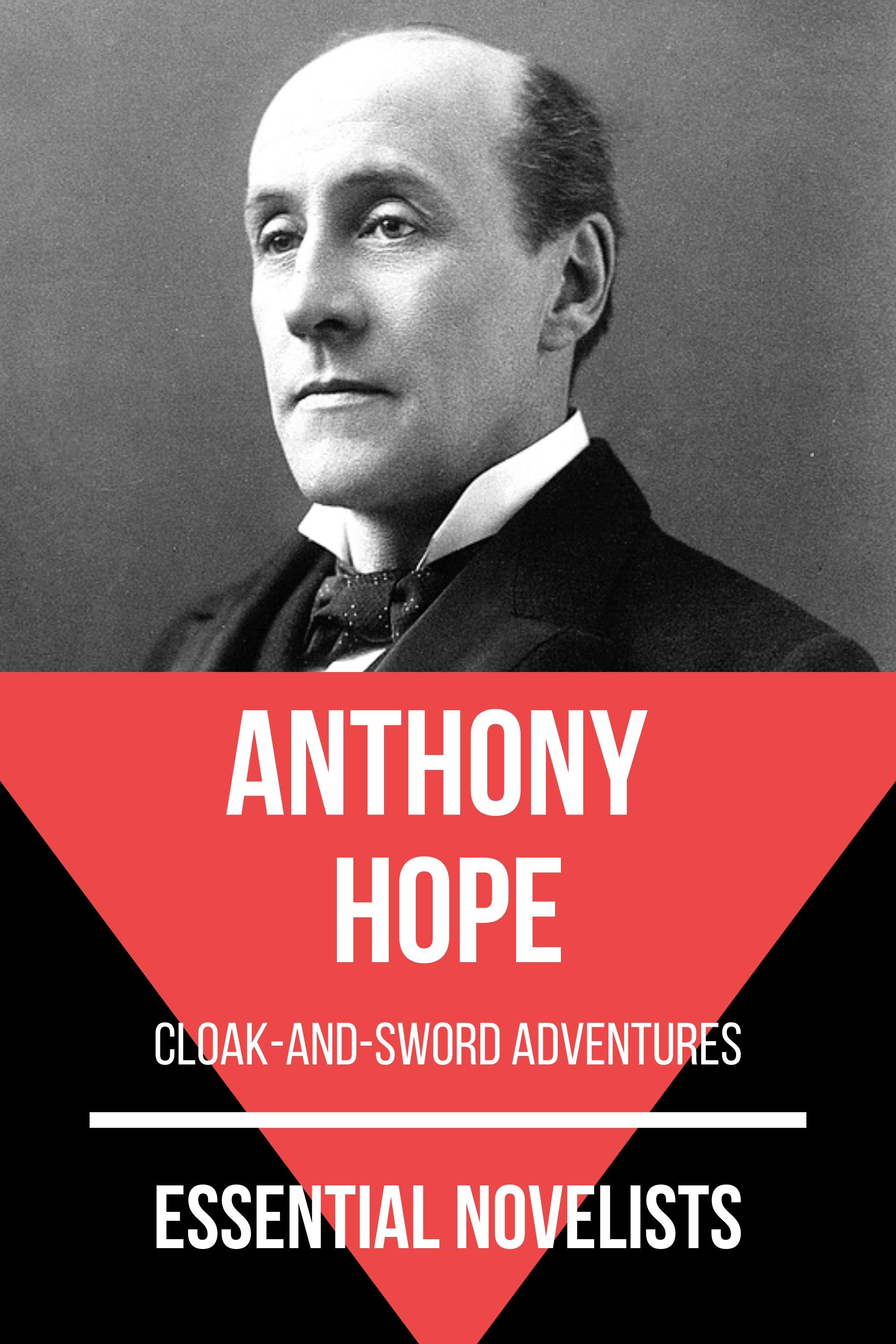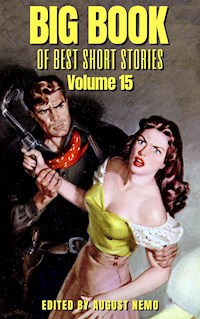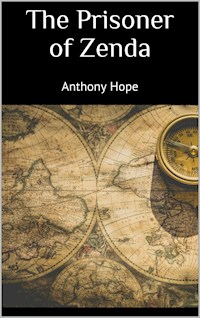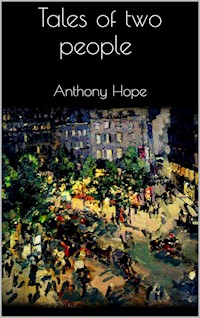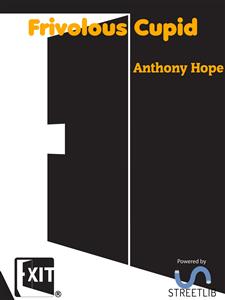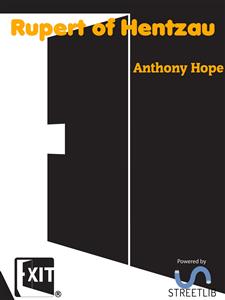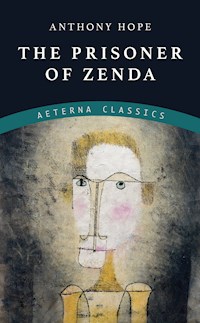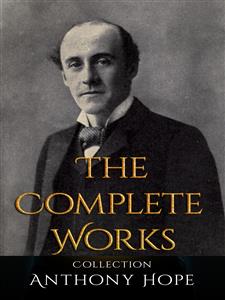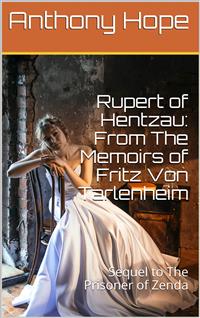5,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Französisch
Rodolphe Rassendyll, un touriste anglais, arrive à Strelsau, capitale d'un pays imaginaire d'Europe Centrale, la Ruritanie. Il y rencontre un lointain cousin dont il est le parfait sosie, le prince héritier Rodolphe V. Celui-ci doit être couronné roi le lendemain, mais à l'issue de la soirée que les deux parents éloignés passent ensemble, le futur souverain ne peut être ranimé: il a bu un vin drogué par une complice de son demi-frère, Michael de Strelsau. Ce dernier escompte se proclamer régent du royaume, en l'absence de Rodolphe V à la cérémonie du couronnement, puis faire assassiner ce dernier pour accéder ainsi au Trône. Mais deux fidèles du prince légitime, le Colonel Zapt et Fritz von Tarlenheim, convainquent Rassendyll de jouer le rôle du souverain au couronnement, grâce à cette providentielle ressemblance. Les choses se compliquent lorsque Rodolphe V, toujours endormi, est kidnappé le même jour par le mercenaire Rupert de Hentzau. En outre, Rassendyll tombe amoureux de la Princesse Flavia, promise en mariage au prince héritier...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Le Prisonnier de Zenda
Chapitre 1 - Elphberg contre RassendyllChapitre 2 - Où il est question de cheveux rouxChapitre 3 - Une joyeuse soiréeChapitre 4 - Le roi est fidèle au rendez-vousChapitre 5 - Ma première journée royaleChapitre 6 - Le secret de la caveChapitre 7 - Bataille ! – Le roi a disparuChapitre 8 - En rivalité avec le duc de StrelsauChapitre 9 - À quoi peut servir une table à théChapitre 10 - Où je succombe à la tentationChapitre 11 - Nous partons pour chasser la bête noireChapitre 12 - Premières escarmouchesChapitre 13 - L’échelle de JacobChapitre 14 - Le moment décisif approcheChapitre 15 - Conversation avec un démonChapitre 16 - Notre plan de batailleChapitre 17 - Divertissements nocturnes de RupertChapitre 18 - Dernier assautChapitre 19 - À la poursuite de Rupert de HentzauChapitre 20 - Le prisonnier du château et le roiChapitre 21 - La fin d’un rêve. – Dernier adieuChapitre 22 - Pour conclurePage de copyrightChapitre 1 - Elphberg contre Rassendyll
« En vérité, Rodolphe, s’écria un matin ma jolie petite belle-sœur, la femme de mon frère, je me demande si jamais vous vous déciderez à faire quelque chose.
– Ma chère Rose, répondis-je en posant la petite cuiller avec laquelle je venais de briser la coquille de mon œuf, pourquoi tenez-vous tant à ce que je fasse quelque chose ? Je ne me plains pas, quant à moi ; je trouve ma situation parfaitement agréable. J’ai un revenu qui suffît à peu près à mes besoins, une situation sociale des plus enviables… Ne suis-je pas le frère de lord Burlesdon et le beau-frère de la plus charmante des femmes, la comtesse Burlesdon ? Voyons, est-ce que cela ne suffit pas ?
– Vous avez vingt-neuf ans, reprit-elle, et vous n’avez encore fait que…
– Ne rien faire, c’est vrai. Mais dans notre famille on peut se donner ce luxe. »
Cette observation déplut à Rose. Chacun sait que, si charmante, si accomplie que soit personnellement ma petite belle-sœur, sa famille n’est pas du monde, du moins du même monde que les Rassendyll. Très jolie, extrêmement riche, elle avait plu à mon frère Robert, qui avait été assez sage pour ne pas s’inquiéter de ses aïeux.
« Bah ! reprit-elle un peu piquée, vos grandes familles sont en général pires que les autres. »
Là-dessus, je passai ma main dans mes cheveux, sachant parfaitement à quoi elle faisait allusion.
« Je suis contente que Robert soit brun ! » continua-t-elle.
À ce moment, Robert, qui se lève tous les matins à sept heures et qui travaille jusqu’au déjeuner, entra.
Il regarda sa femme, vit son air excité, et, lui caressant la joue du bout des doigts d’un geste amical, lui demanda : « Qu’y a-t-il, ma chérie ?
– Rose me reproche de n’être bon à rien et d’avoir les cheveux roux, fis-je avec humeur.
– Je ne lui reproche pas ses cheveux, dit Rose ; ce n’est pas de sa faute.
– Les cheveux roux apparaissent ainsi au moins une fois par génération dans notre famille, repartit mon frère ; le nez droit aussi. Rodolphe a le nez et les cheveux.
– C’est extrêmement contrariant, reprit Rose, très rouge.
– Cela ne me déplaît pas, » fis-je. Et, me levant, je m’inclinai profondément devant le portrait de la comtesse Amélie.
Ma belle-sœur jeta un petit cri d’impatience.
« Combien j’aimerais, Robert, que vous fissiez enlever ce portrait !
– Ma chérie… fit-il doucement.
– Bonté du ciel ! m’écriai-je.
– On pourrait au moins oublier, continua-t-elle.
– Ce serait difficile, Rodolphe étant là, reprit Robert en secouant la tête.
– Et pourquoi vouloir qu’on oublie ?
– Rodolphe ! » s’écria Rose d’un ton indigné et en rougissant, ce qui la rendait encore plus jolie.
Je me mis à rire et me replongeai dans mon œuf. J’avais opéré une heureuse diversion. Rose ne songeait plus à me reprocher ma paresse. Pour clore la discussion et aussi, je dois l’avouer, pour pousser à bout ma sévère petite belle-sœur, je repris :
« Il ne me déplaît pas d’être un Elphberg, au contraire. »
Lorsque je lis un roman, je n’hésite jamais à sauter les explications préliminaires, et cependant, écrivant moi-même une histoire, je reconnais qu’elles sont indispensables. Comment, par exemple, pourrais-je me dispenser d’expliquer pourquoi mon nez et la couleur de mes cheveux exaspéraient ma belle-sœur, et pourquoi je me gratifiais du nom d’Elphberg ?
Si considérée, si ancienne que soit la famille des Rassendyll, elle n’est pourtant point de sang royal comme celle des Elphberg ; elle n’est même point alliée à une maison royale. Quel est donc le lien qui unit la famille régnante de Ruritanie et les Rassendyll, Strelsau et le château de Zenda au manoir de Burlesdon ?
Pour l’expliquer, il me faut, j’en demande bien pardon, ressusciter le scandale que ma petite belle-sœur souhaiterait tant voir oublier. Donc, en l’an de grâce 1733, sous le règne de George II, l’Angleterre étant heureuse – car le roi et le prince de Galles n’en étaient point encore venus aux mains – un certain prince, qui fut connu plus tard dans l’histoire sous le nom de Rodolphe III de Ruritanie, vint faire visite à la cour. Le prince, un beau et grand garçon, était remarquable – il ne m’appartient pas de dire si c’était en bien ou en mal – par un grand nez droit, un peu pointu, et une quantité de cheveux roux, mais d’un roux foncé, presque châtain ; somme toute, le nez et les cheveux qui, de tout temps, ont distingué les Elphberg.
Il passa plusieurs mois en Angleterre, où il fut toujours accueilli de la façon la plus courtoise.
Son départ, toutefois, ne laissa pas que d’étonner un peu : le prince disparut un jour brusquement à la suite d’un duel auquel on lui avait su gré de ne pas se dérober, comme il eût pu le faire en arguant de sa royale naissance.
Il s’était battu avec un gentilhomme connu alors, dans le monde, comme étant le mari d’une femme ravissante. Le prince Rodolphe, grièvement blessé dans ce duel, fut, aussitôt remis, adroitement réexpédié en Ruritanie par l’ambassadeur, qui l’avait trouvé plutôt compromettant.
Son adversaire, le gentilhomme anglais, n’avait pas été blessé ; mais, le jour du duel, le temps étant froid et humide, il avait pris un refroidissement dont il ne s’était jamais remis et était mort au bout de six mois, sans avoir eu le temps de régler très exactement sa situation vis-à-vis de sa femme. Celle-ci, deux mois plus tard, donnait le jour à un enfant mâle, qui hérita des titres et de la fortune des Burlesdon.
La dame était la comtesse Amélie, dont ma belle-sœur eût voulu faire enlever le portrait des murs de son salon de Park-Lane ; le mari, Jacques, était le cinquième comte de Burlesdon, le vingt-deuxième baron de Rassendyll, pair d’Angleterre et chevalier de l’ordre de la Jarretière.
Quant à Rodolphe, de retour en Ruritanie, il s’était marié et avait pris possession du trône que ses descendants n’ont cessé d’occuper jusqu’à ce jour, sauf pendant un très court espace de temps. Enfin, si vous parcourez la galerie de tableaux de Burlesdon, vous serez frappé de voir, parmi ces cinquante portraits du siècle dernier, cinq ou six têtes – et entre autres celle du sixième comte – ornées d’une quantité de cheveux roux foncé, presque acajou, et de beaux grands nez droits. Ces cinq ou six personnages ont aussi les yeux bleus, ce qui étonne, car les Rassendyll ont tous les yeux noirs.
Telle est l’explication, et je suis bien aise de l’avoir terminée. Les défauts qui entachent une honorable lignée constituent un sujet fort délicat, et certainement cette hérédité que nous avions tant de fois eu l’occasion de constater était un nid à médisances. Elle bafouait la discrétion des gens qui préféraient se taire et traçait de singulières confidences entre les lignes des Annuaires de la noblesse.
Il est à remarquer que ma belle-sœur, avec un manque de logique qui doit lui être particulier depuis que nous avons reconnu qu’il n’est pas imputable à son sexe, considérait la couleur de mes cheveux et mon teint comme une offense personnelle ; de plus, elle y voyait le signe extérieur de dispositions particulières. À cet égard, je proteste énergiquement, car ces insinuations, parfaitement injustes d’ailleurs, elle les appuyait sur l’inutilité de la vie que j’avais menée jusqu’ici. Mais, après tout, je ne m’étais pas amusé avec excès, et n’avais-je pas beaucoup appris de côté et d’autre ? Élevé en Allemagne, j’avais suivi les cours de l’Université, et parlais l’allemand aussi couramment et aussi bien que l’anglais. Quant au français, il m’était devenu aussi familier que ma langue maternelle ; avec cela je savais assez d’italien et d’espagnol pour faire convenablement figure dans la langue de Pétrarque et de Cervantès. Bonne lame plutôt que tireur élégant, bon fusil, cavalier intrépide, je crois, en vérité, que j’avais monté tous les animaux qui peuvent se monter. Avec cela, une bonne tête en dépit des mèches flamboyantes qui l’ornaient.
Si pourtant des gens malveillants soutiennent que tout cela c’est perdre son temps plutôt que de l’employer, je n’ai rien à répondre, sauf qu’en ce cas mes parents n’auraient pas dû me laisser cent mille francs de rente et une humeur vagabonde.
« La différence entre vous et Robert, reprit ma petite belle-sœur – qui a le goût, le ciel la conserve ! de monter en chaire – c’est qu’il se rend compte des devoirs que sa position lui impose, tandis que vous, vous ne voyez que les avantages qu’elle vous procure.
– Pour un homme de cœur, ma chère Rose, répondis-je, les avantages sont des devoirs.
– Absurde ! » dit-elle en secouant la tête.
Puis elle reprit au bout d’un moment :
« Voilà sir Jacob Borrodaile qui vous offre une situation pour laquelle vous semblez fait.
– Mille remerciements !
– Il sera ambassadeur d’ici à six mois, et Robert dit que très certainement il vous prendra comme attaché. Voyons, Rodolphe, vous ne pouvez refuser ! Acceptez, quand ce ne serait que pour me faire plaisir. »
Lorsque ma belle-sœur emploie ces moyens-là, qu’elle fronce son joli front, croise ses petites mains et me regarde avec des yeux où je lis un réel intérêt pour le grand paresseux, le propre à rien que je suis, et dont elle pourrait très bien ne pas se soucier, je suis pris de remords, je réfléchis aussi qu’après tout, cette situation aurait certains avantages, que ce serait amusant de voir du nouveau. Je répondis donc :
« Ma chère sœur, si, d’ici à six mois, il n’a pas surgi quelque obstacle imprévu et que sir Jacob m’invite à le suivre, je vous promets que je l’accompagnerai.
– Rodolphe, comme c’est gentil ! Que vous êtes bon ! Je suis si contente !
– Où doit-il aller ?
– Il n’en sait rien encore, mais on ne peut lui donner qu’une grande ambassade.
– Madame, dis-je, pour l’amour de vous, je le suivrai, même si ce n’est qu’une misérable légation ; quand j’ai décidé de faire une chose, je ne la fais pas à demi ! »
J’étais engagé, j’avais donné ma parole d’honneur : il est vrai que j’avais six mois devant moi, et six mois, c’est long. Je me demandais donc ce que j’allais faire pour passer le temps, quand il me vint tout à coup l’idée d’aller faire un tour en Ruritanie. Il peut paraître étrange que cette idée ne me fût pas venue plus tôt, mais mon père – en dépit d’une tendresse, dont il rougissait, pour les Elphberg, tendresse qui l’avait amené à me donner, à moi son second fils, le nom patronymique des Elphberg, Rodolphe – s’était toujours opposé à ce que j’y allasse, et, depuis sa mort, mon frère, influencé par Rose, avait accepté la tradition adoptée dans la famille, qui voulait que l’on se tînt à distance respectueuse de ce pays.
Du jour où cette idée d’un voyage en Ruritanie me fut entrée dans la tête, je n’y tins plus.
« Après tout, me disais-je, les Elphberg ne peuvent revendiquer le monopole exclusif des grands nez et des cheveux roux…, » et la vieille histoire semblait une raison ridiculement insuffisante pour me priver de prendre contact avec un royaume des plus intéressants et importants, qui avait joué un grand rôle dans l’histoire de l’Europe et qui pouvait recommencer sous le sceptre d’un souverain jeune et courageux comme l’était, disait-on, le nouveau roi.
Mes dernières hésitations tombèrent en lisant dans le Timesque tout se préparait à Strelsau pour le couronnement de Rodolphe V. La cérémonie devait avoir lieu dans quinze jours ou trois semaines et, à cette occasion, on annonçait de grandes fêtes.
Je résolus d’assister au couronnement et je fis mes préparatifs.
Je parlai seulement d’un petit tour dans le Tyrol, pays pour lequel je professe un goût très vif. Je gagnai Rose à ma cause en déclarant que je voulais étudier les problèmes sociaux et politiques que présentent les curieux petits pays des alentours.
« Peut-être, laissé-je entendre obscurément, sortira-il quelque chose de cette expédition.
– Que voulez-vous dire ? demanda-t-elle.
– Eh bien ! répondis-je négligemment, il me semble qu’il y a là matière à un ouvrage intéressant et qu’avec un travail intensif…
– Oh ! voulez-vous dire que vous écrirez un livre ? s’écria-t-elle en frappant des mains. Ce serait splendide, ne trouvez-vous pas, Robert ?
– Aujourd’hui, c’est la meilleure introduction à la vie politique », observa mon frère qui avait justement débuté de cette façon quelques années auparavant : Burlesdon. Théories anciennes et événements modernes et Dernières considérations, par un étudiant politicien, sont deux ouvrages d’une valeur reconnue.
« Je crois que vous avez raison, mon cher Bob, dis-je.
– Promettez-moi que vous écrirez ce livre, insista Rose.
– Oh ! non, je ne puis le promettre, mais, si je trouve assez d’éléments, certes, je le ferai.
– C’est déjà bien beau, interrompit Robert.
– Ah ! ajouta Rose avec une moue, les matériaux ne font rien à l’affaire. »
Mais à ce moment elle ne put rien obtenir d’autre de moi qu’une promesse modérée. Pour dire le vrai, j’aurais parié une jolie somme que le récit de mon voyage de cet été ne souillerait pas la moindre feuille de papier et n’userait pas une seule plume. Et cela prouve combien peu nous pouvons savoir ce que nous réserve l’avenir, puisque me voici, remplissant ma promesse et, si jamais j’ai pensé à écrire, écrivant un livre, lequel d’ailleurs ne pourra servir que médiocrement d’introduction à une vie politique et n’a pas de rapport avec le Tyrol pour un sou.
Au reste – que lady Burlesdon me pardonne – je n’ai aucunement l’intention de soumettre à l’œil critique de ma belle-sœur ce récit. C’est une démarche à laquelle, pour bien des raisons, je préfère renoncer.
Chapitre 2 - Où il est question de cheveux roux
Mon oncle William disait toujours qu’un homme qui voyage ne pouvait faire moins, lorsqu’il passait par Paris, que de s’y arrêter vingt-quatre heures. Mon oncle s’enorgueillissait d’une sérieuse expérience du monde, et je suivis son conseil en restant à Paris un jour et une nuit. J’allai chercher George Featherly à l’ambassade et nous dînâmes au cabaret, après quoi nous nous rendîmes à l’Opéra. Puis, ayant soupé fort gentiment, nous passâmes chez Bertram Bertrand, poète de quelque réputation et correspondant à Paris du Critic.Son appartement était assez confortable et nous y rencontrâmes quelques joyeux compagnons bavardant et fumant. Je fus frappé cependant par l’air sombre et comme absent de Bertram ; quand ses hôtes se furent éclipsés et que nous nous trouvâmes seuls, je l’entrepris sur son absorbante préoccupation. Il fit quelques feintes pendant un moment, mais, à la fin, se jetant sur un sofa, il s’écria :
« Eh bien ! je me rends. Je suis épris, éperdument épris !
– Oh ! dis-je par manière de consolation, ce sera pour vous une occasion d’écrire un merveilleux poème ! »
Il ébouriffa sa chevelure d’un revers de main, et se mit à fumer avec furie. George Featherly, debout le dos à la cheminée, souriait cruellement.
« Si c’est l’ancienne histoire, dit-il, vous pouvez étrangler cela net, Bert ; elle quitte Paris demain.
– Je le sais bien, observa Bertram avec brusquerie.
– Il est vrai que cela ne ferait pas une grande différence si elle restait, poursuivit George, inexorable. Elle vole plus haut que les gribouilleurs de papier, mon vieux !
– Qu’elle aille au diable ! dit Bertram.
– Votre conversation serait beaucoup plus intéressante pour moi, me hasardai-je à observer, si je savais de qui vous voulez parler.
– Antoinette Mauban, dit George. – De Mauban, grogna Bertram.
– Ah ! oh ! fis-je, sans insister sur la question du de, vous ne voulez pas dire, Bert…
– Oh ! qu’on me laisse tranquille.
– Et où part-elle ? » demandai-je, car la dame en question jouissait d’une certaine renommée.
George jouait avec une poignée de monnaie ; il sourit malicieusement au pauvre Bertram et répondit plaisamment :
« Personne ne le sait. Au fait, Bert, j’ai rencontré chez elle un homme considérable l’autre soir… il y a environ un mois. Le connaissez-vous ?… le duc de Strelsau.
– Si je le connais !… grommela Bertram.
– Un gentilhomme tout à fait accompli, à ce que je crois. »
Il n’était pas difficile de comprendre que les allusions de George relatives au duc n’avaient d’autre but que d’aggraver la contrariété de Bertram, d’où il conclut que le duc avait distingué par ses attentions Mme de Mauban. C’était une veuve riche, fort belle, et, d’après les bruits qui couraient sur elle, très ambitieuse. Il était tout à fait possible que, comme l’insinuait George, elle volait aussi haut que ce personnage qui était tout ce que l’on pouvait être, sauf qu’il ne jouissait pas d’un rang strictement royal. Car le duc était le fils du feu roi de Ruritanie, mais issu d’un second mariage morganatique, par conséquent demi-frère du nouveau roi. Il avait été le favori de son père et de fâcheux commentaires avaient accueilli son élévation au titre de duc sous le nom d’une ville qui n’était autre que la capitale elle-même. Sa mère était simplement une femme d’une bonne mais modeste naissance.
« Il n’est pas à Paris, n’est-ce pas ? demandai-je.
– Oh ! non ! Il est retourné là-bas pour assister au couronnement du roi, une cérémonie qui, je dois le dire, ne le réjouira pas beaucoup. Allons, Bert, vieux camarade, ne désespère pas. Il n’épousera pas la belle Antoinette, du moins… tant qu’un autre plan ne viendra pas à échouer. Car, peut-être… » Il fit une pause, puis ajouta, en riant : « Il est bien difficile de résister à des attentions royales, n’est-ce pas… ne croyez-vous pas, Rodolphe ?
– Allons ! en voilà assez », dis-je. Et, me levant, je laissai le désespéré Bertram aux mains de George et rentrai me coucher.
Le lendemain soir, George m’accompagna à la gare, où je pris un billet direct pour Dresde.
« Ainsi, ce sont les musées qui vous attirent ? » fit-il avec un sourire incrédule.
George est le roi des potiniers. Si je lui avais dit que je m’en allais en Ruritanie, la nouvelle eût été sue à Londres dans trois jours, et à Park-Lane en moins d’une semaine. J’allais donc lui répondre d’une manière évasive quand il me sauva d’un mensonge en me quittant soudain pour traverser le quai. Le suivant des yeux, je le vis qui se découvrait devant une femme élégante et gracieuse qui sortait de la salle des bagages.
Grande, brune, un peu forte, mais encore de belle tournure, elle pouvait avoir dans les trente ou trente-deux ans. Tandis que George lui parlait, elle jeta un regard de mon côté et ma vanité souffrit à la pensée que, emmitouflé dans un manteau de fourrure avec un cache-nez au cou (c’était une froide journée d’avril) et coiffé d’un chapeau mou qui m’entrait jusqu’aux oreilles, j’étais loin d’être à mon avantage.
Un moment plus tard, George me rejoignit.
« Vous allez avoir une délicieuse compagne de voyage, dit-il : la déesse du pauvre Bertrand, Antoinette de Mauban. Elle va comme vous à Dresde… elle aussi, sans doute, pour visiter les musées. Toutefois il est étrange qu’elle ne désire pas, pour le moment, que je vous présente à elle.
– Mais je ne désire pas du tout lui être présenté, observai-je, un peu contrarié.
– Je lui ai offert de vous mener à elle, mais elle a répondu : Une autre fois. Qui sait, mon vieux, vous allez peut-être avoir la chance d’être tamponnés ; vous la sauverez, et vous supplanterez le duc de Strelsau ! »
Nous n’eûmes à souffrir d’aucun accident pendant le voyage et je puis certifier que Mme de Mauban arriva à bon port ; car, après avoir passé une nuit à Dresde, nous reprîmes le même train le lendemain matin. Comme elle avait clairement manifesté le désir d’être seule, j’avais mis la plus grande discrétion à éviter toute occasion de la rencontrer. Mais je constatai qu’elle suivait la même route que moi lorsque je fus au terme du voyage, et je m’arrangeai de façon à jeter un œil sur elle chaque fois que je pouvais le faire sans être remarqué.
Lorsque nous arrivâmes à la frontière de Ruritanie, – où le vieil officier de garde à la douane m’examina avec un étonnement qui ne me permit plus de conserver le moindre doute sur ma ressemblance avec les Elphberg – j’achetai des journaux où je trouvai certaines nouvelles qui modifièrent quelque peu mes mouvements. Pour une raison que je ne m’expliquais pas, et qui semblait tenir du mystère, la date du couronnement avait tout à coup été avancée, et la cérémonie fixée au surlendemain. Tout le pays était sens dessus dessous : Strelsau, à n’en pas douter, devait être bondé ; il était peu probable que je puisse trouver à me loger, à moins de payer des prix exorbitants. Je pris le parti de m’arrêter à Zenda, petite ville située à environ quinze lieues de la capitale et à trois lieues de la frontière. J’y arrivai vers le soir ; mon intention était de passer la journée du lendemain mardi à excursionner dans les montagnes des environs, qu’on dit fort belles, de jeter un coup d’œil sur le fameux château de Zenda et de prendre le mercredi matin un train pour Strelsau ; je comptais revenir le soir coucher à Zenda.
Je descendis donc à Zenda, et, comme j’attendais sur le quai que le train eût repris sa route, j’aperçus Mme de Mauban : elle s’en allait jusqu’à Strelsau, où elle avait retenu des appartements. Je souris à la pensée que George Featherly eût été considérablement surpris s’il avait pu savoir qu’elle et moi avions été compagnons de voyage pendant si longtemps.
Je fus reçu avec les plus grands égards à l’hôtel, – un hôtel modeste, – tenu par une brave dame âgée et ses deux filles. C’étaient d’excellentes gens, et que les agitations de la capitale ne paraissaient guère troubler. La vieille dame avait, au fond du cœur, un petit faible pour le duc de Strelsau qui, par le testament du roi, se trouvait maître de toute la province de Zenda et propriétaire du château qui s’élevait majestueusement sur la hauteur, à un mille à peu près de l’auberge. Elle ne se gênait pas pour exprimer hautement le regret que ce ne fût pas le duc qui régnât au lieu de son frère.
« Nous aimons tous le duc Michel ; il a toujours vécu au milieu de nous ; il n’est pas un Ruritanien qui ne connaisse le duc Michel. Le roi, au contraire, a passé la plus grande partie de sa vie à l’étranger. Je gage que pas une personne sur dix ici ne l’a vu.
– Et maintenant, approuva l’une des jeunes femmes, on dit qu’il a coupé sa barbe, de sorte qu’on ne le reconnaît plus du tout.
– Coupé sa barbe ! s’exclama la mère. Qui a dit cela ?
– C’est Jean, le garde du duc. Il a vu le roi.
– Oui, c’est vrai. Le roi est en ce moment ici dans la forêt, au pavillon de chasse du duc. C’est de là qu’il partira à Strelsau pour être couronné mercredi matin. »
Ces bavardages m’intéressaient beaucoup et je me proposai tout de suite de me rendre à pied dans la direction du pavillon, espérant avoir la chance de rencontrer le roi ; la vieille dame continua, avec loquacité :
« Ah ! je voudrais bien qu’il y restât à ce pavillon – la chasse et le vin, c’est, dit-on, tout ce qu’il aime au monde – et que ce soit notre duc qui reçoive la couronne mercredi. Voilà ce que je souhaite, et je ne m’en cache pas !
– Chut ! mère, firent les deux filles.
– Oh ! Je ne suis pas la seule à penser ainsi, cria la vieille avec entêtement.
– Quant à moi, fit la plus jeune et la plus jolie des filles, une belle blonde accorte et vive, je déteste Michel, Michel le Noir.Il me faut un Elphberg, mère, un vrai Elphberg, un roux. Le roi, à ce qu’on dit, est aussi roux qu’un renard ou que… »
Et elle se mit à rire en me regardant malicieusement et en faisant un signe de tête à sa sœur qui semblait la désapprouver. « Plus d’un avant lui a possédé une chevelure rousse semblable, murmura la vieille dame, et je me rappelle James, cinquième comte de Burlesdon…
– Mais jamais une femme ! s’écria la fille.
– Hélas ! les femmes aussi… quand il était trop tard, répondit durement la mère, réduisant sa fille au silence et à la confusion.
– Comment se fait-il que le roi soit ici ? demandai-je. Ne sommes-nous pas sur les terres du duc ?
– Le duc a invité son frère. Il doit rester ici jusqu’à mercredi. Le duc est parti pour Strelsau où il prépare l’entrée du roi.
– Ils sont bien ensemble alors ?
– Pas plus que cela », reprit la vieille femme.
Mais ma beauté blonde secoua de nouveau la tête – elle ne pouvait pas se taire bien longtemps – et reprit :
« Ils s’aiment comme peuvent s’aimer deux hommes qui ont envie de la même place et désirent épouser la même femme ! »
La vieille la regarda de travers, mais les derniers mots de la petite avaient excité ma curiosité et j’intervins avant que la mère eût commencé à gronder.
« La même femme aussi ? Contez-moi ça, petite.
– Tout le monde sait que le duc Noir, le duc, mère, si vous préférez, vendrait son âme pour épouser la princesse Flavie, et qu’elle doit être reine.
– Sur ma foi ! fis-je, je commence à plaindre votre duc ! C’est un triste sort pour un homme que de naître cadet. Toujours se résigner et n’avoir que ce que veut bien lui laisser son aîné, et encore en être reconnaissant à Dieu ! »
Je haussai les épaules, et me mis à rire. Puis je pensai à Antoinette de Mauban et à son voyage à Strelsau.
La jeune fille, bravant la colère de sa mère, allait reprendre ses explications, mais elle fut interrompue. Une grosse voix dans la pièce voisine disait d’un ton menaçant :
« Qui est-ce qui parle du duc Noir ici, dans la propre ville de Sa Grandeur ? »
L’enfant poussa un petit cri ; mais son effroi et sa surprise me semblèrent joués.
« C’est Jean. Il ne me dénoncera pas.
– Voilà ce que c’est que de bavarder », reprit la mère.
L’homme dont on avait entendu la voix, entra.
« Nous avons du monde, Jean. »
Il souleva sa casquette, et, m’apercevant, recula d’un pas, comme s’il venait de voir apparaître un spectre.
« Qu’avez-vous, Jean ? demanda la fille aînée ; monsieur est étranger ; il voyage et désire voir le couronnement. »
L’homme, remis de son trouble, continuait à fixer sur moi un regard interrogateur, presque féroce.
« Bonsoir, lui dis-je.
– Bonsoir, Monsieur », murmura-t-il, ne me quittant pas des yeux.
L’espiègle jeune fille se reprit à rire, et, l’interpellant :
« Voyez donc, Jean ; c’est la couleur que vous aimez tant. Ce sont vos cheveux, Monsieur, qui l’étonnent. On n’en voit pas souvent de pareils à Zenda.
– Faites excuse, Monsieur, murmura l’homme embarrassé ; je ne m’attendais pas à trouver du monde ici.
– Donnez un verre de vin à ce brave homme pour boire à ma santé, dis-je ; et maintenant, mesdames, je vais vous remercier et vous souhaiter une bonne nuit. »
Sur ce, je me levai, et, m’inclinant légèrement, je gagnai la porte. La jeune fille courut en avant pour m’éclairer. L’homme s’effaça pour me laisser passer, sans toutefois me quitter des yeux.
Au moment où je passais devant lui, il fit un pas en avant.
« Pardon, Monsieur, demanda-t-il ; mais est-ce que vous connaissez notre roi ?
– Je ne l’ai jamais vu, répondis-je ; j’espère le voir mercredi. »
Il n’ajouta rien, mais je sentis son regard peser sur moi. Jusqu’à ce que la porte se fût refermée, je suivis sur l’escalier la jolie fille qui, me regardant par-dessus son épaule, me dit à demi-voix :
« Il ne faut pas espérer plaire à Jean avec des cheveux de la couleur des vôtres, Monsieur.
– Il aime mieux les cheveux blonds ? dis-je en la regardant.
– Oh ! je ne parlais que des cheveux des hommes, répondit-elle avec un sourire plein de coquetterie.
– Voyons, dis-je en m’emparant du bougeoir, de quelle importance peut être la couleur des cheveux quand il s’agit d’un homme ?
– Cependant j’aime beaucoup la couleur de vos cheveux : c’est le vrai roux des Elphberg.
– Bah ! chez un homme, cela n’a aucun intérêt, pas plus de valeur que cela. »
Je lui mis dans la main une bagatelle et je la quittai.
En réalité, je l’ai reconnu depuis, la couleur des cheveux d’un homme peut avoir une grande influence sur ses destinées.
Chapitre 3 - Une joyeuse soirée
Je n’étais pas assez déraisonnable pour en vouloir au garde du duc de ne pas aimer la couleur de mes cheveux. Si je lui en avais gardé rancune, son obligeance pour moi, le lendemain matin, m’aurait désarmé. Ayant appris que je comptais aller à Strelsau, il vint me trouver, pendant que je déjeunais, pour dire qu’une sœur à lui, mariée à un commerçant de la ville, lui avait offert une chambre dans sa maison. Il avait d’abord accepté avec joie, puis s’était aperçu qu’il ne pouvait pas s’absenter, et venait me proposer, si toutefois un logement aussi simple, quoique propre et confortable, ne me rebutait pas, de prendre sa place. Sa sœur serait enchantée, m’assurait-il, et cela m’éviterait le lendemain des allées et venues inutiles. J’acceptai sans hésitation.
Il me quitta pour télégraphier à sa sœur, pendant que je bouclais ma valise et me disposais à prendre le premier train. Je regrettais pourtant un peu ma promenade en forêt, ma visite aux pavillons de chasse ; aussi, quand la jeune servante me dit que je pouvais gagner une autre station par la forêt, à une dizaine de milles, pris-je le parti d’envoyer directement mon bagage à l’adresse indiquée par Jean et de faire à pied ce petit détour. Jean était parti, je ne pus l’avertir de mon changement d’itinéraire, ce qui avait peu d’importance, somme toute, puisque ce changement n’avait pas d’autre inconvénient que de retarder mon arrivée chez sa sœur de quelques heures. La bonne dame prendrait sans doute très philosophiquement son parti de mon retard.