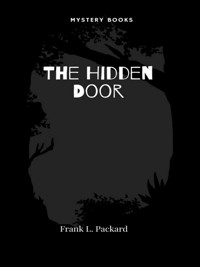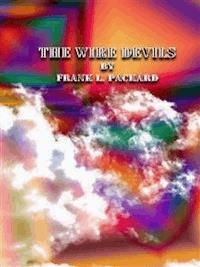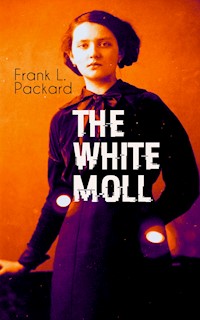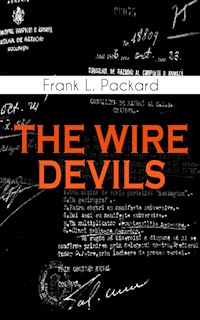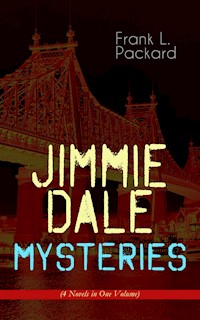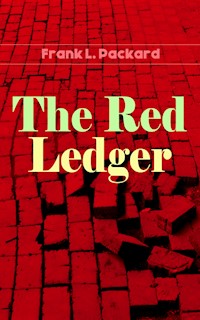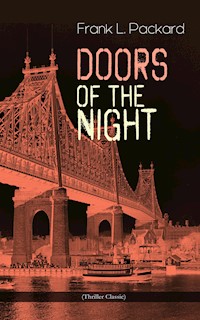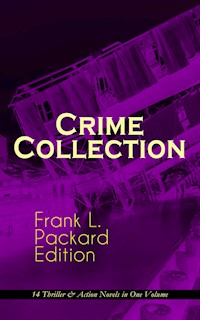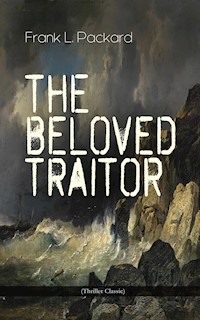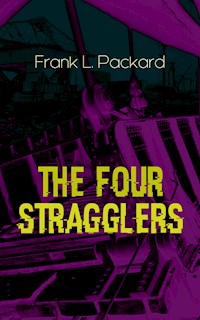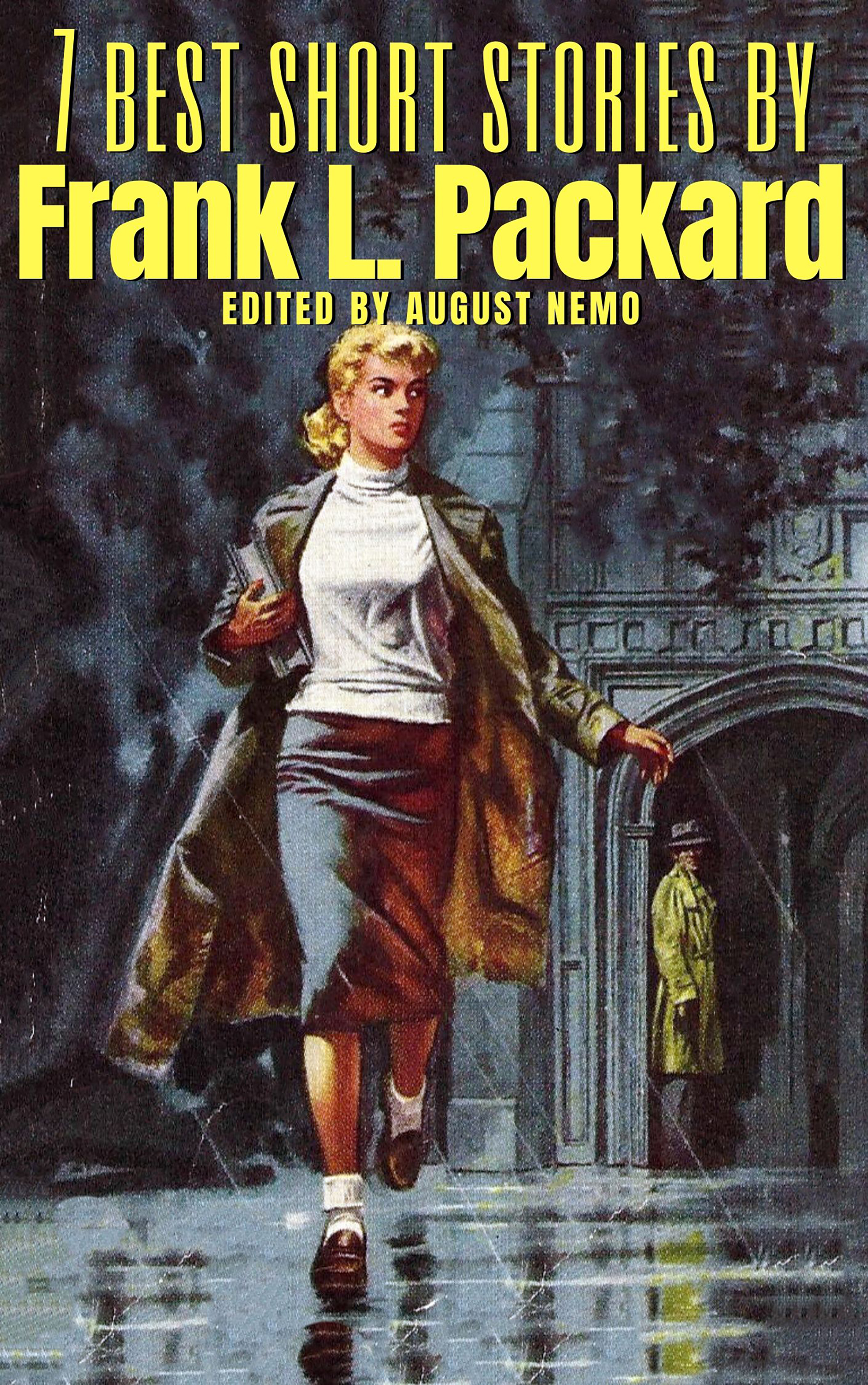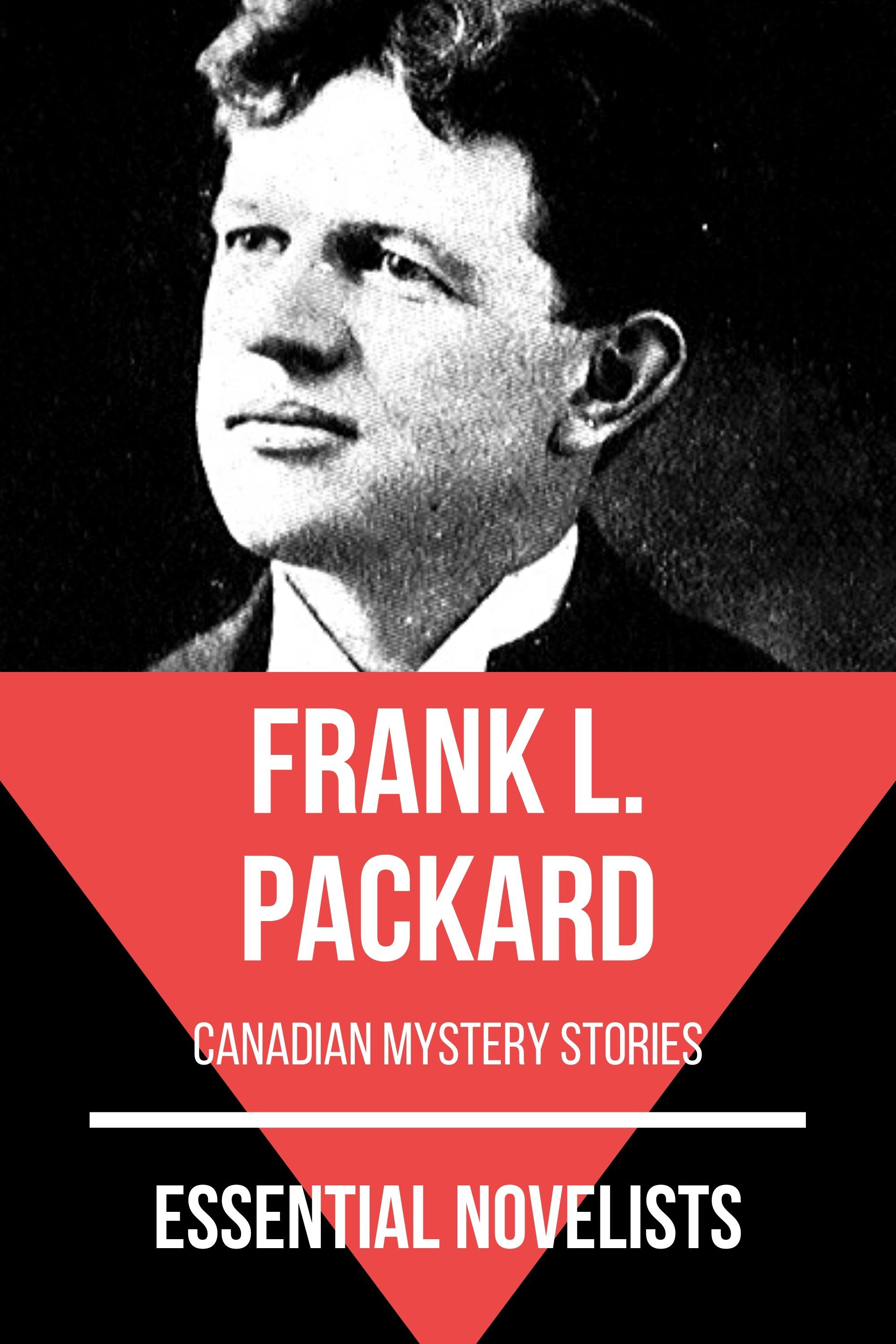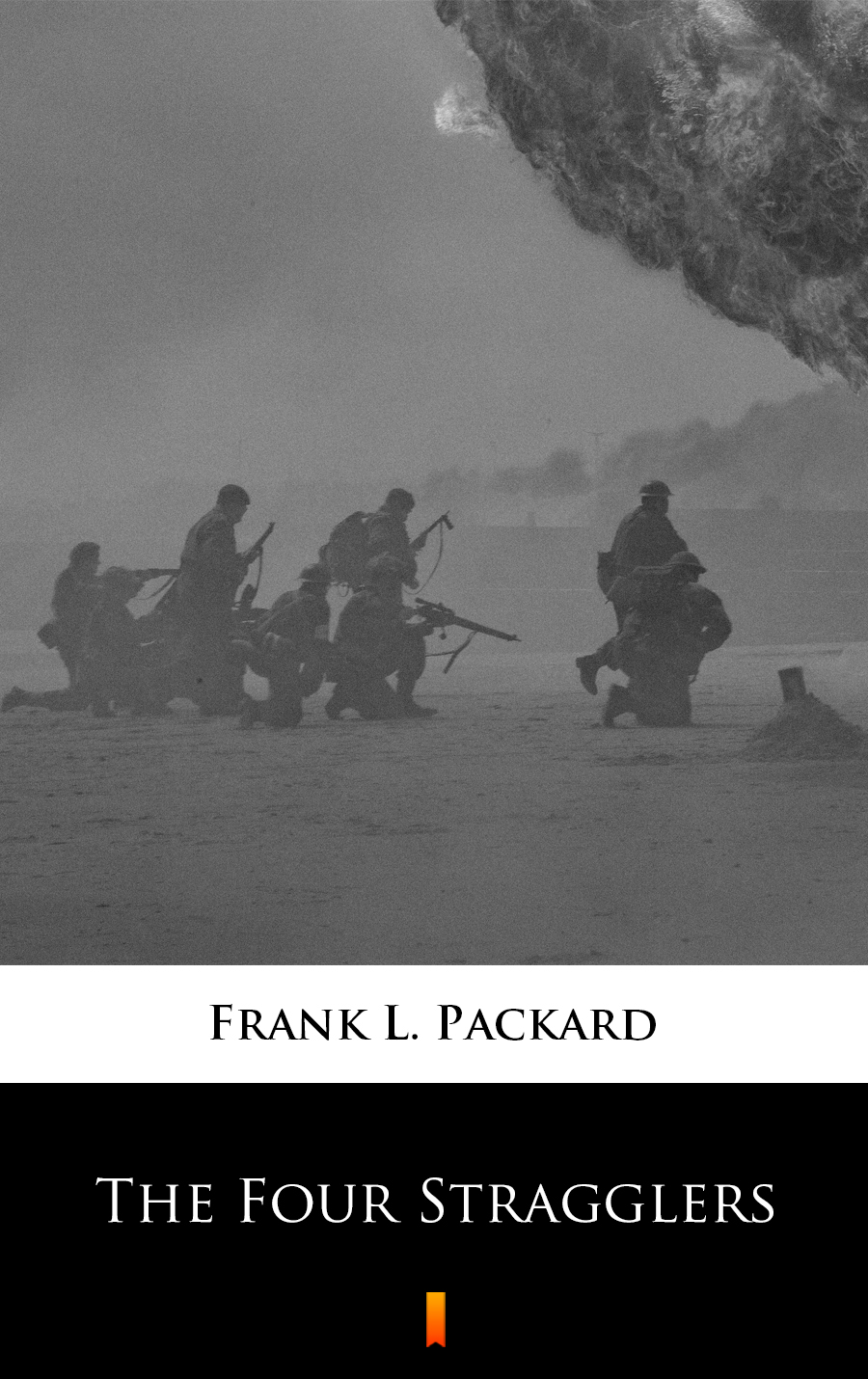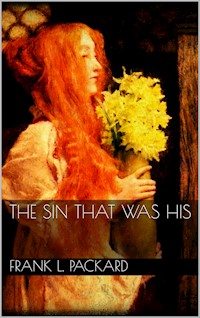1,29 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Librorium Editions
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Französisch
La pendule sonna deux coups dans le salon du bungalow silencieux. Dans la chambre à côté, Ronald Ward se retourna sur son lit une fois de plus : il s’était couché à minuit après avoir avalé un verre de gin tiède mélangé à un soda non moins tiède et n’avait cessé depuis, de compter les heures et les demies qui s’égrenaient. Ce n’était certes pas le verre d’alcool la cause de cette insomnie mais la chaleur. Une chaleur pesante, humide, accablante. Un tel état de choses était chronique à Talete – petite île perdue du Pacifique – mais vraiment ce soir-là c’était l’enfer : les portes et fenêtres du bungalow, grandes ouvertes, laissaient bien pénétrer un peu d’air, mais comme toujours sous les tropiques, c’était la brise de terre qui soufflait, cette brise qui s’établit tous les soirs sans apporter aucun soulagement ; chargée de tous les miasmes de la forêt, lourde de l’odeur de coprah des plantations, elle ne fait qu’ajouter à la pesanteur de l’atmosphère une oppression d’étuve et une humidité qui colle le linge à la peau.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Frank-L. Packard
LES CRÂNES D’OR
© 2023 Librorium Editions
ISBN : 9782385742188
CHAPITRE PREMIERTELLE UNE VIPÈRE
La pendule sonna deux coups dans le salon du bungalow silencieux. Dans la chambre à côté, Ronald Ward se retourna sur son lit une fois de plus : il s’était couché à minuit après avoir avalé un verre de gin tiède mélangé à un soda non moins tiède et n’avait cessé depuis, de compter les heures et les demies qui s’égrenaient. Ce n’était certes pas le verre d’alcool la cause de cette insomnie mais la chaleur. Une chaleur pesante, humide, accablante. Un tel état de choses était chronique à Talete – petite île perdue du Pacifique – mais vraiment ce soir-là c’était l’enfer : les portes et fenêtres du bungalow, grandes ouvertes, laissaient bien pénétrer un peu d’air, mais comme toujours sous les tropiques, c’était la brise de terre qui soufflait, cette brise qui s’établit tous les soirs sans apporter aucun soulagement ; chargée de tous les miasmes de la forêt, lourde de l’odeur de coprah des plantations, elle ne fait qu’ajouter à la pesanteur de l’atmosphère une oppression d’étuve et une humidité qui colle le linge à la peau.
Au son intermittent des sonneries de la pendule, s’en joignait un autre, continu celui-là, et autrement agaçant : à travers les cloisons tropicales si minces qui résonnent comme un violon, Ronald percevait le ronflement sonore et régulier de Gourlay, le régisseur de la plantation, endormi dans la chambre symétrique à la sienne.
Pour la cinquantième fois, Ronald grommela une malédiction rageuse : « Le diable l’emporte, ce Gourlay. »
Comment dormir avec une telle chaleur ? Pourtant on finissait peut-être par s’y habituer à la longue ? Témoin ce Gourlay, ce satané Gourlay. Une fois de plus, Ronald le maudit ; puis il se redressa sur son coude, cherchant par la fenêtre la splendeur inhumaine de la nuit : la lune énorme éclairait comme en plein jour les feuillages dont les teintes se confondaient en reflets métalliques ; les palmes des cocotiers et de l’arbre du voyageur se balançaient parmi les constellations, se découpant sur le ciel comme une fine dentelle. Tout cela composait un décor de magie, mais cette paix n’était que torpeur et n’inspirait pas le repos.
Ronald se rejeta sur son lit en poussant un nouveau juron. Fermant les yeux, il se mit à compter un à un les moutons d’un troupeau imaginaire, puis essaya de se réciter des vers… mais finit par y renoncer. À quoi bon courir après le sommeil qui le fuyait ? Mieux valait s’abandonner aux graves préoccupations qui n’avaient cessé de rouler dans son cerveau depuis deux heures.
Gourlay, par exemple : qu’en savait-il après tout ? Uniquement ce que son père – Michael Ward – lui racontait dans ses lettres pendant l’année qui précéda sa mort, mais lui, Ronald, ne le connaissait que depuis cinq à six semaines. Était-ce sage de s’être ainsi engagé avec lui ?… Pourtant que faire d’autre ?
Les pensées de Ronald remontèrent vers le passé : sa mère était morte lorsqu’il avait dix ans, le laissant seul avec son père qui le fit partir aussitôt pour l’Angleterre ; il y fit toute son éducation ; après le collège il entra à Cambridge où il resta trois ans. Ce fut ensuite la Faculté de Médecine d’Édimbourg d’où Ronald sortit avec son diplôme de docteur. C’était parfait, mais de clientèle point et pas de projets d’avenir à l’horizon…
D’un geste agacé, Ronald essuya les gouttes de sueur qui perlaient à son front et reprit le cours de ses souvenirs : revenir aux colonies et installer à Singapour un cabinet médical ? Était-ce la bonne voie ? Finalement, il partit comme médecin de bord d’un paquebot et, pendant trois ans, parcourut le vaste monde ; mais il ne voulait pas faire ainsi sa carrière. Il avait accepté cela uniquement par esprit d’aventure, par goût de vie errante, goût hérité de son père. Et maintenant ? En avait-il vraiment assez ?
Avant toute chose, il fallait commencer par mettre de l’ordre dans l’exploitation de son père dont il héritait. Mais ensuite ? Ronald n’avait que vingt-sept ans et peut-être retournerait-il errer sur les mers encore deux ou trois ans.
Ici, ses pensées prirent un cours nouveau ; pour la centième fois il regretta d’être arrivé trop tard pour trouver son père encore vivant ; il s’en était fallu de deux semaines. Ce n’était évidemment pas sa faute, on n’arrivait pas vite et pas facilement à Talete, île perdue dans son isolement.
Un bruit léger interrompit la rêverie du jeune homme et le fit se dresser pour écouter attentivement. Oui, un drôle de bruit là, à côté, dans le salon. Était-ce un effet de son imagination ? Il se le demanda après un instant de silence absolu. Mais non, il l’entendait à nouveau ce bruit étrange et infiniment léger : cette fois il put mieux l’identifier : on eût dit le lent glissement d’un reptile sur le plancher. Mais il n’y a pas de serpents à Talete, du moins Gourlay le prétendait. Était-ce, tout simplement, un morceau de papier que la brise faisait voltiger par terre ? Ronald décida d’aller vérifier car si ce bruit devait continuer, il deviendrait encore plus agaçant que les ronflements du régisseur. Il se leva, traversa sa chambre et sortit dans le long couloir bien aéré allant d’un bout à l’autre du bungalow. Il entra au salon où le son étrange avait cessé maintenant… Seul Gourlay troublait le silence par ses ronflements. Le clair de lune pénétrait à flots par la porte-fenêtre de la véranda, éclairant la pièce dans ses moindres recoins.
— Fichtrement bizarre, murmura Ronald. Il y avait ici quelque chose qui remuait il n’y a pas une minute ; j’en suis sûr…
Il sortit sur la véranda et s’arrêta soudain : il apercevait une silhouette blanche, toute menue, qui fuyait le long de la route bordée d’arbres et éclairée par le clair de lune resplendissant. C’était donc cela ?… Quelque indigène chapardeur. Ce ne pouvait être autre chose. Le seul Européen habitant Talete était le vieux Williamson, dont la plantation se trouvait à l’autre bout de l’île et Ronald l’avait vu la veille, couché avec une attaque de paludisme. Et puis pourquoi Williamson serait-il venu rôder en se cachant ? À deux heures du matin encore ? Impossible !
Le jeune homme, le visage durci, descendit en courant les marches de la véranda à la poursuite de la silhouette entrevue. S’il pouvait attraper le bonhomme et lui infliger la correction qu’il méritait, ce serait une leçon salutaire pour le reste des indigènes, menteurs et chapardeurs, comme Gourlay s’en plaignait. Il y avait eu des petits larcins sans gravité, mais assez fréquents pour qu’une occasion de pincer un indigène en flagrant délit fût la bienvenue.
À cet instant de ses réflexions, Ronald, qui courait, fit une grimace : ce n’était pas que la course pût fatiguer un grand garçon d’un mètre quatre-vingt-dix rompu à l’athlétisme et dont le corps musclé n’avait pas un atome de graisse de trop, mais il était pieds nus et la plante de ses pieds n’était pas endurcie comme celle des indigènes. Or, il courait sur un chemin pavé de fragments de corail…
L’homme, se rendant compte qu’il était poursuivi, avait pris le galop. La distance s’accroissait entre eux de plus en plus. Peu importe ! se dit Ronald : il lui suffirait de voir dans quel groupe de huttes le type se réfugierait et le lendemain il le repérerait ; pour cela il ne fallait pas le perdre de vue. Mais que se passait-il ? Au lieu de tourner à droite dans la direction du quartier indigène, l’homme continuait tout droit. Malin, le bonhomme… Il devait se dire qu’en entraînant Ronald sur la plage, il finirait bien par le lasser. Allons donc !… Il allait voir qu’un athlète de Cambridge n’a pas peur d’une course d’une centaine de mètres, d’autant plus que le sable de la plage serait plus doux à la plante des pieds que le corail de la route. En attendant, Ronald en souffrait bigrement et ça ralentissait sa marche. Bah ! rirait bien qui rirait le dernier ; l’individu verrait ce qui lui arriverait une fois sur la plage.
Tout en courant, le fugitif regardait par-dessus son épaule. Il lança un dernier coup d’œil en traversant la route pour s’engager sur la plage. Pendant un instant Ronald le perdit de vue : l’ombre des arbres n’avait pas permis au jeune homme d’apercevoir les traits de l’indigène – si c’en était vraiment un. – Les dents serrées, Ronald se dit qu’en tout cas il ferait payer à cet individu la fatigue de la poursuite.
Lui qui trouvait déjà la nuit étouffante étendu sur son lit, la jugeait tout à fait intenable à courir ainsi par cette chaleur qui faisait coller son pyjama sur son dos trempé de sueur. Mais arrivé sur la plage éclairée comme en plein jour, Ronald s’immobilisa : il se frottait les yeux, stupéfait. Il apercevait le fuyard en train de sauter dans une embarcation ; quatre ou cinq rameurs à demi-nus firent aussitôt force de rames et la barque fila rapidement dans la direction d’une goélette noire, à deux mâts, mouillée à quelques encablures derrière les hauts rochers. L’homme, debout dans l’embarcation, se retournait vers la plage et faisait un geste d’adieu à Ronald qui perçut un strident éclat de rire, un rire diabolique montant et descendant sur une gamme tantôt rauque, tantôt aiguë. Il y avait dans ce rire quelque chose de fantastique, de sinistrement inhumain.
Le jeune homme immobile sur la plage ne fit pas un geste, ne répondit rien à cette provocation.
À quoi bon ? Maintenant la silhouette blanche s’était assise et la barque approchait de la goélette noire. Ronald la vit aborder le navire ; le fuyard monta à bord et le bateau vira et s’éloigna lentement tandis que le vent gonflait ses voiles…
Sans se hâter, Ronald reprit, fort perplexe, le chemin de son bungalow. Il y avait eu dans cet épisode quelque chose d’irréel. Il se demandait s’il n’allait pas se réveiller dans son lit après un mauvais rêve, mais les écorchures faites à ses pieds par le corail le ramenèrent à la réalité. Que signifiait tout ceci ? Qu’y avait-il au fond de cet incident ? Pour quelle raison la goélette était-elle venue mouiller devant Talete ? En tout cas, l’homme avait dû accomplir une mission dont quelqu’un l’avait chargé : ce n’était pas le hasard qui l’avait introduit dans le bungalow, ni la venue de Ronald qui le faisait fuir. Non, l’intrus se trouvait déjà dans le jardin quand le jeune homme pénétrait dans le salon. Lorsqu’il s’y retrouva, Ronald regarda autour de lui : qu’est-ce que cet homme était venu chercher ? La clarté de la lune ne révéla rien. Ronald craqua une allumette et s’approcha de la lampe posée sur la table du milieu, mais… il demeura immobile, l’allumette se consumant dans sa main. Il regardait un petit paquet enveloppé de papier, posé sur la table et qui portait, en caractères majuscules, le nom et l’adresse de son père – Michael Ward…
CHAPITRE IILE POIDS DU PASSÉ
Ronald alluma cette fois la lampe. C’était donc là, la raison de cette visite nocturne, furtive et mystérieuse ? Bien étrange qu’une goélette prît la peine de venir s’embosser, en cachette de tous, devant une île située à l’écart de toute route maritime à seule fin de déposer, au milieu de la nuit, un petit paquet adressé à un homme mort depuis plus de deux mois…
Il prit l’objet qu’il tourna et retourna entre ses doigts avec une curiosité intense. C’était une boîte carrée d’environ quinze centimètres de long, soigneusement enveloppée et entourée d’une mince ficelle. Il vérifia l’adresse : c’était bien Mr. Michael Ward.
À un mort ? À un mort ? ne cessait de se répéter Ronald. Puis, il haussa les épaules car une explication toute simple lui venait à l’esprit : ce n’était pas si bizarre après tout et l’éloignement de Talete en était la cause comme elle le fut de son propre retard lors de la mort de son père. Depuis cette mort, pas un navire n’avait approché de l’île et tout le monde ignorait le décès de Michael Ward. La goélette était le premier bateau venu depuis lors. De toute évidence, l’expéditeur de la petite boîte ignorait la mort de Michael Ward. « Bien sûr, se dit Ronald, mais ce n’est tout de même pas naturel : voyons un peu ? »
Il coupa la ficelle, défit les papiers et en sortit une petite boîte en bois : elle était rectangulaire et ne dépassait pas les dimensions d’un boîtier de grosse montre. Le couvercle glissa sous ses doigts et à l’intérieur, posée sur de l’ouate, étincelait une petite tête de mort en or sous laquelle se trouvait un papier plié en quatre…
Ronald éleva l’objet à la hauteur de ses yeux en fronçant les sourcils. Le macabre bibelot était d’un travail soigné à la fois comme proportions et comme détails cependant, la face présentait une expression particulièrement repoussante. Il y manquait cinq dents et ce vide lui donnait une espèce de sourire sinistre et grimaçant. L’horrible bijou semblait menacer.
Ronald déplia le papier : il ne contenait qu’une seule ligne tracée par une plume malhabile en caractères majuscules tout comme l’adresse :
L’OMBRE APPROCHE DE TOI, Ô TUAN(1).
Inconsciemment, Ronald eut le geste familier qui indiquait chez lui l’hésitation ou la perplexité : il gratta le lobe de son oreille.
Il attira à lui une boîte de cigarettes et en prit une qu’il alluma. Que diable ce message pouvait-il signifier ? Était-ce une menace ? La vengeance d’un Malais ? Sûrement quelque chose de ce genre. Tout, dans les termes du message, le contenu de la boîte, la manière dont elle avait été apportée, tout cela avait clairement le sens d’un avertissement, d’un péril. Cela devait se rapporter au passé de son père, un passé que Ronald, en somme, connaissait à peine…
Il se jeta dans un fauteuil de rotin qui craqua sous son poids et, plaçant le crâne devant lui, étudia à nouveau les caractères tracés sur le papier. Il se mit à réfléchir, essayant de comprendre… C’était vrai pourtant qu’il ignorait tout de la vie de son père ; il en était frappé pour la première fois. Il remonta dans ses souvenirs : il savait que son père – Michael Ward – propriétaire d’une goélette avant son mariage, faisait le va-et-vient entre les îles du Pacifique pour le commerce du coprah et de toutes autres denrées produites par le pays. Financièrement, l’opération était excellente. Une fois marié, Ward s’était établi à Singapour où il avait recommencé le même commerce mais à terre cette fois. Il continua de s’enrichir. « Oui, » se disait Ronald, « on ne manquait de rien chez nous. » C’est ainsi qu’à la mort de son père, il hérita une exploitation qui valait au bas mot trente mille livres.
Comme il songeait à cela, il lui parut que le sourire de la tête de mort ricanait sinistrement, semblant lui dire : « En plus du reste, tu as hérité de moi aussi, mon garçon »…
***
Une fois de plus, Ronald essuya son front ruisselant de sueur, tandis que les ronflements de Gourlay ponctuaient le silence de la nuit. Gourlay ? Savait-il quelque chose, lui ? Le jeune homme reprit le fil de ses souvenirs : il avait dix ans à la mort de sa mère ; son père l’expédia en Angleterre immédiatement puis s’empressa d’acheter une nouvelle goélette. Geste fort naturel, étant donné les circonstances. La mort de Mrs. Ward ayant rompu le foyer, le veuf avait repris son métier de marin dans le désir de trouver l’oubli de son chagrin et de sa solitude. Ronald se souvenait, quel ménage tendre et uni avait été celui de ses parents. Il n’avait jamais revu son père depuis. Ici, le ricanement du crâne sembla devenir de plus en plus ironique : « Cherche, cherche mon garçon. Cherche dans tes souvenirs. Peut-être que tu me trouveras dans une petite niche. » Voyons. Que s’était-il passé ensuite ? Son père avait erré dans l’archipel malais avec son bateau, le Vautour, passant parfois des mois sans donner de ses nouvelles. Puis il y a un an, Ronald avait reçu une lettre annonçant que, las de naviguer, Michael Ward avait acheté une plantation dans l’île de Talete où il résiderait désormais. Et, six mois plus tard, Ronald arrivait, appelé en hâte, pour apprendre que son père venait d’être enterré.
Les circonstances de la vie avaient séparé le père et le fils, en dépit de l’affection qui n’avait pas cessé de les unir. La vie errante du père, les études du fils et son embarquement comme médecin de bord et enfin l’isolement de Talete située en dehors des routes maritimes les avaient tenus séparés. La lettre prévenant Ronald de la maladie de son père le trouva à Liverpool : alarmé, il donna sa démission à la Compagnie de Navigation et partit immédiatement pour le Pacifique. Il arriva à Singapour pour apprendre que l’unique courrier faisant escale à Talete tous les deux ou trois mois venait de partir. Il prit un bateau danois qui l’emmena à l’île de Kulata où il fréta un voilier indigène et mit ainsi trois mois pour parvenir à Talete où on lui apprit la mort de son père. Il sut que Gourlay avait déniché un missionnaire possédant quelques notions de médecine, et que Michael Ward avait été soigné et entouré jusqu’à la fin.
Ronald s’était souvent demandé pourquoi son père avait choisi cette île abandonnée de Dieu et des hommes pour venir s’y isoler ?… Le bibelot macabre sembla lui répondre en ricanant : « Hé… hé… pas si isolée que ça Talete, puisque me voilà… »
Peut-être Gourlay serait-il en mesure de l’aider à élucider cette énigme et l’étrange incident de ce soir. Il accompagnait Ward quand celui-ci s’était installé à Talete et les deux hommes avaient vécu dans une intimité étroite, seuls dans l’île. On finit par se connaître, que diable ! par se confier l’un à l’autre dans cette solitude. Jusqu’ici Ronald n’avait eu aucune raison de poser des questions au régisseur au sujet de son père, mais à présent ? Il se leva brusquement de son siège et, après avoir caché sous une feuille de papier la boîte et le message, alla frapper à la porte de Gourlay : les ronflements cessèrent aussitôt.
— Gourlay, appela Ronald, pouvez-vous venir ici un instant ? J’ai à vous parler.
— Tout de suite.
La voix était encore ensommeillée, mais on sentait le régisseur alerté. L’instant d’après, sa forte silhouette s’encadrait dans le chambranle de la porte. Le pyjama déboutonné laissait voir une poitrine velue. Les yeux noirs enfoncés sous l’arcade sourcilière clignaient à la vive lumière. C’était un gaillard solide, d’une quarantaine d’années, déjà chauve.
— Quelque chose qui ne va pas ? demanda-t-il inquiet. Que se passe-t-il donc ?
D’un geste, Ronald indiqua la table :
— Jetez les yeux sur ce qu’il y a là.
Gourlay s’approcha, prit la petite tête de mort dorée, l’examina de près, puis lut la ligne tracée sur le papier. Enfin il s’enquit :
— Où avez-vous déniché ça ? Je vous croyais couché ?
Il paraissait très intrigué.
— J’étais effectivement au lit ; ce n’est pas moi qui ai déniché ces… ces objets. On est venu les déposer sur cette table.
— Déposer ? dit Gourlay incrédule. Qui ? Quand ? Comment ?
— Il y a une heure environ, mais le moment précis n’a pas d’importance. J’envie votre faculté de sommeil, mon vieux, dans ce sale climat. Quant à moi, il m’était impossible de fermer l’œil et je rêvassais tout éveillé lorsque j’entendis un léger bruit dans cette pièce. Le temps de sauter du lit et de venir : tout était redevenu silencieux, plus personne. Je sors sur la véranda et je vois la silhouette d’un indigène qui détalait à toutes jambes. Pensant avoir affaire à un voleur, je me mis à sa poursuite.
— Vous avez joliment bien fait, riposta Gourlay. Tous les mêmes, ces animaux-là.
— Il courait plus vite que moi, reprit Ronald, car le corail concassé du chemin me mettait la plante des pieds en sang. Bref, mon vieux Gourlay, je suis mon homme jusque sur la plage et là, je le vois qui saute dans une embarcation, laquelle, faisant aussitôt force de rames, le mène à une goélette en panne au large.
Le regard de Gourlay se reporta sur le bijou, puis il essuya avec la manche de son pyjama son front ruisselant de sueur.
— Et quand vous êtes revenu, dit-il d’une voix troublée, vous avez trouvé ceci ?
— Mais oui. C’était enveloppé dans un papier et adressé à mon père. Tenez, regardez. Il y a bien Michael Ward ? Le type l’avait déposé sur la table et en allumant je l’ai aperçu.
— Je n’aime pas du tout ça, bougonna Gourlay. Encore un sale tour de quelque Malais. Reconnaîtriez-vous le bonhomme ?
— Non, répliqua Ronald, et même à cette distance je ne jurerais pas que ce fût vraiment un Malais : le clair de lune déforme ce qu’on voit, mais la seule chose que je suis sûr de reconnaître, c’est son rire. Je n’ai jamais entendu un être humain, blanc ou de couleur, rire ainsi. Il n’a pas cessé durant le temps que l’embarcation s’éloignait. Mais, qu’avez-vous donc, mon bon Gourlay ?
Le régisseur répondit d’une voix altérée, avec un sourire qui ressemblait à une grimace :
— C’est ce rire… J’allais justement vous demander si vous n’aviez pas entendu quelque chose de ce genre ? Décrivez-le-moi bien, s’il vous plaît.
Les sourcils de Ronald se froncèrent.
— Que voulez…
— Décrivez d’abord, je vous dirai ensuite.
— Je ne sais trop comment préciser cela. On eût dit un long ricanement, strident comme le bruit d’une soie qui se déchire : il montait et descendait sur une gamme aiguë, semblant me narguer. C’est tout ce que je trouve comme description.
— Oui, oui, c’est bien ça… La voix du régisseur n’était plus qu’un murmure. Grand Dieu ! Je vois. Je vois, mais, sur mon âme, j’ignore la signification de ce rire. Je l’ai pourtant entendu, moi aussi. Écoutez-moi bien : il s’était écoulé une semaine depuis que votre père et moi étions arrivés ici et la plantation commençait à s’organiser. Une nuit, je fus réveillé par des bruits étranges. Vous avez trouvé l’expression juste en parlant d’une soie qui se déchire ; c’était ça que j’entendais. Mal réveillé encore, je l’attribuai à quelque oiseau nocturne, mais lorsque je compris que cela provenait d’un gosier humain, j’en ai eu froid dans le dos, je vous assure. J’allai à la porte pour essayer de localiser ce rire venu sûrement de l’extérieur. La nuit était noire et sans lune. J’allumai une bougie et vins dans cette pièce, mais je ne vis personne, puis le rire cessa. Puis…
Gourlay se tut en essuyant encore son front.
— Ensuite ? interrogea brièvement Ronald.
Le régisseur eut un drôle de sourire :
— À la porte de la véranda, ouverte comme ce soir, j’aperçus votre père debout sur le seuil, son revolver à la main. Il avait une expression farouche et me cria brusquement : « Éteignez, nom de… Éteignez votre bougie. » Ce fut tout.
— Tout ? s’exclama Ronald, que voulez-vous dire par « tout » ? Qu’est-ce qui est arrivé ensuite ?
— Absolument rien, déclara Gourlay. Votre père s’est refusé à toute explication et m’a renvoyé au lit. Durant toute l’année qui s’écoula après cet incident nous n’y fîmes jamais allusion. Je vous avoue même que je n’y pensais plus du tout, mais en voyant cette satanée tête de mort et vous entendant parler du rire, je me suis dit que cela doit se rattacher à cet incident… Je viens de vous raconter tout ce que je sais et je vous donne ma parole que je ne peux rien ajouter de plus.
Ronald, les lèvres serrées, alla à la porte de la véranda et, tournant le dos à la chambre, scruta pendant un long moment la nuit. Puis tout aussi brusquement il se tourna vers Gourlay :
— Vous croyez que c’est une menace ?
— Je ne le crois pas, répliqua le régisseur, j’en suis certain. Il n’y a pas le moindre doute, voyons.
— Et celui qui l’a envoyée croit mon père en vie, ajouta Ronald.
— Mais oui… répondit Gourlay. Il n’y a pas de doute ! C’est la seule explication de l’adresse tracée sur l’envoi.
Ronald alla prendre une cigarette qu’il se mit à taper sur son ongle d’un air pensif.
— Écoutez-moi bien, Gourlay, dit-il après un silence, à mon arrivée ici je vous ai demandé si vous connaissiez les raisons qui ont amené mon père à venir se retirer dans cette île perdue. Vous m’avez répondu que vous n’en voyiez qu’une seule : en vieillissant, mon père trouvait la vie de marin trop fatigante et désirait désormais la tranquillité. Je dois dire que ses lettres me donnaient la même raison. Mais devant ce qui vient de se passer, n’avez-vous rien à ajouter ?
Gourlay eut un geste catégorique :
— Non, vraiment rien. Votre père ne m’a jamais dit autre chose.
Ronald alluma la cigarette qu’il tapotait encore distraitement, et reprit :
— Je vous ai déjà exprimé mon étonnement de voir mon père choisir comme retraite l’île la plus déserte de tout l’archipel, mais ce soir ça me paraît encore plus bizarre.
— Moi, je n’y ai pas songé, je l’avoue. Votre père connaissait admirablement le pays et cette plantation pouvait fort bien le tenter ; elle est excellente, il y a beaucoup d’argent à gagner. De plus Parkin – l’ancien propriétaire – l’a vendue pour un morceau de pain à votre père. C’était une occasion et voilà tout.
Ronald eut un hochement de tête dubitatif et concéda d’un ton peu convaincu :
— Peut-être bien, après tout, n’empêche que ça ne me satisfait pas tout à fait. Mais vous, Gourlay ? Vous êtes encore jeune, qu’est-ce qui a pu vous pousser à venir dans ce trou ?
Gourlay haussa les épaules :
— Toujours la même histoire. Quand on s’exile dans ces pays, c’est avec l’intention d’y passer seulement quelques années, mais on n’en revient plus, allez. Ce Parkin dont je parlais tout à l’heure est une des rares exceptions qui s’en retournent à la mère-patrie après fortune faite. La plupart des fois ce n’est qu’une succession de hauts et de bas et on finit par traîner toute son existence aux colonies. Je ne vais pas m’attendrir sur mon propre sort, mais il faut avouer que je n’ai pas eu de chance ; il y a encore peu d’années, je possédais une petite plantation, je faisais de bonnes affaires et j’avais quelques économies. Puis, une vague de fond a tout bouleversé et je fus ruiné. Je vivais au jour le jour lorsque votre père m’a fait son offre, une offre très avantageuse : il m’engageait comme régisseur avec une mensualité et un pourcentage sur les affaires. Voilà mon histoire.
Gourlay eut un instant d’hésitation avant de demander :
— Les événements de ce soir changent-ils quelque chose à vos projets ? Vous aviez l’intention de continuer l’exploitation de la plantation.
— Je l’ai toujours, déclara Ronald résolument. Je ne vois aucune raison de changer d’avis : nous avions convenu que moi je prendrais passage sur le Watabi à sa prochaine escale ici pour retrouver des contrées plus civilisées et que vous resteriez pour administrer la plantation à ma place. Je vous en donne la direction, à moins cependant que les incidents de cette nuit vous fassent changer d’avis. À mon tour je pose la question ? conclut le jeune homme en riant.
— Pas le moins du monde, dit Gourlay riant également. Je suis sûr que je n’aurai plus la visite de votre fameuse goélette : la mort de votre père sera sue et on me fichera la paix. D’ailleurs, la menace ne me concerne pas personnellement. Notre accord tient bon, mon cher ami.
— Entendu alors, dit Ronald jetant un regard sur la pendule. Le jour va bientôt se lever, il vaut mieux regagner nos lits. Je ne vois pas à quoi nous servirait d’épiloguer sur cette affaire. Allons dormir.
— Bien sûr. Tout de même, ajouta Gourlay hochant la tête, du diable si je comprends quelque chose à tout ça.
— J’éteins la lampe, bonsoir, mon vieux.
— Bonne nuit.
Ronald ne se pressait pas de regagner sa chambre et n’éteignit pas tout de suite. Prenant le petit crâne doré, il le regarda longuement, les yeux mi-clos, les lèvres serrées. Les explications de Gourlay ne le satisfaisaient pas et sa pensée revenait toujours à l’isolement de son père à Talete. En admettant que Michael Ward fût fatigué de bourlinguer sur les mers, pourquoi choisir une île quasi-déserte ? Voulait-il se cacher ?…
À cette pensée Ronald eut un sursaut d’indignation : il était en train d’insulter la mémoire de son père, le meilleur, le plus droit des hommes. Non, Ward n’avait pas besoin de se cacher et n’avait peur de personne. Le récit de Gourlay n’en était-il pas la meilleure preuve ? Malgré le rire démoniaque qui apprenait à Michael Ward que sa retraite était découverte, il n’avait pas fui ; donc, il ne se cachait pas. Mais, mais il y avait quelque chose tout de même. Quoi ?
Ne trouvant pas de réponse à cette question, Ronald finit par éteindre la lampe et, prenant le sinistre bibelot, rentra chez lui à pas lents. Il se dit qu’il ne saurait jamais puisque son père n’était plus là pour lui donner d’explications. Personnellement ça ne le regardait pas. C’était fini. Mais, il s’immobilisa soudain changé en statue : il revoyait le geste d’adieu ironique du Malais et il lui semblait de nouveau entendre, venant du fond de la nuit obscure, le rire, le rire démoniaque qui le narguait, lui, Ronald.