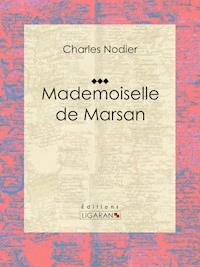
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Extrait : "Parmi les anciens émigrés qui m'avaient accueilli à Venise avec bienveillance, en considération de ma qualité de Français, de mes opinions et de mes malheurs, il en était un qui m'inspirait le plus profond sentiment de respect et d'affection. C'était M. de Marsan. M. de Marsan, dont quelques vieux courtisans se souviennent peut-être, avait été un des plus brillants officiers de la maison militaire de Louis XVI."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de qualité de grands livres de la littérature classique mais également des livres rares en partenariat avec la BNF. Beaucoup de soins sont apportés à ces versions ebook pour éviter les fautes que l'on trouve trop souvent dans des versions numériques de ces textes.
LIGARAN propose des grands classiques dans les domaines suivants :
• Livres rares
• Livres libertins
• Livres d'Histoire
• Poésies
• Première guerre mondiale
• Jeunesse
• Policier
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 164
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EAN : 9782335055801
©Ligaran 2015
Parmi les anciens émigrés qui m’avaient accueilli à Venise avec bienveillance, en considération de ma qualité de Français, de mes opinions et de mes malheurs, il en était un qui m’inspirait le plus profond sentiment de respect et d’affection. C’était M. de Marsan.
M. de Marsan, dont quelques vieux courtisans se souviennent peut-être, avait été un des plus brillants officiers de la maison militaire de Louis XVI. Sa belle figure, ses belles manières, son esprit, son courage, l’avaient fait remarquer dans un temps et dans une cour où ces heureuses recommandations personnelles n’étaient pas fort rares. Il leur dut un avancement rapide qui n’excita aucune réclamation, et un établissement considérable que tout le monde approuva. Sa fille, née en 1788, fut tenue sur les fonts de baptême, au nom de la reine de France, par celle des amies de cette auguste et infortunée souveraine qui jouissait du crédit le mieux affermi à Versailles. La fille de M. de Marsan s’appelait Diana.
M. de Marsan, cassé d’ailleurs par les fatigues de la guerre, était vieux en 1808 ; il s’était marié à trente-cinq ans et avait perdu trois enfants avant que le ciel lui accordât la fille unique dans laquelle s’étaient enfin concentrées toutes ses affections. Mme de Marsan, attachée au service de Mesdames, sœurs du roi, avait peu survécu à leur établissement à Trieste.
Elle les précéda au tombeau.
Le vieil émigré retirait au moins quelque profit de ses longues infortunes : il était devenu philosophe. Assez riche à son gré d’une aisance modeste, sagement préservée par des précautions prises à propos de la catastrophe universelle, il passait paisiblement le reste de sa vie entre d’agréables études et des distractions sédentaires. Le goût de l’histoire naturelle nous avait subitement rapprochés et j’étais fidèle à son piquet de chaque soir. Aussi sa prédilection pour moi, entre tous les jeunes gens dont il aimait l’entretien, avait pris en peu de temps quelque chose de paterne dont Diana aurait eu le droit d’être jalouse. Je ne me suis jamais aperçu qu’il attachât beaucoup d’importance à cette vanité, réellement assez puérile, qu’on appelle le préjugé de la noblesse, et cependant je suis bien convaincu qu’il regrettait quelquefois que je ne fusse pas noble, au point de faire sur lui-même un certain effort pour l’oublier.
– À vous, monsieur le chevalier, me disait-il un jour en me donnant des cartes.
Et je ne sais dans quelle crypte de mes souvenirs, close depuis vingt ans, je vais retrouver cette historiette frivole.
– Je ne suis pas chevalier, m’écriai-je en riant, avant de les avoir déployées.
– Sur ma foi de chrétien, reprit M. de Marsan, les gentilshommes de ma maison en ont armé plus d’un qui était moins digne de cet honneur.
– Je suppose, répondis-je en me levant pour aller à lui, que ce n’était pas sans leur donner l’accolade !
Et je l’embrassai de grand cœur, car j’ai toujours attaché un prix extrême à l’affection des vieillards.
Il fallait pourtant lui passer un entêtement violent et passionné sur une question qui revenait souvent dans les conversations de ce temps-là. Le nom seul de révolution lui causait une révolution véritable, et quoiqu’il regardât le prochain rétablissement des Bourbons sur le trône de leurs pères comme un évènement infaillible, il s’était promis de ne jamais retourner à Paris, dont toutes les pierres lui semblaient baignées encore dans le sang des proscriptions. Cette antipathie contre tous les mouvements politiques du même genre n’épargnait pas les conspirateurs de son propre parti, et, dans sa résignation aux décrets équitables et assurés de la Providence, il blâmait amèrement les insensés qui cherchent à en précipiter l’accomplissement, sans égard aux sages temporisations de la prudence de Dieu. L’idée dont je parle se manifestait si vite et si fréquemment dans ses discours, qu’elle m’avait détourné de bonne heure de lui communiquer tous les secrets de ma turbulente jeunesse, et bien plus encore les rapports que j’avais noués, à mon arrivée à Venise, avec les Carbonari et les émissaires de la Tungend-Bund, dont le nom ne lui inspirait pas moins d’horreur que celui des jacobins. Il faut convenir, au reste, que je commençais à me sentir quelque tendance pour son opinion, avant même de la connaître, et que je n’étais plus guère retenu dans le périlleux réseau des sociétés secrètes que par l’impossibilité de le rompre sans violence. J’avais vingt-six ans, éprouvés par des adversités presque sans exemple à mon âge, et le goût des occupations douces et des loisirs studieux me rappelait incessamment à un autre genre de vie que je n’aurais jamais dû quitter ; mais il arrivait de temps en temps aussi que mes passions orageuses reprenaient le dessus et me replongeaient dans un nouveau chaos d’agitations et de misères dont mon cœur ne pouvait se délivrer qu’en s’attachant fermement à l’espérance de quelque bonheur durable.
C’était ce bonheur que mon imagination insensée s’obstinait à chercher dans l’amour.
Diana de Marsan avait vingt ans, et ne paraissait pas moins ; car son teint vif et brillant d’ailleurs mais un peu hâlé, comme l’est en général celui des Vénitiennes, manquait de cette fraîcheur qui est à la peau d’une femme ce qu’est aux fruits recueillis sur l’arbre le duvet fugitif qui les colore. Sa taille, grande et assez robuste, donnait à son aspect quelque chose d’imposant que relevait encore l’expression ordinaire de sa physionomie. On ne savait ce qui l’emportait dans son regard triste et fier, dans le frémissement inquiet et hautain de ses sourcils, dans le mouvement méprisant et amer de sa bouche, de l’habitude d’un chagrin caché ou d’un désabusement dédaigneux. C’est ainsi que le statuaire antique a représenté cette Diane vraiment divine, que le ciseau du sculpteur a fait la digne sœur d’Apollon, comme la mythologie ; et cette impression ne m’était pas toute personnelle auprès de Diana ; car le plus accrédité des poètes de l’époque lui reprochait à la fin d’un de ses sonnets, d’être formée d’un marbre aussi froid que celui de Velletri. Diana était d’ailleurs, de l’aveu de tout le monde, la plus belle des jeunes filles de Venise.
Le cœur de l’homme, et surtout celui des amants, s’irrite par les difficultés. J’aimai Diana avec d’autant plus d’ardeur peut-être que tout me disait en elle qu’elle ne voulait pas m’aimer. Quant aux suites de ce sentiment, elles n’avaient rien qui fût capable de m’effrayer. La fortune de Diana était trop médiocre pour tenter des prétendants redoutables, et la condition d’un vieux gentilhomme français exilé au bord des lagunes ne promettait pas plus de chances à l’ambition d’un gendre qu’à sa cupidité. Ma position à venir devait au contraire s’agrandir, selon toute apparence, par le triomphe de mon parti, dont M. de Marsan ne doutait pas. J’avais tant hasardé, j’avais tant souffert, et les rois heureux sont si reconnaissants !
Diana ne se méprit pas sur la passion qu’elle m’inspirait : les femmes ne s’y méprennent jamais. Je ne m’aperçus cependant de sa découverte qu’au rembrunissement sinistre de son regard et à la mesure de plus en plus sévère qu’elle gardait envers moi dans ses paroles. Je me serais expliqué cette rigueur toujours croissante de procéder par la différence de nos conditions, car je savais déjà ce que c’est que l’orgueil de la noblesse, et comment il peut affecter les formes de la haine, si Diana eût été informée de cette circonstance, mais j’ai déjà dit que M. de Marsan tenait avec opiniâtreté à m’anoblir, et depuis le jour mémorable où j’avais reçu de lui l’ordre de chevalerie, d’un côté à l’autre d’une table de jeu, le titre de chevalier s’était tellement identifié avec le nom honorable, mais obscur, que j’ai reçu de mes ancêtres, que les Chérin et les d’Hozier n’auraient osé me le contester. Il suffit de connaître le génie hyperbolique des Vénitiens, surtout dans la classe du peuple, pour être sûr d’avance que la politesse des domestiques ne s’était pas arrêtée à si peu de chose. J’étais comte au moins à l’antichambre, et comte illustrissime, si je n’étais que tout juste aussi bon gentilhomme qu’il le fallait au salon. J’avais fini par n’y prendre plus garde, et je subissais sans façon une métamorphose qui humiliait un peu ma franchise et ma modestie, pour ne pas blesser la vanité capricieuse, mais innocente, d’un grand seigneur dans lequel j’avais trouvé un ami.
Je m’étais bien promis de commencer avec Daina par cette explication, quand elle m’aurait donné le moindre signe de condescendance à mes sentiments ; mais elle m’en épargna l’embarras. Sa froideur passa rapidement jusqu’à la rudesse, son indifférence jusqu’au dédain. Au bout de quelques jours il n’y eut plus moyen de s’y tromper, et un homme plus convaincu que je ne le fus jamais de son ascendant sur le cœur des femmes, n’aurait pas hésité à renoncer comme moi à des prétentions sans espérance. Quelques jeunes gens de Venise, mieux fondés dans leurs démarches, m’avaient déjà montré d’ailleurs l’exemple de ce sacrifice.
Je ne boudai pas. Il ne m’aurait manqué que cela pour être complètement ridicule. Je ne pleurais pas non plus. On ne pleure que lorsqu’il faut perdre l’espoir d’être uni à la femme dont on est aimé. Je m’indignai, je me révoltai contre moi-même, je me rongeai les poings de colère ; je prétextai des indispositions, des occupations, des voyages, pour expliquer la rareté de mes visites ; je jouais gros jeu, je me battis en duel, et puis je me rejetai avec frénésie dans les complots téméraires dont j’avais cru un mois plus tôt me séparer à jamais. Je me réjouis de l’idée de mourir d’une manière tragique et glorieuse, pour qu’elle eût honte de m’avoir méprisé. Je me berçai dans cette fantaisie furieuse de conspirations, de proscriptions et de supplices, comme dans un rêve d’amour et de volupté. En un mot, je redevins fou.
Nos assemblées se tenaient aux environs de Rialto, dans l’appartement le plus délabré d’un vieux palais qui était lui-même abandonné depuis longtemps, et dont je ne désignerai pas le propriétaire, que sa haute position actuelle dans une cour d’Allemagne a probablement désabusé de nos folles théories populaires. Il n’y paraissait point, mais il en avait laissé la disposition à un de nos chefs, en se retirant dans la campagne de Venise, et peut-être un peu plus loin du danger. Il est presque inutile de dire de quelle espèce d’hommes se composaient ces réunions clandestines. On peut le deviner sans avoir une grande habitude des trames politiques, et même sans s’être livré à une étude approfondie de l’histoire. Cinq ou six jeunes gens sensibles et généreux, mais aigris par les malheurs de l’humanité et par les excès des tyrans, y tenaient tout au plus une place imperceptible, et, peu à peu détrompés comme moi, ils l’occupaient de jour en jour plus rarement : le reste, c’était ce qu’est partout la foule des ennemis de l’ordre établi, quel qu’il soit ; une cohue d’ambitieux sans talents dont les prétentions s’accroissent et s’irritent en raison de leur nullité ; des hommes perdus de dettes, de mœurs et de réputation, vils rebuts du pharaon et de la débauche ; et quelques misérables cent fois plus vils encore qui n’attendent que l’occasion de vendre au premier pouvoir venu la liste de leurs complices ou de leurs victimes au prix d’un or infâme et d’une ignominieuse impunité. Ce jugement est celui que je commençais à en porter dès lors, mais il était moins général, et surtout moins arrêté dans mon esprit. Il faut avoir revu cela partout pendant le cours d’une trop longue vie, pour être arrivé à y croire.
On conviendra que mon ambition de mort n’était pas tout à fait aussi vainement présomptueuse dans une pareille assemblée que mes projets d’amour auprès de Diana. J’avais des chances, et peu d’hommes, en vérité, auraient consenti à les courir à ma place ; car le succès, presque étranger aux destinées de mon pays et à la mienne, ne devait pas même me procurer la faible satisfaction que nous donne un coup de partie dans la main d’un inconnu au jeu duquel nous nous sommes intéressés par hasard. Dans le cas contraire, c’était différent ; le bourreau emportait mon enjeu. Cette prodigalité insensée de la vie est l’effet d’une passion sans nom, qui peut se faire comprendre que de ceux qui l’ont éprouvée, et il n’y a pas de mal.
Les associations de l’espèce de la nôtre marchaient à découvert dans tout le pays où Napoléon n’avait pas daigné laisser en passant son administration et ses soldats. Elles y agissaient avec liberté, non publiquement avouées par les cabinets, qui n’avaient pas ce courage, mais flattées, enhardies et protégées sous main, avec plus d’astuce que d’habileté, moyennant une certaine réserve mentale dont il serait à souhaiter que le secret fût connu de tous les hommes sincères et dévoués qui engagent leur vie à la défense des couronnes, c’est-à-dire sauf l’intention lâchement préméditée de les sacrifier au besoin à une combinaison de paix. Cette organisation, cependant, aurait été incomplète si elle n’avait pas pénétré jusqu’au cœur des États déjà soumis au grand empereur par les victoires et les traités, et il n’était pas une ville où l’on ne trouvât les éléments nécessaires à son développement. Tel était le but de ces audacieuses propagandes de la liberté européenne qui soulevaient çà et là des barrières d’hommes contre l’oppresseur du monde ; postes aventureux d’éclaireurs jetés au-devant de la sainte coalition des peuples dans le camp de l’ennemi, et qui auraient été si puissants s’ils avaient été plus purs. J’abuse jusqu’à un certain point des privilèges du conteur, en introduisant cette page d’histoire dans un petit écrit dont la forme n’annonce qu’un roman ; mais elle ne sera comptée que pour une page de roman par quiconque n’a pas vu l’histoire de près ; et de tous les jugements qu’on en peut porter, c’est celui qui m’inquiète le moins.
Le but primitif du carbonarisme de ce temps-là, qui n’avait rien de commun avec celui dont nous voyons aujourd’hui se manifester l’œuvre informe, comme ces monstres gigantesques et hideux qui jaillirent du chaos dans les premières journées de la création, était donc certainement le plus noble qu’une conspiration pût se proposer. Il n’avait pour objet que la pieuse fédération des patriotes de tous les pays contre les progrès d’un insatiable despotisme qui aspirait sans déguisement à la monarchie universelle, et cadastrait l’Europe en préfectures pour la donner à ses capitaines. Cette pensée magnanime avait remué profondément les esprits partout où l’indépendance et le bonheur de la terre natale étaient encore tenus pour quelque chose, mais plus particulièrement l’Italie et l’Allemagne.
Le mouvement imprimé à la pensée des peuples par ces graves questions en avait soulevé d’autres. À forces de s’occuper des garanties de l’équilibre universel, on exhumait tous les jours quelques débris des libertés anciennes que les usurpations progressives du pouvoir détruisent lentement, et qui sont une propriété imprescriptible pour les nations. L’occasion était belle pour les réclamer ; et c’est alors qu’arriva ce qui n’était jamais arrivé au monde, et ce qui n’arrivera peut-être plus : une stipulation amiable, solennellement promise entre les populations et les rois, jurée dans les palais, gardée dans les chaumières, et dont les termes synallagmiques étaient, d’une part : Résistance unanime aux armées de Napoléon ; et, de l’autre : Franche et entière reconnaissance des droits politiques anciennement écrits dans tous les États de l’alliance. Il est possible que ce contrat ne se retrouve pas dans les documents officiels de la diplomatie ; et je ne vois pas que l’histoire en ait beaucoup parlé jusqu’ici. Mais l’histoire ne sait rien en France et ne dit ailleurs que ce qu’on lui fait dire, quand on lui permet de parler. Cette combinaison accidentelle d’intérêts si cruellement trahis par l’évènement, fut, du reste, beaucoup trop passagère pour être saisie dans tous ses détails par les observateurs les plus soudains et le plus avantageusement placés.
On comprend qu’elle avait donné une grande importance à la position des sociétés secrètes devenues, pour la première fois, dans le vieux système européen, une autorité légitiment qui n’aspiraient pas encore à remplacer toutes les autorités légitimes pour essayer de la tyrannie à leur tour.
Elles n’en profitèrent pas alors. La diffusion des égoïsmes, des ambitions et des vanités se fait sentir trop vite pour cela dans ces tristes conciliabules, empreints de tous les vices de la société mère dont ils se séparent. Deux mois ne s’étaient pas écoulés, que l’unité première était brisée en quatre ou cinq fractions dans la vendita suprême et dans toutes celles qui en dépendaient. L’une avait pris les termes du traité dans une acception si large, qu’elle n’entendait faire servir la victoire qu’à l’émancipation absolue du peuple, et au rétablissement de cette funeste démocratie dont Venise conservait un sanglant souvenir. L’autre, qui ne pouvait manquer de réunir la majorité en recrutant au moment décisif, par l’ascendant de l’intérêt, les hommes indécis et les hommes corrompus, avait fait bon marché à l’Autriche, par un pacte secret, de ces libertés du pays si vainement réservées. Quelques-uns passaient pour entretenir des intelligences mystérieuses avec le gouvernement de Napoléon et se ménager ainsi une transaction dorée en cas de défaite. Le parti le moins nombreux, mais certainement le plus énergique et le plus pur, n’avait engagé sa coopération intrépide et sincère que sous la condition expresse de l’indépendance des États vénitiens et de la restauration de leur ancienne république. Il s’appuyait au dehors sur l’imposante coalition des montagnards, et il avait pour chef un de ces homme ? résolus, à longue vue et à puissante exécution, dont le nom seul vaut tout un parti.
Ce chef s’appelait Mario Cinci, surnommé le Doge, et c’est à ce parti que des sympathies particulières m’avaient rattaché.
Mario Cinci descendait de cette malheureuse famille romaine dont le crime exécrable n’a cependant pas tari pour elle toutes les sources de la pitié, et qui a fourni l’exemple unique d’un supplice de parricides, arrosé des larmes de la religion, de la justice et du peuple. Le frère cadet de Béatrice, banni à perpétuité des États de l’Église, s’était réfugié dans un vieux château des bords du Tagliamente, où la tradition rapporte qu’il mourut frappé de la foudre dans un âge assez avancé. Une fatalité vengeresse s’était appesantie depuis de génération en génération sur chacun de ses descendants, dont l’histoire chronologique compose une tragédie à plusieurs actes, comme celle des Pélapides. Le dernier était mort sur l’échafaud de la révolution italienne, et de ce sang proscrit par les lois et par le ciel, il ne restait sur toute la terre que Mario Cinci.
La jeunesse de Mario, commencée sous de si funèbres auspices et privée de tout appui dans la société des hommes, avait été violente et redoutée ; il semblait même qu’aucun sentiment doux n’en eût tempéré les emportements, car la seule pensée d’être aimées de lui était un sujet de terreur pour les Vénitiennes, qui n’en parlaient qu’avec un mouvement de frisson. Il ne paraissait jamais dans les lieux publics ; mais lorsqu’il parcourait une des rues étroites de la ville, ou seul, ou tout au plus accompagné de quelques amis presque aussi mystérieux que lui-même, les hommes les plus aguerris se retiraient de son passage, comme pour se dérober à l’influence de ses regards. Cependant, et ceci était propre à ce caractère étrange, ou à je ne sais quelle sombre impression d’effroi qu’il produisait sans le savoir, on le craignait sans le haïr, ainsi qu’on craint les lions ; et il n’y a pas loin de ce sentiment à ces admirations si exaltées qui deviennent quelquefois un culte. Personne ne pouvait lui reprocher un acte injuste ou une cruauté réfléchie, et on racontait au contraire une multitude d’actions généreuses, mais exécutées sans tendresse et sans sympathie. Souvent il avait sauvé des enfants de la mort en les retirant des flots, et jamais il ne les avait embrassés.





























