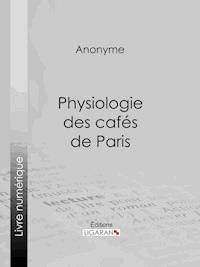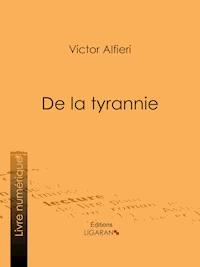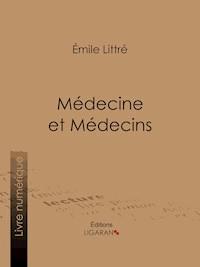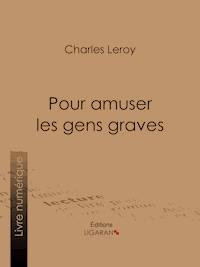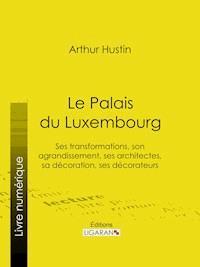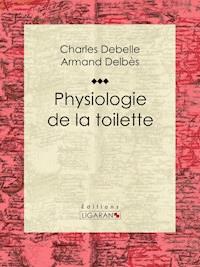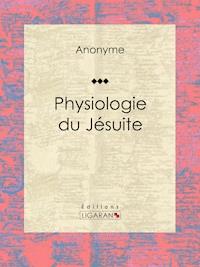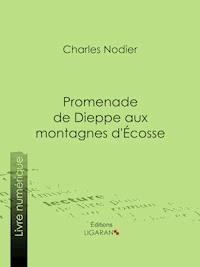
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
Extrait : "A ma femme. Je ne m'accoutume pas à l'idée d'être séparé de toi, de vivre et de penser sans toi. Chaque objet nouveau qui s'offre à ma vue me semble un vol que je te fais ; et quand je pense que tout va être nouveau pour moi, qu'il n'y aura plus une sensation commune entre les sensations multipliées de mes journées, et celles qui remplissent tes souvenirs, je regarde ce voyage avec une espèce de terreur, comme l'essai de la séparation éternelle."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN :
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de grands classiques de la littérature ainsi que des livres rares, dans les domaines suivants :
• Fiction : roman, poésie, théâtre, jeunesse, policier, libertin.
• Non fiction : histoire, essais, biographies, pratiques.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 150
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Je prie le lecteur de rejeter cette brochure s’il s’est promis de lire un voyage ; elle ne contient que les tablettes d’un homme qui passe rapidement dans un pays nouveau pour lui, et qui écrit ses sentiments plutôt que ses observations.
Aucun pays n’est plus digne de l’intérêt du voyageur que les montagnes de l’ouest et du nord de l’Écosse. Elles ont cependant inspiré si peu de curiosité aux nôtres que M. Chantreau a dédaigné d’y pénétrer. Le savant Faujas de Saint-Fond, qui ne s’occupait que de géologie, n’y a cherché et n’y a vu que des pierres. M. John Knox, dont les études purement économiques se bornaient aux pêcheries, n’a parlé que des poissons. M. Gilpin est un imagiste plutôt qu’un voyageur. Abstraction faite des préventions d’un vieillard morose dont l’imagination était depuis longtemps décolorée, il y a beaucoup de choses utiles et intéressantes dans le voyage de Samuel Johnson, comme dans tous ses ouvrages. M. Pennant lui seul a élevé un monument parfait dans toutes ses parties. Je crains que ces deux derniers auteurs n’aient pas eu chez nous les honneurs d’une traduction complète.
Il reste donc un excellent livre à faire sur l’Écosse, à moins que ce livre n’ait paru à mon insu ; mais indépendamment des qualités nécessaires pour faire un livre excellent, il faut avoir vu et revu le pays qu’on se propose de décrire, avant de pouvoir se flatter d’en donner une idée juste aux autres. Ce petit volume ne promet que ce qu’il peut donner, l’esquisse à peine ébauchée d’une promenade rapide. Puisse-t-il même donner ce qu’il promet.
Cependant, puisque mon journal est devenu une espèce d’ouvrage, et que le voilà livré aux chances d’une publicité pour laquelle je ne l’avais pas fait, je dois me mettre à l’abri d’un reproche qui me serait plus pénible que tous ceux de la critique, celui de manquer de reconnaissance envers des personnes dont nous avons reçu des marques signalées de politesse et de bienveillance, et que je me ferais un plaisir de nommer toutes, si la multiplicité des égards et des services ne rendait pas cette tâche un peu difficile : je citerai seulement parmi nos compatriotes, M. le comte de Caraman, chargé d’affaires de France en Angleterre ; M. Hugot, consul à Édimbourg ; M. Herman, agent de commerce à Glasgow ; et d’une autre part, Lord Fife, à Londres ; le général Dulf, en Écosse ; et notre inappréciable ami, M. Hulmandell, dont la sollicitude pour nos besoins et pour nos plaisirs passe toutes les expressions. J’ajouterai en mon nom à cette liste le nom du célèbre docteur Hooker qui a dirigé mes excursions dans le comté de Lennox et ses environs, et qui m’a chargé, à mon départ, d’une riche moisson de plantes rares pour notre ami commun Bory de Saint-Vincent. Celui-ci m’a aidé à son tour à débrouiller des notions presque effacées de ma mémoire, en me prêtant cette facilité d’observation et cette clarté d’analyse qui lui assignent un rang si distingué parmi nos premiers naturalistes.
Il me resterait à rendre grâces à mes compagnons de voyage de ce qu’ils ont fait pour donner à cette légère brochure le seul mérite qu’elle pût offrir au public, si je savais exprimer tout ce que je leur dois sans craindre de blesser leur modestie. Heureusement je connais assez leurs sentiments pour croire qu’ils me sauront plus de gré d’une simple expression d’amitié que des éloges les plus recherchés. M. Eugène Isabey, digne héritier d’un nom européen dont j’ose garantir qu’il soutiendra la gloire, a enrichi mon petit livre de deux de ses dessins. M. de Cailleux a bien voulu prendre sur des occupations plus importantes de beaucoup, le temps de tracer l’itinéraire de notre promenade de sept cents lieues. M. de Taylor m’a adressé la relation détaillée d’une excursion vers le Nord, beaucoup plus variée de faits et d’observations que la mienne, et qui m’est plus chère encore par l’expression des sentiments qu’il accorde à mon amitié, que par l’ornement qu’elle ajoute à mon faible écrit.
On voit qu’après cela, il me reste infiniment peu de chose dans cet ouvrage ; et c’est ce que personne ne sera tenté d’y réclamer.
Je ne m’accoutume pas à l’idée d’être séparé de toi, de vivre et de penser sans toi. Chaque objet nouveau qui s’offre à ma vue me semble un vol que je te fais ; et quand je pense que tout va être nouveau pour moi, qu’il n’y aura plus une sensation commune entre les sensations multipliées de mes journées, et celles qui remplissent tes souvenirs, je regarde ce voyage avec une espèce de terreur, comme l’essai de la séparation éternelle. Depuis douze ans, associée à toutes les vicissitudes de ma vie, tu m’as suivi dans les rigoureux pèlerinages de l’exil et dans les excursions plus agréables que m’a fait entreprendre l’amour de l’étude et des arts. Tu as visité avec moi les riantes campagnes du midi de la France ; les monuments austères de la Normandie et de la Bretagne ; les antiquités majestueuses de l’Italie ; les ruines de la grande Grèce, patrimoine inutile des barbares. Je t’ai nommé tous les lieux, qui rappelaient de fortes pensées, qui attestaient d’anciennes gloires. J’ai appris à notre chère petite fille à bégayer leurs noms solennels, dans une langue qui n’était pas celle de sa nourrice et dont les sons frappaient pour la première fois son oreille. Aujourd’hui, je suis seul ; car l’amitié est un doux auxiliaire du bonheur, mais elle laisse bien vide un cœur qui est séparé de ce qu’il a de plus cher au monde. Je suis seul, et les impressions qui avaient tant de charme quand vous les partagiez avec moi, me trouvent inattentif et presque insouciant. Les noms des sites et des hommes ne me préoccupent un instant que comme des mots inconnus qui ne valent pas la peine qu’on en demande le sens. Arrivé d’hier d’assez bonne heure à Dieppe, je ne suis allé que ce matin au bord de la mer, et j’ai à peine promené mes regards sur la scène magnifique qu’elle déploie ici ; ma fille n’a jamais cherché des coquilles sur ce rivage. Si l’on pensait à tout cela avant de partir, on ne partirait point, mais quel homme est toujours heureux d’être heureux ?
J’ai cependant trouvé un accommodement qui plaît à mon imagination : c’est de vous parler à tout moment comme si vous étiez là, et de ne rien voir, de ne rien éprouver, sans vous le transmettre tout de suite par la pensée.
« Vois-tu, Marie, comme il serait agréable de jouer avec tes petites compagnes sous ces jolies feuillées de Pavilly. Et toi, plonge tes yeux sur cette vue de Dieppe et de la mer du haut de la montagne du Bourdun, qui passe pour un des beaux spectacles de la nature ; ou bien amuse-toi des narrations merveilleuses de notre cocher qui, tout en pressant ses chevaux, raconte d’une voix enrouée les derniers exploits du corsaire Bolidar. »
C’est ainsi que vous allez voyager avec moi, jusque sur les côtes reculées où me pousse la manie de voir d’autres pays et d’étudier d’autres mœurs. Que de contrées variées d’aspects et de caractère nous allons parcourir ensemble ! Cependant nous ne prendrons pas le temps de nous appesantir sur les détails. Nous allons vite, parce que d’autres soins nous rappellent, et que notre foyer nous garde des trésors de tendresse et de bonheur qui ne sont pas ici. Puissé-je, hélas ! les retrouver ! Nous n’avons pas, d’ailleurs, la prétention d’instruire. Notre ambition se borne à jouir de ce qui est beau ; notre esprit se borne à en causer. Si le journal que je trace en courant pouvait avoir quelque mérite, ce serait tout au plus celui de représenter avec naïveté des impressions libres et naturelles. Presque étranger à la langue, à l’histoire et aux mœurs des contrées que je vais visiter, je suis sûr de moins parler des choses sur la foi de leur renommée, que sur celle de mes propres sensations. Seulement ne rebute pas mes haillons poétiques. J’écris très rapidement, et tu sais que ma première pensée s’accoutre volontiers des lambeaux de la toilette des Muses ; mais ce qui est un défaut ridicule par la prétention dans un volume d’apparat, n’est qu’un inconvénient léger dans les impromptus familiers de la négligence. L’abandon des tablettes d’un voyageur est comme celui de ses habits. On prend ce qui vient à l’esprit et ce qui tombe sous la main. Qui sait, au reste, ce que deviendront ces tablettes ? Un volume ou rien, peu m’importe. Il aura comblé tout l’espoir que je fondais sur lui, s’il réussit à tromper quelquefois le tourment de l’absence par une de ces illusions que j’embrasse avec tant de facilité, qu’elles me tiennent quelquefois lieu de bonheur.
Venez donc et ne me quittez plus, car il est huit heures du soir. La marée commence à se retirer, et déjà elle laisse, à plusieurs toises derrière elle, une bande de noirs fucus, inégale, ondoyante, sinueuse, comme la projection irrégulière des dernières vagues, de celles qui ont expiré en flots d’écume au-dessous de ce grain de sable. Nous nous embarquerons sur la corvette l’Unité, capitaine Holden, et c’est elle dont vous voyez flotter d’ici le pavillon noir et bleu.
Ou plutôt, je l’exige, séparons-nous pour cette nuit. La mer est si grosse que les pêcheurs eux-mêmes n’ont pas osé tenter la navigation journalière qui fournit à la subsistance de leur famille. La surface immense est sillonnée partout de bancs élevés et verticaux comme les falaises de la côte, éblouissants de blancheur comme elles, qui courent, se heurtent, se brisent, montent les uns sur les autres et tombent, en rugissant, sur la grève. Le vent est contraire et furieux. Le goéland, qu’il chasse avec impétuosité, resserre ses longues ailes, comme un marinier habile des voiles qui offrent trop de prise, et, abaissant peu à peu sa chute oblique, se laisse rouler jusqu’à terre. Que le ciel me préserve de vous confier, chères amies, aux caprices de ce terrible élément ! Au nom de mon repos, séparons-nous pour cette nuit. Je vous retrouverai sur l’autre rive.
À BRIGHTON.
Cette navigation, qui se fait ordinairement en dix heures, en a duré trente-deux. Il n’était pas minuit que ce nuage noir qu’on appelle le grain s’est montré comme un point dans le sud ; peu à peu il est descendu, développant des formes inégales et fondant sur nous comme un oiseau de proie qui grandit en s’approchant. Il m’a rappelé, dans son accroissement gigantesque et subit, ces bizarres figures d’optique, jeux imparfaits et souvent ridicules de la fantasmagorie, qui se précipitent de la lanterne magique de Robertson, en acquérant successivement des couleurs, des apparences, des figures, et qui finissent par expirer près du visage du spectateur en battant le papier huilé des châssis, de leurs ailes de carton découpé. Malheureusement notre démon était plus réel, et pendant longtemps il nous a fait pirouetter sur les vagues qui montaient jusqu’aux agrès. Tout tournait sur le bâtiment, les ustensiles, les meubles et l’équipage. Le roulis était si fort qu’il nous chassait de nos lits. Joignez à cela le sifflement des cordages, le craquement du vaisseau, les malédictions des passagers français, les goddem méthodiques et pour ainsi dire concentrés de nos matelots, les cris convulsifs des voyageurs atteints du mal de mer, les gémissements des dames, qui prient avec toute la ferveur que la crainte peut donner, car il y avait des dames, et de fort jolies, vraiment ; des yeux d’une mélancolie si douce, des traits d’une si chaste pureté, ce mélange de l’idéale perfection du ciel et des passions de la terre dont se compose la physionomie des héroïnes de roman… Mais il est bien question d’héroïnes de roman sur un bâtiment qui va périr ! Tout s’y réduit à cet échange de compassion et de services qui engage le fort à la défense du faible dans un danger commun, et qui est, suivant moi, lorsque ce danger est inévitable, le sceau le plus achevé de la destination immortelle de l’homme. La philosophie si vantée des anciens aboutissait à admirer l’impassibilité d’une brute pendant la tempête.
Au lever du soleil, nous nous sommes aperçus que l’orage nous avait jetés fort loin de notre direction. Il a fallu revenir à Brighton, en louvoyant, et puis attendre le vent, parce qu’il n’y avait plus de vent. Nos matelots avaient beau siffler du côté du sud-est, la brise n’en tenait compte, et il nous restait à voir la morne stupeur de l’atmosphère, l’expectative peu rassurante d’un orage nouveau qui nous remettrait en pleine mer, ou nous briserait sur ces côtes charmantes de la Grande-Bretagne, dont les contours gracieux se développaient si près de nous, chargés de vertes prairies et de bois pittoresques. Le soleil venait de se coucher dans des nuages bien sombres ; la lune s’était levée large et sanglante ; la mer était plus immobile que le bassin des Tuileries, et il nous semblait que du bras étendu nous pouvions toucher Brighton, où un de ces évènements qui ne sont pas rares dans l’histoire de la navigation, pouvait empêcher toutefois que nous arrivassions jamais. Il ne tiendrait qu’à moi de dire ici que cette situation a quelque chose de plus terrible que les anxiétés de Forage. Le cœur de l’homme, ajouterais-je, conçoit plus aisément l’obligation de céder aux bouleversements d’une nature violente, que l’impossibilité de vaincre l’inertie d’une nature immobile. Quand il souffre en résistant, sa vanité le dédommage ; quand il succombe sans combattre, il perd jusqu’aux charmes du péril, et subit un tourment de plus dans l’épuisement de son énergie abattue ; mais ce serait, en vérité, de la philosophie en pure perte à l’occasion d’un calme plat dans la Manche. D’ailleurs, le vent le plus favorable commence à souffler ; le vaisseau cingle ; les côtes fuient, emportant avec elles le fameux champ de bataille d’Hastings. Nous sommes en rade.
À quatre heures du matin, nous avons jeté l’ancre dans la racle de Brighton, car cette ville n’a point de port. La douane expédie aux bâtiments une petite barque qui vient recevoir l’équipage et les effets, et qui elle-même ne peut pas gagner immédiatement le rivage à défaut de fond. On y arrive sur les épaules robustes des matelots, et cet acte de complaisance n’est taxé qu’à la bagatelle de trois schellings par tête. Nous sommes en Angleterre où le signe représentatif de l’existence d’une famille française, pendant deux ou trois jours, ne représente rien.
Ces premiers détails seront sans doute minutieux. Ils le seraient trop pour le lecteur qui n’aurait pas la bonté de se rappeler que j’écris mon journal ; que mon journal est l’histoire de toutes mes impressions ; qu’une des plus vives qu’il me soit encore donné d’éprouver est l’aspect d’un pays nouveau, et que, longtemps voyageur aventureux et forcé dans le reste de l’Europe, je touche la terre de l’Angleterre pour la première fois.
La rade de Brighton est célèbre par ses bains de mer qui attirent tous les ans la meilleure compagnie du royaume. Elle mérite de l’être par l’élégance pittoresque de ses points de vue dont aucune expression ne peut rendre le charme, surtout quand les rayons du soleil levant se déploient peu à peu sur la face des eaux qui s’éclairent lentement ; frappent çà et là de leur lumière de longues zones de la mer qui se détachent de son obscure étendue comme des îles d’argent, ou jouent entre les voiles d’un petit bâtiment qui flotte inondé de clarté sur un plan brillant parmi des voiles innombrables que le jour n’a pas encore touchées. C’est principalement à l’horizon qu’est remarquable le mélange de l’obscurité qui finit et du jour qui commence. Toutes les ténèbres descendent, toutes les lumières s’élèvent. La terre et le firmament semblent avoir changé d’attributs. Dans les airs, une sombre vapeur se précipite et se dissout. Sur la terre, un doux reflet s’étend, en augmentant sans cesse de transparence et de chaleur ; et la ligne la plus éloignée du noir océan se relève éclatante sur les ombres du ciel.
La propreté recherchée des villes d’Angleterre est si connue, qu’en arrivant à Brighton, je m’étonnais d’être forcé de m’étonner. Qu’on suppose un assemblage de décorations pleines de grâce et de légèreté comme celles que l’imagination désirerait dans un théâtre magique, et on aura quelque idée de notre première station. Brighton n’offre d’ailleurs aucun monument digne de remarque, à moins qu’on ne donne ce nom au palais du prince régent, qui est construit dans le genre oriental, et probablement sur le plan de quelque édifice de l’Inde. Il y a peu d’harmonie entre ce style levantin et de jolies bastides à l’italienne, élevées sous un ciel septentrional ; mais c’est le sceau d’une puissance qui étend son sceptre sur une partie de l’Orient, et qui en tire ses principaux éléments de prospérité. Cette incohérence ne va pas mal, au reste, dans un tableau d’illusions. La féerie n’est pas soumise à la règle des unités.