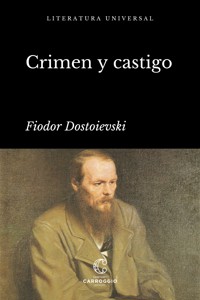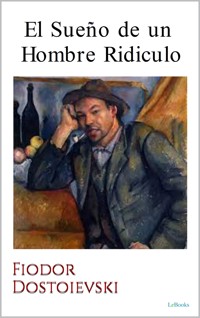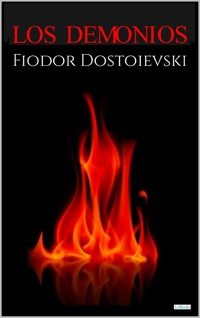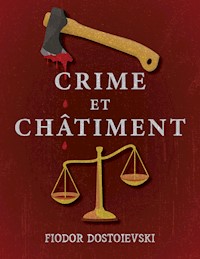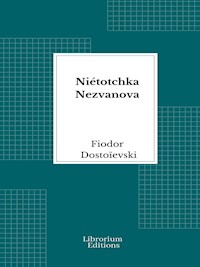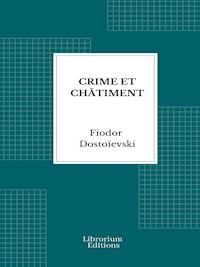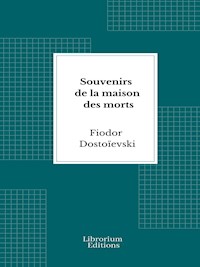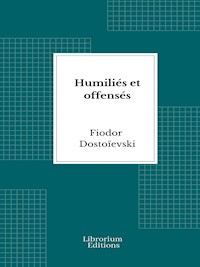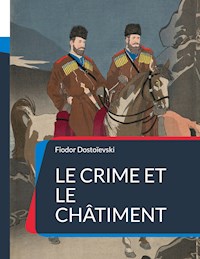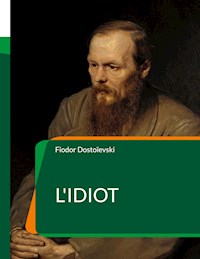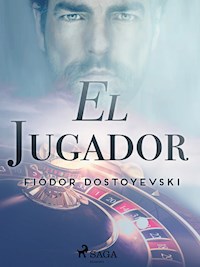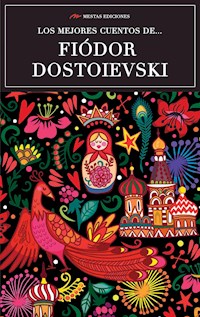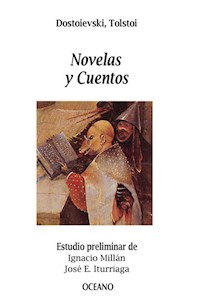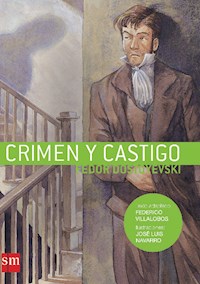Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Bibliothèque russe et slave
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Le narrateur, jeune étudiant de Saint-Pétersbourg, est appelé par son oncle dans sa propriété du village de Stépantchikovo. Toute la maisonnée semble sens dessus dessous et ne plus tourner qu'autour d'un nouveau venu : l'inénarrable Foma Fomitch. Ce roman comique et satirique publié en 1859 est le premier de Dostoïevski après ses dix années de bagne et d'exil.
Traduction intégrale d'Henri Mongault, 1947.
EXTRAIT
Lorsque mon oncle, le colonel Iégor Ilitch Rostanov, prit sa retraite, il alla se fixer dans sa terre de Stépantchikovo dont il venait d’hériter. Là, il se fit si bien à la vie de propriétaire foncier qu’il semblait n’en avoir jamais mené d’autre. On dirait certaines natures taillées pour être aisément satisfaites et s’accoutumer à tout. Notre colonel était de cette sorte. Impossible d’imaginer homme plus paisible, plus accommodant. S’il vous était venu à l’idée de vous faire porter par lui pendant une verste ou deux, je crois bien qu’il y aurait consenti. Il débordait d’une telle bonté que, parfois, on le sentait prêt à tout donner au premier venu, à tout partager, jusqu’à sa dernière chemise. C’était un homme de haute taille et bien proportionné : un vrai géant aux joues fraîches, aux dents d’ivoire, aux longues moustaches châtain sombre, à la voix puissante, sonore et franche, au rire en cascades, qui parlait d’un ton rapide et quelque peu heurté. Il atteignait alors la quarantaine et, depuis l’âge de seize ans, si je ne me trompe, toute sa vie s’était écoulée dans les hussards.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Fiodor Mikhaïlovitch Dostoïevski est un écrivain russe, né à Moscou le 30 octobre 1821 et mort à Saint-Pétersbourg le 28 janvier 1881. Considéré comme l'un des plus grands romanciers russes, il a influencé de nombreux écrivains et philosophes.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 434
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
BIBLIOTHÈQUE RUSSE ET SLAVE
— LITTÉRATURE RUSSE —
Fyodor Dostoïevski
Достоевский Фёдор Михайлович
1821 — 1881
STÉPANTCHIKOVO ET SES HABITANTS
Село Степанчиково и его обитатели
1859
Traduction de Henri Mongault, Paris, Éditions du Chêne, 1947.
© La Bibliothèque russe et slave, 2014
© Henri Mongault, 1947
Couverture : Alexandre MAKOVSKI, Paysage avec église (1900)
Chez le même éditeur — Littérature russe
1. GOGOLLes Âmes mortes. Traduction d’Henri Mongault
2. TOURGUENIEVMémoires d’un chasseur. Traduction d’Henri Mongault
3. TOLSTOÏLes Récits de Sébastopol. Traduction de Louis Jousserandot
4. DOSTOÏEVSKIUn joueur. Traduction d’Henri Mongault
5. TOLSTOÏAnna Karénine. Traduction d’Henri Mongault
6. MEREJKOVSKILa Mort des dieux. Julien l’Apostat. Traduction d’Henri Mongault
7. BABELCavalerie rouge. Traduction de Maurice Parijanine
8. KOROLENKOLe Musicien aveugle. Traduction de Zinovy Lvovsky
9. KOUPRINELe Duel. Traduction d’Henri Mongault
10. GOGOLLe Révizor — Le Mariage. Traduction de Marc Semenoff
11. DOSTOÏEVSKIStépantchikovo et ses habitants. Traduction d’Henri Mongault
12. Les Bylines russes. Édition de Louis Jousserandot
13. PISSEMSKIMille âmes. Traduction de Victor Derély
14. RECHETNIKOVCeux de Podlipnaïa. Traduction de Charles Neyroud
15. TOURGUENIEVPoèmes en prose. Traduction de Charles Salomon
PREMIÈRE PARTIE
I. INTRODUCTION
LORSQUE mon oncle, le colonel Iégor Ilitch Rostanov, prit sa retraite, il alla se fixer dans sa terre de Stépantchikovo dont il venait d’hériter. Là, il se fit si bien à la vie de propriétaire foncier qu’il semblait n’en avoir jamais mené d’autre. On dirait certaines natures taillées pour être aisément satisfaites et s’accoutumer à tout. Notre colonel était de cette sorte. Impossible d’imaginer homme plus paisible, plus accommodant. S’il vous était venu à l’idée de vous faire porter par lui pendant une verste ou deux, je crois bien qu’il y aurait consenti. Il débordait d’une telle bonté que, parfois, on le sentait prêt à tout donner au premier venu, à tout partager, jusqu’à sa dernière chemise. C’était un homme de haute taille et bien proportionné : un vrai géant aux joues fraîches, aux dents d’ivoire, aux longues moustaches châtain sombre, à la voix puissante, sonore et franche, au rire en cascades, qui parlait d’un ton rapide et quelque peu heurté. Il atteignait alors la quarantaine et, depuis l’âge de seize ans, si je ne me trompe, toute sa vie s’était écoulée dans les hussards. Marié fort jeune et devenu veuf rapidement, il gardait au cœur le souvenir ineffaçable d’une femme aimée à la folie. C’est après avoir hérité de Stépantchikovo, ce qui portait maintenant sa fortune personnelle à six cents âmes, qu’il s’était résolu, comme je viens de le dire, à prendre sa retraite pour s’installer dans sa propriété avec ses enfants. Il en avait deux, Ilioucha, un garçon de huit ans dont la naissance avait coûté la vie à sa mère, et Sacha, une fille d’une quinzaine d’années élevée, depuis le veuvage de son père, dans une pension de Moscou. Mais la maison de mon oncle ne tarda pas à rappeler l’arche de Noé ; et voici comment :
Au moment où mon oncle recueillit son héritage et prit sa retraite, sa mère, la générale Krakhotkine, devint veuve. Son mariage avec le général datait de seize ans en arrière, alors que son fils, simple cornette, songeait lui-même à prendre femme. Longtemps, tout en versant d’abondantes larmes, elle avait reproché à ce fils irrespectueux son égoïsme, son manque d’égards, son ingratitude. Et elle lui avait refusé son consentement en lui démontrant que la seule terre de deux cent cinquante âmes qu’il possédait ne suffisait déjà pas à l’entretien de sa famille (entendez par là l’entretien de sa bonne femme de mère, avec son état-major de parasites, ses carlins, roquets, chats angoras et le reste). Cependant, au beau milieu de ces imprécations et réprimandes et au moment où son fils s’y attendait le moins, elle l’avait prévenu en se mariant elle-même, malgré ses quarante-deux ans sonnés. Ce fut là pour elle, d’ailleurs, un nouveau prétexte de s’en prendre à mon pauvre oncle. Elle jura ses grands dieux qu’elle se mariait uniquement afin de trouver pour sa vieillesse l’asile que son fils lui refusait, puisqu’il poussait l’audace et l’égoïsme jusqu’à ce degré inouï : fonder un foyer pour son propre compte !
Je n’ai jamais pu savoir pour quelle raison feu le général Krakhotkine, homme de bons sens, pourtant, se résolut à épouser une veuve plus que quadragénaire. On doit supposer qu’il la croyait riche, ou bien que, comme certains l’ont dit, il sentait venir la nécessité d’une infirmière et prévoyait l’essaim de maladies qui devait fondre sur ses vieux jours. En tout cas, durant leur vie commune, le général n’eut jamais l’air de beaucoup estimer sa femme et ne perdit jamais une occasion de la tourner en ridicule. C’était un parfait original. Il manquait d’instruction, mais non d’intelligence, appliquait son esprit à dénigrer tout et un chacun, à se moquer des gens et à ne s’embarrasser d’aucun principe. Sa maladie, conséquence d’une vie plutôt irrégulière, le rendait hargneux, acerbe, implacable. Malgré une carrière brillante, un fâcheux incident l’avait contraint à prendre une brusque et peu reluisante retraite qui le privait de toute pension. Il y avait trouvé matière à s’aigrir définitivement. Presque dénué de ressources puisqu’il ne possédait qu’une centaine de serfs réduits à la misère, il ne s’en croisa pas moins les bras pour le restant de son existence. Durant les douze années qu’il vécut encore, il ne s’enquit jamais d’où venaient ses ressources et ne se soucia point de savoir qui l’entretenait ; cela ne l’empêchait nullement de mener large train, de dépenser sans compter, d’entretenir voiture et chevaux. Il perdit rapidement l’usage de ses jambes et passa ses dix dernières années dans un confortable fauteuil, roulé, quand besoin était, par deux grands flandrins de laquais, à qui leur maître n’adressa jamais que les gros mots les plus variés. Voiture, laquais et fauteuil étaient entretenus, cela va de soi, par le colonel, qui, sans cesser de s’entendre appliquer l’inévitable épithète d’égoïste et de fils ingrat, envoyait à sa mère jusqu’à son dernier sou, grevait sa propriété d’hypothèques, se privait du nécessaire, s’enfonçait jusqu’au cou dans des dettes hors de proportion avec sa fortune du moment. Mais mon oncle était ainsi fait ; il avait fini par se persuader du bien-fondé des reproches de sa mère et multipliait pour s’en punir les envois d’argent réclamés. La générale professait pour son mari un véritable culte, mais ce qui la ravissait le plus en lui, c’était certainement son grade qui lui valait, à elle, le titre de générale.
Elle possédait dans la maison son appartement particulier, où elle vivait à part de son podagre de mari, parmi ses parasites caquetants et sa ménagerie de chats et de chiens. Elle faisait figure dans sa petite ville. Les baptêmes et les noces où elle trônait comme marraine, les commérages, les parties de « préférence » à un kopeck la fiche, et surtout le respect que lui valait son titre lui apportaient un ample dédommagement aux vexations de sa vie domestique. C’était chez elle que les rapporteuses patentées de la ville apportaient d’abord la fleur de leurs nouvelles ; partout et toujours, elle se voyait réserver la place d’honneur ; bref son généralat lui valait tous les avantages possibles. Et le général laissait faire ; toutefois, en public, il ne ménageait pas à sa femme les outrages les plus sanglants ; il se demandait par exemple pourquoi il s’était embarrassé de cette grosse dondon sans que personne s’avisât de protester. Peu à peu, le vide se faisait autour de lui, et pourtant il ne pouvait se passer de société ; il avait besoin de bavarder et de discuter ; c’était un libertin, un athée à l’ancienne mode qui ne dédaignait pas les sujets élevés et qui avait besoin d’un auditoire.
Mais dans la bonne ville de N*** on ne s’intéressait guère à ce genre de matières, et les auditeurs du général une fois éclipsés, on essaya d’organiser chez lui des parties de whist familiales ; mais ces jeux de cartes se terminaient d’ordinaire pour le général dans de tels accès de fureur que sa femme et ses suivantes, prises d’une panique sans nom, brûlaient des cierges à tous les saints, faisaient dire des messes, se tiraient les cartes, cherchaient des présages dans les fèves, allaient distribuer des aumônes aux prisonniers et n’en attendaient qu’en tremblant davantage l’heure fatidique de l’après-midi où il leur faudrait de nouveau affronter un whist-préférence et où la moindre faute leur vaudrait des cris, des hurlements, des injures, voire des coups. Dans ses moments de contrariété, le général perdait toute retenue ; il braillait comme une vachère et jurait comme un cocher ; parfois, il mettait en pièces les cartes et les jetait par terre, puis chassait ses partenaires en pleurant de rage et de dépit, pour un simple valet joué à la place du neuf. Sur la fin, sa vue s’étant affaiblie, il lui fallut un lecteur. C’est alors qu’apparut Foma Fomitch Opiskine.
J’avoue que je présente mon nouveau personnage avec une certaine solennité, mais il a sans contredit dans mon récit un rôle de premier plan ; inutile d’expliquer pourquoi il a droit à l’attention : je trouve plus décent, plus commode aussi, de laisser le lecteur résoudre la question.
Foma Fomitch entra tout bonnement chez le général Krakhotkine en qualité de parasite — ni plus, ni moins. D’où sortait-il ? Un voile épais enveloppe encore ses origines. J’ai cependant cherché à recueillir quelques renseignements sur le passé de cet homme curieux. On m’a affirmé qu’il avait fait figure de fonctionnaire pendant quelques années et qu’il avait souffert quelque part pour « l’idée ». On m’a dit aussi qu’à Moscou il s’était essayé à la littérature. La chose n’a rien qui surprenne. L’ignorance crasse de Foma Fomitch ne pouvait aucunement être un vice rédhibitoire dans cette carrière. Ce qui est tout à fait certain, c’est que, d’avatar en avatar, il échoua enfin auprès du général en qualité de lecteur et de souffre-douleur. On peut dire qu’il paya cher le pain qu’on lui accorda et qu’aucune humiliation ne lui fut épargnée. Cependant, par la suite, après la mort du général, quand Foma devint inopinément un personnage d’importance, il nous affirma plus d’une fois que, s’il avait condescendu au rôle de bouffon, c’était par générosité pure, pour faire un noble sacrifice à l’amitié : le général, son protecteur, grand homme incompris, ne confiait qu’à lui, Foma, ses pensées les plus secrètes ; si donc, parfois, le malheureux prenait quelque plaisir à lui voir imiter des animaux ; s’il lui demandait des tableaux vivants, n’était-ce pas un devoir de procurer cette distraction à un ami infirme perclus de douleurs ? Mais ces assertions de Foma sont fort sujettes à caution ; pourtant, on ne saurait nier que s’il jouait les bouffons auprès du général son rôle dans l’appartement des dames prenait un tout autre aspect. Comment s’y était-il pris ? un profane aura du mal à le comprendre. La générale lui avait voué, pour des raisons d’ailleurs inconnues une vénération quasi mystique. Grâce à cela, il prit peu à peu un ascendant extraordinaire sur l’élément féminin du logis, ascendant assez semblable à celui qu’exercent les Ivan Iakovlévitch et autres illuminés sur les caillettes, leurs admiratrices, toujours prêtes à leur rendre visite au fond de leurs cabanons. Il contait à ces dames sa vie et ses exploits, leur faisait des lectures édifiantes, leur commentait avec une éloquence mouillée de larmes les différentes vertus du christianisme, les accompagnait à la messe et même aux matines ; quelquefois, il leur prédisait l’avenir, mais ce qui lui convenait le mieux était d’expliquer les songes et de médire du prochain. Le général avait deviné la vie qu’il menait dans l’appartement de derrière et n’en tyrannisait son protégé qu’avec plus de dilection. Mais tant de tourments avaient pour effet de rehausser le prestige de Foma aux yeux de la générale et de sa suite.
Enfin donc, tout changea de face. Le général passa de vie à trépas, et cela d’une manière plutôt originale. Ce libertin, cet athée envahi par une frayeur incroyable se mit à se lamenter, à confesser ses fautes, à réclamer prêtre sur prêtre, image sainte sur image sainte. On l’administra ; on récita à son intention force prières. Le pauvre diable n’en hurlait pas moins qu’il ne voulait pas mourir ; à un certain moment même, les larmes aux yeux, il demanda pardon à Foma Fomitch — circonstance qui devait par la suite fournir audit Foma de quoi jeter force poudre aux yeux. Cependant, voici ce qui se passa à la minute même où l’âme du général allait prendre congé de sa dépouille mortelle. Prascovie Ilinitchna, ma tante, fille du premier lit de la générale, ne s’était pas mariée et vivait dans la maison du général. Depuis dix ans que celui-ci avait perdu l’usage de ses jambes, elle était un de ses souffre-douleur attitrés ; son beau-père ne pouvait se passer d’elle ; seule, à force de patience, de douceur, de dévouement, elle arrivait à le contenter. Elle s’approcha du lit tout éplorée et voulut arranger un oreiller sous la tête de l’agonisant ; mais ledit agonisant la saisit par les cheveux et, trois fois de suite en écumant presque de rage, il trouva encore moyen de tirer sur ses tresses. Dix minutes plus tard, il était mort. La générale déclara aussitôt qu’elle refusait de voir le colonel et qu’elle aimait mieux mourir que de l’admettre en sa présence dans un moment pareil. Malgré cela, il fut quand même prévenu tout de suite. Les obsèques furent somptueuses et payées, bien entendu, par ce fils indigne de paraître sous les yeux de sa mère.
Au bourg de Kniazevka, domaine laissé à l’abandon, indivis entre plusieurs propriétaires, dont le général pour une centaine d’âmes, s’élève maintenant un mausolée de marbre blanc recouvert d’inscriptions à la louange du défunt, toutes célébrant à l’envi son esprit, ses talents, sa magnanimité, sans oublier ses ordres et son grade, Foma Fomitch n’a pas laissé de prendre une part active à ce travail épigraphique.
Quant à la générale, elle se fit longtemps prier avant d’accorder son pardon à son fils. Entourée de ses roquets et de ses femmes, elle répétait, non sans lamentations et pleurnicheries, qu’elle mangerait du pain sec « arrosé de ses larmes » et s’en irait appuyée sur un bâton mendier sous les fenêtres plutôt que d’accéder à la demande du « rebelle ». Elle n’accepterait pour rien au monde l’hospitalité qu’il lui offrait à Stépantchikovo. Non, jamais, au grand jamais, elle ne mettrait les pieds dans cette maison-là. Le mot « pieds » employé dans ce sens est l’un de ceux dont certaines dames tirent un effet surprenant. La générale s’en servait avec un art consommé. Bref, l’éloquence coulait à flots ; mais, malgré les criailleries, les préparatifs de départ suivaient leur cours.
Pendant quinze jours, le colonel faisait quasi quotidiennement les quarante verstes qui séparaient son domaine de la ville, et il avait tous ses chevaux fourbus lorsqu’il reçut enfin l’autorisation de paraître sous les regards courroucés de sa mère. Foma Fomitch s’était chargé des négociations. Durant cet intervalle, il ne cessa d’accabler le fils rebelle de reproches au sujet de sa conduite « barbare » ; il lui fit honte jusqu’aux larmes, jusqu’au désespoir. C’est de cette époque précisément que date l’influence despotique inouïe, inconcevable prise sur mon pauvre oncle par Foma Fomitch. Il devina à quel genre d’homme il avait affaire, sentit aussitôt son rôle de bouffon terminé et se dit que dans le royaume des aveugles les borgnes sont rois. Il tenait sa revanche et la prit belle.
— Vous serez bien avancé, disait-il, si votre propre mère, l’auteur de vos jours, s’en va demander l’aumône en appuyant sur un bâton ses mains tremblantes et desséchées par la faim ! Quelle chose monstrueuse, en premier lieu à cause de son titre de générale, en second lieu à cause de ses vertus ! Et quelle honte n’éprouverez-vous pas le jour où, par erreur, naturellement, mais cela peut arriver, elle viendra mendier à votre porte tandis que vous, fils indigne, à ce moment-là même, peut-être, vous vous vautrerez dans la plume, et, et... enfin dans l’opulence ! Horreur, horreur ! Mais le plus terrible, permettez-moi de vous le dire sans ambages, colonel, c’est de vous voir planté là devant moi comme une souche, la bouche bée et les yeux clignotants. Cela frise l’indécence. Voyons, à la seule idée de ce qui peut survenir, vous devriez vous arracher les cheveux jusqu’au dernier et verser des ruisseaux — que dis-je, des ruisseaux ! — des torrents, des lacs, des océans de larmes !...
Bref, Foma s’emporta si bien qu’il perdit le fil de son discours. Mais c’était l’aboutissement ordinaire de son éloquence. Comme bien on pense, la générale, accompagnée de ses femmes et de ses chiens, de Foma Fomitch et de Mlle Pérépélitsyne, sa confidente en titre, finit par honorer Stépantchikovo de sa présence. À entendre la bonne dame, elle tenait seulement à mettre son fils à l’épreuve et ne voulait que se rendre compte de la déférence qu’il lui témoignerait.
On imagine la situation du colonel au cours de cette expérience ! Tout d’abord, son récent veuvage obligeait la générale à évoquer deux ou trois fois par semaine la mémoire du cher disparu et à donner libre carrière à son désespoir ; comme à point nommé et sans motif apparent, elle s’en prenait alors au colonel. Parfois, quand il y avait des visiteurs, elle faisait asseoir auprès d’elle son petit-fils Ilioucha et sa petite-fille Sacha, couvait d’un regard pathétique ces pauvres enfants affligés d’un tel père, poussait des soupirs à fendre le cœur et répandait en silence durant une grande heure et plus des larmes mystérieuses. Malheur au colonel s’il ne savait pas « comprendre » ces larmes-là. Le cher naïf ne le savait presque jamais. Il arrivait toujours au moment fatidique pour en être témoin et pour subir bon gré mal gré l’examen maternel. Cependant sa déférence ne faisant que croître au lieu de s’éteindre, la générale et Foma Fomitch se sentirent à tout jamais garantis de l’orage qui avait si longtemps grondé sur leurs têtes du vivant du général Krakhotkine. Il arrivait à la brave dame de s’affaler sur un divan et de tomber en pâmoison. Alors, c’était un beau remue-ménage. Le colonel anéanti tremblait comme la feuille.
— Fils dénaturé, criait la générale en reprenant ses sens, tu me déchires jusqu’au fond des entrailles ! Ah !... mes entrailles, mes entrailles !1
— Qu’ai-je bien pu faire pour vous déchirer ainsi ? demandait timidement le colonel.
— Il me déchire les entrailles... et il ose encore se justifier ! Quelle rusticité ! Quelle cruauté !... Je me meurs !
Quand le colonel avait tout a fait perdu la tête, la générale, bien entendu, reprenait goût à la vie. Une demi-heure plus tard, si son fils rencontrait quelqu’un, il l’attrapait par un bouton de sa veste pour lui expliquer :
— Tu comprends, mon cher, c’est une grande dame, une générale ! Elle a un cœur d’or, ma vieille mère, mais ses habitudes sont trop raffinées pour qu’elle puisse s’entendre avec un lourdaud de ma sorte. La voilà fâchée contre moi... J’ai dû l’offenser... Je ne saurais dire en quoi, mais je suis dans mon tort, c’est certain.
Dans ces cas-là, Mlle Pérépélitsyne, créature hargneuse, plus que mûre et portant postiches, aux petits yeux voraces dénués de sourcils, aux lèvres plus minces qu’un fil, aux mains blanchies au lait de concombre, estimait devoir sermonner le colonel.
— Tout cela, monsieur, vient de votre manque de tact. Vous êtes tellement égoïste que cela offense madame votre mère. Elle n’est pas habituée à des façons pareilles. Vous oubliez trop qu’elle est générale et vous, seulement colonel.
— C’est Mlle Pérépélitsyne, expliquait le colonel à son auditeur. Une excellente personne qui se jetterait au feu pour maman ! Oui, une bien digne demoiselle ! Ne la prends pas pour n’importe qui ; son père était lieutenant-colonel, mon cher ! C’est quelque chose, qu’en dis-tu ?
Mais, bien entendu, tout cela n’était encore que roses. Cette même générale, qui se jouait de son fils avec une telle abondance de moyens, tremblait à son tour comme une souris devant son ancien protégé. Foma Fomitch l’avait complètement ensorcelée. Elle ne respirait que par lui, ne voyait que par ses yeux, n’entendait que par ses oreilles. Un de mes petits cousins, lui aussi hussard en retraite, homme jeune encore mais criblé de dettes à un degré inimaginable et contraint pour cette raison de se réfugier quelque temps chez mon oncle, ne m’a point celé ses convictions. À son dire, des rapports illicites existaient entre la générale et Foma Fomitch.
J’ai aussitôt repoussé avec indignation pareille hypothèse, trop grossière et même naïve. Non, il y avait autre chose, comme le lecteur pourra le voir lorsque je lui aurai expliqué le caractère de Foma Fomitch, tel qu’il me fut donné de le comprendre par la suite.
Imaginez-vous l’individu le plus insignifiant, l’esprit le plus étroit, un de ces rebuts de la société, un de ces bons à rien, une de ces âmes viles chez qui aucune qualité ne rachète, hélas ! la haute opinion, à la fois irritable et maladive, qu’ils ont d’eux-mêmes. Je tiens à prévenir mes lecteurs que Foma Fomitch est une personnification de l’amour-propre fielleux autant que démesuré, particulier aux nullités absolues, de cet amour-propre envenimé par les échecs, recuit dans les humiliations, qui sue son hideux venin par tous les pores à la moindre rencontre, au moindre succès d’autrui. Inutile de dire que cela est assaisonné de la plus extravagante susceptibilité et de la méfiance la plus soupçonneuse. On me demandera d’où peut provenir une pareille infatuation et comment elle peut se développer chez d’aussi pitoyables individus, qui, de par la place même qu’ils occupent dans la société, devraient être renseignés sur leur propre néant ?
Que répondre à cela ? N’y aurait-il point parmi eux des exceptions, au nombre desquelles figurerait mon héros ? C’est tout justement le cas, comme la suite va le prouver. Laissez-moi néanmoins vous poser une question : êtes-vous sûrs que ces gens qui semblent résignés, qui semblent heureux et flattés de vous servir de bouffons, de parasites et de flagorneurs ; êtes-vous bien sûrs qu’ils aient dit adieu à tout amour-propre ? Songez un peu aux jalousies, aux commérages, aux délations, aux murmures étouffés qui s’échappent des recoins de vos maisons et du bas bout de vos tables !...
Qui sait si chez quelques-unes de ces tristes épaves dont vous faites des paillasses et des histrions, l’amour-propre ne se développe pas démesurément en raison même de la bassesse de leur état, de leur subordination forcée, de leurs complaisances ravalantes ? Qui sait si leur vanité monstrueuse ne dérive pas du juste sentiment de leur propre dignité bafouée, de leur dignité pervertie dans son germe par la misère, la fange et l’oppression, viciée peut-être dès l’enfance par la vue des parents, victimes eux aussi d’un sort fatal ?
Quoi qu’il en soit, Foma Fomitch, comme je viens de l’insinuer, constitue une exception à la règle générale. Et il en était bien une. Il y avait longtemps de cela ; mais l’aspic de la vanité littéraire fait parfois des piqûres si profondes qu’elles en sont incurables, surtout parmi les sots. Mortifié dès son premier pas, Foma Fomitch s’était joint à jamais à l’innombrable phalange des mortifiés, cette phalange d’où sortent tant de détraqués, de batteurs de pavé, d’anormaux bizarres. C’est de ce moment, me semble-t-il, que date chez lui cette vantardise prodigieuse, cette soif de louanges et d’hommages, ce besoin d’être prôné, exalté, mis à part. Même dans l’abaissement de son rôle de pitre, il sut se faire admirer par un cercle d’idiots. Tenir le premier rôle n’importe où et n’importe comment, grimacer, fanfaronner, vaticiner, telle était sa vraie vocation ! Si personne ne le flattait, il s’en chargeait lui-même. Bien en pied à Stépantchikovo, alors qu’il était le maître et le prophète dans la maison de mon oncle, je me souviens de l’avoir entendu proférer avec une gravité pleine de mystère : « Moi, je ne suis pas fait pour rester ici ! Non, je ne m’y éterniserai pas ! Après vous avoir éduqués, catéchisés et morigénés comme il se doit, adieu ! Je pars pour Moscou fonder une revue. Je vais donner des cours où j’aurai au bas mot trente mille auditeurs, pas moins. Mon nom sera célèbre, enfin ! Alors, malheur à mes ennemis ! »
Il avait souffert d’être méconnu en tant qu’homme de lettres ; et la littérature — méconnue cela va de soi — peut mener à leur perte de plus malins que lui. Je n’en sais rien, mais j’incline à penser qu’il avait déjà subi auparavant bien des déboires ; peut-être, en d’autres carrières, avait-il reçu moins d’honoraires que de camouflets, ou pis encore. C’est là pure supposition de ma part. Cependant, d’après les recherches auxquelles je me suis livré, j’ai acquis la certitude que Foma a, en effet, durant son séjour à Moscou, composé un roman semblable à ceux qui s’y pondaient journellement à la douzaine au cours des « années trente », un de ces Moscou délivré, de ces Capitaine Tempête, de ces Fils de l’amour ou les Russes en l’an 1104, et autres productions analogues qui excitaient alors la verve du baron Brambeus2.
Mais ce génie qui supputait la gloire exigeait en attendant une récompense immédiate. Rien n’est plus agréable que d’être payé d’avance, surtout en pareil cas. Il avait raconté à mon oncle avec un imperturbable sérieux la faribole que voici :
Lui, Foma, avait été créé et mis au monde à seule fin d’accomplir une mission grandiose. Nuit après nuit, cette mission lui était rappelée par un personnage ailé. Cette mission consistait à écrire un profond ouvrage d’édification, qui ferait sur la Russie entière l’effet d’un tremblement de terre. Alors, après ce bouleversement de la Russie, lui, Foma, méprisant toute gloire, irait s’enterrer au plus profond des caveaux du fameux monastère de Kiev afin de prier nuit et jour pour la prospérité de la patrie. Mon oncle s’était laissé prendre à ces billevesées.
Maintenant, imaginez-vous le changement opéré en Foma, l’éternel bafoué, l’éternel vaincu, l’éternel battu peut-être ; — Foma l’égoïste et le sensuel refoulé, Foma, gratte-papier méconnu et bouffon à gages, Foma, âme despote que n’a maté aucune abjection, Foma le fanfaron, Foma l’effronté, quand il se vit soudain au comble des honneurs, adulé, choyé par une protectrice idiote et par un protecteur débonnaire qu’il fascinait. Et ce protecteur lui offrait un asile sûr après toutes ses pérégrinations ! Je me vois obligé ici d’expliquer plus en détail le caractère de mon oncle ; on ne comprendrait point sans cela le succès de Foma Fomitch à Stépantchikovo. Pourtant, le gaillard avait de quoi justifier le dicton qui veut que « pourceau prié à dîner mette les pieds dans le plat ». Il s’entendait à regagner le temps perdu ! Toute âme basse qu’on cesse d’opprimer opprime à son tour. Foma, qui avait subi le joug, ne se faisait pas faute d’imposer son joug à autrui ; on l’avait berné, il entendait berner lui aussi ; on l’avait obligé à faire le saltimbanque, il voulait avoir lui aussi ses totons ! Et son caractère véritable de se donner carrière dans des fanfaronnades sans frein, des caprices impossibles à satisfaire, une tyrannie de tous les instants, un tel comble d’extravagances que les braves gens qui n’en avaient pas encore été témoins se refusaient à y ajouter foi. Ils voyaient là un piège du Malin, se signaient à tour de bras et crachaient de côté pour conjurer le mauvais sort.
Mais revenons à mon oncle. Il faut, je le répète, connaître à fond son caractère pour comprendre la tyrannie qu’exerça chez lui Foma Fomitch et la métamorphose de ce bouffon en grand personnage. C’était sous une écorce un peu rude un homme d’une bonté extrême, d’une délicatesse infinie, d’une noblesse parfaite, d’un courage à toute épreuve. J’insiste sur le mot « courage ». Rien ne l’arrêtait en présence d’un devoir. En dépit de la quarantaine sonnée, il gardait la fraîcheur d’âme d’un enfant. Expansif de nature, et d’une gaieté qui ne désarmait pas, il était toujours prêt à mettre le bien où il n’y en avait pas ; il voyait des anges partout, s’accusait des défauts du prochain, exaltait les qualités de tout le monde. Il était un de ces grands, de ces chastes cœurs qui rougissent de supposer le mal où que ce soit, qui parent les gens de toutes les vertus et se réjouissent de leurs succès, qui vivent continuellement dans un monde idéal et ne s’en prennent qu’à eux-mêmes des échecs qu’ils rencontrent. Se sacrifier aux intérêts de leurs semblables, voilà leur unique vocation.
Pour cette cause, certains verront en mon oncle un caractère sans consistance, un homme peu réfléchi et veule. Sans doute était-il conciliant jusqu’à la faiblesse, mais non faute d’énergie, plutôt par crainte de froisser les gens et de se montrer brutal, par respect pour autrui et par souci d’humanité. D’ailleurs son manque d’énergie se manifestait surtout quand il devait défendre ses propres intérêts, qu’il sacrifia toute sa vie d’un cœur léger, malgré les sarcasmes de ceux même qu’il obligeait avec une complète abnégation. Ce qui lui paraissait invraisemblable c’était d’avoir des ennemis — et il en avait, pourtant. Il craignait le bruit et les cris plus que le feu, et pour éviter les disputes il consentait à tout. Sa bonhomie délicate et pudique le rendait soumis, le poussait à « contenter tout le monde », ainsi qu’il se hâtait de l’avouer pour couper court à tout reproche de faiblesse.
Inutile d’insister sur le fait que s’il pouvait subir toute noble influence, il pouvait aussi devenir la proie d’un habile drôle et se laisser entraîner par lui en quelque fâcheuse affaire pour peu qu’on la lui présentât sous les couleurs d’une bonne action. Il eut à cet égard à se repentir plus d’une fois d’une confiance qui ne connaissait point de bornes. Cependant, chaque fois qu’il devait reconnaître avoir affaire à un malhonnête individu, chaque fois qu’il était dupé, il en venait, après de douloureux combats, à s’accabler de reproches. Figurez-vous maintenant sa paisible demeure livrée soudain à une vieille capricieuse, retombée en enfance, entichée d’un autre idiot, une vieille qui jusqu’alors n’a craint que son général et qui, désormais, ne craint plus personne ; et cette vieille qui comptait prendre sa revanche du passé, mon oncle croyait devoir la révérer pour la bonne raison qu’elle était sa mère ! D’abord, on fit toucher du doigt au pauvre homme sa grossièreté, son manque d’égards, ses mauvaises façons, son égoïsme révoltant. La vieille était assez toquée pour croire au bien-fondé de ces reproches et, ma parole, Foma Fomitch y croyait aussi, en partie du moins. On ancra ensuite dans l’esprit de mon oncle la conviction que Foma lui était envoyé par Dieu en personne pour mettre un frein à ses passions et pour sauver son âme. Hautain et infatué de ses richesses comme il l’était, ne serait-il point enclin à reprocher à Foma le pain qu’il lui donnait ? Mon pauvre oncle ne fut pas long à mesurer la profondeur de ses péchés, à s’arracher les cheveux de désespoir et à implorer son pardon.
— C’est ma faute, disait-il à qui voulait l’entendre ; ma faute, ma très grande faute ! On doit redoubler de délicatesse envers les gens qu’on oblige... C’est-à-dire, non, obliger n’est pas le mot, ma langue a de nouveau fourché... Je n’oblige pas Foma, c’est lui qui me rend service en consentant à vivre sous mon toit ! Et on dirait que je lui reproche le pain qu’il mange !... mais non, je ne le lui reproche pas ! j’ai laissé échapper un mot malheureux comme cela m’arrive trop souvent... Et puis, que voulez-vous, c’est un homme qui a beaucoup souffert, qui s’est sacrifié ; il a supporté pendant dix ans les pires humiliations de la part de son ami malade ; tout cela mérite bien une récompense !... Et quel puits de science ! C’est un écrivain, mon cher ! Le plus noble des hommes, vous dis-je !...
À l’idée du docte et malheureux Foma en butte aux caprices d’un hargneux cacochyme, le noble cœur de mon oncle se fondait de pitié, se gonflait d’indignation. Il attribuait invariablement toutes les bizarreries de Foma, toutes ses incartades, toute son aigreur aux souffrances, aux humiliations que le pauvre diable avait naguère endurées. Dans la générosité de son âme, il s’était dit dès le début qu’un martyr a droit à plus d’indulgence que l’homme ordinaire, qu’on doit non seulement lui pardonner, mais surtout s’appliquer à le réconforter, à le réconcilier avec l’humanité, à panser ses plaies par la douceur. Une fois cette tâche assignée, il s’enflamma pour elle et, dans son zèle aveugle, se trouva désormais incapable de se douter que son nouvel ami n’était en tout et pour tout qu’un égoïste, un extravagant, un fainéant, un goinfre, un balourd. Mon oncle avait une foi aveugle dans la science et le génie de Foma. J’allais oublier de dire qu’il professait pour les mots « science » et « littérature » un enthousiasme d’autant plus naïf et désintéressé qu’il n’avait lui-même jamais rien appris.
C’était là un de ses travers caractéristiques, bien innocent, d’ailleurs.
— Il écrit un ouvrage ! disait-il parfois en marchant sur la pointe des pieds dans une chambre que deux autres pièces séparaient du cabinet de travail de Foma Fomitch. Je ne sais trop quoi, vous comprenez, mon cher, ajoutait-il avec fierté d’un ton mystérieux, mais ce sera certainement de la fameuse drogue..., dans le bon sens du mot, s’entend. Pour eux, ces choses-là, c’est clair comme de l’eau de roche, tandis que pour nous autres, pauvres diables, ce n’est que du charabia... Enfin, Foma s’occupe là de je ne sais quelles forces productrices, il me l’a dit. Sans doute se mêle-t-il de politique ! Oui ! et son nom fera du bruit ! Nous serons tous célèbres à cause de lui ! Ça, il me l’a affirmé plus d’une fois !
Ce que je sais positivement, c’est que mon oncle dut raser ses magnifiques favoris châtains sur l’ordre de Foma qui lui trouvait ainsi un air français et lui reprochait son manque de patriotisme. Peu à peu, Foma s’immisçait dans la gérance de la propriété. Il donnait de sages conseils, qui avaient tout bonnement de quoi effarer. Les paysans ne tardèrent pas à comprendre qui était le véritable maître et de quoi il retournait dans Stépantchikovo ; aussi les voyait-on se gratter la nuque avec perplexité. J’avoue avoir surpris à dessein plus tard un entretien de Foma Fomitch avec eux ; ne nous avait-il pas déclaré qu’il prenait plaisir à deviser avec le sage moujik ? Cette fois-là donc, il était allé rejoindre les paysans sur l’aire ; d’abord, lui qui ne savait pas discerner le blé de l’avoine, il leur parla semailles et moissons ; puis il leur fit une courte homélie sur leurs devoirs sacrés envers leur seigneur ; ensuite il effleura, bien entendu, sans y comprendre lui-même ni a ni b, la théorie de l’électricité et celle de la répartition du travail ; après cela, il expliqua à son auditoire comment la terre tourne autour du soleil, si bien que, tout à fait attendri par son éloquence, il se mit à faire des allusions à nos ministres. Cela n’est pas pour surprendre. Pouchkine ne raconte-t-il pas l’histoire d’un jeune père qui pour inculquer à son fils, gamin de quatre ans, une haute idée de sa vaillance, lui répétait sur tous les tons « Vois-tu, petit, ton papa est si brave que chacun l’admire, même l’empereur ! » Ce jeune père avait besoin d’un auditeur de quatre ans comme Foma Fomitch, des paysans qui l’écoutaient avec une docilité servile.
— Dis donc, notre monsieur, est-ce que le tsar te payait cher ? lui demanda soudain un petit vieux aux cheveux blancs, qui s’avança parmi les moujiks. C’était Archippe surnommé le Court qui croyait évidemment flatter ainsi Foma Fomitch ; mais la question parut trop familière à celui-ci, qui détestait la familiarité.
— Cela ne te regarde pas, espèce de Paechter3, répliqua-t-il en toisant le bonhomme avec mépris. Rentre une peu ta binette, hein ! si tu ne veux pas que je crache dessus.
C’est sur ce ton que Foma Fomitch aimait à deviser avec « le sage paysan russe ».
— Que veux-tu, notre bienfaiteur ! renchérit un autre, nous, on sait rien de rien. On peut pas deviner si tu es un major, ou un colonel, ou une Excellence, pour te donner ton titre.
— Paechter, répéta Foma Fomitch, mais d’un ton radouci. Il y a salaire et salaire, espèce d’ébouriffé. Certains ont le grade de général et ne touchent jamais un sou : le tsar n’a pas à payer ceux qui ne font rien ! Quant à moi, c’est une autre paire de manches ; quand je travaillais au ministère, j’avais vingt mille roubles par an, mais je n’y touchais pas, je faisais mon service pour l’honneur, car ma fortune personnelle me suffisait complètement. Tout ce que j’ai gagné a passé à l’Instruction publique et aux victimes de l’incendie de Kazan4.
— Oh, oh ! Alors, c’est toi qui as reconstruit Kazan, notre bon monsieur ! s’exclama le même paysan tout ébaubi.
Foma Fomitch avait le don d’ébaubir les gens de la campagne.
— Mon Dieu, oui, j’ai fait ce que j’ai pu ! répondait-il d’assez mauvaise grâce, comme s’il regrettait de s’être commis avec « pareil individu ».
Avec mon oncle, les entretiens prenaient un autre tour.
— Voyons, qu’étiez-vous donc autrefois ? demandait par exemple Foma en se calant dans un confortable fauteuil, après un repas copieux. À quoi ressembliez-vous, je vous le demande un peu ? continuait-il tandis qu’un domestique planté derrière lui l’émouchait avec un rameau de tilleul. C’est moi qui ai fait tomber dans votre âme une étincelle du feu céleste. Elle doit y brûler maintenant. Voyons, ai-je ou non jeté dans votre âme une étincelle du feu sacré ? Répondez si c’est oui ou si c’est non !
En réalité, Foma Fomitch ne savait pas lui-même pourquoi il posait cette question. Mais le silence et l’embarras de mon oncle avaient pour effet immédiat de lui échauffer la bile. Naguère si endurant et si résigné, il prenait feu à la moindre contradiction. Le mutisme de mon oncle lui semblait un outrage ; déjà il lui fallait une réponse à tout prix.
— Répondez donc, à la fin ! L’étincelle brûle-t-elle en vous, oui ou non ?
Mon oncle se mordait les lèvres tout penaud, sans trouver de réponse.
— Permettez-moi de vous faire remarquer que j’attends ! insistait Foma d’un ton acerbe.
— Mais répondez donc, Iégor, intervenait la générale en haussant les épaules.
— Je demande si l’étincelle brûle en vous, oui ou non, réitérait Foma d’un ton condescendant ; et il prenait un bonbon dans la bonbonnière placée à portée de sa main par ordre de la générale.
— Je n’en sais, ma foi, rien ! laissait enfin tomber mon oncle en jetant à Foma un regard désespéré. Cela se peut bien après tout... Mais ne me le demande pas, je dirai encore des bêtises...
— Parfait ! Alors, à votre idée, je suis trop peu de chose pour que vous vous donniez la peine de me répondre. Eh bien ! admettons qu’il en soit ainsi ! Admettons que je sois une mazette !
— Voyons, Foma, qu’est-ce qui te prend ? Je n’ai jamais voulu dire ça !
— Si, c’est justement ça que vous avez voulu dire.
— Je te jure bien que non !
— Parfait ! Admettons que je sois un menteur, admettons que je cherche exprès une querelle ! Qu’importe une insulte de plus ou de moins ! Je suis fait pour tout supporter, moi...
— Mais, mon fils... protestait la générale consternée.
— Voyons, Foma, voyons, maman ! s’exclamait à son tour mon oncle désespéré. Je vous jure mes grands dieux que je ne pensais pas à mal... C’est ma langue qui doit avoir encore fourché !... Ne fais pas attention à ce que je dis, Foma, tu sais bien que je suis une vieille bête et que j’ai une case qui manque... Oui, oui, Foma, je comprends, n’insiste plus ! continuait-il avec un geste d’impuissance. Pendant quarante ans, jusqu’au moment où je t’ai connu, j’ai crû être un homme, oui, un homme convenable... Je ne sentais pas que j’étais un abominable pécheur, un abject animal, un égoïste sans frein, et qu’avec un tel poids de méchanceté la terre avait de la peine à me porter !
— Pour égoïste, vous l’êtes, approuvait Foma Fomitch, satisfait dans son amour-propre.
— Oui, oui, moi-même, j’en suis maintenant certain, mais patience ! Je vais me corriger et devenir meilleur.
— Que Dieu vous entende ! concluait Foma Fomitch en poussant un pieux soupir et en se levant pour aller faire sa sieste. Car Foma Fomitch faisait toujours un petit somme après le repas.
Pour terminer ce chapitre, qu’on me permette d’expliquer les rapports que j’entretenais avec mon oncle et de dire pour quelle raison je fus soudain mis en présence de Foma Fomitch, puis entraîné dans le tourbillon des plus grands événements qui se soient jamais déroulés dans le bienheureux domaine de Stépantchikovo. Cette conclusion donnée à mon préambule, j’entrerai dans le vif du récit.
J’étais fort jeune lorsque je devins tout à fait orphelin. Ce fut mon oncle qui me servit de père et même davantage, car il fit pour moi ce que les pères ne font pas toujours. Dès le jour même où il me recueillit, je m’attachai à lui de tout mon cœur. J’avais alors une dizaine d’années, mais cela ne nous empêcha pas de nous entendre au mieux. Nous jouions à la toupie ensemble. Ensemble nous dérobâmes le bonnet d’une de nos vieilles parentes, dame fort acariâtre ; et ce bonnet, je l’attachai aussitôt à la queue d’un cerf-volant que je lâchai dans les airs. Bien des années plus tard, je revis mon oncle à Pétersbourg, où je terminais mes études grâce à ses libéralités. Cette fois-là, je me donnai à lui avec toute l’ardeur de la jeunesse. Comme chacun, j’avais été conquis par le mélange de noblesse, de douceur, de franchise, de gaieté, de naïveté qui enchantait au plus haut degré dans son caractère. Au sortir de l’université je demeurai dans la capitale où, tout désœuvré que je fus, je me croyais, comme nombre de blancs-becs, appelé à faire de grandes choses. Je n’avais simplement aucune envie de m’en aller. Je n’écrivais que de rares lettres à mon oncle, et à seule fin de lui demander les subsides qu’il ne me refusait jamais. Cependant, un de ses domestiques, venu à Pétersbourg pour affaires, me laissa entendre qu’il se passait à Stépantchikovo des choses bizarres. Cela m’intrigua et je me mis à écrire plus souvent. Mon oncle me répondit par des lettres réticentes dans lesquelles il ne parlait, comme à dessein, que de mes études et de mes succès futurs, dont il s’enorgueillissait par avance. Soudain, après un assez long silence, je reçus de lui une missive extraordinaire qui n’avait plus aucun rapport avec les précédentes. Elle était farcie d’allusions si étranges et de contradictions si flagrantes que tout d’abord je n’y compris rien. Celui qui l’avait écrite se trouvait de toute évidence sous l’influence d’une extrême émotion. Une chose seule y était claire : mon oncle me demandait, me priait, me suppliait d’épouser au plus tôt sa pupille, fille d’un très modeste fonctionnaire de province nommé Iéjévikine, et qui, élevée par ses soins dans un excellent pensionnat de Moscou, servait maintenant d’institutrice à ses enfants. Mon oncle écrivait qu’elle avait lieu de se plaindre du sort, que cette jeune fille me devrait le bonheur si je l’épousais, que ce serait là une action généreuse. Il faisait appel à la noblesse de mon cœur et promettait de doter sa pupille. Sur ce dernier point il s’exprimait d’ailleurs avec quelque réticence et terminait en m’adjurant de garder sur tout cela le secret le plus absolu. Cette lettre me mit dans un tel état que je faillis en perdre la tête. Quel jeune homme arrivé au terme de ses études, comme moi à ce moment-là, n’eût pas été séduit par une pareille proposition, ou du moins par son côté romanesque ? De plus, j’avais ouï dire que cette petite institutrice était ravissante. Pourtant, je n’aurais su me résoudre à quoi que ce fût. Je me bornai à annoncer à mon oncle ma prochaine arrivée ; il avait d’ailleurs joint à sa lettre l’argent du voyage. Mais mon indécision, voire mon anxiété tenaient tant de place que je m’attardai encore trois semaines. Tout à coup, un hasard me mit alors en présence d’un ancien camarade de régiment de mon oncle, homme d’un certain âge, fort sensé et célibataire endurci. Dans le voyage qu’il venait de faire du Caucase à Pétersbourg, il s’était arrêté à Stépantchikovo. Il me parla de Foma Fomitch avec indignation et me mit au courant d’une circonstance qui m’était encore totalement inconnue. Foma Fomitch et la générale avaient formé le projet de marier mon oncle à une vieille fille bizarre, aux trois quarts toquée, dont la biographie était extravagante ; mais elle apporterait en dot quelque cinq cent mille roubles. La générale avait déjà réussi à convaincre cette étrange personne qu’elles étaient parentes et à l’installer au cœur de la place ; si bien que mon oncle, tout désespéré qu’il fut, finirait par épouser le demi-million. Enfin, les deux fortes têtes de la maison — la générale et Foma Fomitch — avaient organisé une persécution en règle contre la pauvre institutrice sans défense et cherchaient par tous les moyens à la faire déguerpir, cela pour éviter que le colonel ne tombât amoureux d’elle ou peut-être parce qu’il l’était déjà. Cette dernière idée me frappa extrêmement. Toutefois j’eus beau insister afin de savoir si mon oncle était amoureux pour de bon, mon interlocuteur ne put ou ne voulut pas me donner à ce sujet de réponse précise ; il semblait répugner à me confier toute cette affaire et à me fournir des détails. Ces nouvelles formaient un contraste si grand avec la lettre de mon oncle et ses propositions que ma perplexité redoubla. Il n’y avait plus une minute à perdre, et cette fois je hâtai mon départ. J’étais bien résolu à remonter le moral de mon oncle et à le sauver si possible ; c’est-à-dire à chasser Foma Fomitch, qui avait comploté ce mariage odieux avec une vieille fille sans cervelle ; persuadé enfin que le prétendu amour du colonel n’était qu’une invention tracassière de Foma Fomitch, je prendrais parti pour l’infortunée mais intéressante jeune personne et lui offrirais ma main, etc., etc. Je donnai si bien libre cours à mon imagination que, l’inexpérience et l’oisiveté aidant, je sautai bientôt d’un extrême à l’autre : ma perplexité disparut pour faire place à l’exaltation, au désir brûlant d’accomplir des actes méritoires. Je me vis dans la peau d’un héros magnanime qui se sacrifie noblement au bonheur d’une créature angélique et délicieuse. Bref, je fus, il m’en souvient, durant tout le trajet fort satisfait de ma petite personne. C’était en juin, par un beau soleil clair ; des champs de blé mûrissant s’étendaient à perte de vue. J’avais été si longtemps claquemuré dans Pétersbourg que je croyais voir pour la première fois la divine nature dans sa réalité.
1. Tous les passages en italique sont en français dans le texte. (N. d. t.)
2. Ces noms de fantaisie parodient les titres à panache des romans pseudo-historiques à la Walter Scott dus à la plume facile des Zagoskine, des Lajetchnikov, des Massalski, des Marlinski, etc... et dont se moqua fort agréablement le critique Senkovski, qui signait du pseudeonyme de Baron Brambeus ses célèbres feuilletons du Cabinet de lecture. (N. d. t.)
3. En allemand : fermier. Foma Fomitch aime à faire parade, surtout devant les simples, des quelques mots étrangers qu’il connaît. (N. d. t.)
4. La ville de Kazan fut ravagée par deux terribles incendies, en 1842 et en 1848. (N. d. t.)
II. MONSIEUR BAKHTCHÉIEV
J’APPROCHAIS déjà du terme de mon voyage. En traversant la petite ville de B***, qui n’est qu’à dix verstes de Stépantchikovo, je dus arrêter ma voiture chez un forgeron établi à deux pas de la barrière, pour faire embattre le bandage qui venait de sauter à l’une de mes roues avant. Pour les dix verstes qui me restaient à faire, je n’avais besoin que d’une réparation de fortune et je résolus d’attendre sur place qu’elle fût terminée. Dès que j’eus sauté hors de mon tarantass, j’aperçus un gros monsieur, arrêté là pour des raisons analogues. Depuis une grande heure, il rageait en plein soleil et talonnait, à force de cris et de jurons, les artisans en train de s’affairer autour de sa très belle voiture. Au premier regard, ce monsieur en fureur me fit l’effet d’un fameux bourru. Il était de taille moyenne, extrêmement bouffi, grêlé, et pouvait avoir dans les quarante-cinq ans. Sa corpulence, ses bajoues, son double menton décelaient la bonne vie désœuvrée du gentilhomme campagnard. Ce qui frappait le plus dans sa personne était un je ne sais quoi de féminin. Il semblait à l’aise dans son costume, large, pratique, décent, mais taillé à l’ancienne mode.
J’ignore comment, moi qui le voyais pour la première fois et ne lui avais pas encore adressé la parole, je pus attirer son courroux ; toujours est-il que, lorsque je mis pied à terre, j’essuyai ses regards furibonds. Cependant quelques mots échappés à ses domestiques m’ayant fait comprendre qu’il venait de Stépantchikovo, je crus l’occasion belle de satisfaire ma curiosité en liant conversation avec lui. Vite, je soulevai ma casquette et risquai une remarque bien tournée sur les désagréments que présentent en voyage les arrêts forcés ; mais le gros homme dont je grillais de faire la connaissance me toisa de la tête aux bottes, grommela je ne sais quoi avec un dédain rageur et, pour toute réponse, me tourna fort lourdement le dos. La partie de sa personne qu’il offrait ainsi à ma vue pouvait être un champ d’expérience fertile, mais ne se prêtait guère à la conversation ; en tout cas, le geste du gros monsieur prouvait qu’il ne tenait guère à se montrer aimable envers moi.
— Grichka, as-tu fini de ronchonner, oui ou non ? C’est une rossée que tu veux ? cria-t-il soudain à son valet de chambre comme s’il n’avait pas entendu ma réflexion sur les embarras de voyage.
Ce « Grichka » était un vieux serviteur à cheveux blancs, porteur d’une redingote à pans démesurés et de favoris à n’en plus finir. Lui aussi était fortement irrité ; on pouvait le mesurer à ses grognements et à certains signes. Maître et valet aussitôt s’expliquèrent.
— Une rossée ! Faudrait voir ça ! As-tu fini de gueuler ! bougonna Grichka entre ses dents, mais assez haut pour être entendu de tout le monde.
Et, dans sa rage, il se détourna pour fourgonner au fond de la calèche.
— Hein ? quoi ? quoi ? qu’as-tu dit ? que je peux gueuler ? hurla le gros homme pourpre d’indignation.
— Vous n’arrêtez pas de tracasser les gens, aussi... Pas moyen de placer un mot !
— Ah ! Elle est bien bonne ! Vous l’entendez ? Quand monsieur ronchonne, j’ai tout juste le droit de me taire, n’est-ce pas ?
— Je ronchonne pas, moi !
— Pas possible ! tu ne grognes pas ! Veux-tu que je te dise : tu rages parce que je suis parti avant le dîner.
— Je m’en fiche, du dîner ! Vous pouvez bien vous passer de manger si bon vous semble. C’est pas contre vous que je grogne, c’est contre les charrons.
— Les charrons ? et où t’ont-ils mordu ?
— Nulle part, c’est à cause de la voiture.
— La voiture ? qu’est-ce qu’elle t’a fait ?
— Elle n’avait pas besoin de se détraquer, puisqu’elle allait bien ; faudrait pas que ça la reprenne, c’est pas un coup à faire.
— Laisse la voiture tranquille ! C’est à moi que tu en as. Toi, tu as beau être dans ton tort, tu n’en conviens jamais.
— Dites, monsieur, allez-vous me laisser tranquille à la fin, s’il vous plaît !
— Pas avant que tu m’aies dit pourquoi tu n’as pas pipé un mot de tout le chemin, et pourquoi tu fais une tête pareille ?
— Une mouche m’est entrée au fond du gosier, na ! D’ailleurs, c’est pas à moi de vous raconter des histoires, c’est à Mélanie. Si vous aimez tant qu’on vous en dise, pourquoi ne l’emmenez-vous pas à ma place ?