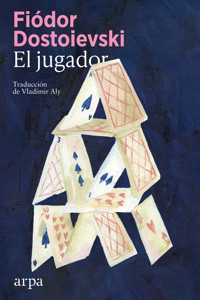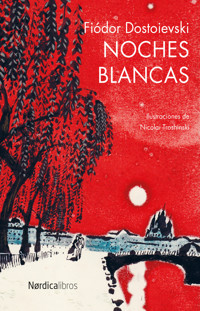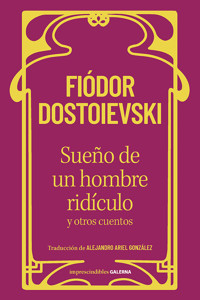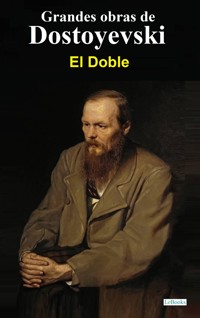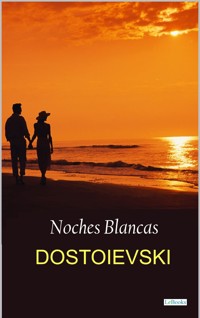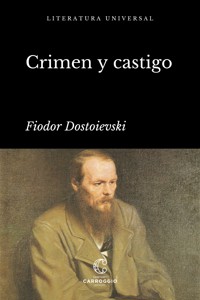Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Bibliothèque russe et slave
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
À Roulettenbourg, ville d'eau imaginaire d'Allemagne au casino réputé, le jeune Alexeï est dévoré par son amour pour Pauline, la belle-fille d'un général dont il est l'employé. Ce livre, écrit et dicté par Dostoïevski en moins d'un mois pendant la rédaction de
Crime et châtiment, décrit les tourments d'un homme plongé dans la passion insurmontable d'une femme et du jeu, qu'il a lui-même vécus.
Traduction intégrale d'Henri Mongault, 1928.
EXTRAIT
Me voici enfin revenu après deux semaines d’absence. Les nôtres sont déjà depuis trois jours installés à Roulettenbourg. Je croyais qu’ils m’attendaient comme le Messie, mais je me trompais. Le général, qui avait une allure fort dégagée, m’a parlé de haut et renvoyé à sa sœur. Il est clair qu’ils ont réussi à emprunter de l’argent. Et même il m’a paru que le général évitait mon regard. Marie Philippovna, fort affairée, ne m’a dit que quelques mots ; elle a pourtant pris et compté l’argent et écouté mon rapport jusqu’au bout. On attendait pour dîner Mézentsov, le Francillon et un Anglais. Bien entendu, dès qu’on a de l’argent, on donne un grand dîner : habitude moscovite. De prime abord Pauline Alexandrovna m’a demandé pourquoi j’avais tant tardé. Et sans attendre ma réponse, elle s’est aussitôt retirée. Évidemment elle l’a fait exprès. Il faut pourtant que nous nous expliquions. J’en ai lourd sur le cœur.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Fiodor Mikhaïlovitch Dostoïevski est un écrivain russe, né à Moscou le 30 octobre 1821 et mort à Saint-Pétersbourg le 28 janvier 1881. Considéré comme l'un des plus grands romanciers russes, il a influencé de nombreux écrivains et philosophes.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 255
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
BIBLIOTHÈQUE RUSSE ET SLAVE
— LITTÉRATURE RUSSE —
Fyodor Dostoïevski
Достоевский Фёдор Михайлович
1821 — 1881
UN JOUEUR
Игрок
1866
Traduction d’Henri Mongault, Paris, Gallimard, 1938.
© La Bibliothèque russe et slave, 2014
© Henri Mongault, 1928, 1938
Couverture : Jean-Eugène BULAND, Le Tripot (1883)
Chez le même éditeur — Littérature russe
1. GOGOLLes Âmes mortes. Traduction d’Henri Mongault
2. TOURGUENIEVMémoires d’un chasseur. Traduction d’Henri Mongault
3. TOLSTOÏLes Récits de Sébastopol. Traduction de Louis Jousserandot
4. DOSTOÏEVSKIUn joueur. Traduction d’Henri Mongault
5. TOLSTOÏAnna Karénine. Traduction d’Henri Mongault
6. MEREJKOVSKILa Mort des dieux. Julien l’Apostat. Traduction d’Henri Mongault
7. BABELCavalerie rouge. Traduction de Maurice Parijanine
I
ME voici enfin revenu après deux semaines d’absence. Les nôtres sont déjà depuis trois jours installés à Roulettenbourg. Je croyais qu’ils m’attendaient comme le Messie, mais je me trompais. Le général, qui avait une allure fort dégagée, m’a parlé de haut et renvoyé à sa sœur. Il est clair qu’ils ont réussi à emprunter de l’argent. Et même il m’a paru que le général évitait mon regard. Marie Philippovna, fort affairée, ne m’a dit que quelques mots ; elle a pourtant pris et compté l’argent et écouté mon rapport jusqu’au bout. On attendait pour dîner Mézentsov, le Francillon1 et un Anglais. Bien entendu, dès qu’on a de l’argent, on donne un grand dîner : habitude moscovite. De prime abord Pauline Alexandrovna m’a demandé pourquoi j’avais tant tardé. Et sans attendre ma réponse, elle s’est aussitôt retirée. Évidemment elle l’a fait exprès. Il faut pourtant que nous nous expliquions. J’en ai lourd sur le cœur.
On m’a donné une petite chambre au cinquième. On sait à l’hôtel que j’appartiens « à la suite du général ». Tout porte à croire qu’ils ont réussi à se faire voir. Tout le monde ici tient le général pour un grand seigneur russe très riche. Avant le dîner il a eu le temps de me donner, entre autres commissions, deux billets de mille francs à changer. Je les ai changés au bureau de l’hôtel. On va maintenant nous croire millionnaires, pendant huit jours tout au moins. J’ai voulu conduire Michel et Nadine à la promenade et j’étais déjà dans l’escalier lorsque le général m’a fait demander : il avait trouvé bon de s’enquérir où j’emmenais les enfants. Cet homme ne peut décidément pas me regarder en face : il le voudrait bien, mais à chaque tentative je lui renvoie un regard si droit, c’est-à-dire si peu respectueux, qu’il paraît perdre contenance. En phrases grandiloquentes, entortillées, dont il finit par perdre le fil, il m’a donné à entendre que notre promenade devait avoir lieu dans le parc, le plus loin possible du casino. En fin de compte il s’est fâché et m’a déclaré brusquement :
— Sinon vous seriez bien capable de mener les enfants à la roulette. Excusez-moi, a-t-il ajouté ; je sais que vous êtes plutôt léger et susceptible de vous laisser entraîner à jouer. En tout cas, quoique je ne sois ni ne désire être votre mentor, j’ai bien le droit de souhaiter que vous ne me compromettiez point...
— Vous oubliez, lui ai-je tranquillement rétorqué, que je n’ai pas d’argent ; il en faut pour perdre au jeu.
— Je vais vous en donner, me répliqua le général qui rougit légèrement.
Il fouilla dans son bureau, consulta un calepin : il me devait environ cent vingt roubles.
— Comment allons-nous faire ? me demanda-t-il. Il faut les convertir en thalers. Prenez toujours cent thalers et ne vous inquiétez pas du reste.
Je pris l’argent sans mot dire.
— Surtout ne prenez pas mes paroles en mauvaise part ; vous êtes tellement susceptible... Si je vous ai fait cette remarque, c’était un simple avertissement, et je crois avoir le droit...
En rentrant dîner avec les enfants, j’ai rencontré toute une cavalcade. Les nôtres étaient allés voir je ne sais quelles ruines. Deux calèches superbes, des chevaux magnifiques ! Mlle Blanche2 occupait une des calèches avec Marie Philippovna et Pauline ; le Francillon, l’Anglais et notre général les accompagnaient à cheval. Les passants s’arrêtaient et contemplaient le cortège ; l’effet était produit ; mais le général ne se tirera pas d’affaire. J’ai calculé qu’avec les quatre mille francs que j’ai rapportés et ceux qu’ils ont pu emprunter, ils doivent avoir maintenant de sept à huit mille francs ; c’est trop peu pour Mlle Blanche.
Mlle Blanche est aussi descendue dans notre hôtel en compagnie de sa mère ; notre Francillon également. Les garçons l’appellent : Monsieur le comte ; la mère de Mlle Blanche se fait appeler : Madame la comtesse. Après tout ils sont peut-être comte et comtesse.
Je me doutais bien que M. le comte ne me reconnaîtrait pas à l’heure du dîner. Bien entendu le général n’a même pas songé à nous présenter ou tout au moins à me nommer à lui, et M. le comte, qui a séjourné en Russie, sait quel mince personnage est un outchitel3, comme ils disent. D’ailleurs, il me connaît fort bien. Mais à vrai dire, on ne m’attendait point ; le général avait, je crois, oublié de donner des ordres ; sans cela il m’eût certainement renvoyé à la table d’hôte. Je me suis présenté de moi-même, ce qui m’a valu un coup d’œil mécontent du général. La bonne Marie Philippovna m’a aussitôt indiqué une place ; mais la rencontre de Mr. Astley m’a tiré d’affaire et, bon gré mal gré, je me suis trouvé faire partie de leur société.
Cet Anglais est un original. J’ai fait sa connaissance en Prusse, dans un compartiment où nous étions assis en face l’un de l’autre, alors que je rejoignais nos gens ; puis je l’ai rencontré à la frontière française et enfin en Suisse, soit deux fois en quinze jours ; et voici maintenant que je le retrouve à Roulettenbourg. Je n’ai jamais vu d’homme aussi timide ; il l’est jusqu’à la bêtise, et il ne l’ignore point, car il n’est certes pas bête. Il est d’ailleurs charmant et modeste. Lors de notre première rencontre en Prusse, j’ai réussi à le faire parler. Il m’a dit qu’il avait voyagé cet été au Cap Nord et désirait beaucoup visiter la foire de Nijni-Novgorod. Je ne sais comment il a fait la connaissance du général ; il me paraît amoureux fou de Pauline : à son entrée il a rougi comme un coquelicot. Il s’est montré fort heureux de m’avoir pour voisin de table et me tient déjà, je crois, pour un de ses intimes.
À table, le Francillon a outrageusement posé ; il traite tout le monde de haut. À Moscou, au contraire, autant qu’il m’en souvienne, il jetait de la poudre aux yeux. Il a beaucoup parlé finances et politique russe. Le général s’est parfois permis de le contredire, mais fort modestement, juste assez pour sauvegarder son prestige.
J’étais d’humeur bizarre. Bien entendu, dès avant le milieu du dîner, je m’étais déjà posé mon éternelle question : « Pourquoi suis-je collé à ce général, pourquoi ne les ai-je pas quittés depuis longtemps » ? Parfois je jetais une œillade à Pauline Alexandrovna ; elle ne m’accordait pas la moindre attention. Finalement la colère me gagna et je me résolus à un éclat.
Je commençai par me mêler à voix haute à la conversation. Je cherchais surtout une prise de bec avec le Francillon. M’adressant au général — je crois même l’avoir interrompu — je lui fis remarquer que, cet été, les Russes ne pouvaient guère prendre leurs repas à table d’hôte. Le général me jeta un regard étonné.
— Pour peu que vous vous respectiez, continuai-je, vous essuierez des avanies. À Paris, sur le Rhin, en Suisse même, les tables d’hôte sont à ce point encombrées de Polonais et de leurs bons amis les Francillons qu’un Russe n’arrive pas à placer un mot.
Je m’exprimais en français. Le général me fixait toujours, ne sachant s’il devait se fâcher ou seulement se montrer surpris de mon manque de tact.
— On vous aura sans doute donné une leçon, me jeta de haut le Francillon.
— À Paris, répliquai-je, j’ai eu une altercation avec un Polonais, puis avec un officier français qui le soutenait. Mais une partie des Français s’est rangée de mon côté, en m’entendant raconter comment j’ai failli cracher dans le café d’un monsignor.
— Cracher ? s’étonna le général avec hauteur ; il promena même son regard autour de la table. Le Francillon m’enveloppa d’un coup d’œil méfiant.
— Parfaitement, répondis-je. Deux jours entiers, j’ai cru que le soin de vos affaires m’appellerait peut-être à Rome. Je me suis donc rendu à la nonciature pour y faire viser mon passeport. J’y fus reçu par un petit abbé d’une cinquantaine d’années, maigre et glacial, qui me pria d’attendre d’un ton poli mais fort sec. J’étais pressé ; pourtant je m’assis et, tirant de ma poche l’Opinion nationale, me pris à lire un article fort outrageant pour la Russie. Cependant je m’aperçus qu’on avait, par une pièce voisine, introduit quelqu’un près de monsignor ; je vis mon abbé se confondre en salutations. Je lui renouvelai ma requête ; il me réitéra — plus sèchement cette fois — d’avoir à attendre. Au bout d’un moment, un nouvel arrivant, un Autrichien, je crois, fut également conduit sans délai au premier étage. Fort vexé, je m’en fus tout droit à l’abbé et lui déclarai péremptoirement que, puisque monsignor recevait, il pouvait bien expédier mon affaire. Mon abbé recula, stupéfait : comment un rien du tout de Russe osait-il se comparer aux hôtes de monsignor ? Le plus insolemment du monde, comme heureux de pouvoir m’offenser, il me toisa de la tête aux pieds et s’écria : « Croyez-vous donc que monsignor va planter là son café pour vous recevoir ? » Alors je m’écriai, moi aussi, mais plus fort que lui : « Eh ! je me moque pas mal du café de votre monsignor ! Je crache dedans ! Si vous n’en finissez pas tout de suite avec mon passeport, j’irai le trouver moi-même. — Comment ! quand il reçoit un cardinal ! » s’exclama l’abbé en reculant épouvanté jusqu’à la porte, où il étendit les bras en croix pour me faire comprendre qu’il mourrait plutôt que de me laisser passer. Je lui rétorquai qu’étant hérétique et barbare je me moquais de tous les archevêques, cardinaux, monsignori, etc... Bref je me montrai intraitable. L’abbé me lança un regard haineux, m’arracha mon passeport et l’emporta au premier. Au bout d’une minute, il était visé. Voulez-vous le voir ?4
Je tirai mon passeport et montrai le visa pontifical.
— Permettez..., voulut dire le général.
— Vous avez bien fait de vous déclarer hérétique et barbare, ricana le Francillon. Cela n’était pas si bête.
— Dois-je donc prendre exemple sur nos Russes, qui n’osent souffler mot et sont prêts à renier leur nationalité ? Je vous assure qu’à Paris, tout au moins dans mon hôtel, on m’a accordé beaucoup plus d’attention, quand on fut au courant de ma dispute avec l’abbé. Un gros Polonais, celui de tous les pensionnaires qui me témoignait le plus d’hostilité, passa au second plan. Les Français me laissèrent même raconter qu’il y a deux ans j’ai vu un personnage sur qui, en 1812, un chasseur français avait tiré, pour le simple plaisir de décharger son fusil. C’était alors un bambin de dix ans dont la famille n’avait pas eu le temps de quitter Moscou.
— Impossible ! s’emporta le Francillon. Les soldats français ne tirent pas sur les enfants.
— Et cependant, répliquai-je, c’est la pure vérité. Je tiens le fait d’un honorable capitaine en retraite, et j’ai vu sur sa joue la trace de la blessure.
Le Français se mit à parler avec volubilité. Le général voulut le soutenir, mais je lui recommandai de parcourir, par exemple, les Mémoires du général Pérovski5, prisonnier des Français en 1812. Finalement, pour rompre les chiens, Marie Philippovna aborda un autre sujet. Le général se montra très mécontent de moi, car le Français et moi nous en étions déjà aux cris. Par contre notre dispute parut plaire beaucoup à Mr. Astley : en se levant de table, il m’offrit de prendre avec lui un verre de vin.
Le soir, à la promenade, je pus avoir avec Pauline Alexandrovna un entretien d’un quart d’heure. Tout le monde était parti au casino à travers le parc. Pauline s’assit sur un banc en face du jet d’eau et permit à Nadine d’aller jouer non loin de là avec de petits camarades. Je laissai aussi aller Michel et nous demeurâmes seuls.
Bien entendu, nous parlâmes d’abord affaires. Pauline se fâcha tout de bon en me voyant ne lui remettre que sept cents florins. Elle était persuadée qu’à Paris j’avais pu engager ses diamants pour deux mille florins ou même davantage.
— Il me faut de l’argent coûte que coûte, me déclara-t-elle ; autrement je suis perdue.
Je lui demandai ce qui s’était passé en mon absence.
— Rien du tout sauf que nous avons reçu deux nouvelles de Pétersbourg : tout d’abord que « grand’mère » était gravement malade, puis, deux jours plus tard, qu’elle serait morte. Nous tenons ce dernier avis de Timothée Pétrovitch, qui passe pour fort exact, ajouta Pauline. Nous attendons maintenant confirmation définitive.
— Ainsi donc tout le monde attend.
— Oui, tout le monde ; c’est depuis six mois le seul espoir.
— Et vous aussi, vous espérez ? demandai-je.
Mais je ne lui suis point du tout parente, je ne suis que la belle-fille du général. Cependant je sais qu’elle ne m’oubliera pas dans son testament.
— Il me semble que vous hériterez d’une jolie somme, dis-je avec assurance.
— Oui, elle m’aimait bien ; mais pourquoi cela vous semble-t-il ?
— Et dites-moi, répliquai-je en la questionnant à mon tour, notre marquis me paraît, lui aussi, au courant de tous ces secrets de famille ?
— En quoi cela vous intéresse-t-il ? me rétorqua Pauline avec un regard sévère.
— Mais, si je ne me trompe, le général a déjà trouvé moyen de lui emprunter de l’argent ?
— Vous êtes bon devin.
— Croyez-vous donc que, s’il avait ignoré l’état de la baboulineka, il eût desserré les cordons de sa bourse ? Avez-vous remarqué que, pendant le dîner, parlant de la grand’mère, il l’a par trois fois appelée : la baboulineka ? Quelle touchante familiarité !
— Vous avez raison ! Dès qu’il apprendra que j’hérite moi aussi, il demandera aussitôt ma main. C’est ce que vous vouliez savoir.
— Je croyais que c’était depuis longtemps chose faite ?
— Vous savez parfaitement que non ! s’emporta Pauline. — Où avez-vous rencontré cet Anglais ? reprit-elle après une minute de silence.
— J’étais sûr que vous alliez me questionner à son sujet.
Je lui racontai mes précédentes rencontres avec Mr. Astley.
— Il est timide et facilement enflammable, ajoutai-je ; et, bien entendu, le voilà déjà amoureux de vous ?
— Oui, il est amoureux de moi, avoua Pauline.
— Il est dix fois plus riche que le Français. Celui-ci a-t-il quelque fortune ? Est-ce vraiment hors de doute ?
— Tout ce qu’il y a de plus hors de doute. Il possède un château. Le général me l’a affirmé, pas plus tard qu’hier. Cela vous suffit-il ?
— À votre place je n’hésiterais pas à épouser l’Anglais.
— Pourquoi ? demanda Pauline.
— Le Français est plus beau, mais c’est un vil personnage ; outre son honnêteté, l’Anglais est dix fois plus riche.
— Oui, mais outre son marquisat, le Français est plus intelligent, m’objecta-t-elle le plus tranquillement du monde.
— Est-ce bien vrai ? continuai-je sur le même ton.
— Tout ce qu’il y a de plus vrai.
Mes questions déplaisaient fort à Pauline ; je compris qu’elle désirait m’irriter par le ton et l’étrangeté de sa réponse ; je le lui dis aussitôt.
— Que voulez-vous, cela m’amuse de vous voir enrager ! Et puis, par le seul fait que je tolère vos questions et vos conjectures, vous me devez une compensation.
— Si je m’arroge le droit de vous poser toutes sortes de questions, répliquai-je tranquillement, c’est justement parce que je suis prêt à n’importe quelle compensation et qu’à l’heure actuelle je tiens ma vie pour rien.
Pauline éclata de rire.
— La dernière fois que nous avons fait l’ascension du Schlangenberg, vous vous êtes dit prêt, sur un signe de moi, à vous précipiter — et il y a bien mille pieds de profondeur — la tête la première. Il arrivera un jour où je dirai ce mot, uniquement pour voir comment vous tiendrez parole, et soyez sûr que je ferai preuve de caractère. Je vous déteste justement parce que je vous ai trop permis, et encore bien davantage parce que j’ai besoin de vous. Mais comme j’ai besoin de vous, je dois, pour le moment, vous ménager.
Elle allait se lever. Son ton était irrité. Depuis quelque temps elle terminait toujours nos entretiens sur un ton d’exaspération, d’animosité, oui, c’est le mot, d’animosité.
— Permettez-moi une question : qui est Mlle Blanche ? lui demandai-je pour ne point la laisser partir sans m’être expliqué avec elle.
— Vous savez parfaitement qui est Mlle Blanche. Aucun fait nouveau ne s’est produit depuis votre départ. Mlle Blanche sera certainement générale — bien entendu si le bruit de la « grand’mère » se confirme, car Mlle Blanche, tout comme sa mère et son cousin le marquis, n’ignore rien de notre ruine.
— Et le général en est amoureux fou ?
— Il ne s’agit pas de cela pour le moment. Écoutez-moi bien. Voici sept cents florins : prenez-les et gagnez-moi le plus que vous pourrez à la roulette : il me faut de l’argent tout de suite et coûte que coûte.
Sur ce, elle appela Nadine et s’en alla rejoindre les nôtres près du casino. Quant à moi, je pris le premier sentier à gauche et donnai libre cours à ma stupéfaction. Son ordre de jouer à la roulette m’avait produit l’effet d’un coup de bâton sur la tête. Chose étrange : alors que j’avais tant de sujets de méditation, je m’absorbai dans l’analyse des sentiments que je nourrissais à l’égard de Pauline.
À vrai dire, pendant ces quinze jours d’absence, j’avais le cœur plus léger que je ne l’ai aujourd’hui, le jour de mon retour. Néanmoins, en voyage, j’éprouvais une angoisse folle, je m’agitais comme un ébouillanté, je la voyais même à tout instant en songe. Une fois (c’était en Suisse) je me suis endormi en wagon et entretenu, paraît-il, à haute voix avec Pauline, ce qui fit rire tous mes compagnons de route. Une fois de plus aujourd’hui je me suis demandé : « Est-ce que je l’aime ? » Et une fois de plus je n’ai su que répondre ; ou plutôt, pour la centième fois, je me suis répondu que je la haïssais. Oui, elle m’était odieuse. Il y a eu des instants (à la fin de chacun de nos entretiens) où j’eusse donné la moitié de ma vie pour l’étrangler ! Je le jure, s’il avait été possible de lui enfoncer lentement un poignard dans la poitrine, je crois que je l’aurais fait avec délice. Et pourtant, je l’affirme sur l’honneur, si, au Schlangenberg, à la pointe à la mode, elle m’avait dit vraiment : « Jetez-vous en bas », je m’y serais jeté aussitôt, et même avec délice. Je le savais. D’une façon ou d’une autre, la crise devait se dénouer. Elle le comprend fort bien, et l’idée que j’ai pleinement conscience qu’elle m’échappe, que je ne puis réaliser mes caprices, — cette idée, j’en suis sûr, lui procure une satisfaction extraordinaire ; sinon pourrait-elle, prudente et avisée comme elle l’est, se montrer si familière, si franche avec moi ? J’ai l’impression que jusqu’à présent elle m’a considéré comme cette impératrice antique, qui se déshabilla devant son esclave, ne le regardant pas comme un homme. Oui, à maintes reprises, elle ne m’a pas regardé comme un homme...
Pourtant, elle m’avait chargé d’une mission : gagner à la roulette coûte que coûte, Je n’avais pas le temps de me demander pourquoi et dans quel délai il fallait gagner, ni quelles nouvelles considérations avaient germé dans cette tête toujours en travail. De plus, durant ces quinze jours, il est évidemment survenu une foule de faits nouveaux, dont je ne me rends pas encore compte. Il faut élucider tout cela, le tirer au clair, et le plus tôt possible. Mais pour le moment, il n’en était pas question : je devais me rendre à la roulette.
1. Dostoïevski emploie toujours en parlant de Des Grieux un terme méprisant : Frantsouzik, Frantsouzichka, dont la langue française ne possède pas l’équivalent. Nous avons eu recours au mot Francillon qui sert souvent, en Suisse et en Belgique, à désigner les Français. Le mot russe a toutefois une nuance plus nettement péjorative.
2. Tous les passages en italique sont en français dans le texte russe. On remarquera certains russismes : faites le jeu, vous perdrez absolument, soyez si bon, je te prends avec, tu as l’esprit pour comprendre, il a du chance, que nous avons cru devoir conserver.
3. Outchitel : un précepteur, un instituteur ; plus loin, la baboulineka : la grand’mère. Les Russes cultivés, qui aiment à mêler leurs propos de phrases en français s’amusent parfois à employer des mots russes en les faisant précéder d’un article à la française. Il y a là une nuance de familiarité que Dostoïevski a soin de noter en donnant à ces mots une graphie française.
4. Trait autobiographique, dont l’auteur fit confidence à son ami, le baron A. E. Vrangel (TCH. VIÉTRINSKI, Dostoïevski d’après sa correspondance, Moscou, 1912, p. 87).
5. Le général comte Vassili Vassiliévitch Pérovski (1794-1857), fait prisonnier par les Français après la bataille de Borodino, a laissé des Mémoires intéressants sur sa captivité. À l’époque où Dostoïevski écrivait Un Joueur, ils venaient d’être publiés dans la revue Les Archives russes (Rousskii Arkhiv, 1865, n° 3).
II
À la vérité cela m’était désagréable ; bien que décidé à jouer, je ne pensais pas débuter pour le compte d’autrui. Cela me déconcerta même un peu, et je pénétrai de fort mauvaise humeur dans la salle de jeu. Tout m’y déplut dès le premier coup d’œil. Je ne puis souffrir la servilité des feuilletonistes de tous pays, et notamment de Russie, qui, au retour du printemps, célèbrent à l’envi deux choses : d’abord la splendeur et le luxe des salles de jeu dans les villes d’eaux du Rhin, puis les monceaux d’or qui, à les en croire, couvrent les tables. On ne les paie pas pour faire ces descriptions, qu’inspire une complaisance désintéressée. En réalité, ces tristes salles sont dénuées de splendeur, et quant à l’or, loin d’être amoncelé sur les tables, il ne se montre guère. Sans doute, durant la saison arrive parfois un original, quelque Anglais ou quelque Asiatique, un Turc, comme cet été, qui gagne ou perd des sommes considérables ; les autres joueurs ne risquent que de petites sommes, et en moyenne il n’y a jamais beaucoup d’argent sur le tapis vert.
Quand, pour la première fois de ma vie, j’eus mis les pieds dans la salle, j’hésitai quelque temps à jouer. Du reste, la foule paralysait mes mouvements. D’ailleurs, eussé-je été seul, c’eût été la même chose ; il me semble même qu’au lieu de jouer je serais plutôt parti. Je l’avoue, le cœur me battait, et je n’étais pas de sang-froid ; depuis longtemps j’étais persuadé que je ne quitterais pas Roulettenbourg sans aventure : quelque chose de radical, de définitif surviendrait fatalement dans ma destinée. Cela doit être et cela sera. Si ridicule que puisse paraître une telle confiance dans la roulette, je trouve encore plus ridicule l’opinion courante, qui estime absurde d’attendre quelque chose du jeu. En quoi le jeu est-il pire que tel autre moyen de se procurer de l’argent, que le commerce, par exemple ? Il est vrai que sur cent individus un seul gagne ; mais que m’importe ?
En tout cas j’avais décidé d’observer d’abord et de ne rien entreprendre d’important ce soir-là. Le résultat de cette première séance ne pouvait être que fortuit et insignifiant, telle était ma conviction. De plus, il fallait étudier le mécanisme du jeu, car, malgré les innombrables descriptions de la roulette que j’avais lues avec avidité, je ne comprenais rien à son organisation.
D’abord, tout me parut malpropre et répugnant. Je ne parle pas de l’expression avide et inquiète de ces visages qui, par douzaines, par centaines même, assiègent le tapis vert. Je ne vois assurément rien de malpropre dans le désir de gagner vite le plus possible ; j’ai toujours trouvé absurde l’idée d’un moraliste repu et renté qui, à l’argument qu’« on jouait petit jeu » répondit : « Tant pis, car alors, on obéit à une cupidité mesquine ». Comme si la cupidité n’était pas toujours pareille, quel que soit son objet ! C’est affaire de proportion. Ce qui est mesquin pour Rothschild représente à mes yeux l’opulence ; et quant au lucre et au gain, ce n’est pas seulement à la roulette, c’est partout que les hommes s’évertuent à s’enrichir aux dépens de leur prochain. C’est une autre question de savoir si le lucre et le profit sont vils en eux-mêmes, et je n’entreprends pas de la résoudre ici. Comme j’éprouvais moi-même un vif désir de gagner, cette cupidité générale, cette souillure de la cupidité, si l’on veut, m’était déjà familière en pénétrant dans la salle. Rien de plus charmant que de ne point faire de cérémonie, d’agir ouvertement et sans contrainte. D’ailleurs, à quoi bon se leurrer soi-même : n’est-ce pas l’occupation la plus vaine, la plus inconsidérée ? Ce qui déplaisait particulièrement, à première vue, chez ce ramassis de joueurs, c’était leur façon respectueuse de procéder, le sérieux et même la déférence avec lesquels tous entouraient le tapis vert. Voilà pourquoi il existe ici une démarcation rigoureuse entre le jeu dit de mauvais genre, et celui qui est permis à un homme comme il faut. Il y a deux sortes de jeux, l’une à l’usage des gentlemen, l’autre plébéienne, cupide, bonne pour la canaille. La distinction est ici expresse, et au fond, comme elle est vile ! Un gentleman, par exemple, risque cinq ou dix louis, rarement davantage — s’il est très riche, il ira jusqu’à mille francs — mais il les risque par amour du jeu, pour le seul plaisir ; il se donne le spectacle du gain ou de la perte, sans se passionner pour le gain. Si la chance le favorise, il aura un sourire de satisfaction, badinera avec son voisin ; peut-être risquera-t-il de nouveau, en doublant l’enjeu, mais uniquement par curiosité, pour observer le hasard, pour se livrer à des calculs... ; en aucun cas, il n’obéira au désir plébéien de gagner.
Bref, un gentleman ne doit considérer le jeu, roulette ou trente et quarante, que comme un passe-temps organisé à seule fin de le divertir. Il ne doit même pas soupçonner les calculs et les pièges sur lesquels est fondée la banque. Il agirait même fort délicatement en supposant que tous les autres joueurs, toute la racaille qui l’entoure et tremble pour un florin, se compose de riches gentlemen qui, tout comme lui, jouent uniquement pour se distraire. Cette ignorance complète de la réalité, cette crédulité naïve seraient des plus aristocratiques. J’ai vu bien des mères faire avancer leurs filles, gracieuses et innocentes créatures de quinze ou seize ans, et leur remettre quelques pièces d’or en leur expliquant la règle du jeu. La jeune personne gagnait ou perdait, et se retirait enchantée, le sourire aux lèvres. Notre général s’approcha de la table avec une assurance majestueuse ; un valet s’empressa de lui avancer une chaise, mais il n’y fit pas attention ; avec une lenteur extrême il sortit son porte-monnaie, en retira trois cents francs, les mit sur noir et gagna. Il ne releva pas son gain. Noir sortit de nouveau ; il laissa encore sa mise, et lorsque, la troisième fois, ce fut rouge qui gagna, il perdit douze cents francs d’un coup. Il se retira impassible et souriant. Je suis sûr qu’il enrageait et que si la mise avait été double ou triple, il aurait difficilement gardé son sang-froid. D’ailleurs, sous mes yeux, un Français gagna, puis perdit, sans l’ombre d’émotion, une trentaine de mille francs. Un vrai gentleman ne doit pas s’émouvoir, même s’il perdait toute sa fortune. Il doit faire peu de cas de l’argent, comme si cela ne méritait aucune attention. Évidemment il est très aristocratique de paraître ignorer la malpropreté de cette canaille et du milieu où elle évolue. Parfois le contraire n’est pas moins distingué : remarquer, observer le manège de cette canaille, l’examiner même à la lorgnette, mais en affectant de regarder cette foule sordide comme une distraction, une comédie destinée à divertir le spectateur. On peut se mêler soi-même à cette foule, mais alors il faut témoigner par son attitude que l’on vient ici en amateur, sans avoir rien de commun avec elle. D’ailleurs, il ne convient pas de regarder avec insistance : ce serait de nouveau indigne d’un gentleman, car ce spectacle ne mérite pas une attention soutenue. Et ils ne sont pas nombreux, pour un gentleman, les spectacles dignes d’intérêt. Cependant il me semblait que tout cela méritait une sérieuse attention, surtout pour celui qui n’est pas venu en simple spectateur, mais se range lui-même sincèrement et de bonne foi parmi cette racaille. Quant à mes convictions morales intimes, elles ne sauraient naturellement trouver place ici. Je tiens à le dire pour l’acquit de ma conscience. Je noterai toutefois que depuis un certain temps j’éprouve une vive répugnance à appliquer à mes actes et à mes pensées un critérium moral. Je subis une autre impulsion...
La racaille, en effet, joue d’une façon malpropre. Je suis même porté à croire que de vulgaires vols se commettent aux tables de jeu. Les croupiers qui, assis aux bouts, surveillent les mises et règlent les comptes, ont énormément à faire. Belles canailles que ces croupiers ! Ce sont pour la plupart des Français. D’ailleurs ces notes et ces observations n’ont pas pour but de décrire la roulette ; je me mets au courant, afin de savoir comment me comporter à l’avenir. J’ai remarqué notamment que l’on voit souvent se glisser, entre les joueurs du premier rang, une main qui s’approprie le gain d’autrui. Il en résulte une altercation, fréquemment des éclats de voix, — et allez donc prouver, à l’aide de témoins, que c’est bien votre mise !