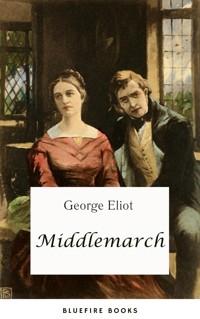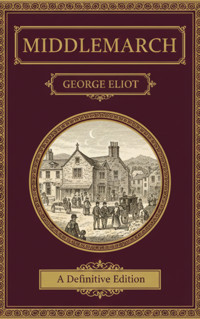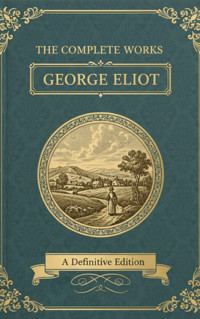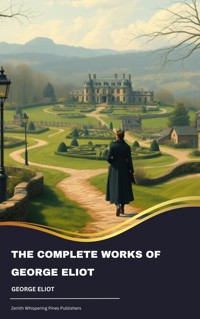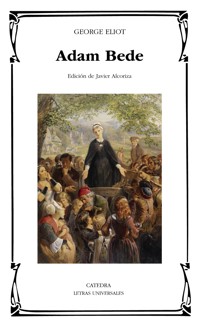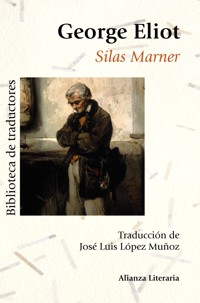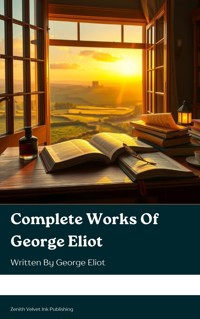1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Librorium Editions
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Une seule goutte d’encre sert de miroir, en Égypte, à un moderne nécromancien qui se fait fort d’évoquer, aux yeux de tout venant, les scènes lointaines du passé. Moi aussi, lecteur, avec cette goutte d’encre au bout de ma plume, je veux essayer de vous montrer le tableau d’intérieur qu’offrait l’atelier de M. Jonathan Burge, charpentier et constructeur au village d’Hayslope, le 18 juin de l’an de grâce 1799. Sous les rayons ardents du soleil de l’après-midi, cinq ouvriers s’y occupaient activement de portes, de fenêtres et de lambrissage. Le parfum de bois de sapin qu’exhalait une haute pile de planches près de la porte ouverte se mêlait à la senteur des blanches fleurs d’un sureau qui étalait ses branches devant la fenêtre opposée ; les rayons obliques du soleil brillaient au travers des minces et légers copeaux que l’actif rabot chassait devant lui, et faisaient ressortir le beau grain des panneaux de chêne dressés contre la muraille. Sur un tas de ces copeaux délicats, un chien de berger, au poil gris et rude, s’était fait un lit moelleux, et, couché, le museau entre les pattes de devant, relevait de temps en temps les paupières pour jeter un regard sur le plus grand des ouvriers, qui sculptait un écusson au centre d’un panneau de bois.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
ADAM BEDE
de
GEORGE ELIOT
© 2024 Librorium Editions
ISBN : 9782385748081
ADAM BEDE
LIVRE PREMIER
CHAPITRE PREMIERl’atelier
Une seule goutte d’encre sert de miroir, en Égypte, à un moderne nécromancien qui se fait fort d’évoquer, aux yeux de tout venant, les scènes lointaines du passé. Moi aussi, lecteur, avec cette goutte d’encre au bout de ma plume, je veux essayer de vous montrer le tableau d’intérieur qu’offrait l’atelier de M. Jonathan Burge, charpentier et constructeur au village d’Hayslope, le 18 juin de l’an de grâce 1799.
Sous les rayons ardents du soleil de l’après-midi, cinq ouvriers s’y occupaient activement de portes, de fenêtres et de lambrissage. Le parfum de bois de sapin qu’exhalait une haute pile de planches près de la porte ouverte se mêlait à la senteur des blanches fleurs d’un sureau qui étalait ses branches devant la fenêtre opposée ; les rayons obliques du soleil brillaient au travers des minces et légers copeaux que l’actif rabot chassait devant lui, et faisaient ressortir le beau grain des panneaux de chêne dressés contre la muraille. Sur un tas de ces copeaux délicats, un chien de berger, au poil gris et rude, s’était fait un lit moelleux, et, couché, le museau entre les pattes de devant, relevait de temps en temps les paupières pour jeter un regard sur le plus grand des ouvriers, qui sculptait un écusson au centre d’un panneau de bois. C’était celui dont la belle voix de baryton, dominant le bruit du rabot et du marteau, chantait :
Réveille-toi, mon âme ; au sortir du sommeil, Recommence ta tâche au lever du soleil ; Secoue la paresse…
Ici, quelque mesure à prendre demandant une attention plus concentrée, la voix fit place à un léger sifflement ; mais elle reprit bientôt avec une nouvelle force :
Que la sincérité brille en tous tes discours ; Que ta conscience comme un beau jour soit claire.
Une telle voix ne pouvait sortir que d’une large poitrine, et c’était celle d’un homme de prés de six pieds, à la charpente forte et bien musclée, avec les épaules si plates et la tête si bien posée, que, lorsqu’il se redressa pour examiner son travail à distance, il avait l’air d’un soldat au port d’arme. La manche de chemise remontée au-dessus du coude laissait voir un bras qui devait gagner le prix dans tous les concours de force ; cependant la main large et souple, terminée par des doigts effilés, paraissait experte aux ouvrages d’adresse. Par sa haute stature, Adam Bede était Saxon et justifiait son nom ; toutefois, le noir de jais de ses cheveux, qui contrastait avec son léger bonnet de papier[1], et le vif regard de ses yeux foncés, brillant sous des sourcils accentués, proéminents et mobiles, indiquaient un mélange de sang celtique. Ses traits étaient grands, fortement dessinés, et n’avaient dans leur repos d’autre beauté qu’une expression de bonne humeur et d’honnêteté intelligente.
Au premier coup d’œil on reconnaît l’ouvrier voisin pour le frère d’Adam. Il est presque aussi grand ; il a le même type de visage, la même couleur de cheveux et le même teint ; mais cette grande ressemblance de famille ne fait que mieux ressortir la différence de tournure et d’expression. Les larges épaules de Seth sont légèrement voûtées ; ses yeux sont gris ; ses sourcils sont moins proéminents et mobiles ; son regard, moins vif, est doux et confiant. Il a quitté son bonnet de papier, et vous ne voyez point des cheveux fermes et épais comme ceux d’Adam, mais clairsemés et ondés, laissant discerner le contour exact de l’arcade frontale qui avance décidément plus que le sourcil.
Les mendiants paresseux étaient toujours sûrs d’obtenir quelque pièce de monnaie de Seth ; ils ne s’adressaient presque jamais à Adam.
Le concert formé par les outils et la voix de ce dernier fut enfin interrompu par Seth, qui, redressant la porte à laquelle il venait de travailler assidûment, la plaça contre le mur en disant :
« Là ! J’ai pourtant fini ma porte aujourd’hui ! »
Tous les ouvriers levèrent les yeux. Jim Salt, homme replet à cheveux rouges, connu sous le nom de Jim le Roux, cessa de raboter, tandis qu’Adam disait à Seth, avec un regard de vive surprise : « Comment ? Est-ce que tu penses avoir fini cette porte ?
— Bien sûr, dit Seth très étonné ; qu’est-ce qui y manque ? »
Un bruyant éclat de rire des trois autres ouvriers fit retourner Seth d’un air ébahi. Adam, se contentant de sourire légèrement, dit à Seth, d’un ton de voix plus doux que précédemment : « C’est que tu as oublié les panneaux. »
Le rire recommença de plus belle, tandis que Seth se prenait la tête en rougissant jusques à la racine des cheveux.
« Hourra ! s’écria un petit gaillard très-agile, surnommé Ben le Vif, qui s’élança pour saisir la porte. Nous allons la poser devant l’atelier et écrire dessus : « Ouvrage de Seth Bede le Méthodiste. » Ici, Jim ; passe-moi le pot de rouge.
— Quelle bêtise ! dit Adam. Laissez ça, Ben Cranage. Il vous arrivera peut-être bien un jour de faire aussi quelque bévue. Vous rirez en dedans, alors.
— Tâchez seulement de m’y prendre, Adam. Il se passera du temps avant que ma tête se remplisse de méthodisme, dit Ben.
— Ça se peut ; mais elle est souvent pleine de boisson, ce qui est pire. »
Néanmoins Ben avait en main le pot de rouge et, sur le point de peindre son inscription, traçait en l’air, en guise de prélude, un S imaginaire.
« Voulez-vous finir ? cria Adam en posant ses outils et s’élançant vers Ben dont il saisit l’épaule droite. Finissez, ou je vous fais sauter l’âme du corps. »
Ben tressaillit sous l’étreinte de fer d’Adam ; mais, en petit homme courageux qu’il était, il ne voulut point céder. Avec la main gauche il saisit le pinceau de sa droite impuissante, et fit un mouvement comme pour mettre son dessein à exécution. Adam le fit pirouetter, lui saisit l’autre épaule, et, le poussant devant lui, l’aplatit contre le mur. Mais alors Seth prit la parole.
« Laisse-le, Addy, laisse-le. Ben voulait plaisanter. Il a bien le droit de se moquer de moi. Je ne puis m’empêcher d’en rire moi-même.
— Je ne le lâcherai pas qu’il ne promette de laisser cette porte, dit Adam.
— Allons, Ben, mon garçon, dit Seth d’un ton persuasif, il ne faut pas se quereller pour ça. Vous savez bien qu’Adam a sa tête. Vous retourneriez tout aussi facilement un char de foin dans une ruelle. Dites que vous laisserez la porte, et que cela finisse.
— Adam ne me fait pas peur, dit Ben ; mais, puisque vous le demandez, Ben, je consens à dire que je la laisserai.
— Allons, vous faites bien, Ben, » dit Adam qui le relâcha en riant.
Ils reprirent tous leur travail ; mais Ben le Vif, qui avait eu le dessous dans ce conflit physique, était fort désireux de racheter son humiliation par quelque quolibet qui réussît mieux.
« À quoi pensiez-vous, Seth ? commença-t-il ; à la jolie prêcheuse ou à son sermon, quand vous avez oublié les panneaux ?
— Venez l’entendre, Ben, lui dit Seth amicalement ; elle prêchera ce soir sur la pelouse : peut-être cela vous donnera-t-il quelques pensées qui vaudront mieux que ces mauvaises chansons que vous aimez tant. Il se peut que vous y preniez de la religion, et ce sera le meilleur gain que vous ayez jamais fait.
— Chaque chose a son temps, Seth ; j’y penserai quand je voudrai m’établir ; les célibataires n’ont pas besoin de si gros gains. Il se peut que je fasse un jour ma cour et ma religion en même temps, ainsi que vous, Seth ; mais vous ne voudriez pas me voir convertir pour me planter entre vous et la jolie prêcheuse, et vous l’enlever.
— Ce n’est pas à craindre, Ben ; je crois que vous ne réussiriez pas mieux que moi. Seulement, venez l’entendre, et vous n’en parlerez plus si légèrement.
— Eh bien, j’ai presqu’envie d’aller la voir un moment ce soir, s’il n’y a pas bonne société au Buisson de houx. Quel texte prendra-t-elle ? Vous pourriez peut-être me le dire, Seth, si j’arrive trop tard pour l’entendre. Sera-ce : « Que venez-vous voir ? Une prophétesse ? Oui, je vous le dis en vérité, et plus qu’une prophétesse, une très-jolie femme. »
— Allons, Ben, dit Adam assez sévèrement, laissez tranquilles les paroles de la Bible ; vous allez trop loin à présent.
— Tiens ! est-ce que vous allez vous convertir, Adam ? Il y a un moment que je vous croyais sourd à la prédication des femmes.
— Non, je n’ai changé en rien. Je n’ai rien dit contre les femmes qui prêchent ; je vous ai dit : laissez la Bible tranquille ; vous avez un livre de bons mots, il me semble, dont vous n’êtes pas mal fier : que vos mains sales s’en contentent.
— Tiens ! vous devenez un aussi grand saint que Seth. Je pense que vous irez au prêche ce soir. Vous dirigerez joliment bien le chant. Mais je ne sais trop ce que dira le pasteur Irwine en voyant son grand favori, Adam Bede, tourner au méthodisme.
— Ne vous inquiétez pas de moi, Ben. Je ne deviendrai pas plus méthodiste que vous, et il est assez probable que vous deviendrez quelque chose de pire. Monsieur Irwine a trop de bon sens pour vouloir empêcher les gens de se conduire comme ils l’entendent quant aux formes de la religion. C’est entre eux et Dieu, comme il me l’a dit souvent.
— Je veux bien ; mais, pour tout ça, il n’en aime pas davantage les dissidents.
— Peut-être ; je n’aime pas beaucoup non plus la bière forte de Josh Tod, mais je ne vous empêche pas pour ça de vous enivrer avec. »
Un éclat de rire accueillit cette pointe d’Adam ; mais Seth lui dit très-sérieusement :
« Non, Adam, il ne faut comparer la religion de personne à de la bière forte. Tu ne peux prétendre que les dissidents et les méthodistes n’aient un sentiment religieux aussi profond que ceux de l’Église établie.
— Non, mon garçon, je ne me moque de la religion de personne. Que chacun suive en cela sa conscience. Seulement je pense qu’il vaudrait mieux que leur conscience leur permît de rester tranquillement dans l’Église, car on y peut apprendre une foule de bonnes choses. Et puis on peut aussi avoir une exagération religieuse ; nous avons besoin de quelque chose de plus que l’Évangile dans ce monde. Voyez les canaux, et les aqueducs, et les machines des mines de charbon, et les filatures d’Arckwright, là à Cromford ; je suppose qu’un homme doit savoir quelque chose de plus que l’Évangile pour faire toutes ces choses. Mais, à entendre quelques-uns de ces prêcheurs, vous croiriez qu’un homme n’a rien d’autre à faire toute sa vie qu’à fermer les yeux et regarder ce qui se passe dans son intérieur. Je sais qu’un homme doit garder dans son cœur l’amour de Dieu et de la sainte Bible. Mais que dit-elle, la Bible ? Eh bien, elle dit que Dieu mit son esprit dans l’artisan qui construisit le tabernacle, pour qu’il en fît les sculptures et toutes les choses qui demandaient une main habile. Et c’est là ma manière de voir ; l’esprit de Dieu est en toutes choses et en tous temps — les jours de travail comme le dimanche — dans les grands travaux et inventions, dans les plans et les machines. Et Dieu nous a donné notre intelligence et nos mains aussi bien que nos âmes ; et si un homme fait quelques petits ouvrages en dehors des heures de travail, — s’il construit un four pour éviter à sa femme d’aller chez le boulanger ; ou s’il gratte un peu la terre de son jardin pour faire venir deux pommes de terre au lieu d’une, il fait plus de bien et il est tout aussi près de Dieu que s’il courait après quelque prédicateur pour prier et gémir.
— Bien touché, Adam ! dit Jim le Roux, qui avait arrêté le mouvement de son rabot pendant qu’Adam parlait ; voilà le meilleur sermon que j’aie entendu depuis longtemps. À propos de ça, il y a bien douze mois que ma femme me tourmente pour que je lui fasse un four.
— Il y a quelque raison dans ce que tu viens de dire, Adam, observa Seth gravement. Mais tu sais très-bien toi-même que c’est en entendant ces prédicateurs auxquels tu trouves tant à redire, que bien des paresseux sont devenus de bons travailleurs. C’est le prédicateur qui fait abandonner le cabaret, et si un homme prend des sentiments religieux, il n’en fait pas plus mal, pour cela, son ouvrage.
— Seulement il oubliera quelquefois les panneaux des portes ! dit Ben le Vif.
— Ah ! Ben, vous avez trouvé une plaisanterie contre moi pour le reste de votre vie. Mais ici ce n’est pas la religion qui a tort ; c’est bien Seth Bede, qui a toujours été un étourneau, et la religion ne l’a pas encore guéri, malheureusement.
— Ne vous inquiétez pas de moi, dit Ben le Vif ; vous êtes un vrai bon garçon, panneaux ou non, et vous ne hérissez pas vos poils à la moindre plaisanterie, comme quelqu’un de vos proches qui est peut-être plus habile.
— Seth, mon garçon, dit Adam sans relever le sarcasme qu’on lui lançait, il ne faut pas m’en vouloir. Je ne t’avais point en vue dans ce que je viens de dire. Les uns ont une manière de voir, les autres une différente.
— Je sais bien, Addy, que tu n’as point de mauvaise intention à mon égard. Tu es comme ton chien Gyp, qui aboie quelquefois contre moi, mais qui me lèche toujours la main après. »
Tous les bras se remirent au travail, et le silence dura quelques minutes, jusqu’au moment où l’horloge de l’église commença à sonner six heures. Avant que le premier coup eût cessé de tinter, Jim le Roux avait lâché son rabot et saisissait sa veste ; Ben le Vif avait laissé une vis à moitié enfoncée et jeté le tourne-vis dans son panier à outils ; Placide Taft, qui, d’accord avec son nom, avait gardé le silence pendant la précédente conversation, avait laissé retomber son marteau au moment où il le levait, et Seth lui-même s’était redressé et étendait la main vers son bonnet de papier. Adam seul avait continué son travail comme si de rien n’était ; mais, n’entendant plus le bruit des outils, il leva les yeux et dit d’un ton indigné : « Voyez ça, à présent ! Je ne puis souffrir de voir des hommes jeter ainsi leurs outils à l’instant où l’horloge commence à sonner, comme s’ils ne prenaient aucun plaisir à leur ouvrage et qu’ils eussent peur de donner un coup de trop. »
Seth parut un peu confus et mit plus de lenteur à ses préparatifs de départ ; mais Placide Taft rompit le silence en disant :
« Eh ! Adam, mon garçon, tu parles en jeune homme ; quand tu auras quarante-six ans comme moi, au lieu de vingt-six, tu n’auras plus tant de zèle à travailler pour rien !
— Qu’est-ce que cela signifie ? répondit Adam encore irrité. Je voudrais bien savoir ce que l’âge doit y faire. Vous n’êtes pas encore enroidi, je suppose. Je déteste voir tomber les bras d’un homme comme s’il était fusillé, avant que l’heure ait complètement sonné, comme s’il ne mettait pas le moindre amour-propre ou plaisir à son ouvrage. La meule à aiguiser même tourne encore après qu’on l’a lâchée.
— Sacrebleu, Adam ! s’écria Ben le Vif, laisse un peu les gens tranquilles, veux-tu. Tu trouvais à redire aux prêcheurs, il y a un moment, — tu n’aimes pas mal à prêcher toi-même. Tu peux aimer le travail plus que le jeu ; pour moi, j’aime le jeu plus que le travail : ça doit t’arranger, — ça ne te laisse que plus d’ouvrage à faire. »
Avec ce discours de sortie, qu’il considérait comme très-concluant, Ben le Vif se chargea de son panier et sortit de l’atelier, suivi de près par Placide Taft et Jim le Roux. Seth hésitait et regardait fixement Adam, comme s’il attendait qu’il lui dît quelque chose.
« Iras-tu à la maison avant la prédication ? demanda Adam en levant les yeux.
— Non, j’ai mon chapeau et mon habit chez Will Masquery ; je ne rentrerai pas avant dix heures. Il se peut que j’escorte Dinah Morris jusque chez elle, si elle y consent. Personne de chez les Poyser ne vient avec elle, tu sais.
— Alors je dirai à la mère de ne pas t’attendre.
— Tu ne vas pas toi-même chez les Poyser, ce soir ? dit Seth presque timidement, comme il se retournait pour quitter l’atelier.
— Non, j’irai à l’école. »
Jusque-là Gyp était resté sur son lit confortable, relevant seulement la tête et surveillant plus attentivement son maître, en voyant partir les autres ouvriers. Mais, dès qu’Adam eut mis son compas dans sa poche et commencé à rouler son tablier autour de sa taille, Gyp s’élança et le regarda fixement au visage dans une patiente expectative. Si Gyp eût possédé une queue, il l’aurait bien certainement remuée ; mais, étant dépourvu de ce véhicule de ses émotions, il était comme beaucoup d’autres très-dignes personnages, destinés à paraître plus flegmatiques que ne les a faits la nature.
« Allons, Gyp, es-tu prêt pour le panier ? » dit Adam d’un ton de voix aussi doux que lorsqu’il avait parlé à Seth.
Gyp s’avança avec un court aboiement, comme pour dire : « Naturellement. » Le pauvre animal n’avait pas une grande variété d’expressions à son usage.
Ledit panier était celui qui, les jours de travail, contenait le dîner d’Adam et de Seth, et aucun employé officiel d’une procession n’aurait plus résolument dédaigné toute connaissance sur son passage, que Gyp portant ce panier en trottant sur les talons de son maître.
En quittant l’atelier, Adam ferma la porte, dont il retira la clef pour la poser à la maison de l’autre côté du chantier. C’était une maison basse, au toit de chaume gris et à murs jaunâtres, colorée par la lumière du soir d’un ton chaud et agréable. Les fenêtres plombées étaient brillantes et sans taches, et la dalle de pierre à l’entrée était aussi propre qu’un galet blanc à marée basse. Debout sur cette pierre se tenait une vieille femme, en robe de toile à raies de couleur sombre, avec un fichu rouge et un bonnet blanc ; elle parlait à quelques poules tachetées, que paraissait avoir attirées vers elle l’espérance illusoire d’une distribution de pommes de terre froides ou d’un peu d’orge. Sa vue était voilée, car elle ne reconnut Adam que lorsqu’il lui dit : « Voici la clef, Dolly ; rentrez-la pour moi, s’il vous plaît.
— Certainement ; mais ne voulez-vous pas entrer vous-même, Adam ? Mademoiselle Mary est à la maison et maître Burge sera bientôt de retour : je réponds qu’il sera bien aise de vous retenir à souper.
— Non, Dolly, je vous remercie ; je vais à la maison. Bonsoir. »
Adam s’éloigna à grandes enjambées, avec Gyp à ses trousses ; il sortit du chantier et suivit la grande route qui descendait du village à la vallée. Comme il arrivait au pied de la rampe, un cavalier d’un certain âge, avec un portemanteau derrière lui, arrêta son cheval lorsque Adam fut passé, et se retourna pour suivre plus longtemps des yeux cet ouvrier de belle et robuste taille, en bonnet de papier, en culotte de peau et bas bleu foncé.
Adam, sans se douter de l’admiration dont il était l’objet, prit à travers les prés et entonna le chant qui lui avait tout le jour rempli la tête :
Que tes discours soient toujours sincères, Que ta conscience soit claire comme un beau jour ; Car le Dieu qui voit tout surveille constamment Tes projets, tes travaux, tes sentiments secrets.
↑
Bonnet porté généralement par les ouvriers de sa condition à cette époque.
CHAPITRE IIla prédication
Vers sept heures moins un quart à peu près, il y avait une apparence d’agitation inusitée dans le village d’Hayslope et le long de sa petite rue, depuis les Armes des Donnithorne jusqu’à la porte du cimetière ; les habitants paraissaient évidemment être sortis de leurs maisons pour un autre but que celui de se promener aux rayons du soleil couchant. Les Armes des Donnithorne étaient au commencement du village, et une petite cour de ferme et un fenil à côté montraient qu’il y avait du terrain attaché à l’auberge et promettaient au voyageur bonne nourriture pour lui et son cheval, ce qui pouvait le consoler de l’ignorance dans laquelle une enseigne, effacée par le temps, le laissait quant aux armoiries de cette ancienne famille des Donnithorne.
M. Casson, l’aubergiste, était depuis un moment debout sur sa porte, les mains dans les poches, se balançant sur les orteils et les talons, les yeux tournés vers un espace de terrain sans clôture, avec un érable au milieu, qu’il savait être le but vers lequel se dirigeaient d’un air grave certaines personnes des deux sexes qu’il voyait passer de temps en temps.
Le personnage de M. Casson n’était point un de ces types ordinaires qu’on peut laisser passer sans description. Vu de face, il paraissait principalement composé de deux sphères offrant entre elles les mêmes rapports que la terre et la lune ; ainsi, on pouvait dire approximativement que la sphère inférieure était treize fois plus grosse que la supérieure, qui, naturellement, représentait un satellite et un tributaire. Mais là cessait la ressemblance, car la tête de M. Casson était loin d’avoir l’air d’un mélancolique satellite ou d’un globe taché, comme Milton a irrévérencieusement appelé la lune ; au contraire, aucune tête ou visage n’aurait pu offrir une apparence plus brillante et de meilleure santé ; son expression, venant presque exclusivement de joues rondes et rubicondes, dont le point de jonction formait le nez, — les yeux pouvant à peine être aperçus, — son expression, dis-je, était celle d’une heureuse satisfaction, tempérée par un sentiment de dignité personnelle qui se faisait habituellement remarquer dans son attitude et sa démarche. On ne pouvait guère blâmer ce sentiment chez un homme qui avait été sommelier dans la famille pendant quinze ans, et que sa condition présente mettait nécessairement en fréquent contact avec des inférieurs. Concilier cette dignité avec la curiosité qui le portait à se diriger vers la Pelouse, était le problème que M. Casson retournait dans sa tête depuis cinq minutes ; mais, au moment où il paraissait l’avoir résolu, en sortant les mains de ses poches et les confiant aux échancrures de son gilet, en penchant la tête de côté et en s’armant d’un air d’indifférence hautaine pour tout ce qu’il pourrait remarquer, ses pensées furent détournées par l’approche du cavalier que nous avons vu s’arrêter pour suivre du regard notre ami Adam, et qui arrivait maintenant à la porte des Armes des Donnithorne.
« Ôtez-lui la bride et donnez-lui à boire, dit le voyageur au palefrenier en blouse qui était sorti de la cour au bruit des pas du cheval.
— Eh bien ! qu’est-ce qui se passe dans votre joli village, aubergiste ? continua-t-il en descendant de cheval. Il y a bien du mouvement.
— C’est une prédication méthodiste, monsieur ; on a publié qu’une jeune femme prêcherait sur la Pelouse, répondit M. Casson d’une voix de fausset sifflante et avec un accent légèrement affecté. Vous serait-il agréable d’entrer, monsieur, et de prendre quelque chose ?
— Non, il faut que j’aille directement à Drosseter. Je veux seulement faire boire mon cheval. Et que dit votre pasteur de voir une jeune femme venir prêcher presque à son nez ?
— Le pasteur Irwine, monsieur, ne demeure pas ici ; il habite Broxton, sur la colline que vous voyez là-bas. La cure d’ici tombe en ruines, monsieur, et ne pourrait loger des gens comme il faut. Il vient prêcher ici le dimanche après-midi, monsieur, et met toujours son cheval chez moi. C’est une jument grise, monsieur, dont il fait grand cas. Il a toujours mis son cheval ici, monsieur, même avant que je tinsse les Armes des Donnithorne. Je ne suis pas d’ici, moi ; vous pouvez vous en apercevoir à mon langage, monsieur. Ils ont une drôle de manière de parler dans ce pays, monsieur ; les messieurs ont de la peine à les comprendre. J’ai été élevé au milieu des messieurs, monsieur, et j’ai pris leur langage quand j’étais enfant. Ainsi, comment croyez-vous que les gens d’ici disent pour : « N’avez-vous pas ? » — Les gens comme il faut, vous savez, disent havn’t you ? — Eh bien, ceux de par ici, savez-vous, disent hanna yey ? C’est ce que ces gens appellent le dialéque, monsieur. C’est ce que j’ai entendu le chevalier Donnithorne dire plusieurs fois ; c’est leur dialéque qu’il dit.
— Bien, dit l’étranger en souriant, je le connais très-bien. Mais vous ne devez pas avoir beaucoup de méthodistes par ici, dans ce canton agricole. J’aurais à peine cru qu’on y pût trouver quelque chose qui leur ressemblât. Vous êtes tous agriculteurs, n’est-ce pas ? Les méthodistes peuvent rarement se recruter dans cette classe.
— Mais, monsieur, il y a un assez joli nombre d’ouvriers dans les alentours. Il y a maître Burge, qui afferme le bois de charpente par là-haut et qui entreprend un bon nombre de bâtisses et de réparations. Puis, pas bien loin, il y a les Carrières ; il n’y a pas mal d’ouvrage de ce côté du pays, monsieur. Il y a aussi un beau mouchet de méthodistes à Treddleston ; c’est une ville avec marché, à trois milles d’ici, à peu près, vous l’avez peut-être traversée en venant, monsieur ? Il y a dans ce moment sur la Pelouse un assez joli groupe de ces gens qui en viennent. C’est de là que les nôtres les tirent, quoique nous n’ayons que deux hommes de leur secte dans tout Hayslope, Will Maskery, le charron, et Seth Bede, un jeune homme qui travaille en charpenterie.
— Alors la prêcheuse vient de Treddleston, n’est-ce pas ?
— Non, monsieur ; elle vient du Stonyshire, à peu près à trente milles d’ici. Elle est en visite chez maître Poyser, à la Grand’Ferme, là où vous voyez ces granges et ces beaux noyers, droit à votre gauche, monsieur. C’est la propre nièce de la femme de Poyser, et ils doivent être joliment vexés de la voir se rendre ridicule comme ça. Mais j’ai entendu dire que rien ne peut retenir ces méthodistes quand cette lubie est entrée dans leur cervelle ; bon nombre d’entre eux deviennent fous avec leur religion. Pourtant cette jeune fille a l’air assez tranquille, à ce que je me suis laissé dire, car je ne l’ai pas vue moi-même.
— Eh bien, je voudrais avoir le temps de la voir ; mais il faut que je poursuive ma route. Je m’en suis déjà détourné depuis plus de vingt minutes, pour jeter un coup d’œil sur cette résidence dans la vallée. C’est celle du chevalier Donnithorne, je suppose ?
— Oui, monsieur ; c’est Donnithorne le Château, c’est bien ça. Il y a là de fameux chênes, monsieur, n’est-ce pas ? Je dois les connaître, car je suis resté là sommelier pendant quinze ans. C’est le capitaine Donnithorne qui doit en hériter, monsieur, le petit-fils du chevalier Donnithorne. Il sera majeur aux prochaines fenaisons, monsieur, et nous verrons du beau. Il possède tout le pays que vous voyez de ce côté, monsieur, le chevalier Donnithorne ; oui, monsieur.
— Bien, c’est un joli séjour, quel qu’en soit le propriétaire, dit le voyageur en remontant à cheval, et l’on y trouve aussi de beaux hommes, bien découplés. J’ai rencontré le plus superbe garçon que j’aie vu de ma vie, il y a environ une demi-heure, avant de monter la colline ; un charpentier, un gaillard aux larges épaules, avec les yeux et les cheveux noirs, et marchant en vrai soldat. Nous avons besoin de gens de cette trempe pour frotter les Français.
— Alors, monsieur, ce doit être Adam Bede, j’en réponds, le fils de Thias Bede ; tout le monde ici le connaît. C’est un individu très-instruit et d’une force prodigieuse. Le Seigneur nous protège, monsieur, — pardon, si je vous parle ainsi, — il peut marcher quarante milles dans un jour et lever un marteau de cinq cents livres ; c’est le favori de nos messieurs, monsieur. Le capitaine Donnithorne et le pasteur Irwine en font grand cas. Mais il est un peu vif et tranchant.
— Bien. Bonsoir, monsieur, il me faut partir.
— Votre serviteur, monsieur, bonne route ! »
Le voyageur mit son cheval au trot pour remonter le village ; mais, en approchant de la Pelouse, la beauté de la vue qui s’étendait à sa droite, le singulier contraste qu’offrait le groupe des villageois avec celui des méthodistes, près de l’érable, et peut-être encore plus la curiosité de voir prêcher une jeune femme, l’emportèrent sur son désir d’arriver au but de son voyage, et il s’arrêta.
La Pelouse s’étendait à l’extrémité du village et de là la route se partageait en deux branches : l’une conduisait plus haut sur la colline, en passant près de l’église, et l’autre serpentait agréablement en descendant vers la vallée. Du côté de la Pelouse, dans la direction de l’église, une ligne presque continue de chaumières s’étendait jusqu’à l’entrée du cimetière ; mais de l’autre côté, au nord-ouest, rien ne masquait la vue des champs ondulés, de la vallée boiseuse et des sombres masses des montagnes lointaines. Ce riche district du Loamshire, où se trouve Hayslope, touche à la triste frontière du Stoanyshire, dont les arides montagnes le surplombent, comme on voit un frère, grand, osseux et basané, dominer la jeune et fraîche sœur qui s’appuie à son bras. Une course à cheval de deux ou trois heures peut transporter le voyageur d’une région froide et sans verdure, entrecoupée de longs bancs de pierres grises, à des bois touffus ou à de riants coteaux ornés de festons de verdure, de gras pâturages ou de riches moissons. À chaque détour il découvre quelque belle et ancienne résidence blottie dans la vallée ou couronnant la colline ; quelque heureuse demeure avec sa longue suite de dépendances et de meules dorées ; quelque clocher grisâtre s’élançant d’un agréable mélange d’arbres, de chaume et de tuiles d’un rouge foncé. C’était justement ce dernier tableau que l’église d’Hayslope offrait à notre voyageur, tandis qu’il gravissait le sentier conduisant aux plateaux supérieurs ; de sa station, près de la Pelouse, il avait devant les yeux, réunis en une seule vue, tous les autres traits caractéristiques de ce charmant paysage. Plus loin, à l’horizon, se dressaient de grandes masses de montagnes coniques, placées comme des bornes gigantesques pour protéger ce pays de blés et de pâturages contre les vents du nord, âpres et destructeurs, pas assez éloignées, cependant, pour être voilées par la brume empourprée, mais laissant voir leurs flancs verdâtres marquetés de brebis ; présentant à l’œil les effets de lumière les plus variés, suivant l’heure et la saison, elles n’en restaient pas moins toujours âpres et tristes. Au-dessous, les yeux se reposaient sur une ceinture de bois entrecoupés de riants pâturages ou de guérets jaunissants. Le feuillage n’offrait point encore la verdure uniforme de l’été, mais laissait voir les chaudes teintes des bourgeons du chêne et le vert tendre du frêne et du tilleul. Plus bas, dans la vallée, les arbres paraissaient s’être précipités et réunis, afin de protéger la maison seigneuriale qui les dominait de ses créneaux et d’où s’échappaient de légères colonnes de fumée bleuâtre.
Un vaste parc et une large nappe d’eau devaient sans doute s’étendre devant la façade ; mais la pente ondulée des prairies empêchait notre voyageur de les apercevoir de la pelouse du village. À leur place il voyait un premier plan tout aussi délicieux. Les rayons du soleil, à l’horizon, glissaient comme de l’or transparent entre les tiges mollement inclinées des herbes fleuries, de la haute oseille rouge et des blanches ombelles de ciguë qui bordaient les haies. C’était ce moment de l’été où le bruit des faux qui s’aiguisent nous fait jeter de longs regards de regret sur les fleurs dont sont parées les prairies.
Si l’étranger eût légèrement changé de position, en se tournant vers l’est, il aurait encore pu voir quelques séduisants fragments du paysage, au delà des prairies et des chantiers de Jonathan Burge, du côté des beaux noyers de la Grand’Ferme ; mais probablement il trouvait plus d’intérêt à observer les groupes vivants qui étaient près de lui. Toutes les générations du village s’y trouvaient représentées, depuis le vieux père Taft, avec son bonnet de nuit, tout à fait courbé sous le poids des ans, mais encore assez robuste pour rester longtemps sur ses jambes, soutenu par sa courte canne, jusqu’aux marmots à petites têtes rondes penchées en avant. De temps en temps approchait un nouvel arrivant, peut-être quelque épais laboureur, qui, son souper avalé, venait voir ce spectacle inaccoutumé, écoutant avec un regard hébété ce que chacun pouvait avoir à dire, mais n’apportant point assez d’intérêt à ce qui se passait pour adresser quelque question. Cependant, tous avaient soin de ne point se joindre aux méthodistes sur la Pelouse et évitaient ainsi de s’identifier avec l’auditoire en attente, car il n’en était aucun qui n’eût désavoué l’imputation d’être venu pour écouter la prêcheuse ; ils avaient seulement voulu voir quel air cela avait. Les hommes étaient principalement rassemblés dans le voisinage de la forge. Mais ne vous imaginez point qu’ils fussent réunis en un groupe. Les villageois ne se serrent jamais ; le chuchotement leur est inconnu, et ils sont presque aussi incapables de baisser la voix qu’une vache ou un cerf pourrait le faire. Le véritable paysan anglais tourne le dos à son interlocuteur, auquel il jette une question par-dessus l’épaule, comme s’il était prêt à s’enfuir avant la réponse, et s’éloigne de deux ou trois pas quand l’intérêt du dialogue atteint le plus haut degré. Aussi le groupe, près de la forge, n’était nullement condensé et ne formait point un écran devant Chad Cranage le forgeron, qui, croisant ses bras noircis, s’appuyait contre le montant de sa porte. Il poussait de temps en temps un éclat de rire à ses propres plaisanteries, auxquelles il donnait une préférence marquée sur les quolibets lancés par Ben le Vif, qui avait renoncé aux charmes du Buisson de houx pour voir la vie sous un nouvel aspect. Mais ces deux genres d’esprit étaient traités avec un égal dédain par M. Joshua Rann. Le tablier de cuir et l’air chagrin et renfrogné de M. Rann ne laissent ignorer à personne que c’est le cordonnier du village ; son menton et sa poitrine portés en avant pourraient indiquer le clerc de la paroisse habitué à lire au lutrin. Le vieux José, comme l’appellent irrévérencieusement ses voisins, est dans un état de bouillante indignation ; mais il n’a point encore desserré les lèvres, si ce n’est pour dire d’une voix de basse profonde et vibrante, comme s’il accordait un violoncelle : « Sehon, roi des Amorites ; par la grâce de Dieu, il souffrit constamment ; et Og, roi de Bassan ; par la grâce de Dieu, il souffrit constamment ; » citation qui paraît avoir peu rapport à la circonstance actuelle ; mais, comme c’est le cas de toute anomalie, elle se trouvera en être la conséquence naturelle, comme je vais l’expliquer. En effet, M. Rann défendait dans son for intérieur la dignité de l’Église établie contre cette scandaleuse irruption du méthodisme ; et comme cette dignité était pour lui intimement liée à la sonorité de sa propre voix dans les répons, son mécontentement lui suggérait une citation du psaume qu’il avait lu au service du soir du dernier dimanche.
La curiosité plus vive des femmes les avait fait avancer jusqu’à la limite même de la Pelouse, d’où elles pouvaient examiner de plus près le costume semblable à celui des quakers et la singulière tournure des méthodistes du sexe féminin. Au-dessous de l’érable on avait amené un petit char pour servir de tribune et placé deux bancs et des chaises. Quelques-uns des méthodistes y étaient assis, les yeux fermés et comme absorbés par la prière et la méditation. D’autres préféraient rester debout et regardaient les villageois avec un air de compassion mélancolique. C’est ce qui divertissait complètement Bessy Cranage, la rieuse fille du forgeron, surnommée par ses voisins Bess Chad. Elle s’étonnait que « les gens pussent s’arranger des mines comme cela. » Bess Chad surtout était l’objet de la compassion des méthodistes ; car ses cheveux, rejetés en arrière sous un bonnet posé sur le haut de la tête, laissaient en évidence un ornement dont elle était beaucoup plus fière que de ses joues rosées : c’étaient de grandes boucles d’oreilles rondes, avec des pierres fausses ; ce qui lui attirait le blâme, non-seulement des méthodistes, mais aussi de sa propre cousine, Bess Timothy ; celle-ci, s’intéressant à elle en qualité de parente, désirait souvent que ces boucles d’oreilles pussent en finir une fois pour toutes.
Bess Timothy, quoique ayant gardé son nom de fille parmi ses intimes, était depuis longtemps la femme de Jim le Roux et possédait un assortiment de joyaux d’un autre genre, parmi lesquels il suffit de citer un gros marmot qu’elle berçait dans ses bras et un solide petit gaillard de cinq ans en culottes courtes et jambes rouges ; il portait suspendu à son cou un vieux bidon rouillé en guise de tambour, et évitait soigneusement le petit chien terrier de Bess Chad. Ce jeune rejeton d’Olivier, connu sous le nom de Bess, le fils de Bess Timothy, étant d’un caractère curieux et qu’aucune timidité ne retenait, avait dépassé le groupe de femmes et d’enfants et se promenait autour des méthodistes, les regardant sous le nez, la bouche grande ouverte, et frappant sur son tambour en manière d’accompagnement musical.
Mais une des femmes âgées se baissa pour le prendre par l’épaule d’un air de sérieux reproche ; Ben, fils de Ben Timothy, lui lança alors de vigoureux coups de pied ; puis, jouant des flûtes, s’en fut chercher un refuge derrière les jambes de son père.
« Eh ! petit chien de vaurien, dit Jim le Roux avec orgueil paternel, si tu ne laisses pas ce tambour tranquille, je vais te l’ôter. Qu’est-ce que ça veut dire, de donner des coups de pied au monde ?
— Ici ; donnez-le-moi, Jim, dit Chad Cranage ; je vais l’attacher et le ferrer comme les chevaux. Eh bien, maître Casson, continua-t-il, comme ce personnage s’avançait vers le groupe, comment va ce soir ? Êtes-vous venu pour nous aider à gémir ? On dit que les gens gémissent toujours quand ils prêtent l’oreille aux méthodistes, comme si la guerre était au dedans d’eux. Je compte bien beugler aussi fort que votre vache l’autre soir, et alors la prêcheuse pensera que je suis dans la bonne voie.
— Je vous engagerai à ne point faire de bêtises, Chad, dit M. Casson d’un air assez digne ; Poyser apprendrait avec peine qu’on eût en quelque manière manqué de respect à la nièce de sa femme, quoiqu’il puisse ne pas voir avec plaisir qu’elle se mette à prêcher.
— Puis, elle est agréable à voir, aussi, dit Ben le Vif. Et moi, je suis pour les jolies femmes qui prêchent ; je suis sûr qu’elles me persuaderaient bien plus vite que ces vieux prédicateurs. Je ne serais pas étonné de me trouver méthodiste avant la nuit, et de commencer à faire la cour à la sermonneuse, comme Seth Bede.
— Je crois bien que Seth vise beaucoup trop haut, dit M. Casson. Les parents de cette femme n’aimeraient pas la voir s’abaisser à un ouvrier charpentier.
— Tiens, tiens, tiens ! dit Ben en allongeant l’intonation. Qu’est-ce que les parents des gens ont à voir à ça ? Pas un iota. La femme de Poyser peut bien lever le nez et oublier les temps passés ; mais cette Dinah Morris, dit-on, est aussi pauvre qu’elle l’a jamais été ; elle travaille à une filature et a beaucoup à faire à s’entretenir. Un jeune et solide charpentier, qui est déjà un méthodiste tout fait, comme Seth, ne serait pas un si mauvais parti pour elle. Encore que les Poyser estiment Adam Bede autant que si c’était leur propre neveu.
— Ça ne dit rien ! dit M. Joshua Rann ; Adam et Seth sont deux hommes ; vous ne voulez pas qu’ils se coiffent tous deux de la même fille.
— Peut-être, dit Ben le Vif dédaigneusement ; mais je suis pour Seth, moi, quand il serait encore deux fois plus méthodiste. Seth a eu le beau rôle avec moi, car je l’ai toujours taquiné depuis que nous travaillons ensemble, et il ne m’en veut pas plus pour cela qu’un agneau. Et c’est un gaillard qui a du courage aussi, car, lorsque nous vîmes un vieil arbre tout de feu, un soir que nous traversions les champs, et que nous crûmes que c’était un revenant, Seth ne s’en inquiéta pas, mais il y alla tout droit, comme un constable. Tiens, le voilà qui sort de chez Will Masquery, et voilà Will lui-même, avec l’air aussi doux que s’il ne pouvait frapper sur une tête de clou, crainte de lui faire mal. Et voilà la jolie prêcheuse ! Ma foi, elle a ôté son chapeau. Il faut que je la voie d’un peu plus près. »
Plusieurs des hommes suivirent l’exemple de Ben, et le voyageur poussa son cheval en avant sur la Pelouse, tandis que Dinah, précédant ses compagnons, marchait assez rapidement vers le char sous l’érable. Près de la grande taille de Seth, elle paraissait petite ; mais élevée sur la tribune elle semblait d’une stature au-dessus de la moyenne, quoique, en réalité, elle ne la dépassât pas. Sa taille était svelte et le paraissait encore davantage à cause de son costume noir et sans ampleur. L’étranger fut surpris en la voyant, non de sa délicatesse féminine, mais de l’absence complète d’importance personnelle de son maintien. Il s’était attendu à la voir s’avancer gravement et à pas comptés, avec un sourire assuré de sainteté intime, ou peut-être l’expression acerbe d’un blâme orgueilleux. Il ne connaissait que deux types de méthodistes : l’extatique et le bilieux. Mais Dinah marchait tout simplement et ne semblait pas plus s’occuper de l’effet qu’elle pouvait produire que ne le ferait un petit garçon. Il n’y avait ni rougeur à ses joues, ni tremblement qui dît : « Je sais que vous me trouvez jolie femme et trop jeune pour prêcher. » Il n’y avait ni abaissement, ni élévation des paupières, ni pose de bras qui pût dire : « Vous devez me considérer comme une sainte. » Elle n’avait point de livre à ses mains non gantées, qui retombaient légèrement croisées devant elle ; restant debout elle tournait ses yeux bleus vers l’assemblée. Son regard n’avait pas de la finesse, mais cette limpidité qui prouve que l’esprit est pénétré de ce qu’il veut énoncer, plutôt qu’impressionné par les objets extérieurs. Elle était abritée des rayons du soleil couchant par les branches de l’érable. Dans cette demi-teinte lumineuse, le coloris délicat de son visage semblait, comme les fleurs vers le soir, s’embellir d’une douce vivacité. Son teint était d’une blancheur transparente ; l’ovale de son visage régulier ; sa bouche ferme et à lèvres bien indiquées ; ses narines délicates ; son front bas et droit s’élevait en arcade entre des bandeaux lisses de cheveux d’un ton clair et légèrement roux ; ils étaient retirés derrière les oreilles et recouverts, excepté à un ou deux pouces au-dessus du front, suivant l’usage des quakers, par un bonnet filoché. Ses sourcils, de la même teinte que les cheveux, formaient une ligne parfaitement horizontale et bien dessinée ; ses cils, quoique moins foncés, étaient longs et fournis. Rien n’était indécis ou inachevé dans ce visage qui rappelait ces fleurs dont les pétales d’un bleu pur ont quelques touches rosées. Ses yeux n’avaient aucune beauté particulière autre que l’expression ; ils paraissaient si simples, si candides, si sérieusement bienveillants, qu’aucune intention de reproche, aucun sourire de moquerie ne pouvaient résister à leur regard. Joshua Rann toussa longuement, comme pour éclaircir sa gorge et se mieux reconnaître ; Chad Cranage souleva sa casquette de cuir et se gratta la tête ; et Ben le Vif s’étonna que Seth osât lui faire la cour.
« Une douce et agréable femme ! se dit l’étranger ; mais certainement la nature ne la destinait point à prêcher. »
Peut-être était-il du nombre de ceux qui pensent que la nature a des procédés de mise en scène, et que, dans la prévision de faciliter l’art et la psychologie, elle façonne ses acteurs suivant leur rôle, pour qu’il n’y ait point de méprise à leur égard. Mais Dinah commença à parler.
« Chers amis, dit-elle d’une voix claire, mais peu élevée, demandons à Dieu sa bénédiction. »
Elle ferma les yeux et, inclinant légèrement la tête, elle continua sur le même ton, comme si elle parlait à quelqu’un tout près d’elle.
« Sauveur des hommes ! lorsqu’une pauvre femme chargée de péchés vint pour puiser de l’eau, elle te trouva assis sur le bord du puits ; elle ne te connaissait point, elle ne te cherchait point ; son esprit était obscurci ; sa vie n’était pas dans la sainteté. Mais tu lui parlas, tu l’enseignas, tu lui montras que ses œuvres étaient à découvert devant toi, et que, cependant, tu étais prêt à lui donner ce pardon dont elle n’avait point connaissance. Jésus ! tu es au milieu de nous et tu connais tous les hommes ; s’il s’en trouve ici de semblables à cette pauvre femme, si leur esprit est obscurci, leur vie en dehors de la sainteté ; s’ils ne sont point venus pour te chercher, s’ils n’ont aucun désir d’être enseignés, aie pour eux la même miséricorde que tu as montrée pour elle. Parle-leur, Seigneur ; ouvre leurs oreilles à mon message ; mets leurs péchés devant leurs yeux, et rends-les altérés de ce salut que tu es prêt à leur accorder.
« Seigneur, tu es toujours avec les tiens ; ils te voient dans la veille de leurs nuits et tu leur parles sur la route. Et tu es près de ceux qui ne t’ont pas connu : ouvre leurs yeux, afin qu’ils te voient ; qu’ils te voient pleurer sur eux et leur dire : « Ne voulez-vous point venir à moi pour avoir la vie ? » Qu’ils te voient suspendu sur la croix et disant : « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu’ils font. » Qu’ils te contemplent tel que tu viendras dans ta gloire pour les juger au dernier jour. Amen ! »
Dinah rouvrit les yeux et s’arrêta en regardant le groupe des villageois, qui s’étaient maintenant rassemblés un peu plus près d’elle et à sa droite.
« Chers amis, commença-t-elle en élevant un peu la voix, vous avez tous été à l’église, et je pense que tous vous avez entendu le ministre lire ces paroles : « L’esprit de Dieu est sur moi, parce qu’il m’a oint pour prêcher aux pauvres son Évangile. » Jésus a prononcé ces paroles ; il a dit qu’il était venu pour prêcher l’Évangile aux pauvres gens. Je ne sais si vous avez jamais beaucoup réfléchi à ces paroles, mais je veux vous dire quand je me rappelle les avoir entendues pour la première fois. C’était justement une soirée semblable à celle-ci ; j’étais une petite fille, et ma tante qui m’a élevée me conduisit avec elle pour entendre un homme vertueux qui prêchait en plein air, comme nous sommes ici. Je me rappelle sa figure ; il était très-âgé et il avait de très-longs cheveux blancs ; sa voix était belle et douce et ne ressemblait à aucune voix que j’eusse jamais entendue. Pour moi, petite fille qui ne savais presque rien, ce vieillard me paraissait un homme si différent de tous ceux que j’avais vus jusqu’alors, que je pensai qu’il était peut-être descendu du ciel pour nous prêcher, et je dis : « Tante, est-ce qu’il retournera au ciel ce soir, comme dans l’image de la Bible ? »
« Cet homme de Dieu était M. Wesley, qui passa sa vie à faire ce que faisait notre Seigneur, prêchant l’Évangile aux pauvres gens. Il est entré dans son repos il y a huit ans. Dans les années suivantes, j’en appris davantage à son sujet ; mais alors je n’étais qu’une enfant légère et irréfléchie, et je me rappelais seulement une chose qu’il nous avait dite dans un sermon : c’est que le mot Évangile veut dire bonne nouvelle ! L’Évangile, vous savez, est ce que la Bible nous apprend à l’égard de Dieu.
« Pensez à cela, maintenant ! Jésus-Christ est véritablement descendu du ciel, comme moi, naïve petite fille, je pensais que M. Wesley l’avait fait ; et il en est descendu pour dire de bonnes nouvelles aux pauvres gens à l’égard de Dieu. Eh bien, chers amis, vous et moi sommes de ces pauvres gens. Nous avons été élevés dans de misérables chaumières ; nous avons été nourris de pain d’avoine et avons vécu à la dure. Nous avons bien peu été à l’école et lu bien peu de livres ; nous savons peu de choses en dehors de ce qui se passe tout près de nous. Nous sommes justement l’espèce de gens qui ont besoin d’entendre de bonnes nouvelles, car, lorsque quelqu’un est dans une belle position, il ne tient pas beaucoup à apprendre les nouvelles des choses lointaines ; mais, si un pauvre homme et une pauvre femme sont dans la détresse et ont à travailler durement pour vivre, ils aiment bien à recevoir une lettre qui leur apprend qu’ils ont un ami qui veut leur venir en aide. Certainement nous pourrions savoir quelque chose de Dieu, même si nous n’avons jamais connu l’Évangile, la bonne nouvelle que notre Sauveur nous a apportée, car nous n’ignorons pas que toute chose vient de Dieu. Ne dites-vous pas, presque chaque jour : « Ceci ou cela arrivera, s’il plaît à Dieu ? » ou bien : « Nous commencerons bientôt à faucher l’herbe, s’il plaît à Dieu de nous envoyer encore un peu de soleil ? » Nous savons très-bien que nous sommes entièrement sous la main de Dieu ; nous ne nous sommes point donné la vie ; nous ne pouvons être maîtres de nous pendant notre sommeil ; la lumière du jour, et le vent, et le blé, et les vaches qui nous donnent leur lait : tout ce que nous avons vient de Dieu. Et il nous a donné nos âmes, et il a mis l’amour entre les parents et les enfants, entre le mari et la femme. Mais est-ce là tout ce dont nous avons besoin pour connaître Dieu ? Nous croyons qu’il est grand et puissant, et peut faire tout ce qu’il veut ; nous nous sentons perdus, comme si nous luttions contre une eau profonde, quand nous essayons de penser à lui.
« Mais peut-être vous vient-il à l’esprit des doutes comme celui-ci : Est-ce que Dieu s’occupe beaucoup de pauvres gens tels que nous ? Peut-être n’a-t-il fait le monde que pour les grands, les savants et les riches. Ça ne lui a pas beaucoup coûté de nous donner notre petite bouchée de nourriture et un lambeau de vêtement ; mais comment savons-nous s’il s’intéresse à nous, plus que nous ne le faisons des vers et autres insectes du jardin, lorsque nous cultivons nos oignons et nos carottes ? Dieu s’occupe-t-il de nous à notre mort ? A-t-il quelque consolation pour nous quand nous sommes estropiés, ou malades, ou dans la misère ? Peut-être aussi est-il fâché contre nous ; autrement, pourquoi avons-nous la sécheresse et les mauvaises moissons, et les fièvres, et toutes sortes de maux et d’inquiétudes ? Car notre vie est pleine de chagrins, et si Dieu nous envoie le bien, il semble aussi nous envoyer le mal. Comment en est-il ainsi ? Pourquoi est-ce ainsi ?
« Ah ! chers amis, nous sommes dans un grand besoin de nouvelles sur Dieu ; et que signifient les autres bonnes nouvelles si nous n’avons pas de celles-là ? Car toutes les choses de cette vie ont une fin, et, quand nous mourons, nous les laissons toutes. Mais Dieu reste encore quand tout nous a quittés. Que ferons-nous s’il n’est pas notre ami ? »
Alors Dinah raconta comment la bonne nouvelle avait été apportée, et comment les desseins de Dieu à l’égard des chétifs de ce monde avaient été manifestés par la vie de Jésus, passée dans la sainteté et les œuvres de miséricorde.
« Ainsi, vous voyez, chers amis, continua-t-elle, que Jésus a employé presque tout son temps à faire du bien aux pauvres ; il leur a prêché en plein air, il en a fait ses amis, il les a enseignés et a pris beaucoup de peines pour eux. Ce n’est pas qu’il n’ait aussi fait du bien aux riches, car il était plein d’amour pour tous les hommes ; seulement il voyait que les pauvres avaient un plus grand besoin de son secours. C’est ainsi qu’il guérissait les estropiés, les malades et les aveugles, qu’il faisait des miracles pour nourrir ceux qui avaient faim, parce que, disait-il, il avait pitié d’eux ; et il était très-bon pour les petits enfants, il consolait ceux qui avaient perdu leurs proches, il parlait avec une douce compassion aux pauvres pécheurs qui étaient attristés d’avoir péché.
« Ah ! n’aimeriez-vous pas un tel homme si vous pouviez le voir, — s’il était dans ce village ? Quel tendre cœur il doit avoir ! Quel consolateur on trouverait dans l’affliction ! Comme il serait agréable de recevoir ses instructions !
« Eh bien ! chers amis, qu’était-il cet homme ? Était-ce seulement un homme bon, — un homme très-bon, et rien de plus, — comme notre cher M. Wesley, qui nous a été repris ?… Ah ! c’était le Fils de Dieu, — fait à l’image du Père, dit la Bible, c’est-à-dire tout à fait semblable à Dieu, qui est le commencement et la fin de toutes choses, — le Dieu que nous avons besoin de connaître. Ainsi, tout l’amour que Jésus a montré pour les malheureux est ce même amour que Dieu a pour nous. Nous pouvons comprendre les enseignements de Jésus, parce qu’il est venu avec un corps semblable au nôtre, et qu’il s’est servi des mêmes paroles dont nous nous servons entre nous. Avant, nous étions effrayés de penser à ce qu’était Dieu, — le Dieu qui a fait le monde et les cieux, et le tonnerre et l’éclair. Nous ne pouvons jamais le voir ; nous pouvons seulement voir les choses qu’il a faites ; et quelques-unes de ces choses sont si effrayantes, que nous pouvions bien trembler en pensant à lui. Mais notre Sauveur béni nous a montré ce qu’est Dieu d’une manière telle que les pauvres gens ignorants peuvent le comprendre ; il nous a montré ce qu’est le cœur de Dieu, quelles sont ses miséricordes pour nous.
« Mais voyons encore pourquoi Jésus est venu sur la terre. Une fois il dit : « Je suis venu pour chercher et sauver ce qui était perdu ; » et une autre fois : « Je ne suis point venu pour appeler les justes, mais pour appeler les pécheurs à la repentance. »
« Ce qui était perdu !… Les pécheurs !… Ah ! chers amis, seraient-ce vous ? serait-ce moi ? »
Jusque-là, le voyageur avait été retenu contre sa volonté par le charme des notes claires de la voix pure de Dinah, qui offraient une variété de modulations semblables à celles d’un bel instrument touché habilement par l’instinct musical qui s’ignore. Les choses simples qu’elle disait paraissaient des nouveautés, ainsi qu’une mélodie déjà connue nous apporte un nouveau plaisir quand nous l’entendons chanter par la pure voix d’un enfant de chœur. La calme et profonde conviction avec laquelle elle parlait était elle-même une preuve de la vérité de sa mission. Il vit qu’elle avait complètement captivé ses auditeurs. Les villageois s’étaient rassemblés près d’elle, et on lisait une grave attention sur toutes les figures. Elle parlait lentement, quoique très-couramment, s’arrêtait parfois après une question, ou avant quelque transition d’idées. Aucun changement d’attitude en elle ; point de gestes ; l’effet de son discours était uniquement produit par les inflexions de sa voix, et, quand elle en vint à cette question : « Dieu prendra-t-il soin de nous quand nous mourrons ? » elle le prononça avec un accent si plaintif de supplication, que les larmes vinrent aux yeux de quelques-uns des plus endurcis. L’étranger avait cessé de douter qu’elle pût fixer l’attention de ses rustiques auditeurs ; mais il se demandait encore si elle pourrait les émouvoir violemment, ce qui devait être le cachet nécessaire de sa vocation de prédicateur méthodiste, jusqu’au moment où elle articula ces mots : « Perdus ! — Pécheurs ! » qui amenèrent un grand changement dans sa voix et ses manières. Elle avait fait une longue pause avant cette exclamation, pendant laquelle elle avait paru toute émue de pensées qui se lisaient sur ses traits. Son visage pâle le devint encore davantage ; les cercles sous ses yeux prirent une teinte plus foncée, comme lorsque des larmes les remplissent ; la douceur bienveillante de son regard se changea en une expression de pitié épouvantée ; on eût pu croire qu’elle avait vu soudainement quelque ange destructeur planer sur l’assemblée. Sa voix devint profonde et contenue ; mais il n’y avait point encore de gestes. Rien ne ressemblait moins au type ordinaire du harangueur que Dinah. Elle ne prêchait point comme elle entendait les autres le faire, mais elle parlait sous l’influence directe de ses propres sentiments, et sous l’inspiration de sa simple foi personnelle.
Maintenant elle était entrée dans un autre ordre de démonstrations. Sa manière devint moins calme, son débit plus rapide et agité ; elle essaya de faire comprendre à ces gens leur culpabilité, leurs ténèbres volontaires, leur état de désobéissance envers Dieu, — en appuyant sur l’odieux du péché, sur la sainteté divine et sur les souffrances de notre Sauveur par lesquelles la voie du salut leur était ouverte. Enfin, il sembla que, par son ardent désir de retrouver les brebis perdues, il ne lui suffisait plus de s’adresser à la masse de ses auditeurs. Elle en interpella d’abord un, puis un autre, en les suppliant de venir à Dieu pendant qu’il en était temps encore ; leur peignant la désolation de leurs âmes, perdues dans le péché de ce monde, bien loin de Dieu leur Père ; puis l’amour du Sauveur, qui veillait et attendait leur retour.
Bien des soupirs et des gémissements lui répondaient de la part de ses frères méthodistes ; mais l’esprit villageois ne s’émeut pas si facilement, et une vague anxiété un peu excitée, et qui pouvait très facilement s’évanouir de nouveau, était le plus grand effet que la prédication de Dinah eût obtenu sur eux jusque-là. Cependant, pas un ne s’était retiré, excepté les enfants et le vieux Père Taft, qui, trop sourd pour saisir beaucoup de mots, était depuis quelque temps retourné à son coin favori. Ben le Vif se sentait fort mal à l’aise, et regrettait presque d’être venu entendre Dinah ; il pensait que ce qu’elle disait le poursuivrait en quelque manière ; pourtant il ne pouvait s’empêcher de trouver du plaisir à la regarder et à l’écouter, quoiqu’il craignît à chaque instant qu’elle ne fixât ses regards sur lui et ne s’adressât particulièrement à lui, comme elle l’avait fait pour Jim le Roux, qui pour le moment tenait son enfant dans ses bras pour soulager sa femme. Ce gros homme, dont le cœur était bon, avait déjà essuyé quelques larmes avec son poing, souhaitant devenir un meilleur sujet, qui irait moins souvent au Buisson de houx, vers les Carrières, et observerait plus régulièrement le dimanche.
Devant Jim le Roux se trouvait Bess Chad, qui n’avait cessé de montrer une tranquillité involontaire et une attention soutenue depuis l’instant où Dinah avait commencé de parler. Non point que le sujet du discours l’eût de suite captivée, car elle était perdue dans la difficile recherche de comprendre quel plaisir et quelle satisfaction il pouvait y avoir pour une jeune femme qui portait un chapeau comme celui de Dinah. Abandonnant cette recherche sans succès, elle se mit à étudier le nez de Dinah, ses yeux, sa bouche et ses cheveux, curieuse de savoir s’il valait mieux désirer un pâle visage de cette espèce, ou des joues grasses et roses et des yeux noirs bien ouverts comme les siens. Mais peu à peu l’influence de la gravité générale réagit sur elle, et elle eut la conscience de ce que disait Dinah. Les doux accents, la tendre persuasion ne la touchaient point ; mais, lorsque vinrent les supplications plus sévères, elle commença d’être effrayée. La pauvre Bessy avait toujours été considérée comme une jeune fille légère ; elle le savait. S’il fallait être sérieuse et modeste, il est clair qu’elle était dans la mauvaise voie : elle ne pouvait trouver facilement les passages dans son livre à l’église, comme le faisait Sally Rann ; elle avait souvent ri à la dérobée en faisant sa révérence à M. Irwine, et ces manquements religieux étaient accompagnés d’une négligence correspondante dans ses moindres habitudes ; car Bessy appartenait sans aucun doute à cette espèce de femmes irrégulières et peu propres chez lesquelles vous pouvez vous hasarder tout au plus à manger un œuf, une pomme ou une noix