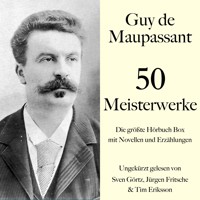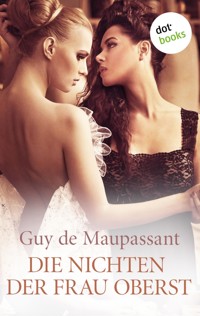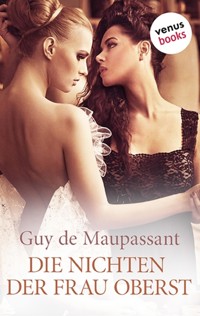Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Les contes de la Bécasse est un recueil composé des 17 nouvelles écrites par Guy de Maupassant de 1882 à 1883 : La Bécasse (1882) Ce cochon de Morin (1882) La Folle (1882) Pierrot (1882) Menuet (1882) La Peur (1882) Farce normande (1882) Les Sabots (1883) La Rempailleuse (1882) En mer (1883) ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 164
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Contes de la Becasse
Pages de titreLA BÉCASSECE COCHON DE MORINLA FOLLEPIERROTMENUETLA PEURFARCE NORMANDELES SABOTSLA REMPAILLEUSEEN MERUN NORMANDLE TESTAMENTAUX CHAMPSUN COQ CHANTAUN FILSSAINT-ANTOINEL’AVENTURE DE WALTER SCHNAFFSPage de copyright1
Contes de la Becasse
Guy de Maupassant
2
LA BÉCASSE
Le vieux baron des Ravots avait été pendant quarante ans le roi
des chasseurs de sa province. Mais, depuis cinq à six années, une
paralysie des jambes le clouait à son fauteuil, et il ne pouvait plus
que tirer des pigeons de la fenêtre de son salon ou du haut de son
grand perron.
Le reste du temps il lisait.
C’était un homme de commerce aimable chez qui était resté
beaucoup de l’esprit lettré du dernier siècle. Il adorait les contes, les
petits contes polissons, et aussi les histoires vraies arrivées dans son
entourage. Dès qu’un ami entrait chez lui, il demandait :
— Eh bien, quoi de nouveau ?
Et il savait interroger à la façon d’un juge d’instruction.
Par les jours de soleil il faisait rouler devant la porte son large
fauteuil pareil à un lit. Un domestique, derrière son dos, tenait les
fusils, les chargeait et les passait à son maître ; un autre valet, caché
dans un massif, lâchait un pigeon de temps en temps, à des
intervalles irréguliers, pour que le baron ne fût pas prévenu et
demeurât en éveil.
Et, du matin au soir, il tirait les oiseaux rapides, se désolant quand
il s’était laissé surprendre, et riant aux larmes quand la bête tombait
d’aplomb ou faisait quelque culbute inattendue et drôle. Il se tournait
alors vers le garçon qui chargeait les armes, et il demandait, en
suffoquant de gaieté :
— Y est-il, celui-là, Joseph ! As-tu vu comme il est descendu ?
Et Joseph répondait invariablement :
— Oh ! monsieur le baron ne les manque pas.
3
À l’automne, au moment des chasses, il invitait, comme à l’ancien
temps, ses amis, et il aimait entendre au loin les détonations. Il les
comptait, heureux quand elles se précipitaient. Et, le soir, il exigeait
de chacun le récit fidèle de sa journée.
Et on restait trois heures à table en racontant des coups de fusil.
C’étaient d’étranges et invraisemblables aventures, où se
complaisait l’humeur hâbleuse des chasseurs. Quelques-unes avaient
fait date et revenaient régulièrement. L’histoire d’un lapin que le petit
vicomte de Bourril avait manqué dans son vestibule les faisait se
tordre chaque année de la même façon. Toutes les cinq minutes un
nouvel orateur prononçait :
— J’entends : « Birr ! birr ! » et une compagnie magnifique me
part à dix pas. J’ajuste : pif ! paf ! j’en vois tomber une pluie, une
vraie pluie. Il y en avait sept !
Et tous, étonnés, mais réciproquement crédules, s’extasiaient.
Mais il existait dans la maison une vieille coutume, appelée le
« conte de la Bécasse ».
Au moment du passage de cette reine des gibiers, la même
cérémonie recommençait à chaque dîner.
Comme ils adoraient l’incomparable oiseau, on en mangeait tous
les soirs un par convive ; mais on avait soin de laisser dans un plat
toutes les têtes.
Alors le baron, officiant comme un évêque, se faisait apporter sur
une assiette un peu de graisse, oignait avec soin les têtes précieuses
en les tenant par le bout de la mince aiguille qui leur sert le bec. Une
chandelle allumée était posée près de lui, et tout le monde se taisait,
dans l’anxiété de l’attente.
Puis il saisissait un des crânes ainsi préparés, le fixait sur une
épingle, piquait l’épingle sur un bouchon, maintenait le tout en
équilibre au moyen de petits bâtons croisés comme des balanciers, et
plantait délicatement cet appareil sur un goulot de bouteille en
manière de tourniquet.
Tous les convives comptaient ensemble, d’une voix forte :
— Une, — deux, — trois.
Et le baron, d’un coup de doigt, faisait vivement pivoter ce joujou.
Celui des invités que désignait, en s’arrêtant, le long bec pointu
4
devenait maître de toutes les têtes, régal exquis qui faisait loucher ses
voisins.
Il les prenait une à une et les faisait griller sur la chandelle. La
graisse crépitait, la peau rissolée fumait, et l’élu du hasard croquait le
crâne suiffé en le tenant par le nez et en poussant des exclamations
de plaisir.
Et chaque fois les dîneurs, levant leurs verres, buvaient à sa santé.
Puis, quand il avait achevé le dernier, il devait, sur l’ordre du
baron, conter une histoire pour indemniser les déshérités.
Voici quelques-uns de ces récits :
5
CE COCHON DE MORIN
A M. Oudinot.
6
I
« Ça, mon ami, dis-je à Labarbe, tu viens encore de prononcer ces
quatre mots, « ce cochon de Morin ». Pourquoi, diable, n’ai-je jamais
entendu parler de Morin sans qu’on le traitât de « cochon » ?
Labarbe, aujourd’hui député, me regarda avec des yeux de chat-
huant. « Comment, tu ne sais pas l’histoire de Morin, et tu es de la
Rochelle ? »
J’avouai que je ne savais pas l’histoire de Morin. Alors Labarbe se
frotta les mains et commença son récit.
« Tu as connu Morin, n’est-ce pas, et tu te rappelles son grand
magasin de mercerie sur le quai de la Rochelle ?
— « Oui, parfaitement.
— « Eh bien, sache qu’en 1862 ou 63 Morin alla passer quinze
jours à Paris, pour son plaisir, ou ses plaisirs, mais sous prétexte de
renouveler ses approvisionnements. Tu sais ce que sont, pour un
commerçant de province, quinze jours de Paris. Cela vous met le feu
dans le sang. Tous les soirs des spectacles, des frôlements de
femmes, une continuelle excitation d’esprit. On devient fou. On ne
voit plus que danseuses en maillot, actrices décolletées, jambes
rondes, épaules grasses, tout cela presque à portée de la main, sans
qu’on ose ou qu’on puisse y toucher. C’est à peine si on goûte, une
fois ou deux, à quelques mets inférieurs. Et l’on s’en va, le cœur
encore tout secoué, l’âme émoustillée, avec une espèce de
démangeaison de baisers qui vous chatouillent les lèvres.
Morin se trouvait dans cet état, quand il prit son billet pour la
Rochelle par l’express de 8 h. 40 du soir. Et il se promenait plein de
regrets et de trouble dans la grande salle commune du chemin de fer
7
d’Orléans, quand il s’arrêta net devant une jeune femme qui
embrassait une vieille dame. Elle avait relevé sa voilette, et Morin,
ravi, murmura : « Bigre, la belle personne ! »
Quand elle eut fait ses adieux à la vieille, elle entra dans la salle
d’attente, et Morin la suivit ; puis elle passa sur le quai, et Morin la
suivit encore ; puis elle monta dans un wagon vide, et Morin la suivit
toujours.
Il y avait peu de voyageurs pour l’express. La locomotive siffla ;
le train partit. Ils étaient seuls.
Morin la dévorait des yeux. Elle semblait avoir dix-neuf à vingt
ans ; elle était blonde, grande, d’allure hardie. Elle roula autour de
ses jambes une couverture de voyage, et s’étendit sur les banquettes
pour dormir.
Morin se demandait : « Qui est-ce ? » Et mille suppositions, mille
projets lui traversaient l’esprit. Il se disait : « On raconte tant
d’aventures de chemin de fer. C’en est une peut-être qui se présente
pour moi. Qui sait ? une bonne fortune est si vite arrivée. Il me
suffirait peut-être d’être audacieux. N’est-ce pas Danton qui disait :
« De l’audace, de l’audace, et toujours de l’audace. » Si ce n’est pas
Danton, c’est Mirabeau.
Enfin, qu’importe. Oui, mais je manque d’audace, voilà le hic.
Oh ! Si on savait, si on pouvait lire dans les âmes ! Je parie qu’on
passe tous les jours, sans s’en douter, à côté d’occasions magnifiques.
Il lui suffirait d’un geste pourtant pour m’indiquer qu’elle ne
demande pas mieux… »
Alors, il supposa des combinaisons qui le conduisaient au
triomphe. Il imaginait une entrée en rapport chevaleresque, des petits
services qu’il lui rendait, une conversation vive, galante, finissait par
une déclaration qui finissait par… par ce que tu penses.
Mais ce qui lui manquait toujours, c’était le début, le prétexte. Et
il attendait une circonstance heureuse, le cœur ravagé, l’esprit sens
dessus dessous.
La nuit cependant s’écoulait et la belle enfant dormait toujours,
tandis que Morin méditait sa chute. Le jour parut, et bientôt le soleil
lança son premier rayon, un long rayon clair venu du bout de
l’horizon, sur le doux visage de la dormeuse.
8
Elle s’éveilla, s’assit, regarda la campagne, regarda Morin et
sourit. Elle sourit en femme heureuse, d’un air engageant et gai.
Morin tressaillit. Pas de doute, c’était pour lui ce sourire-là, c’était
bien une invitation discrète, le signal rêvé qu’il attendait. Il voulait
dire, ce sourire : « Êtes-vous bête, êtes-vous niais, êtes-vous jobard,
d’être resté là, comme un pieu, sur votre siège depuis hier soir.
« Voyons, regardez-moi, ne suis-je pas charmante ?
Et vous demeurez comme ça toute une nuit en tête à tête avec une
jolie femme sans rien oser, grand sot. »
Elle souriait toujours en le regardant ; elle commençait même à
rire ; et il perdait la tête, cherchant un mot de circonstance, un
compliment, quelque chose à dire enfin, n’importe quoi. Mais il ne
trouvait rien, rien. Alors, saisi d’une audace de poltron, il pensa :
« Tant pis, je risque tout » ; et brusquement, sans crier « gare », il
s’avança, les mains tendues, les lèvres gourmandes, et, la saisissant à
pleins bras, il l’embrassa.
D’un bond elle fut debout criant : « Au secours », hurlant
d’épouvante. Et elle ouvrit la portière, elle agita ses bras dehors, folle
de peur, essayant de sauter, tandis que Morin éperdu, persuadé
qu’elle allait se précipiter sur la voie, la retenait par sa jupe en
bégayant : « Madame… oh ! … madame. »
Le train ralentit sa marche, s’arrêta. Deux employés se
précipitèrent aux signaux désespérés de la jeune femme qui tomba
dans leurs bras en balbutiant : « Cet homme a voulu… a voulu…
me… me… » Et elle s’évanouit.
On était en gare de Mauzé. Le gendarme présent arrêta Morin.
Quand la victime de sa brutalité eut repris connaissance, elle fit sa
déclaration. L’autorité verbalisa. Et le pauvre mercier ne put regagner
son domicile que le soir, sous le coup d’une poursuite judiciaire pour
outrage aux bonnes mœurs dans un lieu public.
9
II
J’étais alors rédacteur en chef du Fanal des Charentes ; et je
voyais Morin, chaque soir, au Café du commerce.
Dès le lendemain de son aventure, il vint me trouver, ne sachant
que faire. Je ne lui cachai pas mon opinion : « Tu n’es qu’un cochon.
On ne se conduit pas comme ça. »
Il pleurait ; sa femme l’avait battu ; et il voyait son commerce
ruiné, son nom dans la boue, déshonoré, ses amis, indignés, ne le
saluant plus. Il finit par me faire pitié, et j’appelai mon collaborateur
Rivet, un petit homme goguenard et de bon conseil, pour prendre ses
avis.
Il m’engagea à voir le procureur impérial, qui était de mes amis.
Je renvoyai Morin chez lui et je me rendis chez ce magistrat.
J’appris que la femme outragée était une jeune fille, Mlle
Henriette Bonnel, qui venait de prendre à Paris ses brevets
d’institutrice et qui, n’ayant plus ni père ni mère, passait ses vacances
chez son oncle et sa tante, braves petits bourgeois de Mauzé.
Ce qui rendait grave la situation de Morin, c’est que l’oncle avait
porté plainte. Le ministère public consentait à laisser tomber l’affaire
si cette plainte était retirée. Voilà ce qu’il fallait obtenir.
Je retournai chez Morin. Je le trouvai dans son lit, malade
d’émotion et de chagrin. Sa femme, une grande gaillarde osseuse et
barbue, le maltraitait sans repos. Elle m’introduisit dans la chambre
en me criant par la figure : « Vous venez voir ce cochon de Morin ?
Tenez, le voilà, le coco ! »
Et elle se planta devant le lit, les poings sur les hanches. J’exposai
la situation ; et il me supplia d’aller trouver la famille. La mission
10
était délicate ; cependant je l’acceptai. Le pauvre diable ne cessait de
répéter : « Je t’assure que je ne l’ai pas même embrassée, non, pas
même. Je te le jure ! »
Je répondis : « C’est égal, tu n’es qu’un cochon. » Et je pris mille
francs qu’il m’abandonna pour les employer comme je le jugerais
convenable.
Mais comme je ne tenais pas à m’aventurer seul dans la maison
des parents, je priai Rivet de m’accompagner. Il y consentit, à la
condition qu’on partirait immédiatement, car il avait, le lendemain
dans l’après-midi, une affaire urgente à la Rochelle.
Et, deux heures plus tard, nous sonnions à la porte d’une jolie
maison de campagne. Une belle jeune fille vint nous ouvrir. C’était
elle assurément. Je dis tout bas à Rivet : « Sacrebleu, je commence à
comprendre Morin. »
L’oncle, M. Tonnelet, était justement un abonné du Fanal, un
fervent coreligionnaire politique qui nous reçut à bras ouverts, nous
félicita, nous congratula, nous serra les mains, enthousiasmé d’avoir
chez lui les deux rédacteurs de son journal. Rivet me souffla dans
l’oreille : « Je crois que nous pourrons arranger l’affaire de ce cochon
de Morin. »
La nièce s’était éloignée ; et j’abordai la question délicate.
J’agitai le spectre du scandale ; je fis valoir la dépréciation
inévitable que subirait la jeune personne après le bruit d’une pareille
affaire ; car on ne croirait jamais à un simple baiser.
Le bonhomme semblait indécis ; mais il ne pouvait rien décider
sans sa femme qui ne rentrerait que tard dans la soirée. Tout à coup il
poussa un cri de triomphe : « Tenez, j’ai une idée excellente. Je vous
tiens, je vous garde. Vous allez dîner et coucher ici tous les deux ; et,
quand ma femme sera revenue, j’espère que nous nous entendrons. »
Rivet résistait ; mais le désir de tirer d’affaire ce cochon de Morin
le décida ; et nous acceptâmes l’invitation.
L’oncle se leva, radieux, appela sa nièce, et nous proposa une
promenade dans sa propriété en proclamant : « À ce soir les affaires
sérieuses. »
Rivet et lui se mirent à parler politique. Quant à moi, je me trouvai
bientôt à quelques pas en arrière, à côté de la jeune fille. Elle était
11
vraiment charmante, charmante !
Avec des précautions infinies, je commençai à lui parler de son
aventure pour tâcher de m’en faire une alliée.
Mais elle ne parut pas confuse le moins du monde ; elle
m’écoutait de l’air d’une personne qui s’amuse beaucoup.
Je lui disais : « Songez donc, mademoiselle, à tous les ennuis que
vous aurez.
Il vous faudra comparaître devant le tribunal, affronter les regards
malicieux, parler en face de tout ce monde, raconter publiquement
cette triste scène du wagon. Voyons, entre nous, n’auriez-vous pas
mieux fait de ne rien dire, de remettre à sa place ce polisson sans
appeler les employés ; et de changer simplement de voiture. »
Elle se mit à rire. « C’est vrai ce que vous dites ! mais que voulez-
vous ? J’ai eu peur ; et, quand on a peur, on ne raisonne plus. Après
avoir compris la situation, j’ai bien regretté mes cris ; mais il était
trop tard. Songez aussi que cet imbécile s’est jeté sur moi comme un
furieux, sans prononcer un mot, avec une figure de fou. Je ne savais
même pas ce qu’il me voulait. »
Elle me regardait en face, sans être troublée ou intimidée. Je me
disais : « Mais c’est une gaillarde, cette fille. Je comprends que ce
cochon de Morin se soit trompé.
Je repris, en badinant : « Voyons Mademoiselle, avouez qu’il était
excusable, car, enfin, on ne peut pas se trouver en face d’une aussi
belle personne que vous sans éprouver le désir absolument légitime
de l’embrasser. »
Elle rit plus fort, toutes les dents au vent : « Entre le désir et
l’action, monsieur, il y a place pour le respect. »
La phrase était drôle, bien que peu claire. Je demandai
brusquement : « Eh bien, voyons, si je vous embrassais, moi,
maintenant ; qu’est-ce que vous feriez ? »
Elle s’arrêta pour me considérer du haut en bas, puis elle dit,
tranquillement : « Oh, vous, ce n’est pas la même chose. »
Je le savais bien, parbleu, que ce n’était pas la même chose,
puisqu’on m’appelait dans toute la province « le beau Labarbe ».
J’avais trente ans, alors, mais je demandai : « Pourquoi ça ? »
Elle haussa les épaules, et répondit : « Tiens ! parce que vous
12
n’êtes pas aussi bête que lui. » Puis elle ajouta, en me regardant en
dessous : « Ni aussi laid. »
Avant qu’elle eût pu faire un mouvement pour m’éviter, je lui
avais planté un bon baiser sur la joue. Elle sauta de côté, mais trop
tard. Puis elle dit : « Eh bien vous n’êtes pas gêné non plus, vous.
Mais ne recommencez pas ce jeu-là. »
Je pris un air humble et je dis à mi-voix : « Oh ! mademoiselle,
quant à moi, si j’ai un désir au cœur, c’est de passer devant un
tribunal pour la même cause que Morin. »
Elle demanda à son tour : « Pourquoi ça ? » Je la regardai au fond
des yeux sérieusement. « Parce que vous êtes une des plus belles
créatures qui soient ; parce que ce serait pour moi un brevet, un titre,
une gloire, que d’avoir voulu vous violenter. Parce qu’on dirait après
vous avoir vue : « Tiens, Labarbe n’a pas volé ce qui lui arrive, mais
il a de la chance tout de même. »
Elle se remit à rire de tout son cœur.
« Êtes-vous drôle ? » Elle n’avait pas fini le mot « drôle » que je
la tenais à pleins bras et je lui jetais des baisers voraces partout où je
trouvais une place, dans les cheveux, sur le front, sur les yeux, sur la
bouche parfois, sur les joues, par toute la tête, dont elle découvrait
toujours malgré elle un coin pour garantir les autres.
À la fin, elle se dégagea, rouge et blessée. « Vous êtes un grossier,
monsieur, et vous me faites repentir de vous avoir écouté. »
Je lui saisis la main, un peu confus, balbutiant : « Pardon, pardon,
mademoiselle. Je vous ai blessée ; j’ai été brutal ! Ne m’en voulez
pas. Si vous saviez ? … » Je cherchais vainement une excuse.
Elle prononça, au bout d’un moment : « Je n’ai rien à savoir,
monsieur. »
Mais j’avais trouvé ; je m’écriai : « Mademoiselle, voici un an que
je vous aime ! »
Elle fut vraiment surprise et releva les yeux. Je repris : « Oui,
mademoiselle, écoutez-moi. Je ne connais pas Morin et je me moque
bien de lui. Peu m’importe qu’il aille en prison et devant les
tribunaux. Je vous ai vue ici l’an passé, vous étiez là-bas, devant la
grille. J’ai reçu une secousse en vous apercevant et votre image ne
m’a plus quitté. Croyez-moi, ou ne me croyez pas, peu m’importe. Je
13
vous ai trouvée adorable ; votre souvenir me possédait ; j’ai voulu
vous revoir ; j’ai saisi le prétexte de cette bête de Morin ; et me voici.
Les circonstances m’ont fait passer les bornes ; pardonnez-moi, je
vous en supplie, pardonnez-moi. »
Elle guettait la vérité dans mon regard, prête à sourire de
nouveau ; et elle murmura : « Blagueur. »
Je levai la main, et, d’un ton sincère (je crois même que j’étais
sincère) : « Je vous jure que je ne mens pas. »
Elle dit simplement : « Allons donc. »
Nous étions seuls, tout seuls, Rivet et l’oncle ayant disparu dans
les allées tournantes ; et je lui fis une vraie déclaration, longue,
douce, en lui pressant et lui baisant les doigts. Elle écoutait cela
comme une chose agréable et nouvelle, sans bien savoir ce qu’elle en
devait croire.
Je finissais par me sentir troublé ; par penser ce que je disais ;
j’étais pâle, oppressé, frissonnant ; et, doucement, je lui pris la taille.
Je lui parlais tout bas dans les petits cheveux frisés de l’oreille.
Elle semblait morte tant elle restait rêveuse.
Puis sa main rencontra la mienne et la serra ; je pressai lentement
sa taille d’une étreinte tremblante et toujours grandissante ; elle ne
remuait plus du tout ; j’effleurais sa joue de ma bouche ; et tout à
coup mes lèvres, sans chercher, trouvèrent les siennes. Ce fut un
long, long baiser ; et il aurait encore duré longtemps ; si je n’avais
entendu « hum, hum » à quelques pas derrière moi.
Elle s’enfuit à travers un massif. Je me retournai et j’aperçus Rivet
qui me rejoignait.
Il se campa au milieu du chemin ; et sans rire : « Eh bien ! c’est
comme ça que tu arranges l’affaire de ce cochon de Morin. »
Je répondis avec fatuité : « On fait ce qu’on peut, mon cher. Et
l’oncle ? Qu’en as-tu obtenu ? Moi, je réponds de la nièce. »
Rivet déclara : « J’ai été moins heureux avec l’oncle. »
Et je lui pris le bras pour rentrer.
14
III
Le dîner acheva de me faire perdre la tête. J’étais à côté d’elle et
ma main sans cesse rencontrait sa main sous la nappe ; mon pied
pressait son pied ; nos regards se joignaient, se mêlaient.
On fit ensuite un tour au clair de lune et je lui murmurai dans
l’âme toutes les tendresses qui me montaient du cœur. Je la tenais
serrée contre moi, l’embrassant à tout moment, mouillant mes lèvres
aux siennes. Devant nous, l’oncle et Rivet discutaient. Leurs ombres
les suivaient gravement sur le sable des chemins.
On rentra. Et bientôt l’employé du télégraphe apporta une dépêche
de la tante annonçant qu’elle ne reviendrait que le lendemain matin, à
sept heures, par le premier train.
L’oncle, dit : « Eh bien, Henriette, va montrer leurs chambres à
ces messieurs. » On serra la main du bonhomme et on monta. Elle
nous conduisit d’abord dans l’appartement de Rivet, et il me souffla
dans l’oreille : « Pas de danger qu’elle nous ait menés chez toi
d’abord. » Puis elle me guida vers mon lit. Dès qu’elle fut seule avec
moi, je la saisis de nouveau dans mes bras, tâchant d’affoler sa raison
et de culbuter sa résistance. Mais, quand elle se sentit tout près de
défaillir, elle s’enfuit.
Je me glissais entre mes draps, très contrarié, très agité, et très
penaud, sachant bien que je ne dormirais guère, cherchant quelle
maladresse j’avais pu commettre, quand on heurta doucement ma
porte.
Je demandai : « Qui est là ? »