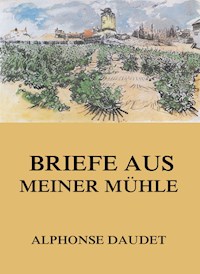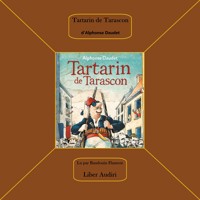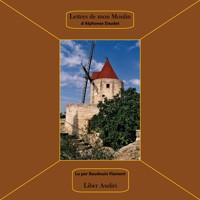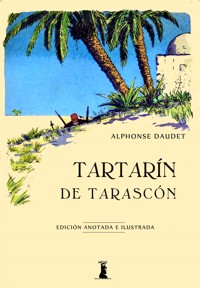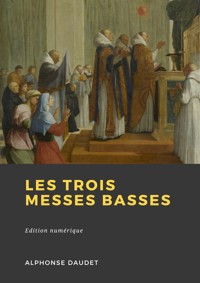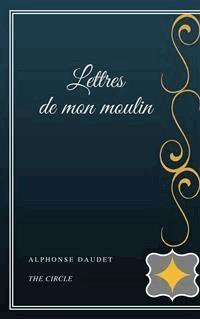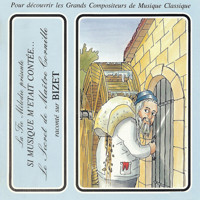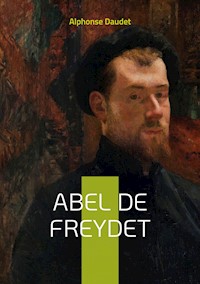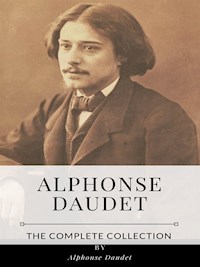Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Französisch
Parus en 1873, les Contes du lundi évoquent dans la première partie, « La Fantaisie et l'Histoire », cette période de défaite et de bouleversements que fut la guerre de 1870. Fierté blessée, grandeur ou malice animent des textes devenus des classiques comme « Le porte-drapeau », « La dernière classe », « L'enfant espion ».L'humour, noir ou rose, domine dans « Caprices et souvenirs » de la seconde partie.Simplicité, finesse, émotion, poésie, vérité du trait sont les qualités maîtresses de ce recueil qui, avec les Lettres de mon moulin, fait d'Alphonse Daudet un des plus célèbres écrivains du xixe siècle.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 317
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Contes du Lundi
Contes du LundiPREMIÈRE PARTIELA FANTAISIE ET L’HISTOIRELA DERNIÈRE CLASSELA PARTIE DE BILLARDLA VISION DU JUGE DE COLMARL’ENFANT ESPIONLES MÈRESLE SIÈGE DE BERLINLE MAUVAIS ZOUAVELA PENDULE DE BOUGIVALL’ILLUSTRE DOCTEUR-PROFESSEURLE SALON DES SCHWANTHALERSINGULIÈRE INFLUENCE DE LA PENDULE DE BOUGIVAL« DE LA GAIETÉ, MES ENFANTS, DE LA GAIETÉ ! »CONCLUSIONLA DÉFENSE DE TARASCONLES ORPHÉONSLES CAVALCADESLA TROUÉELA DÉFENSE DU CERCLELAPINS DE GARENNE ET LAPINS DE CHOUXLE PUNCH D’ADIEULE PRUSSIEN DE BÉLISAIRELES PAYSANS À PARISAUX AVANT-POSTESÀ LA COURNEUVE, UN MATIN DE DÉCEMBRELE LONG DE LA MARNESOUVENIR DU FORT MONTROUGEÀ LA FOUILLEUSEPAYSAGES D’INSURRECTION AU MARAISÀ MONTMARTREAU FAUBOURG SAINT-ANTOINELE BACLE PORTE-DRAPEAULA MORT DE CHAUVINALSACE ! ALSACE !LE CARAVANSÉRAILUN DÉCORÉ DU 15 AOÛTMON KÉPILE TURCO DE LA COMMUNELE CONCERT DE LA HUITIÈMELA BATAILLE DU PÈRE-LACHAISELES PETITS PATÉSMONOLOGUE À BORDLES FÉES DE FRANCEDEUXIÈME PARTIECAPRICES ET SOUVENIRSAVEC TROIS CENT MILLE FRANCS QUE M’A PROMIS GIRARDIN !…ARTHURLES TROIS SOMMATIONSUN SOIR DE PREMIÈRELA SOUPE AU FROMAGELE DERNIER LIVRETMAISON À VENDRECONTES DE NOËLCONTES DE NOËL IILES TROIS MESSES BASSESLE PAPE EST MORTPAYSAGES GASTRONOMIQUESL’AILLOLILE KOUSSKOUSSLA POLENTALA MOISSON AU BORD DE LA MERLES ÉMOTIONS D’UN PERDREAU ROUGETLE MIROIRL’EMPEREUR AVEUGLEPage de copyrightContes du Lundi
Alphonse Daudet
PREMIÈRE PARTIE
LA FANTAISIE ET L’HISTOIRE
LA DERNIÈRE CLASSE
RÉCIT D’UN PETIT ALSACIEN
Ce matin-là, j’étais très en retard pour aller à l’école, et j’avais grand-peur d’être grondé, d’autant que M. Hamel nous avait dit qu’il nous interrogerait sur les participes, et je n’en savais pas le premier mot. Un moment l’idée me vint de manquer la classe et de prendre ma course à travers champs.
Le temps était si chaud, si clair on entendait les merles siffler à la lisière du bois, et dans le pré Rippert, derrière la scierie, les Prussiens qui faisaient l’exercice. Tout cela me tentait bien plus que la règle des participes ; mais j’eus la force de résister, et je courus bien vite vers l’école.
En passant devant la mairie, je vis qu’il y avait du monde arrêté près du petit grillage aux affiches.
Depuis deux ans, c’est de là que nous sont venues toutes les mauvaises nouvelles, les batailles perdues, les réquisitions, les ordres de la commandanture ; et je pensai sans m’arrêter : “Qu’est-ce qu’il y a encore ?” Alors, comme je traversais la place en courant, le forgeron Wachter, qui était là avec son apprenti en train de lire l’affiche, me cria : “Ne te dépêche pas tant, petit ; tu y arriveras toujours assez tôt à ton école !”
Je crus qu’il se moquait de moi, et j’entrai tout essoufflé dans la petite cour de M. Hamel.
D’ordinaire, au commencement de la classe, il se faisait un grand tapage qu’on entendait jusque dans la rue, les pupitres ouverts, fermés, les leçons qu’on répétait très haut tous ensemble en se bouchant les oreilles pour mieux apprendre, et la grosse règle du maître qui tapait sur les tables : “Un peu de silence !” Je comptais sur tout ce train pour gagner mon banc sans être vu ; mais, justement, ce jour-là, tout était tranquille, comme un matin de dimanche. Par la fenêtre ouverte, je voyais mes camarades déjà rangés à leurs places, et M. Hamel, qui passait et repassait avec la terrible règle en fer sous le bras. Il fallut ouvrir la porte et entrer au milieu de ce grand calme. Vous pensez si j’étais rouge et si j’avais peur !
Eh bien ! non. M Hamel me regarda sans colère et me dit très doucement : “Va vite à ta place, mon petit Franz ; nous allions commencer sans toi.” J’enjambai le banc et je m’assis tout de suite à mon pupitre. Alors seulement, un peu remis de ma frayeur, je remarquai que notre maître avait sa belle redingote verte, son jabot plissé fin et la calotte de soie noire brodée qu’il ne mettait que les jours d’inspection ou de distribution de prix. Du reste, toute la classe avait quelque chose d’extraordinaire et de solennel. Mais ce qui me surprit le plus, ce fut de voir au fond de la salle, sur les bancs qui restaient vides d’habitude, des gens du village assis et silencieux comme nous, le vieux Hauser avec son tricorne, l’ancien maire, l’ancien facteur, et puis d’autres personnes encore. Tout ce monde-là paraissait triste ; et Hauser avait apporté un vieil abécédaire mangé aux bords qu’il tenait grand ouvert sur ses genoux, avec ses grosses lunettes posées en travers des pages.
Pendant que je m’étonnais de tout cela, M. Hamel était monté dans sa chaire, et de la même voix douce et grave dont il m’avait reçu, il nous dit : “Mes enfants, c’est la dernière fois que je vous fais la classe. L’ordre est venu de Berlin de ne plus enseigner que l’allemand dans les écoles de l’Alsace et de la Lorraine… Le nouveau maître arrive demain. Aujourd’hui, c’est votre dernière leçon de français. Je vous prie d’être bien attentifs.” Ces quelques paroles me bouleversèrent. Ah ! les misérables, voilà ce qu’ils avaient affiché à la mairie.
Ma dernière leçon de français !…
Et moi qui savais à peine écrire ! Je n’apprendrais donc jamais ! Il faudrait donc en rester là !…
Comme je m’en voulais maintenant du temps perdu, des classes manquées à courir les nids ou à faire des glissades sur la Saar ! Mes livres que tout à l’heure encore je trouvais si ennuyeux, si lourds à porter, ma grammaire, mon histoire sainte me semblaient à présent de vieux amis qui me feraient beaucoup de peine à quitter. C’est comme M. Hamel. L’idée qu’il allait partir, que je ne le verrais plus, me faisait oublier les punitions, les coups de règle.
Pauvre homme !
C’est en l’honneur de cette dernière classe qu’il avait mis ses beaux habits du dimanche, et maintenant je comprenais pourquoi ces vieux du village étaient venus s’asseoir au bout de la salle. Cela semblait dire qu’ils regrettaient de ne pas y être venus plus souvent, à cette école. C’était aussi comme une façon de remercier notre maître de quarante ans de bons services, et de rendre leurs devoirs à la patrie qui s’en allait…
J’en étais là de mes réflexions, quand j’entendis appeler mon nom. C’était mon tour de réciter. Que n’aurais-je pas donné pour pouvoir dire tout au long cette fameuse règle des participes, bien haut, bien clair, sans une faute ?
Mais je m’embrouillai aux premiers mots, et je restai debout à me balancer dans mon banc, le cœur gros, sans oser lever la tête. J’entendais M. Hamel qui me parlait : “Je ne te gronderai pas, mon petit Franz, tu dois être assez puni… voilà ce que c’est. Tous les jours on se dit : “Bah ! j’ai bien le temps. J’apprendrai “demain.” Et puis tu vois ce qui arrive… Ah ! ça été le grand malheur de notre Alsace de toujours remettre son instruction à demain. Maintenant ces gens-là sont en droit de nous dire : “Comment ! vous prétendiez être français, et vous ne savez ni lire ni écrire votre langue !” Dans tout ça, mon pauvre Franz, ce n’est pas encore toi le plus coupable. Nous avons tous notre bonne part de reproches à nous faire.
“Vos parents n’ont pas assez tenu à vous voir instruits. Ils aimaient mieux vous envoyer travailler à la terre ou aux filatures pour avoir quelques sous de plus. Moi-même, n’ai-je rien à me reprocher ? Est-ce que je ne vous ai pas souvent fait arroser mon jardin au lieu de travailler ? Et quand je voulais aller pêcher des truites, est-ce que je me gênais pour vous donner congé ?…” Alors, d’une chose à l’autre, M. Hamel se mit à nous parler de la langue française, disant que c’était la plus belle langue du monde, la plus claire, la plus solide ; qu’il fallait la garder entre nous et ne jamais l’oublier, parce que, quand un peuple tombe esclave, tant qu’il tient bien sa langue, c’est comme s’il tenait la clef de sa prison… Puis il prit une grammaire et nous lut notre leçon. J’étais étonné de voir comme je comprenais. Tout ce qu’il disait me semblait facile, facile. Je crois aussi que je n’avais jamais si bien écouté et que lui non plus n’avait jamais mis autant de patience à ses explications.
On aurait dit qu’avant de s’en aller le pauvre homme voulait nous donner tout son savoir, nous le faire entrer dans la tête d’un seul coup. La leçon finie, on passa à l’écriture. Pour ce jour-là, M. Hamel nous avait préparé des exemples tout neufs, sur lesquels était écrit en belle ronde :
France, Alsace, France, Alsace. Cela faisait comme des petits drapeaux qui flottaient tout autour de la classe, pendus à la tringle de nos pupitres. Il fallait voir comme chacun s’appliquait, et quel silence !
On n’entendait rien que le grincement des plumes sur le papier. Un moment des hannetons entrèrent ; mais personne n’y fit attention, pas même les tout petits qui s’appliquaient à tracer leurs bâtons, avec un cœur, une conscience, comme si cela encore était du français… Sur la toiture de l’école, des pigeons roucoulaient tout bas, et je me disais en les écoutant : “Est-ce qu’on ne va pas les obliger à chanter en allemand, eux aussi ?” De temps en temps, quand je levais les yeux de dessus ma page, je voyais M. Hamel immobile dans sa chaire et fixant les objets autour de lui, comme s’il avait voulu emporter dans son regard toute sa petite maison d’école… Pensez ! depuis quarante ans, il était là à la même place, avec sa cour en face de lui et sa classe toute pareille. Seulement les bancs, les pupitres s’étaient polis, frottés par l’usage ; les noyers de la cour avaient grandi, et le houblon qu’il avait planté lui-même enguirlandait maintenant les fenêtres jusqu’au toit. Quel crève-cœur ça devait être pour ce pauvre homme de quitter toutes ces choses, et d’entendre sa sœur qui allait, venait, dans la chambre au-dessus, en train de fermer leurs malles.
Car ils devaient partir le lendemain, s’en aller du pays pour toujours.
Tout de même, il eut le courage de nous faire la classe jusqu’au bout. Après l’écriture, nous eûmes la leçon d’histoire ; ensuite les petits chantèrent tous ensemble le BÀ BE BI BO BU. Là-bas au fond de la salle, le vieux Hauser avait mis ses lunettes, et, tenant son abécédaire à deux mains, il épelait les lettres avec eux. On voyait qu’il s’appliquait lui aussi ; sa voix tremblait d’émotion, et c’était si drôle de l’entendre, que nous avions tous envie de rire et de pleurer. Ah ! je m’en souviendrai de cette dernière classe…
Tout à coup, l’horloge de l’église sonna midi, puis l’Angélus. Au même moment, les trompettes des Prussiens qui revenaient de l’exercice éclatèrent sous nos fenêtres… M. Hamel se leva, tout pâle, dans sa chaire. Jamais il ne m’avait paru si grand.
“Mes amis, dit-il, mes, je… je…”
Mais quelque chose l’étouffait. Il ne pouvait pas achever sa phrase.
Alors il se tourna vers le tableau, prit un morceau de craie et, en appuyant de toutes ses forces, il écrivit aussi gros qu’il put :
“VIVE LA FRANCE !”
Puis il resta là, la tête appuyée au mur, et, sans parler, avec sa main, il nous faisait signe : “C’est fini… allez-vous-en.”
LA PARTIE DE BILLARD
COMME on se bat depuis deux jours et qu’ils ont passé la nuit sac au dos sous une pluie torrentielle, les soldats sont exténués. Pourtant voilà trois mortelles heures qu’on les laisse se morfondre, l’arme au pied, dans les flaques des grandes routes, dans la boue des champs détrempés.
Alourdis par la fatigue, les nuits passées, les uniformes pleins d’eau, ils se serrent les uns contre les autres pour se réchauffer, pour se soutenir. Il y en a qui dorment tout debout, appuyés au sac d’un voisin, et la lassitude, les privations se voient mieux sur ces visages détendus, abandonnés dans le sommeil. La pluie, la boue, pas de feu, pas de soupe, un ciel bas et noir, l’ennemi qu’on sent tout autour.
C’est lugubre…
Qu’est-ce qu’on fait là. Qu’est-ce qui se passe ?
Les canons, la gueule tournée vers le bois, ont l’air de guetter quelque chose. Les mitrailleuses embusquées regardent fixement l’horizon. Tout semble prêt pour une attaque. Pourquoi n’attaque-t-on pas ? Qu’est-ce qu’on attend ?… on attend des ordres, et le quartier général n’en envoie pas.
Il n’est pas loin cependant le quartier général.
C’est ce beau château Louis XIII dont les briques rouges, lavées par la pluie, luisent à mi-côte entre les massifs. Vraie demeure princière, bien digne de porter le fanion d’un maréchal de France. Derrière un grand fossé et une rampe de pierre qui les séparent de la route, les pelouses montent tout droit jusqu’au perron, unies et vertes, bordées de vases fleuris.
De l’autre côté, du côté intime de la maison, les charmilles font des trouées lumineuses, la pièce d’eau où nagent des cygnes s’étale comme un miroir, et sous le toit en pagode d’une immense volière, lançant des cris aigus dans le feuillage, des paons, des faisans dorés battent des ailes et font la roue. Quoique les maîtres soient partis, on ne sent pas là l’abandon, le grand lâchez-tout de la guerre.
L’oriflamme du chef de l’armée a préservé jusqu’aux moindres fleurettes des pelouses, et c’est quelque chose de saisissant de trouver, si près du champ de bataille, ce calme opulent qui vient de l’ordre des choses, de l’alignement correct des massifs, de la profondeur silencieuse des avenues.
La pluie, qui tasse là-bas de si vilaine boue sur les chemins et creuse des ornières si profondes, n’est plus ici qu’une ondée élégante, aristocratique, avivant la rougeur des briques, le vert des pelouses, lustrant les feuilles des orangers, les plumes blanches des cygnes. Tout reluit, tout est paisible. vraiment, sans le drapeau qui flotte à la crête du toit, sans les deux soldats en faction devant la grille, jamais on ne se croirait au quartier général. Les chevaux reposent dans les écuries. Çà et là on rencontre des brosseurs, des ordonnances en petite tenue flânant aux abords des cuisines, ou quelque jardinier en pantalon rouge promenant tranquillement son râteau dans le sable des grandes cours.
La salle à manger, dont les fenêtres donnent sur le perron, laisse voir une table à moitié desservie, des bouteilles débouchées, des verres ternis et vides, blafards sur la nappe froissée, toute une fin de repas, les convives partis.
Dans la pièce à côté, on entend des éclats de voix, des rires, des billes qui roulent, des verres qui se choquent. Le maréchal est en train de faire sa partie, et voilà pourquoi l’armée attend des ordres. Quand le maréchal a commencé sa partie, le ciel peut bien crouler, rien au monde ne saurait l’empêcher de la finir.
Le billard !
C’est sa faiblesse à ce grand homme de guerre.
Il est là, sérieux comme à la bataille, en grande tenue, la poitrine couverte de plaques, l’œil brillant, les pommettes enflammées, dans l’animation du repas, du jeu, des grogs. Ses aides de camp l’entourent, empressés, respectueux, se pâmant d’admiration à chacun de ses coups. Quand le maréchal fait un point, tous se précipitent vers la marque ; quand le maréchal a soif, tous veulent lui préparer son grog. C’est un froissement d’épaulettes et de panaches, un cliquetis de croix et d’aiguillettes, et de voir tous ces jolis sourires, ces fines révérences de courtisans, tant de broderies et d’uniformes neufs, dans cette haute salle à boiseries de chêne, ouverte sur des parcs, sur des cours d’honneur, cela rappelle les automnes de Compiègne et repose un peu des capotes souillées qui se morfondent là-bas, au long des routes, et font des groupes si sombres sous la pluie.
Le partenaire du maréchal est un petit capitaine d’état-major, sanglé, frisé, ganté de clair, qui est de première force au billard et capable de rouler tous les maréchaux de la terre, mais il sait se tenir à une distance respectueuse de son chef, et s’applique à ne pas gagner, à ne pas perdre non plus trop facilement. C’est ce qu’on appelle un officier d’avenir…
“Attention, jeune homme, tenons-nous bien. Le maréchal en à quinze et vous dix. Il s’agit de mener la partie jusqu’au bout comme cela, et vous aurez fait plus pour votre avancement que si vous étiez dehors avec les autres, sous ces torrents d’eau qui noient l’horizon, à salir votre bel uniforme, à ternir l’or de vos aiguillettes, attendant des ordres qui ne viennent pas.” C’est une partie vraiment intéressante. Les billes courent, se frôlent, croisent leurs couleurs. Les bandes rendent bien, le tapis s’échauffe… Soudain la flamme d’un coup de canon passe dans le ciel.
Un bruit sourd fait trembler les vitres. Tout le monde tressaille ; on se regarde avec inquiétude.
Seul le maréchal n’a rien vu, rien entendu : penché sur le billard, il est en train de combiner un magnifique effet de recul ; c’est son fort, à lui, les effets de recul !…
Mais voilà un nouvel éclair, puis un autre. Les coups de canon se succèdent, se précipitent. Les aides de camp courent aux fenêtres. Est-ce que les Prussiens attaqueraient ?
“Eh bien, qu’ils attaquent ! dit le maréchal en mettant du blanc… À vous de jouer, capitaine.” L’état-major frémit d’admiration. Turenne endormi sur un affût n’est rien auprès de ce maréchal, si calme devant son billard au moment de l’action… Pendant ce temps, le vacarme redouble.
Aux secousses du canon se mêlent les déchirements des mitrailleuses, les roulements des feux de peloton. Une buée rouge, noire sur les bords, monte au bout des pelouses. Tout le fond du parc est embrasé. Les paons, les faisans effarés clament dans la volière ; les chevaux arabes, sentant la poudre, se cabrent au fond des écuries.
Le quartier général commence à s’émouvoir. Dépêches sur dépêches. Les estafettes arrivent à bride abattue, on demande le maréchal.
Le maréchal est inabordable. Quand je vous disais que rien ne pourrait l’empêcher d’achever sa partie.
“À vous de jouer, capitaine.” Mais le capitaine a des distractions. Ce que c’est pourtant que d’être jeune ! Le voilà qui perd la tête, oublie son jeu et fait coup sur coup deux séries, qui lui donnent presque partie gagnée. Cette fois le maréchal devient furieux. La surprise, l’indignation éclatent sur son mâle visage. Juste à ce moment, un cheval lancé ventre à terre s’abat dans la cour, Un aide de camp couvert de boue force la consigne, franchit le perron d’un saut : “Maréchal ! maréchal !…” Il faut voir comme il est reçu… Tout bouffant de colère et rouge comme un coq, le maréchal paraît à la fenêtre, sa queue de billard à la main :
“Qu’est-ce qu’il y a ?… Qu’est-ce que c’est ?… Il n’y a donc pas de factionnaire par ici ?
— Mais, maréchal…
— C’est bon… Tout à l’heure… qu’on attende mes ordres, nom de… D… !” ’ Et la fenêtre se referme avec violence.
Qu’on attende ses ordres !
C’est bien ce qu’ils font, les pauvres gens. Le vent leur chasse la pluie et la mitraille en pleine figure.
Des bataillons entiers sont écrasés, pendant que d’autres restent, inutiles, l’arme au bras, sans pouvoir se rendre compte de leur inaction. Rien à faire. on attend des ordres…
Par exemple, comme on n’a pas besoin d’ordres pour mourir, les hommes tombent par centaines derrière les buissons, dans les fossés, en face du grand château silencieux. Même tombés, la mitraille les déchire encore, et par leurs blessures ouvertes coule sans bruit le sang généreux de la France… Là-haut, dans la salle de billard, cela chauffe terriblement : le maréchal a repris son avance ; mais le petit capitaine se défend comme un lion…
Dix-sept ! dix-huit ! dix-neuf !…
À peine a-t-on le temps de marquer les points. Le bruit de la bataille se rapproche. Le maréchal ne joue plus que pour un. Déjà des obus arrivent dans le parc. En voilà un qui éclate au-dessus de la pièce d’eau. Le miroir s’éraille ; un cygne nage, épeuré, dans un tourbillon de plumes sanglantes. C’est le dernier coup…
Maintenant, un grand silence. Rien que la pluie qui tombe sur les charmilles, un roulement confus au bas du coteau, et, par les chemins détrempés, quelque chose comme le piétinement d’un troupeau qui se hâte… L’armée est en pleine déroute.
Le maréchal a gagné sa partie.
LA VISION DU JUGE DE COLMAR
AVANT qu’il eût prêté serment à l’empereur Guillaume, il n’y avait pas d’homme plus heureux que le petit juge Dollinger, du tribunal de Colmar, lorsqu’il arrivait à l’audience avec sa toque sur l’oreille, son gros ventre, sa lèvre en fleur et ses trois mentons bien posés sur un ruban de mousseline :
“Ah ! le bon petit somme que je vais faire”, avait-il l’air de se dire en s’asseyant ; et c’était plaisir de le voir allonger ses jambes grassouillettes, s’enfoncer sur son grand fauteuil, sur ce rond de cuir frais et mœlleux auquel il devait d’avoir encore l’humeur égale et le teint clair, après trente ans de magistrature assise.
Infortuné Dollinger !
C’est ce rond de cuir qui l’a perdu. Il se trouvait si bien dessus, sa place était si bien faite sur ce coussinet de moleskine, qu’il a mieux aimé devenir Prussien que de bouger de là. L’empereur Guillaume lui a dit : “Restez assis, monsieur Dollinger !” et Dollinger est resté assis ; et aujourd’hui le voilà conseiller à la cour de Colmar, rendant bravement la justice au nom de Sa Majesté berlinoise.
Autour de lui, rien n’est changé : c’est toujours le même tribunal fané et monotone, la même salle de catéchisme avec ses bancs luisants, ses murs nus, son bourdonnement d’avocats, le même demi-jour tombant des hautes fenêtres à rideaux de serge, le même grand christ poudreux qui penche la tête, les bras étendus. En passant à la Prusse, la cour de Colmar n’a pas dérogé ; il y a toujours un buste d’empereur au fond du prétoire… Mais c’est égal ! Dollinger se sent dépaysé.
Il a beau se rouler dans son fauteuil, s’y enfoncer rageusement, il n’y trouve plus les bons petits sommes d’autrefois, et quand par hasard il lui arrive encore de s’endormir à l’audience, c’est pour faire des rêves épouvantables.
Dollinger rêve qu’il est sur une haute montagne, quelque chose comme le Honeck ou le ballon d’Alsace… Qu’est-ce qu’il fait là, tout seul, en robe de juge, assis sur un grand fauteuil, à ces hauteurs immenses où l’on ne voit plus rien que des arbres rabougris et des tourbillons de petites mouches ?…
Dollinger ne le sait pas. Il attend, tout frissonnant de la sueur froide et de l’angoisse du cauchemar.
Un grand soleil rouge se lève de l’autre côté du Rhin, derrière les sapins de la forêt Noire, et, à mesure que le soleil monte, en bas, dans les vallées de Thann, de Munster, d’un bout à l’autre de l’Alsace, c’est un roulement confus, un bruit de pas, de voitures en marche, et cela grossit, et cela s’approche, et Dollinger a le cœur serré ! Bientôt, par la longue route tournante qui grimpe aux flancs de la montagne, le juge de Colmar voit venir à lui un cortège lugubre et interminable, tout le peuple d’Alsace qui s’est donné rendez-vous à cette passe des Vosges pour émigrer solennellement.
En avant montent de longs chariots attelés de quatre bœufs, ces longs chariots à claire-voie que l’on rencontre tout débordants de gerbes au temps des moissons, et qui maintenant s’en vont chargés de meubles, de hardes, d’instruments de travail.
Ce sont les grands lits, les hautes armoires, les garnitures d’indienne, les huches, les rouets, les petites chaises des enfants, les fauteuils des ancêtres, vieilles reliques entassées, tirées de leurs coins, dispersant au vent de la route la sainte poussière des foyers. Des maisons entières partent dans ces chariots. Aussi n’avancent-ils qu’en gémissant, et les bœufs les tirent avec peine, comme si le sol s’attachait aux roues, comme si ces parcelles de terre sèche restées aux herses, aux charrues, aux pioches, aux râteaux, rendant la charge encore plus lourde, faisaient de ce départ un déracinement.
Derrière se presse une foule silencieuse, de tout rang, de tout âge, depuis les grands vieux à tricorne qui s’appuient en tremblant sur des bâtons, jusqu’aux petits blondins frisés, vêtus d’une bretelle et d’un pantalon de futaine, depuis l’aïlleule paralytique que de fiers garçons portent sur leurs épaules, jusqu’aux enfants de lait que les mères serrent contre leurs poitrines ; tous, les vaillants comme les infirmes, ceux qui seront les soldats de l’année prochaine et ceux qui ont fait la terrible campagne, des cuirassiers amputés qui se traînent sur des béquilles, des artilleurs hâves, exténués, ayant encore dans leurs uniformes en loques la moisissure des casemates de Spandau ; tout cela défile fièrement sur la route, au bord de laquelle le juge Colmar est assis, et, en passant devant lui, chaque visage se détourne avec une terrible expression de colère et de dégoût… oh ! le malheureux Dollinger ! Il voudrait se cacher, s’enfuir ; mais impossible. Son fauteuil est incrusté dans la montagne, son rond de cuir dans son fauteuil, et lui dans son rond de cuir.
Alors il comprend qu’il est là comme au pilori, et qu’on a mis le pilori aussi haut pour que sa honte se vît de plus loin… Et le défilé continue, village par village, ceux de la frontière suisse menant d’immenses troupeaux, ceux de la Saar poussant leurs durs outils de fer dans des wagons à minerais. Puis les villes arrivent, tout le peuple des filatures, les tanneufs, les tisserands, les ourdisseurs, les bourgeois, les prêtres, les rabbins, les magistrats, des robes noires, des robes rouges… voilà le tribunal de Colmar, son vieux président en tête. Et Dollinger, mourant de honte, essaie de cacher sa figure, mais ses mains sont paralysées ; de fermer les yeux, mais ses paupières restent immobiles et droites. Il faut qu’il voie et qu’on le voie, et qu’il ne perde pas un des regards de mépris que ses collègues lui jettent en passant…
Ce juge au pilori, c’est quelque chose de terrible !
Mais ce qui est plus terrible encore, c’est qu’il a tous les siens dans cette foule, et que pas un qui n’a l’air de le reconnaître. Sa femme, ses enfants passent devant lui en baissant la tête. on dirait qu’ils ont honte, eux aussi ! Jusqu’à son petit Michel qu’il aime tant, et qui s’en va pour toujours sans seulement le regarder. Seul, son vieux président s’est arrêté une minute pour lui dire à voix basse : “Venez avec nous, Dollinger. Ne restez pas là, mon ami…” Mais Dollinger ne peut pas se lever. Il s’agite, il appelle, et le cortège défile pendant des heures ; et lorsqu’il s’éloigne au jour tombant, toutes ces belles vallées pleines de clochers et d’usines se font silencieuses. L’Alsace entière est partie. Il n’y a plus que le juge de Colmar qui reste là-haut, cloué sur son pilori, assis et inamovible…
… Soudain la scène change. Des ifs, des croix noires, des rangées de tombes, une foule en deuil.
C’est le cimetière de Colmar, un jour de grand enterrement. Toutes les cloches de la ville sont en branle. Le conseiller Dollinger vient de mourir. Ce que l’honneur n’avait pas pu faire, la mort s’en est chargée. Elle a dévissé de son rond de cuir le magistrat inamovible, et couché tout de son long l’homme qui s’entêtait à rester assis…
Rêver qu’on est mort et se pleurer soi-même, il n’y a pas de sensation plus horrible. Le cœur navré, Dollinger assiste à ses propres funérailles ; et ce qui le désespère encore plus que sa mort, c’est que, dans cette foule immense qui se presse autour de lui, il n’a pas un ami, pas un parent. Personne de Colmar, rien que des Prussiens ! Ce sont des soldats prussiens qui ont fourni l’escorte, des magistrats prussiens qui mènent le deuil, et les discours qu’on prononce sur sa tombe sont des discours prussiens, et la terre qu’on lui jette dessus et qu’il trouve si froide est de la terre prussienne, hélas !
Tout à coup la foule s’écarte, respectueuse ; un magnifique cuirassier blanc s’approche, cachant sous son manteau quelque chose qui a l’air d’une grande couronne d’immortelles. Tout autour on dit : “voilà Bismarck !… voilà Bismarck !…” Et le juge de Colmar pense avec tristesse : “C’est beaucoup d’honneur que vous me faites, monsieur le comte, mais si j’avais là mon petit Michel…” Un immense éclat de rire l’empêche d’achever, un rire fou, scandaleux, sauvage, inextinguible.
“Qu’est-ce qu’ils font donc ?” se demande le juge, épouvanté, Il se dresse, il regarde… C’est son rond, son rond de cuir que M. de Bismarck vient de déposer religieusement sur sa tombe avec cette inscription en entourage dans la moleskine :
AU JUGE DOLLINGER
HONNEUR DE LA MAGISTRATURE ASSISE
SOUVENIRS ET REGRETS
D’un bout à l’autre du cimetière, tout le monde rit, tout le monde se tord, et cette grosse gaieté prussienne résonne jusqu’au fond du caveau, où le mort pleure de honte, écrasé sous un ridicule éternel…
L’ENFANT ESPION
IL s’appelait Stenne, le petit Stenne.
C’était un enfant de Paris, malingre et pâle, qui pouvait avoir dix ans, peut-être quinze ; avec ces moucherons-là, on ne sait jamais. Sa mère était morte ; son père, ancien soldat de marine, gardait un square dans le quartier du Temple. Les babies, les bonnes, les vieilles dames à pliants, les mères pauvres, tout le Paris trotte-menu qui vient se mettre à l’abri des voitures dans ces parterres bordés de trottoirs, connaissaient le père Stenne et l’adoraient. on savait que, sous sa rude moustache, effroi des chiens et des traîneurs de bancs, se cachait un bon sourire attendri, presque maternel, et que, pour voir ce sourire, on n’avait qu’à dire au bonhomme : “Comment va votre petit garçon ?…” Il l’aimait tant, son garçon, le père Stenne ! Il était si heureux, le soir, après la classe, quand le petit venait le prendre et qu’ils faisaient tous deux le tour des allées, s’arrêtant à chaque banc pour saluer les habitués, répondre à leurs bonnes manières.
Avec le siège, malheureusement tout changea.
Le square du père Stenne fut fermé, on y mit du pétrole, et le pauvre homme, obligé à une surveillance incessante, passait sa vie dans les massifs déserts et bouleversés, seul, sans fumer, n’ayant plus son garçon que le soir, bien tard, à la maison.
Aussi il fallait voir sa moustache, quand il parlait des Prussiens… Le petit Stenne, lui, ne se plaignait pas trop de cette nouvelle vie.
Un siège ! C’est si amusant pour les gamins ! Plus d’école ! plus de mutuelle ! Des vacances tout le temps et la rue comme champ de foire…
L’enfant restait dehors jusqu’au soir, à courir. Il accompagnait les bataillons du quartier qui allaient au rempart, choisissant de préférence ceux qui avaient une bonne musique ; et là-dessus petit Stenne était très ferré, Il vous disait fort bien que celle du 96e ne valait pas grand-chose, mais qu’au 55e ils en avaient une excellente. D’autres fois, il regardait les mobiles faire l’exercice ; puis il y avait les queues…
Son panier sous le bras, il se mêlait à ces longues files qui se formaient dans l’ombre des matins d’hiver sans gaz, à la grille des bouchers, des boulangers. Là, les pieds dans l’eau, on faisait des connaissances, on causait politique, et comme fils de M. Stenne, chacun lui demandait son avis. Mais le plus amusant de tout, c’était encore les parties de bouchon, ce fameux jeu de galoche que les mobiles bretons avaient mis à la mode pendant le siège.
Quand le petit Stenne n’était pas au rempart ni aux boulangeries, vous étiez sûr de le trouver à la partie de galoche de la place du Château-d’Eau. Lui ne jouait pas, bien entendu : il faut trop d’argent. Il se contentait de regarder les joueurs avec des yeux !
Un, surtout, un grand en cotte bleue, qui ne misait que des pièces de cent sous, excitait son admiration. Quand il courait, celui-là, on entendait les écus sonner au fond de sa cotte…
Un jour, en ramassant une pièce qui avait roulé jusque sous les pieds du petit Stenne, le grand lui dit à voix basse :
“Ça te fait loucher, hein ?… Eh bien, si tu veux, je te dirai où on en trouve.”
La partie finie, il l’emmena dans un coin de la place et lui proposa de venir avec lui vendre des journaux aux Prussiens : on avait trente francs par voyage. D’abord Stenne refusa, très indigné ; et du coup, il resta trois jours sans retourner à la partie.
Trois jours terribles. Il ne mangeait plus, il ne dormait plus. La nuit, il voyait des tas de galoches dressées au pied de son lit, et des pièces de cent sous qui filaient à plat, toutes luisantes. La tentation était trop forte. Le quatrième jour, il retourna au Château-d’Eau, revit le grand, se laissa séduire…
Ils partirent par un matin de neige, un sac de toile sur l’épaule, des journaux cachés sous leurs blouses. Quand ils arrivèrent à la porte de Flandres, il faisait à peine jour. Le grand prit Stenne par la main et, s’approchant du factionnaire – un brave sédentaire qui avait le nez rouge et l’air bon, il lui dit d’une voix de pauvre “Laissez-nous passer, mon bon monsieur… Notre mère est malade, papa est mort. Nous allons voir avec mon petit frère à ramasser des pommes de terre dans le champ.” Il pleurait. Stenne, tout honteux, baissait la tête.
Le factionnaire les regarda un moment, jeta un coup d’œil sur la route déserte et blanche.
“Passez vite”, leur dit-il en s’écartant.
Et les voilà sur le chemin d’Aubervilliers. C’est le grand qui riait !
Confusément, comme dans un rêve, le petit Stenne voyait des usines transformées en casernes, des barricades désertes, garnies de chiffons mouillés, de longues cheminées qui trouaient le brouillard et montaient dans le ciel, vides, ébréchées.
De loin en loin, une sentinelle, des officiers encapuchonnés qui regardaient là-bas avec des lorgnettes, et de petites tentes trempées de neige fondue devant des feux qui mouraient. Le grand connaissait le chemin, prenait à travers champs pour éviter les postes. Pourtant, ils arrivèrent, sans pouvoir y échapper, à une grand garde de francs-tireurs, Les francs-tireurs étaient là avec leurs petits cabans, accroupis au fond d’une fosse pleine d’eau, tout le long du chemin de fer de Soissons. Cette fois le grand eut beau recommencer son histoire, on ne voulut pas les laisser passer. Alors, pendant qu’il se lamentait, de la maison du garde-barrière sortit sur la voie un vieux sergent, tout blanc, tout ridé, qui ressemblait au père Stenne : “Allons ! mioches, ne pleurons plus ! dit-il aux enfants, on vous y laissera aller, à vos pommes de terre ; mais avant, entrez vous chauffer un peu… Il a l’air gelé, ce gamin-là !” Hélas ! Ce n’était pas de froid qu’il tremblait le petit Stenne, c’était de peur, c’était de honte… Dans le poste, ils trouvèrent quelques soldats blottis autour d’un feu maigre, un vrai feu de veuve, à la flamme duquel ils faisaient dégeler du biscuit au bout de leurs baïonnettes. on se serra pour faire place aux enfants. on leur donna la goutte, un peu de café. Pendant qu’ils buvaient, un officier vint sur la porte, appela le sergent, lui parla tout bas et s’en alla bien vite.
“Garçons ! dit le sergent en rentrant, radieux…, y aura du tabac, cette nuit… on a surpris le mot des Prussiens… Je crois que cette fois nous allons le leur reprendre, ce sacré Bourgeti !” Il y eut une explosion de bravos et de rires. on dansait, on chantait, on astiquait les sabres baïonnettes ; et, profitant de ce tumulte, les enfants disparurent.
Passé la tranchée, il n’y avait plus que la plaine, et au fond un long mur blanc troué de meurtrières.
C’est vers ce mur qu’ils se dirigèrent, s’arrêtant à chaque pas pour faire semblant de ramasser des pommes de terre.
“Rentrons… N’y allons pas”, disait tout le temps le petit Stenne.
L’autre levait les épaules et avançait toujours.
Soudain ils entendirent le trictrac d’un fusil qu’on armait.
“Couche-toi !” fit le grand, en se jetant par terre.
Une fois couché, il siffla, Un autre sifflet répondit sur la neige. Ils s’avancèrent en rampant… Devant le mur, au ras du sol, parurent deux moustaches jaunes sous un béret crasseux. Le grand sauta dans la tranchée, à côté du Prussien : “C’est mon frère”, dit-il en montrant son compagnon.
Il était si petit, ce Stenne, qu’en le voyant le Prussien se mit à rire et fut obligé de le prendre dans ses bras pour le hisser jusqu’à la brèche.
De l’autre côté du mur, c’étaient de grands remblais de terre, des arbres couchés, des trous noirs dans la neige, et dans chaque trou le même béret crasseux, les mêmes moustaches jaunes qui riaient en voyant passer les enfants.
Dans un coin, une maison de jardinier casematée de troncs d’arbres. Le bas était plein de soldats qui jouaient aux cartes, faisaient la soupe sur un grand feu clair. Cela sentait bon les choux, le lard ; quelle différence avec le bivouac des francs-tireurs ! En haut, les officiers on les entendait jouer au piano, déboucher du vin de Champagne. Quand les Parisiens entrèrent, un hurrah de joie les accueillit.
Ils donnèrent leurs journaux ; puis on leur versa à boire et on les fit causer. Tous ces officiers avaient l’air fier et méchant ; mais le grand les amusait avec sa verve faubourienne, son vocabulaire de voyou. Ils riaient, répétaient ses mots après lui, se roulaient avec délices dans cette boue de Paris qu’on leur apportait.
Le petit Stenne aurait bien voulu parler, lui aussi, prouver qu’il n’était pas bête ; mais quelque chose le gênait. En face de lui se tenait à part un Prussien plus âgé, plus sérieux que les autres, qui lisait, ou plutôt faisait semblant, car ses yeux ne le quittaient pas. Il y avait dans ce regard de la tendresse et des reproches, comme si cet homme avait eu au pays un enfant du même âge que Stenne, et qu’il se fût dit : “J’aimerais mieux mourir que de voir mon fils faire un métier pareil…” À partir de ce moment, Stenne sentit comme une main qui se posait sur son cœur et l’empêchait de battre.
Pour échapper à cette angoisse, il se mit à boire.
Bientôt tout tourna autour de lui. Il entendait vaguement, au milieu de gros rires, son camarade qui se moquait des gardes nationaux, de leur façon de faire l’exercice, imitait une prise d’armes au Marais, une alerte de nuit sur les remparts. Ensuite le grand baissa la voix, les officiers se rapprochèrent et les figures devinrent graves. Le misérable était en train de les prévenir de l’attaque des francs-tireurs…
Pour le coup, le petit Stenne se leva, furieux, dégrisé : “Pas cela, grand… Je ne veux pas.” Mais l’autre ne fit que rire et continua. Avant qu’il eût fini, tous les officiers étaient debout. Un d’eux montra la porte aux enfants : “F… le camp !” leur dit-il.
Et ils se mirent à causer entre eux, très vite, en allemand. Le grand sortit, fier comme un doge, en faisant sonner son argent. Stenne le suivit, la tête basse ; et lorsqu’il passa près du Prussien dont le regard l’avait tant gêné, entendit une voix triste qui disait : “Bas chôli, ça… Bas chôli…” Les larmes lui en vinrent aux yeux.
Une fois dans la plaine, les enfants se mirent à courir et rentrèrent rapidement. Leur sac était plein de pommes de terre que leur avaient données les Prussiens ; avec cela ils passèrent sans encombre à la tranchée des francs-tireurs. on s’y préparait pour l’attaque de la nuit. Des troupes arrivaient, silencieuses, se massant derrière les murs. Le vieux sergent était là, occupé à placer ses hommes, l’air si heureux ! Quand les enfants passèrent, il les reconnut et leur envoya un bon sourire… Oh ! que ce sourire fit mal au petit Stenne ! Un moment il eut envie de crier : “N’allez pas là-bas… nous vous avons trahis.” Mais l’autre lui avait dit : “Si tu parles, nous serons fusillés”, et la peur le retint…
À La Courneuve, ils entrèrent dans une maison abandonnée pour partager l’argent. La vérité m’oblige à dire que le partage fut fait honnêtement, et que d’entendre sonner ces beaux écus sous sa blouse, de penser aux parties de galoche qu’il avait là en perspective, le petit Stenne ne trouvait plus son crime aussi affreux.