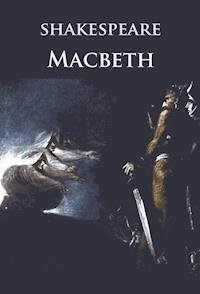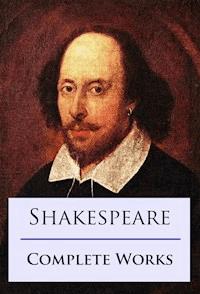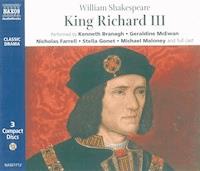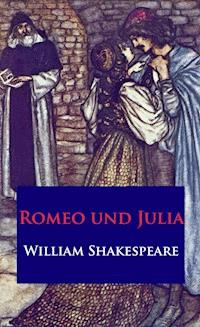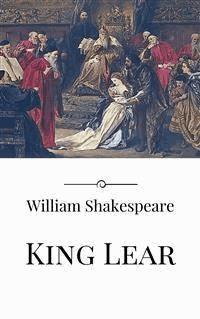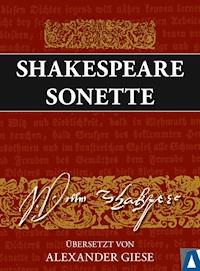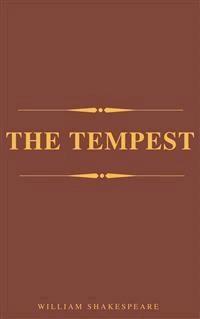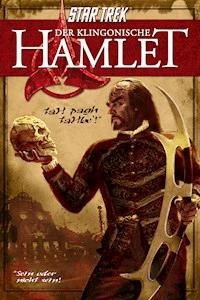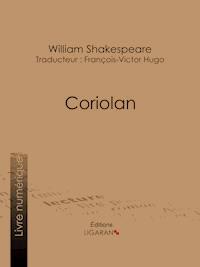
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Französisch
"Coriolan est une pièce de théâtre écrite par William Shakespeare, publiée pour la première fois en 1623. Elle raconte l'histoire de Coriolan, un général romain qui, après avoir remporté de nombreuses batailles, aspire à devenir consul. Cependant, son arrogance et son mépris pour le peuple romain le conduisent à sa perte. La pièce explore des thèmes tels que la politique, la loyauté, la trahison et la nature humaine. Coriolan est considéré comme l'une des tragédies les plus sombres de Shakespeare, avec des personnages complexes et une intrigue captivante. C'est une œuvre incontournable pour tous les amateurs de théâtre et de littérature classique.
Extrait : ""PREMIER CITOYEN : Avant que nous allions plus loin, écoutez-moi. PLUSIEURS CITOYENS, à la fois : Parlez, parlez, PREMIER CITOYEN : Vous êtes tous résolus à mourir plutôt qu'à subir la famine ? TOUS : Résolus, résolus. PREMIER CITOYEN : Et d'abord vous savez que Caïus Marcius est le principal ennemi du peuple. TOUS : Nous le savons, nous le savons. PREMIER CITOYEN : Tuons-le, et nous aurons le blé au prix que nous voudrons. Est-ce là votre verdict ?"""
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 163
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
CAIUS MARCIUS CORIOLAN, patricien romain.
TITUS LARTIUS, général dans la guerre contre les Volsques.
COMINIUS, général dans la guerre contre les Volsques.
MÉNÉNIUS AGRIPPA, ami de Coriolan.
SICINIUS VELUTUS, tribun du peuple.
JUNIUS BRUTUS, tribun du peuple.
LE JEUNE MARCIUS, fils de Coriolan.
UN HÉRAUT ROMAIN.
TULLUS AUFIDIUS, général des Volsques.
UN LIEUTENANT D’AUFIDIUS.
VOLUMNIE, mère de Coriolan.
VIRGILIE, femme de Coriolan.
VALÉRIE, amie de Virgilie.
UNE SUIVANTE DE VIRGILIE.
SÉNATEURS ROMAINS ET VOLSQUES, PATRICIENS, ÉDILES, LICTEURS, SOLDATS, CITOYENS, CONJURÉS, MESSAGERS, SERVITEURS.
La scène est tantôt à Rome, tantôt à Corioles et à Antium.
Rome. Une rue.
Entre une foule de citoyens mutinés, armés de bâtons, de massues et d’autres armes.
Avant que nous allions plus loin, écoutez-moi.
Parlez, parlez.
Vous êtes tous résolus à mourir plutôt qu’à subir la famine ?
Résolus, résolus.
Et d’abord vous savez que Caïus Marcius est le principal ennemi du peuple.
Nous le savons, nous le savons.
Tuons-le, et nous aurons le blé au prix que nous voudrons. Est-ce là votre verdict ?
Assez de paroles ! À l’œuvre. En avant, en avant !
Un mot, dignes citoyens.
On nous appelle pauvres citoyens ; il n’y a de dignité que pour les patriciens. Le superflu de nos gouvernants suffirait à nous soulager. Si seulement ils nous cédaient des restes sains encore, nous pourrions nous figurer qu’ils nous secourent par humanité ; mais ils nous trouvent déjà trop coûteux. La maigreur qui nous afflige, effet de notre misère, est comme un inventaire détaillé de leur opulence ; notre détresse est profit pour eux. Vengeons-nous à coups de pique, avant de devenir des squelettes. Car, les dieux le savent, ce qui me fait parler, c’est la faim du pain et non la soif de la vengeance.
Prétendez-vous agir spécialement contre Caïus Marcius ?
Contre lui d’abord : il est le limier du peuple.
Mais considérez-vous les services qu’il a rendus à son pays ?
Certainement, et c’est avec plaisir qu’on lui en tiendrait compte, s’il ne se payait pas lui-même en orgueil.
Allons, parlez sans malveillance.
Je vous dis que ce qu’il a fait d’illustre, il l’a fait dans ce but : les gens de conscience timorée ont beau dire volontiers qu’il a tout fait pour son pays, il a tout fait pour plaire à sa mère et pour servir son orgueil qui, certes, est à la hauteur de son mérite !
Vous lui faites un crime d’une irrémédiable disposition de nature. Du moins vous ne pouvez pas dire qu’il est cupide.
Si je ne le puis, je ne suis pas pour cela à court d’accusations. Il a plus de vices qu’il n’en faut pour lasser les récriminations.
Cris au loin.
Quels sont ces cris ? L’autre côté de la ville est en mouvement. Pourquoi restons-nous ici à bavarder ? Au Capitole !
Allons, allons !
Doucement !… Qui vient là ?
Entre Ménénius Agrippa.
Le digne Ménénius Agrippa ! En voilà un qui a toujours aimé le peuple.
Il est assez honnête. Si tous les autres étaient comme lui !
Que voulez-vous donc faire, mes concitoyens ? Où allez-vous avec des bâtons et des massues ? Qu’y a-t-il ? Parlez, je vous prie.
Notre projet n’est pas ignoré des sénateurs : depuis quinze jours ils ont eu vent de nos intentions, nous allons les leur signifier par des actes. Ils disent que les pauvres solliciteurs ont la voix forte : ils sauront que nous avons aussi le bras fort.
Quoi ! mes maîtres, mes bons amis, mes honnêtes voisins, vous voulez donc votre ruine !
C’est impossible, monsieur : nous sommes déjà ruinés.
Amis, croyez-moi, les patriciens ont pour vous la plus charitable sollicitude. Pour vos besoins, pour vos souffrances au milieu de cette disette, autant vaudrait frapper le ciel de vos bâtons que les lever contre le gouvernement romain : il poursuivra sa course en broyant dix mille freins plus solides que celui que vous pourrez jamais vraisemblablement lui opposer. Quant à la disette, ce ne sont pas les patriciens, ce sont les dieux qui la font ; et près d’eux vos genoux vous serviront mieux que vos bras. Hélas ! vous êtes entraînés par la calamité à une calamité plus grande. Vous calomniez les nautoniers de l’État : ils veillent sur vous en pères, et vous les maudissez comme des ennemis !
Eux, veiller sur nous !… Oui, vraiment !… Ils n’ont jamais veillé sur nous. Ils nous laissent mourir de faim, quand leurs magasins regorgent de grain, font des édits en faveur de l’usure pour soutenir les usuriers, rappellent chaque jour quelque acte salutaire établi contre les riches, et promulguent des statuts chaque jour plus vexatoires pour enchaîner et opprimer le pauvre ! Si les guerres ne nous dévorent, ce seront eux ; et voilà tout l’amour qu’ils nous portent !
De deux choses l’une : ne vous défendez pas d’une étrange malveillance, ou laissez-vous accuser de folie. Je vais vous conter une jolie fable ; il se peut que vous l’ayez déjà entendue. Mais, comme elle sert à mes fins, je me risquerai à la débiter encore.
Soit ! je l’entendrai, monsieur ; mais ne croyez pas leurrer notre misère avec une fable. N’importe ! si ça vous plaît, narrez toujours.
Un jour, tous les membres du corps humain se mutinèrent contre le ventre, l’accusant et se plaignant de ce que lui seul il demeurait au milieu du corps, paresseux et inactif, absorbant comme un gouffre la nourriture, sans jamais porter sa part du labeur commun, là où tous les autres organes s’occupaient de voir, d’entendre, de penser, de diriger, de marcher, de sentir et de subvenir, par leur mutuel concours, aux appétits et aux désirs communs du corps entier. Le ventre répondit…
Voyons, monsieur, quelle réponse fit le ventre ?
Je vais vous le dire, monsieur. Avec une espèce de sourire qui ne venait pas de la rate, mais de certaine région (car, après tout, je puis aussi bien faire sourire le ventre que le faire parler), il répondit dédaigneusement aux membres mécontents, à ces mutins qui se récriaient contre ses accaparements, exactement comme vous récriminez contre nos sénateurs parce qu’ils ne sont pas traités comme vous…
Voyons la réponse du ventre… Quoi ! si la tête portant couronne royale, l’œil vigilant, le cœur, notre conseiller, le bras, notre soldat, le pied, notre coursier, notre trompette, la langue, et tant d’autres menus auxiliaires qui défendent notre constitution, si tous…
Eh bien, après ? Ce gaillard-là veut-il pas me couper la parole ! Eh bien, après ? eh bien, après ?
Si tous étaient molestés par le ventre vorace qui est la sentine du corps…
Eh bien, après ?
Si tous ces organes se plaignaient, que pouvait répondre le ventre ?
Je vais vous le dire. Si vous voulez m’accorder un peu de ce que vous n’avez guère, un moment de patience, vous allez entendre la réponse du ventre.
Vous mettez le temps à la dire !
Notez bien ceci, l’ami ! Votre ventre, toujours fort grave, gardant son calme, sans s’emporter comme ses accusateurs, répondit ainsi : Il est bien vrai, mes chers conjoints, que je reçois le premier toute la nourriturequi vous fait vivre ; et c’est chose juste, puisque je suis le grenier et le magasindu corps entier. Mais, si vous vous souvenez, je renvoie tout par les rivières du sang, jusqu’au palais du cœur, jusqu’au trône de la raison ; et, grâce aux conduits sinueux du corps humain, les nerfs les plus forts et les moindres veinesreçoivent de moi ce simple nécessairequi les fait vivre. Et, bien que tous à la fois, mes bons amis… C’est le ventre qui parle, remarquez bien.
Oui, monsieur. Parfaitement, parfaitement !
Bien que tous à la fois vous ne puissiezvoir ce que je fournis à chacun de vous, je puis vous prouver, par un compte rigoureux, que je vous transmets toute la farineet ne garde pour moi que le son. Qu’en dites-vous ?
C’était une réponse. Quelle application en faites-vous ?
Le sénat de Rome est cet excellent ventre, et vous êtes les membres révoltés. Car, ses conseils et ses mesures étant bien examinés, les affaires étant dûment digérées dans l’intérêt de la chose publique, vous reconnaîtrez que les bienfaits généraux que vous recueillez procèdent ou viennent de lui, et nullement de vous-mêmes… Qu’en pensez-vous, vous le gros orteil de cette assemblée ?
Moi, le gros orteil ! Pourquoi le gros orteil ?
Parce qu’étant l’un des plus infimes, des plus bas, des plus pauvres de cette édifiante rébellion, tu marches le premier. Mâtin de la plus triste race, tu cours, en avant de la meute dans l’espoir de quelques reliefs. Allons, préparez vos massues et vos bâtons les plus raides. Rome est sur le point de se battre avec ses rats. Il faut qu’un des deux partis succombe… Salut, noble Marcius !
Entre Caïus Marcius.
Merci.
Aux citoyens.
De quoi s’agit-il, factieux vils qui, à force de gratter la triste vanité qui vous démange, avez fait de vous des galeux ?
Nous n’avons jamais de vous que de bonnes paroles.
Celui qui l’accorderait une bonne parole serait un flatteur au-dessous du dégoût… Que vous faut-il, aboyeurs, à qui ne conviennent ni la paix ni la guerre ? L’une vous épouvante, l’autre vous rend insolents. Celui qui compte sur vous trouve, le moment venu, au lieu de lions, des lièvres, au lieu de renards, des oies. Non, vous n’êtes pas plus sûrs qu’un tison ardent sur la glace, qu’un grêlon au soleil. Votre vertu consiste à exalter celui que ses fautes ont abattu, et à maudire la justice qui l’a frappé. Qui mérite la gloire mérite votre haine, et vos affections sont les appétits d’un malade qui désire surtout ce qui peut augmenter son mal. S’appuyer sur votre faveur, c’est nager avec des nageoires de plomb et vouloir abattre un chêne avec un roseau. Se fier à vous ! Plutôt vous pendre ! À chaque minute vous changez d’idée : vous trouvez noble celui que vous haïssiez tout à l’heure, infâme celui que vous couronniez. Qu’y a-t-il ? Pourquoi, dans les divers quartiers de la cité, criez-vous ainsi contre ce noble sénat qui, sous l’égide des dieux, vous lient en respect et empêche que vous ne vous dévoriez les uns les autres ?
À Ménénius.
Que réclament-ils ?
Du blé au prix qui leur plaît : ils disent que la ville en regorge.
Les pendards ! ils parlent ! Assis au coin du feu, ils prétendent juger ce qui se fait au Capitole, qui a chance d’élévation, qui prospère et qui décline, épousent telle faction, forment des alliances conjecturales, fortifient leur parti, et ravalent celui qu’ils n’aiment pas au-dessous de leurs savates ! Ils disent que le blé ne manque pas ! Ah ! si la noblesse mettait de côté ses scrupules et me laissait tirer l’épée, je ferais de ces milliers de manants une hécatombe de cadavres aussi haute que ma lance !
Ma foi, je crois ceux-ci presque complètement persuadés : car, si ample que soit leur manque de sagesse, ils sont d’une couardise démesurée. Mais, je vous prie, que dit l’autre attroupement ?
Il s’est dispersé. Ah ! les pendards ! Ils disaient qu’ils étaient affamés, soupiraient des maximes, que… la faim brise les murs de pierre, qu’il faut que les chiens mangent, que… la nourriture est faite pour toutes les bouches ; que… les dieux n’ont pas envoyé le blé pour les riches seulement… C’est en centons de cette sorte qu’ils ont éventé leurs plaintes ; on leur a répondu en leur accordant leur requête, étrange requête, capable de frapper au cœur la noblesse, et de faire pâlir le pouvoir le plus hardi ! Alors ils ont jeté leurs bonnets en l’air comme pour les accrocher aux cornes de la lune, et ont exhalé leur animosité en acclamations.
Que leur a-t-on accordé ?
Cinq tribuns de leur choix pour défendre leur vulgaire politique : ils ont élu Junius Brutus, Sicinius Velutus, et je ne sais qui. Sangdieu ! la canaille aurait démantelé la ville, avant d’obtenir cela de moi. Cette concession entamera peu à peu le pouvoir et fournira un thème de plus en plus fort aux arguments de l’insurrection.
C’est étrange.
Allons, retournez chez vous, racaille.
Entre un messager.
Où est Caïus Marcius ?
Ici. De quoi s’agit-il ?
La nouvelle, monsieur, c’est que les Volsques ont pris les armes.
J’en suis bien aise : nous allons avoir le moyen de dégorger un superflu fétide… Voici l’élite de nos anciens.
Entrent Cominius, Titus Lartius, vieillard en cheveux blancs, et d’autres sénateurs ; puis Junius Brutus et Sicinius Velutus.
Marcius, vous nous avez dit vrai : les Volsques ont pris les armes.
Ils ont un chef, Tullus Aufidius, qui vous donnera de la besogne. J’ai la faiblesse d’être jaloux de sa vaillance : et si je n’étais moi, c’est lui que je voudrais être.
Vous vous êtes déjà mesurés.
Quand la moitié du monde serait aux prises avec l’autre, et quand il serait de mon parti, je passerais à l’ennemi, rien que pour faire la guerre contre lui : c’est un lion que je suis fier de relancer.
Eh bien, digne Marcius, accompagnez Cominius dans cette guerre.
C’est une promesse déjà faite.
Oui, monsieur, et je la tiendrai… Titus Lartius, tu vas me voir encore une fois attaquer Tullus en face. Quoi, serais-tu perclus ! Te récuserais-tu ?
Non, Caïus Marcius, je m’appuierai sur une béquille et je combattrai avec l’autre plutôt que de renoncer à cette lutte.
Ô vrai preux !
Accompagnez-nous jusqu’au Capitole où je sais que nos meilleurs amis nous attendent.
Ouvrez la marche ; suivez, Cominius, et nous autres nous viendrons après… À vous le pas.
Noble Lartius !
En route ! À vos logis ! partez.
Non, qu’ils nous suivent ! Les Volsques ont beaucoup de blé ; emmenons ces rats pour ronger leurs provisions… Respectables mutins, votre valeur donne de beaux fruits. De grâce, suivez-nous.
Sortent les sénateurs, Cominius, Titus Lartius, Marcius et Ménénius. Les citoyens se dispersent.
Vit-on jamais un homme aussi arrogant que ce Marcius ?
Il n’a pas d’égal.
Quand nous avons été élus tribuns du peuple…
Avez-vous remarqué ses lèvres et ses yeux ?
Non, mais ses sarcasmes.
Une fois emporté, il n’hésiterait pas à narguer les dieux !
À bafouer la chaste lune !
La guerre le dévore ! il devient trop fier de sa vaillance.
Sa nature, chatouillée par le succès, dédaigne jusqu’à l’ombre qu’il foule en plein midi. Mais je m’étonne que son insolence daigne se laisser commander par Cominius.
La renommée à laquelle il vise et dont il est déjà paré ne saurait s’acquérir et se conserver plus aisément qu’au second rang. Car le moindre revers passera pour être la faute du général, celui-ci eût-il accompli tout ce qui est possible à un homme, et la censure étourdie s’écriera alors : Oh ! si Marcius avait conduit l’affaire !
Et puis, si les choses vont bien, l’opinion, qui est si entichée de Marcius, en ravira tout le mérite à Cominius.
Bref, la moitié de la gloire de Cominius sera pour Marcius, Marcius n’en fût-il pas digne, et toutes ses fautes seront à la gloire de Marcius, ne l’eût-il en rien mérité.
Allons savoir comment l’expédition s’effectue, et quelles forces, outre son énergie personnelle, l’assisteront dans cette campagne.
Allons !
Ils sortent.
Corioles. Le sénat.
Entrent Tullus Aufidius et les sénateurs.
Ainsi, Aufidius, votre opinion est que ceux de Rome ont pénétré nos conseils, et connaissent nos menées.
N’est-ce pas votre avis ? Quel projet a jamais été médité dans cet État et mis matériellement à exécution avant que Rome en eût été prévenue ? Il y a quatre jours à peine que j’ai eu des nouvelles de là ; voici les paroles même : je crois que j’ai la lettre ici ; oui, la voici !
Il lit.
« Ils ont levé des forces, mais on ne sait si c’est pour l’est ou pour l’ouest. La disette est grande, le peuple révolté. Le bruit court que Cominius, Marcius, votre vieil ennemi, plus haï de Rome que de vous, et Titus Lartius, un Romain très vaillant, doivent tous trois diriger cette expédition vers son but, très probablement contre vous. Prenez-y garde. »
Notre armée est en campagne : nous n’avons jamais douté que Rome ne fût prête à nous tenir tête.
Et vous avez cru sage de tenir cachés vos grands desseins jusqu’au moment où ils devront se révéler d’eux-mêmes ; mais il semble qu’avant d’éclore ils aient été connus de Rome. Leur découverte va circonscrire notre plan qui était de surprendre plusieurs villes, avant même que Rome sût que nous étions sur pied.
Noble Aufidius, prenez votre commission, courez à vos troupes, et laissez-nous seuls garder Corioles. S’ils viennent camper sous nos murs, amenez votre armée pour les chasser ; mais vous reconnaîtrez, je crois, que leurs préparatifs n’étaient pas contre nous.
Oh ! n’en doutez pas ; je parle sur des certitudes. Il y a plus : quelques détachements de leurs forces sont déjà en marche, et tout droit sur Corioles. Je laisse Vos Seigneuries. Si nous venons à nous rencontrer, Caïus Marcius et moi, nous nous sommes juré de ne cesser le combat que quand l’un des deux ne pourrait plus agir.
Que les dieux vous assistent !
Et gardent vos Seigneuries !
Adieu.
Adieu.
Adieu.
Ils sortent.
Rome. Dans la maison de Volumnie.
Entrent Volumnie et Virgilie ; elles s’assoient sur deux petits tabourets et cousent.