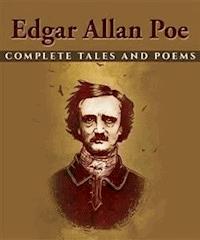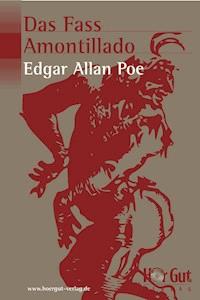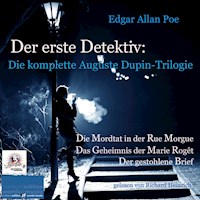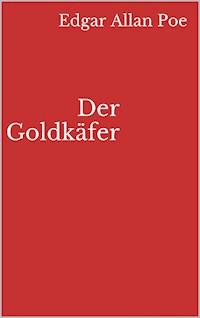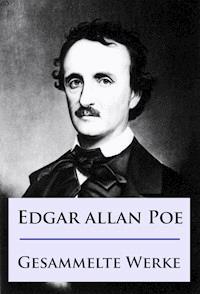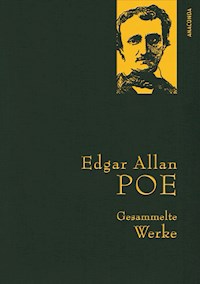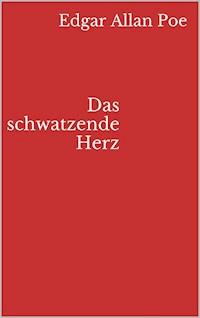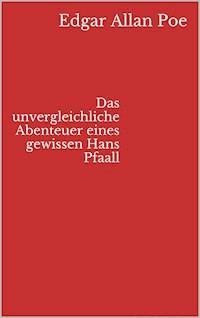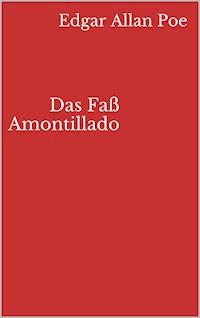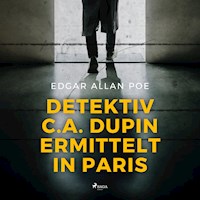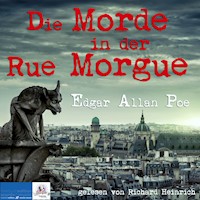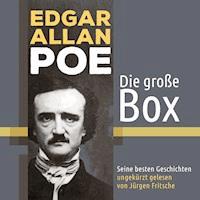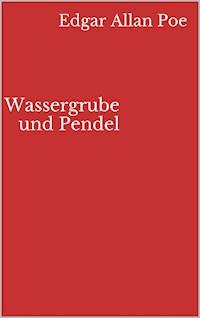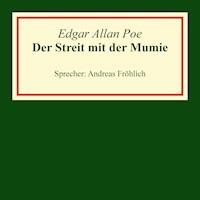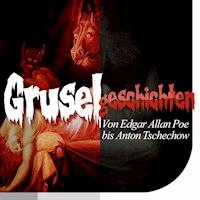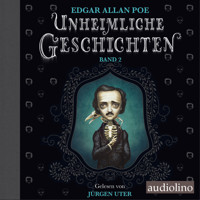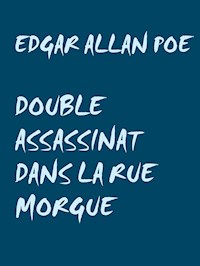
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Double assassinat dans la rue morgue est une nouvelle de l'écrivain américain Edgar Allan Poe, parue en 1841 dans le Graham's Magazine, traduite en français par Isabelle Meunier puis, en 1856 par Charles Baudelaire pour le recueil Histoires extraordinaires.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 67
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
DOUBLE ASSASSINAT DANS LA RUE MORGUE
Pages de titrePage de copyrightEdgar Allan Poe
Traduit par Charles Baudelaire
DOUBLE ASSASSINAT
DANS LA RUE MORGUE
Histoires extraordinaires
Quelle chanson chantaient les sirènes ? quel nom
Achille avait-il pris, quand il se cachait parmi les
femmes ? – Questions embarrassantes, il est vrai, mais
qui ne sont pas situées au-delà de toute conjecture.
SIR THOMAS BROWNE.
Les facultés de l’esprit qu’on définit par le terme
analytiquessont en elles-mêmes fort peu susceptibles
d’analyse. Nous ne les apprécions que par leurs résultats. Ce que
nous en savons, entre autre choses, c’est qu’elles sont pour celui
qui les possède à un degré extraordinaire une source de
jouissances des plus vives. De même que l’homme fort se réjouit
dans son aptitude physique, se complaît dans les exercices qui
provoquent les muscles à l’action, de même l’analyse prend sa
gloire dans cette activité spirituelle dont la fonction est de
débrouiller. Il tire du plaisir même des plus triviales occasions
qui mettent ses talents en jeu. Il raffole des énigmes, des rébus,
des hiéroglyphes ; il déploie dans chacune des solutions une
puissance de perspicacité qui, dans l’opinion vulgaire, prend un
caractère surnaturel. Les résultats, habilement déduits par
l’âme même et l’essence de sa méthode, ont réellement tout l’air
d’une intuition.
Cette faculté derésolutiontire peut-être une grande force
de l’étude des mathématiques, et particulièrement de la très
haute branche de cette science, qui, fort improprement et
simplement en raison de ses opérations rétrogrades, a été
nommée l’analyse, comme si elle était l’analyse par excellence.
Car, en somme, tout calcul n’est pas en soi une analyse. Un
joueur d’échecs, par exemple, fait fort bien l’un sans l’autre. Il
suit de là que le jeu d’échecs, dans ses effets sur la nature
spirituelle, est fort mal apprécié. Je ne veux pas écrire ici un
traité de l’analyse, mais simplement mettre en tête d’un récit
passablement singulier quelques observations jetées tout à fait à
l’abandon et qui lui serviront de préface.
-2 -
Je prends donc cette occasion de proclamer que la haute
puissance de la réflexion est bien plus activement et plus
profitablement exploitée par le modeste jeu de dames que par
toute la laborieuse futilité des échecs. Dans ce dernier jeu, où les
pièces sont douées de mouvements divers et bizarres, et
représentent des valeurs diverses et variées, la complexité est
prise – erreur fort commune – pour de la profondeur.
L’attention y est puissamment mise en jeu. Si elle se relâche
d’un instant, on commet une erreur, d’où il résulte une perte ou
une défaite. Comme les mouvements possibles sont non
seulement variés, mais inégaux enpuissance, les chances de
pareilles erreurs sont très multipliées ; et dans neuf cas sur dix,
c’est le joueur le plus attentif qui gagne et non pas le plus habile.
Dans les dames, au contraire, où le mouvement est simple dans
son espèce et ne subit que peu de variations, les probabilités
d’inadvertance sont beaucoup moindres, et l’attention n’étant
pas absolument et entièrement accaparée, tous les avantages
remportés par chacun des joueurs ne peuvent être remportés
que par une perspicacité supérieure.
Pour laisser là ces abstractions, supposons un jeu de dames
où la totalité des pièces soit réduite à quatredames, et où
naturellement il n’y ait pas lieu de s’attendre à des étourderies.
Il est évident qu’ici la victoire ne peut être décidée, – les deux
parties étant absolument égales, – que par une tactique habile,
résultat de quelque puissant effort de l’intellect. Privé des
ressources ordinaires, l’analyste entre dans l’esprit de son
adversaire, s’identifie avec lui, et souvent découvre d’un seul
coup d’œil l’unique moyen – un moyen quelquefois
absurdement simple – de l’attirer dans une faute ou de le
précipiter dans un faux calcul.
On a longtemps cité le whist pour son action sur la faculté
du calcul ; et on a connu des hommes d’une haute intelligence
qui semblaient y prendre un plaisir incompréhensible et
dédaigner les échecs comme un jeu frivole. En effet, il n’y a
aucun jeu analogue qui fasse plus travailler la faculté de
l’analyse. Le meilleur joueur d’échecs de la chrétienté ne peut
- 3 -
guère être autre chose que le meilleur joueur d’échecs ; mais la
force au whist implique la puissance de réussir dans toutes les
spéculations bien autrement importantes où l’esprit lutte avec
l’esprit.
Quand je dis la force, j’entends cette perfection dans le jeu
qui comprend l’intelligence de tous les cas dont on peut
légitimement faire son profit. Ils sont non seulement divers,
mais complexes, et se dérobent souvent dans des profondeurs
de la pensée absolument inaccessibles à une intelligence
ordinaire.
Observer attentivement, c’est se rappeler distinctement ; et,
à ce point de vue, le joueur d’échecs capable d’une attention très
intense jouera fort bien au whist, puisque les règles de Hoyle,
basées elles mêmes sur le simple mécanisme du jeu, sont
facilement et généralement intelligibles.
Aussi, avoir une mémoire fidèle et procéder d’après le livre
sont des points qui constituent pour le vulgaire lesummumdu
bien jouer. Mais c’est dans les cas situés au-delà de la règle que
le talent de l’analyste se manifeste ; il fait en silence une foule
d’observations et de déductions. Ses partenaires en font peut-
être autant ; et la différence d’étendue dans les renseignements
ainsi acquis ne gît pas tant dans la validité de la déduction que
dans la qualité de l’observation. L’important, le principal est de
savoir ce qu’il faut observer. Notre joueur ne se confine pas dans
son jeu, et, bien que ce jeu soit l’objet actuel de son attention, il
ne rejette pas pour cela les déductions qui naissent d’objets
étrangers au jeu. Il examine la physionomie de son partenaire, il
la compare soigneusement avec celle de chacun de ses
adversaires. Il considère la manière dont chaque partenaire
distribue ses cartes ; il compte souvent, grâce aux regards que
laissent échapper les joueurs satisfaits, les atouts et les
honneurs, un à un. Il note chaque mouvement de la
physionomie, à mesure que le jeu marche, et recueille un capital
de pensées dans les expressions variées de certitude, de
- 4 -
surprise, de triomphe ou de mauvaise humeur. À la manière de
ramasser une levée, il devine si la même personne en peut faire
une autre dans la suite. Il reconnaît ce qui est joué par feinte à
l’air dont c’est jeté sur la table. Une parole accidentelle,
involontaire, une carte qui tombe, ou qu’on retourne par
hasard, qu’on ramasse avec anxiété ou avec insouciance ; le
compte des levées et l’ordre dans lequel elles sont rangées ;
l’embarras, l’hésitation, la vivacité, la trépidation, – tout est
pour lui symptôme, diagnostic, tout rend compte de cette
perception, – intuitive en apparence, – du véritable état des
choses. Quand les deux ou trois premiers tours ont été faits, il
possède à fond le jeu qui est dans chaque main, et peut dès lors
jouer ses cartes en parfaite connaissance de cause, comme si
tous les autres joueurs avaient retourné les leurs.
La faculté d’analyse ne doit pas être confondue avec la
simple ingéniosité ; car, pendant que l’analyste est
nécessairement ingénieux, il arrive souvent que l’homme
ingénieux est absolument incapable d’analyse. La faculté de
combinaison, ou constructivité, à laquelle les phrénologues – ils
ont tort, selon moi, – assignent un organe à part, en supposant
qu’elle soit une faculté primordiale, a paru dans des êtres dont
l’intelligence était limitrophe de l’idiotie, assez souvent pour
attirer l’attention générale des écrivains psychologistes. Entre
l’ingéniosité et l’aptitude analytique, il y a une différence
beaucoup plus grande qu’entre l’imaginative et l’imagination,
mais d’un caractère rigoureusement analogue. En somme, on
verra que l’homme ingénieux est toujours plein d’imaginative, et
que l’hommevraimentimaginatif n’est jamais autre chose
qu’un analyste.
Le récit qui suit sera pour le lecteur un commentaire
lumineux des propositions que je viens d’avancer. Je demeurais
à Paris, – pendant le printemps et une partie de l’été de 18.., –
et j’y fis la connaissance d’un certain C. Auguste Dupin. Ce
jeune gentleman appartenait à une excellente famille, une
famille illustre même ; mais, par une série d’événements
malencontreux, il se trouva réduit à une telle pauvreté, que
- 5 -
l’énergie de son caractère y succomba, et qu’il cessa de se
pousser dans le monde et de s’occuper du rétablissement de sa
fortune. Grâce à la courtoisie de ses créanciers, il resta en
possession d’un petit reliquat de son patrimoine ; et, sur la rente
qu’il en tirait, il trouva moyen, par une économie rigoureuse, de
subvenir aux nécessités de la vie, sans s’inquiéter autrement des
superfluités. Les livres étaient véritablement son seul luxe, et à
Paris on se les procure facilement.
Notre première connaissance se fit dans un obscur cabinet
de lecture de la rue Montmartre, par ce fait fortuit que nous
étions tous deux à la recherche d’un même livre, fort
remarquable et fort rare ; cette coïncidence nous rapprocha.
Nous nous vîmes toujours de plus en plus. Je fus profondément
intéressé par sa petite histoire de famille, qu’il me raconta
minutieusement avec cette candeur et cet abandon, – ce sans-
façon dumoi, – qui est le propre de tout Français quand il parle
de ses propres affaires.