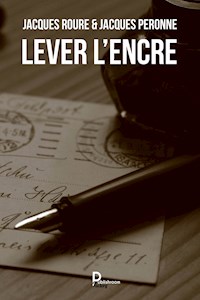Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Publishroom
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Hélène nous raconte son quotidien au sein de sa famille peu conventionnelle.
Beauvais. 32, impasse de l’Abattoir.
Il se passait depuis longtemps des choses étranges dans mon cerveau. Surtout une furieuse envie, retenue depuis ma plus tendre enfance, de tuer ma mère. Les ressentiments prennent souvent leurs sources dans des idées bizarres.
Je m’appelle Hélène Vendeuil. À l’âge de cinq ans maman m’avait sévèrement punie pour avoir refusé d’embrasser tante Berthe. Maintenant, à quinze ans passés, je me souvenais de l’origine de cette rébellion, survenue en recevant en pleines narines, par un bel après-midi d’été, où les pins étalaient le parfum délicat des résines, l’haleine de ma tante mêlant voluptueusement une odeur confuse de vieux Munster et d’urine de chat. En ce dimanche de juillet, j’étais attablée, pour le repas de midi, entre mon père, ma mère et tante Berthe, qu’ils accueillaient, depuis mon plus jeune âge, pour ces repas hebdomadaires, auxquels je participais, en évitant de respirer par le nez.
Découvrez le nouveau Roman de Jacques Roure et laissez-vous emporter par cette histoire qui recèle plus d'un secret de famille !
À PROPOS DE L'AUTEUR
Jacques Roure est né en 1938. Après avoir exercé la profession de neuropsychiatre et psychanalyste, il crée à Aix-en-Provence le théâtre de la Fonderie. Comédien et metteur en scène, il s’oriente en même temps vers l’écriture de chansons pour de nombreuses personnalités.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 294
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
JacquesRoure
Entrezdans les rondes
Morne enfance
Beauvais. 32, impasse de l’Abattoir.
Il se passait depuis longtemps des choses étranges dans mon cerveau. Surtout une furieuse envie, retenue depuis ma plus tendre enfance, de tuer ma mère. Les ressentiments prennent souvent leurs sources dans des idées bizarres.
Je m’appelle Hélène Vendeuil. À l’âge de cinq ans maman m’avait sévèrement punie pour avoir refusé d’embrasser tante Berthe.
Maintenant, à quinze ans passés, je me souvenais de l’origine de cette rébellion, survenue en recevant en pleines narines, par un bel après-midi d’été, où les pins étalaient le parfum délicat des résines, l’haleine de ma tante mêlant voluptueusement une odeur confuse de vieux Munster et d’urine de chat.
En ce dimanche de juillet, j’étais attablée, pour le repas de midi, entre mon père, ma mère et tante Berthe, qu’ils accueillaient, depuis mon plus jeune âge, pour ces repas hebdomadaires, auxquels je participais, en évitant de respirer par le nez.
Tante Berthe avait quarante-cinq ans. Sœur jumelle de ma mère, encore célibataire, elle s’envoyait de temps en temps en l’air avec le concierge de son immeuble. Leurs copulations régulières se terminaient par l’ingestion de quelques verres de vieux rhum, avait-elle raconté en gloussant dans une conversation que je surpris, ce qui avait sans doute le mérite de suspendre quelque temps la pollution de l’air ambiant.
Elle n’était pas laide, un peu longue du cou, une étroite ouverture buccale agrandie à l’aide d’un rouge à lèvres mauve. Ses yeux étaient noirs, perçants comme troués à la vrille. Elle arrivait toujours vêtue d’extravagantes guenilles laissant, par bonheur ce dimanche-là, l’invraisemblable renard relativement pelé, tête et queue comprises, qu’elle arborait comme un trophée, les jours où la température extérieure descendait au-dessous de 20 degrés. Je me suis demandé longtemps si ce pauvre renard n’était pas en réalité un putois. Il avait seulement concentré, au cours de toutes ces années d’utilisation, les fragrances bucco-dentaires de ma tante.
J’avais pu faire l’impasse, au début du repas, sur la salade de tomates, prétextant les habituelles aigreurs engendrées par les crudités en général.
–Mais cette petite n’aime rien ! éructa tante Berthe, en dégageant des effluves encore plus nauséabonds qu’à l’accoutumée. Pas possible, pensai-je, elle a dû péter en même temps. Prise de haut-le-cœur, je fis semblant de m’essuyer la bouche avec la serviette, la conservant devant mon visage, pour contrecarrer l’envie de vomir tripes et boyaux. Je me demandais à ce moment-là, pourquoi j’avais envisagé de tuer seulement ma mère, puisque cette Berthe était directement responsable de mes envies d’assassinat. Je projetai immédiatement de me débarrasser de la paire, car la survivance d’un des deux spécimens demeurerait toujours un danger pour mon existence.
Maman n’était pas à proprement parler, méchante. Elle avait, en fait, le don de me poser des questions stupides, auxquelles, elle-même, n’avait pas de réponse :
–Pourquoi as-tu les mains aussi plates ?
Je regardais mes mains, posées délicatement de part et d’autre de mon assiette et ne trouvai rien à redire sur cette partie de mon anatomie. Les doigts étaient un peu minces, les articulations souples, les ongles coupés ras comme me l’avait recommandé mon professeur de piano :
–Une artiste doit avoir des mains impeccables et la pulpe de chaque extrémité doit pouvoir attaquer franchement la note sans être gênée par une quelconque fantaisie ongulée. Telles étaient les préconisations de mon professeur, madame Adélaïde Dutoit qui avait décroché à l’âge de 18 ans le premier prix d’harmonie et de solfège, au conservatoire de Poitiers. Elle n’avait pas réussi à s’imposer comme concertiste, malgré ses dons évidents. À chaque concert, elle était prise d’un trac insurmontable. Ses mains ne tremblaient pas mais l’indisposition émotionnelle qui l’étreignait se fixait sur sa vessie, entrainant une irrésistible envie d’uriner, l’amenant à garnir copieusement sa culotte pour avoir quelques chances de terminer le concert sans débordement. Elle saluait rapidement mais ne consentait à aucun rappel. Elle quittait précipitamment sa loge pour retourner dans sa demeure où des flots de pleurs prenaient la place de ses fuites urinaires. Après la deuxième expérience, elle avait décidé d’arrêter définitivement ses productions scéniques malgré les articles flatteurs récoltés au détour de ses deux seuls concerts. Elle s’était reconvertie dans l’enseignement privé à son domicile. Elle n’était pas avare en compliments sur la vigueur de ma main gauche et sur l’élégante dextérité de ma main droite qu’elle qualifiait d’outil délicat :
–Oui, un oiseau. Ta main droite est un oiseau capable de produire les sons les plus sensibles. Si j’avais possédé cette même partie dans mon anatomie, je n’aurais pas eu la chance de te connaitre.
–Vous ne regrettez rien ?
–Non, car tu vas être celle que j’aurais aimé devenir… Je te le promets.
Alors, maman pouvait bien affubler mes mains de tous les qualificatifs, même détestables, elle n’arriverait en rien à me faire déprécier cette partie de moi-même.
Au fond je ne demandais pas grand-chose. D’abord qu’on me foute une paix royale, ensuite qu’on me laisse le loisir de manger ou de pas manger, satisfaite de mes trente-sept kilos toute habillée. J’étais heureuse d’avoir un poids dont le chiffre était égal à celui de ma température rectale, n’était-ce pas là un signe de parfait équilibre ? Depuis des années que cette tordue de Berthe, puante et pâteuse, me donnait des conseils, en prenant à témoin ma mère, j’avais pu constituer progressivement les bases de ma détestation. Aujourd’hui, elles avaient enfin percé les couches profondes de mon cerveau pour apparaitre, au cours de ce repas, en pleine lumière. Je compris instantanément qu’il y avait, dans ce duo diabolique, la cause et l’entretien régulier de mes pensées assassines et de mon dégoût des aliments.
Le médecin de la famille, le bon docteur Cristol avait diagnostiqué une anorexie et conseillait à ma mère d’exercer un contrôle strict sur mes ingurgitations. Pendant un temps, voulant faire plaisir à ce superviseur patenté de la santé familiale, je dévorai ostensiblement tout le contenu de mon assiette sous le regard béat de maman. Cela se poursuivait, une fois les agapes terminées, par un passage derrière la maison où avec l’aide d’un index enfoncé au ras de ma gorge, je rejetais en jet, dans un coin de la demeure, à l’abri des regards, le trop plein de mon estomac.
L’automne arriva. D’un poids léger je repris le chemin de l’école. Je flottais dans ma jupe plissée bleu marine et laissait poindre, en bombant légèrement le torse, sous mon chemisier blanc deux petits seins naissants. Mon visage un peu creux au-dessous des pommettes me plaisait beaucoup. Je le trouvais fin et lumineux. Je pense que j’étais plutôt jolie.
L’école, où j’étais demi-pensionnaire, me permettait le temps d’un repas d’échapper aux incantations familiales. J’adorais mon professeur de français, mademoiselle Duchemin, dont j’étais un peu la chouchoute. Dans la cour de récréation :
–Hélène, tu es très belle et très intelligente.
Elle passait sa main dans mes cheveux ce qui déclenchait dans mon corps un frisson délicieux.
–Mais… mais tu me parais bien préoccupée ?
Je m’échappais sur un sourire qui me rendait encore plus radieuse. Je me demandais pourquoi mademoiselle Duchemin n’était pas ma mère et pourquoi, la trentaine passée, elle n’était pas encore mariée, malgré sa douceur et son charme.
Peut-être n’aimait-elle pas les garçons. D’ailleurs moi non plus je n’aimais pas particulièrement les garçons. Je les trouvais patauds et surtout très bêtes.
Le lundi matin était le jour de la pesée. Désespérément la balance trahissait mes trente-sept kilos, avec ce jour-là une embellie de deux cents grammes. Le sourire affiché par ma mère déclencha une envie irrépressible de meurtre, mais je n’avais à ma disposition sur la table de toilette que le peigne et une brosse à dents. Les ciseaux à ongles avaient été cachés, depuis qu’un matin, au sortir de la douche, je m’étais livrée à quelques scarifications sur l’intérieur de l’avant-bras gauche. Je m’en étais tirée avec une paire de gifles qui avaient eu le mérite de me donner brutalement quelques couleurs. Cela m’avait permis de rajouter une ligne sur le petit carnet où je consignais au chapitre « sévices divers » les agressions maternelles. La liste s’allongeait et le nombre de mes récriminations grossissait, depuis que j’avais inscrit également le nom de tante Berthe dans mon journal intime.
Mon père avait-il un jour existé ? Il était là, sans être là, acquiesçant à tout ce que disait sa femme, pourvu qu’on le laisse lire tranquillement son journal et regarder à la télé le foot. « Je ne comprends pas » disait-elle, mais seulement à la mi-temps, « qu’on puisse regarder ces agitations de manchots ». Elle haussait les épaules émettait un « pffft » qui contenait de manière résumée tout le contenu de sa pensée et retournait à la cuisine pour commencer son ménage.
Le ménage de ma mère était un exercice religieux, bien fini dans les moindres détails car la poussière et les microbes « se logent partout… Il faut les combattre sans relâche, les tuer dans l’œuf, les poursuivre au plus profond de leur tanière ». Ce ménage, commencé dès la fin du repas du soir, allait se poursuivre méticuleusement jusqu’au coucher pour reprendre à l’aube du lendemain. Avant de s’endormir, elle se levait à plusieurs reprises pour vérifier la fermeture de la porte d’entrée, puis de tous les robinets et terminait son œuvre vespérale par les penderies, pour contrôler que tous les boutons des vestes de son mari étaient bien cachés par le pan comportant les boutonnières, qu’elle rabattait méticuleusement sur eux. Elle souhaitait une bonne nuit aux vêtements puis, sitôt la tête sur l’oreiller, elle s’endormait dans un ronflement relativement puissant. Je savais qu’à partir de ce moment la « bête » devenait inoffensive. J’allais pouvoir commencer ma nuit.
Mes nuits débutaient toujours par les dernières notes apportées à mon cahier secret, puis à une relecture rapide avant d’enfermer ce trésor dans mon cartable. J’avais essayé de trouver un coin de chambre pouvant servir de cachette mais les investigations nettoyeuses de ma mère ne laissaient aucune chance à un quelconque recoin. J’avais donc décidé de ne jamais m’en séparer.
Un soir, douillettement allongée dans mon lit, je me suis souvenue du délicat frisson déclenché par mademoiselle Duchemin, quand elle avait caressé mes cheveux. J’écartai mes doigts les faisaient pénétrer à partir de mon front au travers de ma chevelure, d’avant en arrière puis de gauche à droite en pensant à mon professeur, mais je ne ressentis rien. Alors je laissais descendre doucement mes deux mains sur mes épaules et jusqu’à mes deux seins. Un instant elles demeurèrent immobiles puis effleurèrent délicatement leurs petites extrémités, déjà dressées et là, très rapidement je sentis se reproduire la délicieuse sensation des caresses de ma maîtresse dans la cour de récréation. Audacieuse, je poursuivis l’exploration de mon corps, d’abord mon ventre dont je recueillis au passage quelques gargouillis puis la face interne de mes cuisses pour poser enfin ma main droite sur mon sexe… Et je connus là mon premier orgasme.
La tante Berthe, dont les connaissances littéraires se limitaient à la lecture de « La Vie du Rail » et de quelques polars chinés sur les marchés, avait jeté son dévolu sur les enquêtes du commissaire Maigret. Elle acheta un jour, pour l’enrichissement de sa culture, un Jean Bruce dont le titre « Cinq gars pour Singapour » lui fit forte impression. Poursuivie par cette littérature qui lui semblait être le sommet de la création, elle enchaîna avec « Atout cœur à Tokyo » puis « Gâchis à Karachi », mais resta toujours attachée au premier de ces titres. Comment parvint-elle à convaincre ma mère, phobique de l’avion, qu’elle considérait comme le plus gros des insectes volants, d’embarquer avec elle via Singapour ? Je pense que maman avait dû lire que, dans ce pays, de grosses contraventions étaient infligées aux gens jetant à terre des papiers ou des déchets (y compris les mégots de cigarettes), qui crachent ou qui urinent dans les lieux publics, ce qui était passible d’une amende de mille dollars. Sûr, qu’elle n’était pas restée indifférente à cette asepsie de surface. Du tourisme dans ces conditions représentait la meilleure défense contre une agression extérieure dans un pays où elle ne pourrait pas maîtriser la désinfection de son parcours.
Pourquoi, en ce jeudi 17 juillet 2014 décidèrent-elles d’embarquer sur un vol allant vers la Russie ? Je pense que tante Berthe, ayant lu durant le voyage aller, toujours de ce même Jean Bruce « Moche coup à Moscou », la décida pour cette escale, avant de reprendre, dès son retour, ses activités ménagères et mon espionnage alimentaire.
Le vol de la Malaysia Airlines disparut ce jour-là des écrans radar et n’arriva jamais à destination. Perdu corps et biens dans une mer lointaine. Le destin avait brutalement frappé mes deux victimes potentielles. J’eus quelque temps des regrets de n’avoir pas été la main fatale, et des remords, imaginant avoir été quelque peu responsable de cette catastrophe. Je pleurais surtout sur toutes les victimes innocentes, dont seul le drame m’avait touchée, mais fus débarrassée le jour même d’un fardeau devenu bien pesant et dont l’exécution à la maison m’aurait causé quelques problèmes. Le soir même, après avoir ingurgité sans aucune réticence un plat de nouilles au gratin, une compote de pommes et trois bananes je m’endormis après quelques caresses, le sentiment du devoir accompli.
Les jours passèrent tranquilles. Je m’étonnais de la sérénité de mon père, plus souriant que jamais. Il ne lisait plus le journal. Les soirs de foot il me demandait quel film nous pourrions regarder ensemble. Il avait décidé de me conduire chaque matin à l’école et de venir m’y rechercher à la sortie de l’étude. Après un bon petit déjeuner, vêtue d’un tee-shirt et d’une salopette nous prenions la route du lycée. Il m’arrêtait devant une boulangerie où il m’achetait deux pains au chocolat pour la récréation de 10 heures et me déposait devant mon lieu d’étude où j’allais retrouver mademoiselle Duchemin, ma tripoteuse attitrée devenue directrice de l’établissement.
Je pesais à ce jour 49 kilos, profitant, pensais-je, de l’exécution de ma mère et de ma tante, par pilote interposé pour connaitre un symptôme longtemps inconnu : l’appétit, ce qui pour 1,60 mètre me semblait idéal. À la maison on ouvrait les fenêtres, on laissait la vie reprendre tranquillement, même dans les placards où les costumes pouvaient maintenant dormir en toute quiétude.
Un soir, alors que nous étions confortablement installés dans le canapé du salon, Papa m’apprit que Maman n’était pas ma mère. Ils n’avaient jamais pu copuler car « sa femme », me dit-il ce jour-là, trouvait cette activité particulièrement dégoûtante et totalement irréalisable en dehors de préparatifs d’asepsie quasiment chirurgicaux. Je n’imaginai pas comment on pouvait introduire les parties reproductrices d’un individu dans un stérilisateur. Il avait reçu, comme un cadeau tombé du ciel, une enfant de deux ans, fruit de quelques séquences « amoureuses » exécutées hors du champ opératoire des activités légitimes, devenant de jour en jour plus aseptisées. La génitrice passagère déposa un jour à la maison un bébé de trois mois à peine, qu’il ne se souvenait pas avoir conçu. Il me fit entrer, encore pendue à six tétées par jour, dans le cercle familial. Il me confia qu’il avait pris, à cette occasion, la seule colère de sa vie disant à « ma mère » :
–C’est mon enfant. Elle s’appelle Hélène et comme tu demeures toujours fermée à mes tentatives d’avoir un jour un rejeton, j’ai décidé de lui ouvrir la porte. Je l’ai reconnue, adoptée. Si tu ne veux pas être sa mère, elle sera ma fille.
Dès mon arrivée, il avait abandonné toute tentative de pénétration dans les méandres vaginaux de sa femme, jugés définitivement inexplorables et certainement peuplés de défenses inexpugnables. Une sorte de terrain miné constituant le seul utérus virtuel jamais rencontré au long de sa carrière érotique.
À partir de cet instant, il ne cessa de se consoler avec la boulangère du quartier, nymphomane et bisexuelle, qui l’avait mis à son tableau de chasse une fois par semaine. Je compris alors le sourire enjôleur de ma vendeuse de pains au chocolat qui m’avait dès le premier jour appelée Hélène. Je me mis, dès cet instant, à aimer encore davantage les viennoiseries tendues par la main de cette fée érotique sachant rendre mon père heureux.
Je n’avais déjà pas à faire le deuil de la disparition de cette fausse génitrice puisqu’en définitive elle n’était même pas ma mère et je débarrassai, dans cet acting-out quasi psychanalytique, jusqu’au dernier refoulement d’une conscience déjà peu ébranlée par la culpabilité. J’imaginais combien cette nouvelle vie allait devenir idyllique.
Lors d’une de mes sorties de l’école, madame Duchemin continuait, dès que je la retrouvais, à passer ses mains dans mes cheveux, pour le plus grand plaisir de mes sens. Elle échangeait avec mon père des regards et des paroles qui me parurent, d’entrée, érotiquement chargés. Cette façon qu’elle avait de soulever ses sourcils en même temps que sa bouche, pour dessiner un sourire dévastateur, me fit comprendre que ces deux êtres ne resteraient pas longtemps éloignés.
Deux mois plus tard madame Duchemin vint d’abord dîner une fois par semaine avec nous à la maison. Puis à la fin de l’année elle s’installa définitivement chez nous. Connaissant et acceptant la bigamie de ce père aimant, après quelques mois, je lui demandai, elle qui se prénommait Madeleine, si je pouvais l’appeler « Molly ». Elle ne trouva rien à redire à ce nouveau baptême, qui regroupait définitivement dans cette appellation les fonctions de femme, de mère, d’amie et d’amante.
Je poursuivais ma croissance pondérale, à la limite de la boulimie. Au cours de mes éveils nocturnes, je poursuivais avec bonheur, ma suralimentation. Termite du réfrigérateur, j’évitais ainsi, que les aliments entreposés atteignent leur date de péremption. Tout y passait, les crèmes glacées, avalées à la cuillère à soupe, les restes de poulet, arrosés de mayonnaise, en passant par les tablettes de chocolat dans le placard de la cuisine. Pour délayer le contenu de mon estomac, j’ajoutais quelques verres de jus d’orange ou de Coca-Cola. J’avais abandonné mes tripotages avant sommeil, enfin amoureuse d’un garçon de ma classe qui m’avait déjà coincée à plusieurs reprises dans le placard à balais du collège. On allait se retrouver très vite pour parfaire une éducation sexuelle encore demeurée à l’état embryonnaire.
Un matin ma bascule accusa 60 kg. Je n’arrivais plus à mettre un frein à mon appétit et puis Bernard, c’était le prénom de l’heureux élu, se plaisait en compagnie de mes formes.
–Là, tu ressembles à quelque chose.
Je ne savais pas ce qu’était ce quelque chose mais je pris ça pour un compliment. Nous réalisâmes nos envies mutuelles, un jour où toute sa famille avait quitté le domicile. Il fut doux et tendre, je n’avais aucune peur et puis voyant son sexe qui me paraissait être de proportion raisonnable, je fus définitivement rassurée. Je guidai d’abord lentement sa main sur mon ventre et lui mis au bout des doigts l’objet de sa première convoitise en contrôlant ses mouvements, leur vitesse, leur pression. Je lui communiquai le fruit de mes expériences ce qui allait lui permettre de gagner beaucoup de temps. Comblée à trois reprises, je le laissais ensuite s’occuper de lui et aller et venir à sa guise dans mon corps.
–Reste comme tu es. Comme ça, tu es très belle.
Il me fit part de cette délicieuse analyse quand il retrouva son sourire, après quelques grimacements et une série de cris gutturaux, me faisant comprendre que la séance était terminée. Il ajouta qu’il trouvait superbes mes formes et séduisant mon ventre un peu rebondi, quant à mes fesses, n’en parlons pas… J’allais pouvoir, de retour à la maison assouvir pour son plus grand plaisir et le mien cette fantastique faim, qu’avait, semble-t-il mis en route cette partie de cul, dans des proportions, pensais-je, assez physiologiques.
Tout allait relativement bien. Maman et tante Berthe devaient faire bon ménage avec les dauphins. L’eau, relativement abondante, satisfaisait certainement la folie nettoyeuse de ma pseudo conceptrice. Quant à la tante, les bulles qu’elle produisait remplaçaient avantageusement les paroles acides de ses discours enfin débarrassés des miasmes de son haleine.
Tout baignait aussi à la maison. Je partais le matin avec « Molly » à l’école et le soir, après le repas et des échanges de mots et de sourires qui remplaçaient les aigreurs et les remontrances de ma vie antérieure, nous regagnions nos chambres. Molly demeurait avec papa jusqu’à l’apparition de son premier ronflement puis elle venait me rejoindre sous ma couette, s’allongeait à mes côtés et là commençait une série de caresses mutuelles jusqu’à mon premier sommeil. Je me promettais de parfaire l’éducation sexuelle de Bernard en lui communiquant les différentes manœuvres de Molly, la trouvant experte en la matière. Papa, de son côté, continuait à satisfaire, hebdomadairement, les besoins de sa boulangère quand son pétrisseur de mari s’en allait aux champs de courses.
Tout dans notre vie était serein et calme. L’avenir me paraissait radieux. Mais un retour inopiné du boulanger, un après-midi où papa s’envoyait en l’air avec son épouse, se termina dans une dramaturgie excessive. Ayant touché un gros tiercé dans la dernière course, il arriva heureux et excité, un fer à cheval dans la main. Ce porte-bonheur termina sa course sur le crâne de papa, lui éclatant le frontal et le laissant raide mort sur cette ruade inattendue. La boulangère, paralysée par la surprise, ne put résister à la strangulation de son mari. Le turfiste en prit pour 20 ans aux Assises. La boulangère, propriétaire de son commerce, nous avait laissé par testament, n’ayant pas de descendance, la gérance de la boutique. Prévoyait-elle cette issue fatale ? Cette question étant demeurée sans réponse, nous fîmes le deuil de papa. Lui, de son côté, m’avait légué la demeure de l’impasse de l’Abattoir. Je lui fis ériger, dans le petit cimetière de son village natal de Corrèze, une stèle surmontée d’un cheval cabré en béton, ayant collé le fer à cheval meurtrier sous le sabot droit de cette monture. Nous avions, avant l’arrivée de la police, remplacé « le porte-bonheur » par un marteau, précédemment tenu par des gants de ménage et trempé dans le sang paternel.
Nous portâmes le deuil de papa et de la boulangère pendant toute une année. Nous avions décidé avec Molly de demeurer indissolublement liées, jusqu’à la fin de nos existences.
Cette perte simultanée de deux êtres chers avait réalisé une amputation sentimentale immense et douloureuse. Nous analysions l’absence de ce corps aimé dans le vacarme de nos illusions perdues. Orphelines de nos sentiments, nous demeurions toutefois liées par nos fonctions désirantes. Molly ne s’éternisa pas sur la perte de ce phallus partagé avec les rondeurs enfarinées de la boulangère. Je restais l’unique objet de son amour et de sa convoitise. Notre dualité nous aida à faire le deuil d’une situation qui serait devenue tôt ou tard problématique. Cela n’avait rien d’extraordinaire en soi. Tracer sa vie sur des normes habituellement reconnues par la plus grande partie du genre humain, ne me paraissait constituer en rien un idéal. Je m’étonnais que la fusion permanente de deux êtres puisse encore demeurer une règle de vie, lue et approuvée. Le couple, plus ou moins rapidement, s’emmerde. Cet acte, quelque peu barbare et relativement assez antinaturel, n’avait jamais déclenché chez moi une quelconque liesse. Pas conne, la tante Berthe qui avait réussi à conserver sa liberté, en poursuivant ses frictions épidermiques, visant à éteindre sa libido, sans lier son avenir à un individu, même quelconque. C’était à peu près le seul comportement acquis, pour lequel je lui décernai une médaille, celle de Saint Ugozon, patron des fromagers, pour perpétuer, sans plus aucun désagrément domestique, la qualité de ses effluves.
Nous affichions, avec Molly, une complémentarité sentimentalo-érotique me paraissant être le summum de l’intelligence amoureuse. Je n’avais pas renoncé à me livrer à quelques extravagances hors de notre territoire mais ma paresse constitutionnelle, perçue comme une qualité nécessaire au bonheur, ne m’incitait pas à la dispersion. Nos deux corps réagissaient à la même stimulation érotique et la possibilité de me faire transpercer par un organe externe, à dimensions variables, me posait un nouveau problème qu’il ne me semblait pas utile de résoudre pour le moment.
Je décidai de suivre des cours par correspondance, après la démission de Molly de ses fonctions éducatives et de reprendre, auprès de madame Dutoit, le tripotage sophistiqué d’un clavier de piano.
Molly prit rapidement possession du fonds de commerce. Après quelques travaux, elle transforma le fournil et la salle de vente en boutique de prêt-à-porter.
–On va habiller les grosses, parce que, tu vois, le gras est le plus bel emballage du squelette.
Elle était généreuse, ma Molly, je la pris dans mes bras simplement pour essayer de faire le tour de son corps déjà relativement important. J’enviais ses rondeurs étalées comme de fluctuantes sculptures, harmonieusement réparties sur toute la surface de son être. Comment pouvait-on demeurer svelte. Le mot lui-même était détestable. Il devait être passablement allumé, le Julius Rabinat, ce poète, dont même la descendance directe a oublié le nom et qui, délaissant Paris, trouva son heure de gloire, en déclamant en 1793, à la sortie de la messe des Rameaux cet admirable morceau de littérature :
« Lorsque la tête des rois tombe
Emportant au fond de leur tombe
Leur détestable majesté
Demeure parmi les délices
La svelte flèche de Senlis
Grimpant jusqu’à l’éternité ».
Fallait le placer ce mot dans cette « mirlitonade ». Le brave Rabinat ne s’en remit jamais. Vous dire comment j’avais découvert cet auteur, demeure encore à ce jour un grand mystère. Avec Jean Bruce, tante Berthe s’était tracé un irrémédiable destin. Avec Senlis, je ne courais pas les mêmes dangers. La ville n’étant séparée de Beauvais que d’une cinquantaine de kilomètres.
Désirant seconder Molly dans l’approche psychologique des rondeurs, je me plongeai dans la lecture d’œuvres pouvant m’apporter une connaissance supplémentaire des comportements humains. J’ai survolé l’œuvre, oh combien vaste, du chantre de la vulgarisation psychanalytique : Pierre Daco. J’ai compris, tout de suite, qu’il n’était pas indispensable pour comprendre la nature humaine, d’absorber ces couillonnades alambiquées, allant des « Prodigieuses victoires de la psychologie moderne » en passant par « Les triomphes de la psychanalyse », constituant un étalage de somptueuses contorsions sodomisantes, susceptibles d’être comprises par un vertébré inférieur, à condition qu’il sache lire, pour paraître plus intelligent. Je refermais cette bible après avoir feuilleté « Comprendre les femmes et leur psychologie profonde » où cet analyste de grandes surfaces affirmait, péremptoirement, que la rénovation du monde dépendait de celle de la femme. Sans boursoufler démesurément ma cervelle, j’étais, depuis longtemps, persuadée de cette donnée basique. À part papa, j’avais depuis longtemps relégué le mâle dans une position secondaire et seule sa puissance musculaire lui permettait de se placer aux premiers rangs, si l’on désirait éviter les emmerdements. Je remplaçai ces prétentieuses données par la culture de mes propres affects. L’amour, plus que les mots, me paraissait être le seul véhicule indispensable à la compréhension de l’autre. Je n’avais d’ailleurs ni envie d’aimer, ni envie de comprendre le monde entier. Les sentiments ne s’abandonnent pas n’importe où. Mon cœur n’avait jamais pu se poser sur la piste rudimentaire de ma mère. Avait-elle seulement une piste ? J’en doute car, jamais, au grand jamais, en compagnie de tante Berthe, elles n’auraient pu rater à ce point l’atterrissage, dans ce qui fut leur dernière fugue vacancière.
Dessous chics, dessuschoc
Avec Molly nous avions bien travaillé. Elle s’était montrée plus apte à plonger ses mains dans le ciment que dans la farine. Nous avions transformé, avec l’aide de quelques artisans, la boulangerie en une élégante boutique de prêt-à-porter.
Nous avions ciblé notre clientèle sur la catégorie des grosses, ayant acquis, chacune de notre côté, par l’intermédiaire d’une alimentation orientée sur les graisses et les sucres, un volume assez remarquable. Je baignais, avec volupté, dans les rondeurs de ma compagne. De son côté, elle puisait un immense plaisir dans la contemplation de ma jeune beauté boudinée et débordante. Cette approximative hygiène alimentaire avait en tous cas le mérite de nous donner une vitalité et une belle et bonne humeur, capables de surmonter toutes les difficultés de la vie quotidienne. Je remplaçais auprès d’elle, pour presque tous ses désirs, avantageusement papa. Nous avions réussi, dans le quartier, par séduire à peu près tout le monde. Les affaires démarrèrent tranquillement et l’assassin de mon géniteur, débutant à peine ses vacances forcées derrière les barreaux, il nous restait de beaux jours devant nous. Nous avions le temps de penser à la conduite à adopter quand il aurait purgé sa peine, car il ne perdait rien pour attendre. Il se forgeait, pendant ces années de réclusion une santé sans cesse défaillante, sans aucune visite de notre part, malgré ses demandes réitérées. Nous avions décidé que ce lieu était pour lui une sorte de couvent, dans lequel il pouvait, tout à loisir sans les angoisses que lui procurait régulièrement l’arrivée des courses, se pencher sur son intériorité. Le vide qui occupait la plus grande partie de son esprit, lui laisserait assez de place pour emplir son cerveau de la construction d’un futur qu’il n’allait pas regretter. Cette perspective d’une riposte à distance des évènements, cette légitime défense différée, était pour nous deux la réduction la plus parfaite d’une loi universelle. Peu nous importait que les gouvernants aient, depuis longtemps, au nom de l’humanité, fait disparaître ce sommet de la rationalité, pour ne pas laisser dans les mains des victimes un quelconque pouvoir. La part de folie qui baignait ma cervelle me paraissait être la fonction la plus raisonnablement conservée de mon parcours. Pas kamikaze pour deux sous, je n’imaginais pas me faire exploser comme un ballon de foire pour me venger de l’atteinte physique et définitive dont avait été victime papa. Je n’avais rien contre moi-même et je ne voulais pas engager ma vie dans un combat me conduisant à une punition inacceptable.
Le mari de la boulangère avait quand même réalisé le crime passionnel parfait. Il aurait pu bénéficier des circonstances atténuantes du jury. Mais celui-ci, malencontreusement constitué d’une majorité de femmes n’eut que faire de ce turfiste. L’encouragement demeura pour la race chevaline dont il avait certainement, par ses pronostics hasardeux, augmenté considérablement les rations de foin. L’amour qu’il portait à la race équine le dépeça de tout sentiment pouvant se poser sur le genre humain. La passion se situait ailleurs que dans sa relation conjugale. Il n’y avait pas de raison pour chercher des excuses à cette activité violemment sacrificielle qui avait détruit le même jour les destinées d’un arpenteur d’hippodromes et d’une pétrisseuse de baguettes. Il en prit pour vingt ans, verdict relativement léger susceptible quand même de reconstituer, même mollement, ses finances dont l’éparpillement sur les champs de courses lui devenait interdit.
Ayant suffisamment appris de la vie les méandres et les soubresauts, au travers d’une absence d’éducation dans cet antre familial biscornu, j’étais parée pour faire face au quotidien, dont la complexité me paraissait absente, compte tenu des batailles menées dans mon enfance et mon adolescence. Je n’avais plus besoin, après Pierre Daco, de me plonger dans les œuvres complètes de Boris Cyrulnik, pour comprendre que très tôt j’avais découvert la résilience, sans m’approprier le concept. Je n’étais pas comme un quelconque monsieur Jourdain, faisant de la prose sans le savoir, attendant qu’un gourou me fasse comprendre, par un terme étymologiquement scientifique, que j’avais, avant tout le monde, inventé l’eau tiède. J’avais au hasard de la lecture de quelques-unes de ses citations, retenu celle disant « qu’il fallait passer sa vie à la tricoter ». J’avais compris qu’à côté de mon propre ouvrage, j’allais pouvoir, en découpant des patrons de mode, habiller la vie d’autres femmes, ne sachant pas compter les mailles. Dans le fond, je trouvais ces conseilleurs bien utiles pour nous resservir des recettes, déjà écrites depuis bien longtemps mais, remises au goût du jour pour le plus grand bienfait de l’édition française.
Pourvue du solide bagage psychologique, acquis jour après jour, dans les batailles livrées à maman et à tante Berthe, je me sentais capable d’entrer dans le rôle d’une psychothérapeute en habillement, et concevoir en compagnie de Molly, le premier centre de traitement pour le « relooking » de femmes pourvues de symptômes névrotiques, et susceptibles de recourir à une autre voie thérapeutique, ayant auparavant résisté à l’administration de diverses drogues. Molly trouva l’idée excellente. Elle ne mit pas un seul instant en doute les capacités dont je m’étais définitivement affublée. J’avais inventé une spécialité ne nécessitant pas plus que pour un psychanalyste, de diplôme particulier.
Je rigolais en m’asseyant en compagnie de Molly, devant un confortable cassoulet baignant dans les jus de la graisse d’un confit de canard. Nous commencions à imaginer l’angle d’attaque de notre présente et future clientèle. Je lui proposais de trouver l’en-tête de notre magasin. «XX ailes», pourquoi pas ? «Kilo Vénus», c’était rigolo ! On finit par opter pour «Entrez dans les rondes» dont le double sens, érotico-artistique, me plaisait particulièrement. Molly sourit, me caressant les cheveux, réactivant les émois de nos premières rencontres et opta également pour cette proposition.
Alors se poursuivit notre polyphagie compulsive et bienheureuse. Gastronomes de la grande bouffe, épicuriennes d’engloutissements orchestrés comme un opéra, nous apportions un soin obsessionnel à la qualité de nos fonctions masticatoires. Brossage méticuleux des dents plusieurs fois par jour et toujours après chaque repas. Nous avions souscrit une mutuelle complémentaire qui, par avance, pourvoirait à la possibilité de nous faire installer des implants, en cas de défection des molaires, dont on connait l’importance dans le broiement des aliments consistants. Nous en possédions une douzaine chacune et pour le moment nous étions parées. Je gardais de mon côté deux dents de sagesse, dont l’inutile présence ne m’avait pas encore importunée. Molly avait vu les siennes extirpées, sous anesthésie locale, quelques années auparavant sans que cela nuise à ses ingurgitations postopératoires.
Le repas prenait fin. La dégustation d’une crème brûlée et de deux éclairs au chocolat m’amena, grâce à l’élévation d’esprit qui suivait toujours nos agapes, à lui faire part de mes décisions.
–Je vais installer un cabinet de consultation à l’entrée même du magasin. Ce sera le passage obligé de chaque cliente ayant poussé la porte. Il faudra d’abord une mise en condition. Je dresserai, dans un entretien préalable, la structure de la personnalité, ses désirs, la liste de ses complexes, ses qualités et ses défauts.
De son côté, Molly déterminerait, à l’aide de ce profil psychologique, le traitement vestimentaire à appliquer.