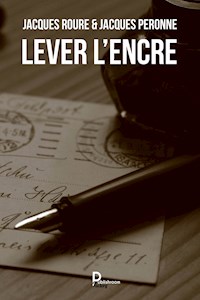
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Publishroom
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Französisch
Découvrez une correspondance poignante entre deux amis d'enfance qui observent le monde !
Assignés à douce résidence, ils ont repris la plume, pour échanger quotidiennement, dans le silence d’un monde subitement éteint, leurs sentiments, leurs émotions, colorée par leur regard sur le présent dans la lumière de leurs souvenirs.
Dans cette correspondance croisée, duo sucré-salé, ils nous font voyager dans une histoire drôle, émouvante, tendre et violente.
Une lecture réjouissante entre Aix-en-Provence et Méditerranée, pleine de surprises, où la pandémie sert de prétexte à une promenade, au jour le jour, sur les chemins suivis par leur existence.
L'architecte et le psychiatre vous offrent une part de leur amitié durant ce temps de confinement...
À PROPOS DES AUTEURS
Jacques Peronne, architecte des pierres et des mots, narrateur poétique du Luberon aux îles du Levant et
Jacques Roure, psychiatre, romancier et auteur de chansons se sont rencontrés à 12 ans sur les bancs du collège en 1950.
Leur amitié a traversé le siècle avec la tendresse et l’humour qui a toujours accompagné leur vagabondage.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 400
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Jacques Roure & Jacques Peronne
Lever l’encre
PREFACE.
Et si un beau jour de mars,le mot «pandémie» n’avait pas mis un terme à notre liberté d’action pendant 55 jours, nous obligeant à rester confinés ou à ne sortir qu’avec mille précautions?
Et si deux amis d’enfance que des raisons professionnelles avaient éloignés, n’avaient pas décidé, devant ces injonctions, de s’écrirequotidiennement, via leurs ordinateurs
Et si, chemin faisant, ils ne s’étaient pas pris aujeu…
Vous n’auriez pas entre les mains ce livre. Souvenirs d’enfance qu’ils ressuscitent l’un pour l’autre, réflexions sur la vie et la mort, questions d’actualité… mais pas que … comme on dit aujourd’hui.
Le mot»honnête homme» m’est venu à l’esprit, en cause leur grande culture.Ils maîtrisent l’art de la parole.Cependant leur objectif n’est pas de briller en société. Ils se rebellent contre les injustices, fustigent les gouvernants et rêvent encore d’une société plus juste, plus humaine.
Ces deux-là s’aiment comme des frères. Frères choisis. Hasard de la vie.
Leurs lettres baignent dans des évocations lumineuses. Souvenirs d’une enfance heureuse, remplie de farces. Omniprésence de l’émotion.
Que dire de leur façon d’écrire ? Rien d’ennuyeux ou de linéaire. Un mot de l’un ouvre la porte à la réflexion de l’autre qui enchaîne aussitôt sur une pensée nouvelle. Comme disait le poète Térence « rien de ce qui est humain ne (leur) est étranger».
La vieillesse c’est avoir tous les âges, en même temps que son âge, écrit l’un d’eux. C’est pour cela qu’il ressort de cet échange de lettres une formidable force de vie.
FanellyHutin (Lauréate du salon du livre de Fuveau)
Samedi 28 mars2020
Mon cher Jacques,
Comment, dans ces jours mornes qui nous éclairent, ne pas reprendre la plume, ce « scripteur » redoutable, seul capable de conserver nos souvenirs. Je m’évade, un instant, de cette pandémie accablante pour rechercher, avec toi, à la lumière de nos sensations, de nos émotions et de notre longue amitié, le chemin à emprunter.
Un peu lassé, au quinzième jour de cet enfermement, par les sirènes de la télé et les prédictions des augures de pacotille, profitant de leur splendide ignorance, pour se parer d’un « savoir ». Alors, je brode pour ne pas laisser ma tête, encore un peu pensante, être engloutie par ce flot de nuisances. Je fonce…
Dans la nuit des oublis se baladent les songes. Cette relative paix intérieure nous rend ignorants du reste du monde. On s’abreuve, inconscients, à la source de l’inexistence. Le temps, à l’extérieur, fait ce qu’il veut. On ne va quand même pas lui donner des ordres.
Ce matin, un peu de neige a recouvert, de-ci de-là, une végétation encore ensommeillée. Drôle de météo pour un mois de mars.
Et à la nuit succède le silence. Les routes sont désertes ; seul un vent léger agite les branches du tilleul dans le jardin. Les images des rues vides, apportées par un drone survolant la capitale, semblent s’épanouir dans ce couvre-feu imposé par l’univers. Déjà quinze jours passés dans cette inoccupation qui a vu naître la résistance.
J’avais connu au printemps de l’année 1943, au cours d’une enfance puisant dans cet immobilisme tant de contentement pour ma paresse, des joies quelque peu déplacées. On connaissait l’ennemi. Il avait déferlé sur une grande partie de l’Europe, avait rempli les hôpitaux militaires de blessés autour desquels s’affairaient les soignants, dévoués à réparer la folie des hommes. Les morts se décomposaient à ciel ouvert, dans un champ de labours, une forêt ou un étang. On escamotait les funérailles. On n’avait pas d’images, pas d’experts pour raisonner, jour après jour, sur les probabilités incertaines de l’évolution du conflit.
L’ennemi existait aussi dans les villes. Toute la fange des délateurs, des cupides, des éteints de l’âme, s’activait dans la souffrance humaine. On connaissait pourtant le remède. Il avait été inventé après les méandres des tranchées de 14-18. Pour ne pas recenser, une nouvelle fois, 20 millions de morts. Nous devions, sans plus attendre, traiter par la paix cette épidémie mortifère.
Mais la guerre est la guerre. Elle s’arrête le temps de fourbir de nouvelles armes, avant de se répandre dans une traînée de poudre. On l’attend, on l’imagine, on la prévoit, on en discute. L’homme devient le prédicateur de nos misères et l’organisateur autorisé des meurtres et du chaos.
Il n’était pas le seul en 1918, presque à la fin des hostilités, à venir compléter l’hécatombe guerrière. Il s’appelait « H1N1 », comme un agent secret dans un quelconque roman de Ian Flemming. Du Kansas, on ne l’avait pas vu venir. Il avait débarqué dans les bagages de la force expéditionnaire américaine, débarquée à Bordeaux cette année-là. Une grippe, injustement surnommée « espagnole », qui allait compléter le massacre des tranchées par 70 millions de morts supplémentaires.
C’est quoi, cent millions de cadavres ? De la chair à virus après la chair à canon, en face de l’inutile vanité de puissants.
Aujourd’hui, cent ans après, la nature décide de lâcher sur le monde un ennemi universel. A-t-elle trouvé une raison de déclarer sa guerre à l’humanité ? Peut-être blessée dans son amour propre par tant de dédain et d’agressions subies depuis trop d’années…
Dans ce mois de mars 2020, on ne compte plus ses sous, l’argent est devenu dérisoire, le « Covid-19 » partage équitablement les moyens de passer le Styx, enfant des ténèbres et de la nuit. Où va-t-il s’arrêter ? On est encore ce matin confronté à notre splendide incapacité, à l’histoire qui nous consume, une fois de plus, sur le bûcher des vanités.
J’attends la nuit pour qu’à nouveau mes songes baladent mes oublis. Pour retrouver, dans le sommeil, l’absence momentanée de mon existence. Pour imaginer que demain, nous allons devenir meilleurs.
Je t’embrasse.
J.R.
Dimanche 29 mars
Mon cher Jacques,
Bien reçu ! Les drames succèdent aux drames ! Sommes-nous les témoins aveuglés de l’Apocalypse ? Quand je te lis, je me le demande ! Nos grands-pères en 14-18, nos pères en 39-45, notre génération des années 50-60 dans une guerre sans nom, en Algérie, des décennies de paix précaire (bien que...) et aujourd’hui, la colère de Dieu sous la forme d’un virus qui dévore les populations ! Mais que vient-il faire Dieu, dans cette histoire ! N’est-il pas mort ?
Nous sommes nés, tous les deux, juste avant « la Dernière » dont on garde l’odeur. Je me souviens d’un dimanche après-midi où mes parents m’ont emmené au cinéma. Nous avons vu « L’Eternel retour » dont certaines séquences m’ont terrifié ! En rentrant à la maison, dans le 41, un gradé allemand était à côté de moi, se tenant au montant en inox du tramway de la rue Paradis. Peut-être rejoignait-il la villa de Saint-Giniez, antre de la Gestapo, où on torturait joyeusement ? J’ai en mémoire ses bottes lustrées et ses pantalons vert-de-gris parfaitement repassés. Il m’a caressé les cheveux. Son ticket de tram était glissé dans une chevalière.
Le 27 mai 1944, à Lourmarin, le ciel s’est obscurci sous le tapis des forteresses volantes américaines qui allaient bombarder Marseille. Dans les villages, on ouvrait les charniers de résistants.
Nous avons vu le jour lors de l’une des pires contaminations : le nazisme ! Ne l’appelle-t-on pas la « Peste brune » ?
Pour mettre un peu de couleur dans ces ténèbres, je te propose de danser ! Tu n’as pas vu « Danser sa peine », documentaire diffusé sur France 2, jeudi dernier, en seconde partie de soirée, assez tard pour être réservé aux insomniaques et aux passionnés.
Dans cette période inédite de retranchement, faite de sérénité domestique et molle, mêlée à une sourde anxiété, le choc est électro ! Moment de grâce, petite lumière dans la noirceur sanitaire du moment où les marchands de cercueils sont en rupture de stock. Une grande surface de bricolage proposerait une bière en pvc à monter en kit baptisée coronavire. On aurait dû se méfier : corona n’est-il pas le nom d’une bière ?
Ce film est comme une balise dans la nuit d’un lac décomposé. J’espère que tu le retrouveras en replay. Il montre Angelin Preljocaj créant une chorégraphie à la prison des Baumettes (deuxième monument célèbre à Marseille après Notre-Dame-de-la-Garde) avec cinq détenues volontaires, graciles ou enrobées, européennes ou non, jeunes ou moins jeunes. La condition était qu’elles soient « permissionnables ». Les seuls liens entre Annie, Litale, Malika, Sonia et Sylvia étaient l’inexpérience et l’espérance de s’évader de l’enfer carcéral l’espace de quelques mois, à raison de deux répétitions par semaine. Difficile de t’en parler avant que tu ne l’aiesvu.
Comme mon ami René Frégni qui dirige des ateliers d’écriture à la prison, Angelin fréquente régulièrement les Baumettes pour parler aux détenus de la danse, et danser. Il présenta au Directeur du Centre pénitenciaire le projet de monter un ballet avec des danseuses-pensionnaires, avec l’objectif de le produire à son Pavillon Noir d’Aix-en-Provence.
Miracle de la danse. Génie du chorégraphe. Amour, humanité. Sauvetage de cinq naufragées de la vie. À la première du spectacle, délire des spectateurs. Émotion sidérée des téléspectateurs que nous étions. Courte tournée de la troupe à Montpellier. Évasion. Vacances. Retour de la joie. Tout au long des images saisies dans la salle de sports de la prison, on voit les corps des femmes s’ébrouer, sortir douloureusement de leur chrysalide, s’élever, s’épanouir.
Douleur et ré-enchantement, résignation et renaissance. Rédemption.
Jusqu’à l’acmé devant le public. Être gratifiée ! Espérer à nouveau ! Chasser la honte ! Montrer sa souffrance ! L’offrir en partage ! Mais aussi sa force ! Reconnaître son corps ! Se le réapproprier. S’entendre enfin avec lui.
Fin du film. Étreintes entre le chorégraphe et les filles au seuil de la prison qu’on doit bien rejoindre. On rit, on pleure. À bientôt, la liberté !
C’est bien l’art qui sauvera l’humanité. Si le comptable ne tue pas le danseur !
Merci, Angelin, pour l’acte de résistance qui autorise, une fois encore, à croire en l’homme.
Voilà, j’en ai fini pour ce soir. L’heure a changé. Stupidité. Appelle-moi quand tu auras vu le film.
« Les songes baladent les oublis »
Je t’embrasse
J.P
Lundi 30 mars
Jacques,
Ah ! La danse ! Je partage, bien que n’ayant pas encore vu l’émission avec Preljocaj, le bonheur d’avoir vu sortir de terre, à Aix-en-Provence, le Pavillon Noir.
Depuis Béjart et « Messe pour un temps présent », en 1968, déjà, je n’avais plus eu de réelle passion pour la danse. Je contemple rétrospectivement, avec stupeur, l’exil à Bruxelles de cet immense chorégraphe, que la France, en temps de paix, a poussé hors des frontières, comme un émigré porteur de tous les maux. Il ne faut jamais être trop en avance, sauf pour prendre un train. Les orfèvres culturels de l’époque qui battaient le plomb, avaient laissé parler leur arrogance et leur jalousie pour ne pas le voir s’emparer de l’Opéra Garnier. Dans ces lieux, on préféra placer Roland Petit, accompagné de Zizi Jeanmaire et son « truc en plume ».
Il n’avait rien d’un métèque, ce fils de Gaston Berger, cet éveilleur d’idées, qui exerça au Ministère de l’Éducation Nationale, jusqu’en 1960, je crois.
En mai 1968, on se méfiait encore plus des révolutionnaires. Les décideurs rétrogrades étaient en place et cherchaient, avant tout, à ne pas s’enrhumer à l’ombre d’un séquoia.
Angelin nous a amené sa touche personnelle dans le choix de ses danseurs. Il dirige, nous aimons cela, toute une troupe totalement étrangère aux critères habituels des écoles de danse. Seule compte l’énergie, la grâce, l’émotion d’un pas de danse.
J’attends de voir cette expérience des Baumettes qui, tu le sais, viennent d’être démolies. Ce n’était pas la Bastille, c’était devenu un foutoir mourant où l’on avait l’audace d’enfermer encore des détenus. Bon, ils l’avaient un peu cherché. Mais quand on pense que notre pays possède encore, sous le regard critique de la coûteuse administration européenne, de tels taudis, on ne s’étonne pas aujourd’hui que nos hôpitaux aient payé, à leur tour, l’avarice de nos gouvernements successifs.
Ce soir, dans nos tanières, on se frotte aux statistiques de la journée. On est en train de se rendre compte que, pour continuer d’exister, la réalité n’a besoin que de « héros ordinaires » : des médecins, des infirmières, des aide-soignantes, des femmes de ménage, des éboueurs, des livreurs, des cuisiniers, des facteurs… Et j’en passe.
À quoi servent les fortunes accumulées grâce à la chiourme des galères, aux smicards des temps modernes, à l’absence d’empathie d’un monde devenu fou. Oui, car le monde est fou. Fou de pouvoir et de puissance, fou des passions les plus inutiles, fou de penser qu’en saignant l’autre, il va augmenter le nombre de ses globules rouges.
J’avais ce soir l’esprit à la bêtise. J’ai succombé devant « Papy fait de la résistance », ce cimetière burlesque de tant de comédiens qui nous ont donné du bonheur : Jacques Villeret, Jean Yanne, Jacqueline Maillan… Ils sont en train de se distraire avec les morts d’hier et ceux de demain.
Dieu n’existe plus pour avoir laissé un rassemblement d’évangélistes propager la maladie à la place de la bonne parole. Nous sommes des voyous et la nature est arrivée pour distribuer les punitions. Qui serons-nous quand on pourra arpenter un square, une forêt, un champ de blé sous un air devenu respirable ? J’apprends que, l’an dernier, la pollution de l’air a fait en France 48.000 morts, juste après l’alcool et le tabac. D’accord, on peut s’empêcher de picoler ou de fumer mais respirer… !
Aujourd’hui le ciel se dégage, l’atmosphère redevient transparente. Le « Covid-19 » a fait, en quelques semaines, ce que tous les illuminés du pays s’imaginaient faire en augmentant le prix du gazole à la pompe. Pauvres thaumaturges de foire, pauvres législateurs de cours de récréation, pauvres petits comptables qui voient dans le tri sélectif des ordures, l’alpha et l’oméga de la disparition du cloaque qu’est devenue la terre dans beaucoup trop d’endroits.
La nature nous oblige à la regarder dans les yeux. Elle a été jusque-là trop laxiste. Elle attendait son heure. La banquise fondait, on s’en foutait. La mer de glace, on y pensait, c’était un petit peu plus près de chez nous.
Et la chauve-souris attendait, gorgée de ces germes infectieux, que les chinois, les premiers, ont attrapé en bouffant du pangolin que le virus était venu habiter. Chez nous, on peut être végétarien, véganien, polyphage ou ascète, on s’en tient à des choses apparemment comestibles. L’asiatique bouffe de tout et crache encore plus. Il fallait que ça nous arrive de la plus grande puissance au monde. Elle n’a pas raté son coup, triomphe de la mondialisation, prêchée par les experts et les savants comme la panacée d’une marche en avant de l’humanité.
Demain, on verra. On va continuer de se téléphoner et de s’écrire. Ton regard sensible et poétique me traduira tes sentiments. On écoutera Manu Dibango qui vient de s’envoler, on suivra attentivement l’évolution de Christophe en espérant l’entendre rechanter, au plus vite, «Les mots bleus».
Je vais rejoindre ma petite chienne Ella, déjà endormie, pour voir, je l’espère le jour se lever.
Je t’embrasse
J.R.
30 mars2020
Qui se lève le plus tôt, Ella ou toi ? Je parie sur la première.
Ce matin, le soleil est voilé. Peu importe. Pas de projet de randonnées prévues, sauf dans nos imaginaires respectifs. En parlant de la force d’imaginer, cette réflexion d’un enfant à la sortie de la projection d’un film du Tintin d’Hergé :
« Le capitaine Haddock n’a pas la même voix que dans les livres ! »
Tu évoques Christophe. Dans la feuille de chou provençale déposée dans notre boîte aux lettres, je découvrais, ce matin, qu’il était hospitalisé pour insuffisance respiratoire. Il est un jeune de 74 ans. Je me souviens que tu le connais bien. Au-delà des Marionnettes, je suis sensible à ses textes crépusculaires chantés d’une voix au timbre d’outre-tombe. Il est venu jouer aux boules à Lourmarin. Beau visage sculpté dans le bois, expressif. Peu disert. Secret.
Pour meubler le vide, face à la perte de repères et à la fuite des jours, on prend des rendez-vous structurants. Dîner vers 20 h, film ou émission sélectionnés à 21 h. Si on avait imaginé tant de régularité ! Hier soir, le Tigre du Bengale de Fritz Lang. 1959. Près de 3 heures. Nous ne l’avons pas vu ensemble : c’est l’année de mon départ vers un service militaire de 28 mois ! Déroutant, le film. Décors majestueux en carton pâte, Indiens grimés à l’excès et mal doublés, éléphants fardés, jungle de parc public, naïveté de l’intrigue, mais splendeur épique, charge érotique, générosité du réalisateur (combien de millions de dollars ?), mais aussi spiritualité, prégnance de la mort incarnée par un cobra dans une séquence. Magnifique bande dessinée. Rêve assuré.
Tu me parlais de Maurice Béjart à côté duquel Roland Petit est un bellâtre prétentieux. Tu sais que notre fille Manon est danseuse. Avant qu’elle ne parte en Italie animer une école de danse, elle avait tenté d’intégrer des corps de ballet dans la région. Manon a un corps parfait. Longiligne, à la découpe musculaire athlétique, de taille modeste. De vraies qualités d’expression, et une énergie sans faille. Quand elle saute, on se demande si elle retombera sur les planches ! Il lui avait été dit qu’elle était trop petite, ou trop musclée. Il est vrai qu’elle était davantage passionnée par Le Sacre du printemps que par Le lac des cygnes, et sans doute mieux dans un jean que portant tutu.
Ah ! La Nature, que tu évoques ! Que tu invoques ! Celle à laquelle on paye un si lourd tribut à force de la maltraiter, ou pire, de l’ignorer. Celle qui faisait dire au bon La Fontaine dans sa lettre à Monsieur de Maucroix «et maintenant, il ne faut pas quitter la nature d’un pas». Tu te souviens des cours de français de du Bourguet, dit Crapaud, en classe de seconde?
Cette nature, éminemment complexe, à la diversité inouïe, généreuse mais colérique, rancunière, et que l’enfermement nous fait retrouver (paradoxe !). Ne serait-ce que du fait que son parcours, sa consommation, nous sont interdits. Nous les prédateurs insatiables, suicidaires collectifs !
Je n’ai plus de tondeuse. Non pas pour tondre le gazon mais pour couper les herbes folles dites mauvaises quand elles sont vraiment trop hautes. Donc, avant que le jardin ne ressemble à une brousse, car nous sommes encore civilisés, je travaille à la main. Au mieux avec une faucille, le plus souvent avec les mains seules. Trimballant un tapis de seuil sur lequel je m’agenouille pour le confort de mes genoux, je visite le jardin. Avec comme seuls témoins vivants les tourterelles, les mésanges bleues et les perruches envahissantes importées de Chine (sont-elles porteuses d’un nouveau virus, s’interrogent les paranos ?) et la petite foule des insectes, laquelle s’amenuise de jour enjour.
Pour décrire mon exploration, il m’arrive de consulter des livres de botanique ou d’entomologie. Non par pédantisme mais pour mémoriser. J’observe le lepture porte-cœur, un petit rampant nerveux à la cuirasse orange, le cherche-midi à la robe rouge et noire aux dessins géométriques, pas plus gros que l’ongle du petit doigt, je capte les senteurs (oignons sauvages, menthe, sauge médicinale, romarin, lavande, et tant d’autres), j’entends les notes graves du gros bourdon à la pelisse sombre violacée qui butine à cœur joie.
Et les fleurs qui m’enseignent les couleurs ! Étoiles d’or du pissenlit, perles roses de la mauve, merveille d’une inconnue : la brunelle commune, court épi rondelet de trois centimètres de haut, améthyste et bleu roi avec des bractées sombres, sur un cheveu de tige. Parmi une infinité de trésors sur lesquels on marche, à côté desquels on passe sans voir, sans sentir ni écouter. Pas le temps !
Retour inattendu de notre situation d’assiégés : les retrouvailles. Nous avions perdu la curiosité !
Je termine cette lettre. Pardonne le désordre. Passer de l’émerveillement à l’émotion.
C’est l’histoire d’un couple de nonagénaires racontée et filmée par les journalistes de France Info. Henri est gravement contaminé par corona. Il est hospitalisé dans le service de réanimation de l’hôpital Bichat. À deux heures du matin, on appelle Monique. On craint le pire pour son mari. Monique est testée positive. On va venir la chercher et l’emmener à Bichat. Elle est placée... dans la chambre d’Henri ! Tous deux s’en sortiront. Ensemble !
On les voit assis sur leur canapé, dans un appartement bien en ordre, aux meubles rustiques de brocante. Ils se tiennent par la main. Racontent leur aventure. Les yeux brillent. Parfois, les voix se brisent. Il insiste sur le dévouement extraordinaire du personnel soignant. Leur amour est vaillant. C’est très beau !
Confinés, nous ? Une pensée pour les détenus qui partagent à deux une chambre de9 m².
Avec ta guitare, tu nous chanteras «les mots bleus» de ton ami Christophe.
Je t’embrasse,
J.P.
30 mars
Ami des bêtes,
Détrompe-toi. Ella, ma petite chienne teckel, se fait tirer l’oreille pour mettre une patte sur le parquet. Elle partage avec moi, la paresse ordinaire que je cultive depuis toujours. Je contemple l’agitation du monde avec appréhension. Ce mouvement incessant de molécules provoque, à force d’entrechoquements des désastres.
Ce matin, dans le silence prolongé de la nuit, j’écoute pousser l’herbe, et les arbres murmurer. Même l’eau du robinet de la cuisine me parait arriver directement d’une source.
En parlant d’Hergé, tu me donnes envie de relire tous les «Tintin». Cet homme talentueux et inoffensif, soupçonné, après la Libération, d’avoir été fasciste, raciste et collabo. Bon, Tintin au Congo donnait une image bienveillante des colonisateurs. Maintenant, une kyrielle de repentis, émanant des instances dirigeantes, semble caresser dans le sens du poil une humanité qui se fout pas mal de tout ce qui n’est pas présent dans son champ de vision. Chez nous «Y a Bon Banania» est quand même demeurée jusqu’en 1970; une publicité raciste qui n’a pas vu son créateur étouffé sous les poussières de cacao.
Je pense, je ne sais pas pourquoi, à l’imagination visionnaire d’Hergé dans «On a marché sur la lune» qui nous a permis de brièvement coloniser cet astre et ramener de la poussière et quelques cailloux, dont l’importance, encore aujourd’hui, reste à démontrer. Et là, on entre en relation avec la connerie humaine, capable de prouesses techniques pour conquérir l’espace intersidéral et incapable d’assurer ne serait-ce qu’un peu de sérénité dans notre espace vital. On a déjà pourri la Terre et l’on voudrait aller chercher ailleurs un lieu pour y organiser notre foutoir.
Je crois me souvenir que nous avions d’autres rêves. Avant, ce n’était pas mieux, peut-être, mais c’était différent.
J’avais un vélomoteur que je pilotais, sans casque, pour prendre la route du Seuil, à l’ombre de deux bois de chênes pour traverser Rognes, saluer en passant le petit tambour d’Arcole à Cadenet et descendre vers Lourmarin.
J’adorais ce petit chemin traversant la campagne, me conduisant vers cette belle ferme fortifiée, La Taurine, ta maison de campagne. Tu lui avais sculpté son blason dans de la pierre de Rognes : un taureau placide et débonnaire.
On était là, hors du temps, déroulant nos humeurs au gré des saisons. Tantôt dans l’indolence colorée traversant l’or d’un champ de blé, laissant éclater comme des tâches d’incandescence, le rouge des coquelicots, tantôt sillonné par le soc des charrues, crevant la terre de lignes parallèles qui allaient se perdre dans les haies de cistes et d’arbousiers. La nature abritait dans son ventre les semences d’automne et servait le repas aux pies et aux corneilles. Vêtues de leur robe de deuil, elles arpentaient les labours avec l’œil aiguisé des chercheurs de trésor. On laissait la journée s’épanouir tranquille, dans le langage feutré de nos confidences.
C’était aussi le temps de nos amours débutantes où les passions à l’abri de notre décence, pouvaient choisir les mots porteurs de nos désirs. Je revois ton père et ta mère, détendus sur le banc de pierre en bordure de l’aire de galets, près des larges murs soutenant cette forteresse. On avait besoin de rien, seulement d’être ensemble, échangeant des projets pour un avenir qui était simplement demain.
Et dans les jours frileux, la grande cheminée du salon, avec sa table de ferme patinée par les mains d’un siècle oublié où nous partagions un peu de bonheur.
Ce soir, en écoutant les informations, je n’étais pas surpris d’apprendre que la Chine nous avait caché pas mal d’informations. L’épidémie aurait commencé en septembre, vite étouffée pour ne pas compromettre les prouesses productives de ce géant.
Je pensais à l’essai d’Alain Peyrefitte, il y a au moins une cinquante d’années, « Quand la Chine s’éveillera » dont le sous-titre était : le monde tremblera. Et l’on tremble de fièvre, d’une maladie nouvelle importée en même temps que des tonnes de fringues et des monceaux d’appareils Hi-Tech.
Quand on voit la rapidité avec laquelle s’est propagée cette «mondialisation» pour traverser la terre, la mer et les océans, et atteindre aussi l’Amérique, on se demande si les promoteurs de la menace atomique, en passant par le bouclier des étoiles, n’avaient pas pris la place du Docteur Folamour dans un film de Stanley Kubrick. Ils avaient oublié en chemin qu’un virus est encore plus dangereux que l’atome.
Pour une fois, l’hôtelier milliardaire qui dirige les USA n’avait pas mis ça au point, sous son ridicule tapis laqué de cheveux blonds abritant son cerveau monomaniaque. Hier, il demandait encore aux entreprises de continuer à produire. Les 500 décès de ce jour l’ont incité à mettre New York en quarantaine. Le maire ne l’avait pas attendu, il avait déjà confiné la population.
Les masques sont arrivés aujourd’hui, en France. Les «tutos» abondent sur internet pour fabriquer cette denrée rare. C’est le retour de la démerde, du système D, à l’heure où les autos n’auront bientôt plus besoin de chauffeur, on redonne à la confection à domicile un prix d’excellence.
Enfin se taisent les bouches des politiciens de tous bords, à part la Ségolène qui redouble d’efforts pour exposer son incompétence. On aurait dû la laisser se geler dans les glaces, mais cette ambassadrice des pôles Arctique et Antarctique avait pris soin de ne jamais y mettre les pieds. Roselyne Bachelot arborait ce soir un sourire satisfait. On a retrouvé, je ne sais où, 500 000 masques qui dormaient encore, à la suite de ses commandes jugées à l’époque pléthoriques.
À Orly, un pont aérien, voyait un cargo atterrir, avec quelques millions de masques. Ces bouts de papier sont repartis dans des camions, escortés par les motards, dans la crainte d’un braquage, jusqu’à l’arrivée des divers entrepôts.
On pleure encore beaucoup trop de vies perdues. On voit la bonne bouille de Patrick Devedjian qui était, de l’avis de tous, un homme rare. On en trouve encore pour éteindre, définitivement j’espère, l’image d’un Balkany ou d’un Cahuzac.
J’adore aussi Monique et Henri, ces rescapés du virus, dont l’amour et le bonheur inondaient le visage. Ils ont laissé, à Bichat, le souvenir de leur humanité et nous ont raconté, une fois encore, le dévouement exceptionnel des équipes de soin. Je pense comme toi, c’est magnifique.
Je vais sortir dans le jardin pour regarder le ciel de nuit. Je vais aussi penser à toi, qui fais partie des gens que j’aime.
Ella est déjà sous la couette. Elle va ouvrir un peu les yeux pour que je lui caresse le ventre.
Promis, je te chanterai «les mots bleus» bientôt.
Je t’embrasse
J.R.
30 Mars
Confirmation : mars est bien le mois des fous. Restons-le définitivement ! Demain, avril ! Dans mon jardin, ni amandiers neigeux, ni cerisiers couleur joues de jeune fille. Seul, un arbre de Judée, qui primitivement s’appelait de Judas, mais qu’un arboriculteur avisé a rebaptisé afin d’élargir sa clientèle vers les sorties de messe, commence à dévoiler son mauve-carminé. Discrètement, le blanc et le vieux rose des ailes de papillon froissées des fleurs de ciste, les clochettes bouton d’or d’un grand buisson d’une espèce indéterminée et les éclats céruléens des romarins accompagnent le treizième apôtre, lequel reste à réhabiliter.
Tu me parlais d’Hergé alias Georges Rémi. Dans notre correspondance, il est prévisible que nous ouvrirons souvent les albums de l’enfance. C’est là que nous puisons notre énergie de vieux «confinés à perpétuité». Les photos jaunies s’animent, virent au technicolor et nous emmènent sur le grand huit du bonheur.
Ainsi, un souvenir précis. En 1950 – j’avais 13 ans – mon père qui vivait un moment très difficile (tu connais), m’a envoyé chez une cousine qui passait les vacances de Noël dans son somptueux chalet de Megève. J’ai détesté ces vacances, ma virago de tante qui interdisait de tremper les tartines dans le café au lait ! Mes cousins de l’Ile Saint Louis à Paris, le ski, l’énorme arbre de Noël que nous avons dû décorer, la crèche en carton, le froid glacial des champs de neige, mes souliers en bois et bien d’autres choses plus blessantes, qu’une honte indélébile m’oblige à taire. À jamais, l’aversion des sports d’hiver ! Rentré enfin à la maison après une semaine d’épouvante, mes cadeaux m’attendaient. Après les effusions, je me retrouvai dans mon lit. Pour ne pas gêner mon petit frère qui dormait à côté, j’ai fait de mon drap-de-dessus une tente, allumé la belle lampe de poche qu’on m’avait offerte, et lu jusqu’à la dernière page «Le trésor de Rackam le Rouge», ma plus belle consolation. Te souviens-tu des odeurs ? Celle des livres neufs ?
Tes descriptions me rappellent Jean Giono. Mon mentor. J’ai écrit un poème à son intention. Il est à deux volets. Le premier est l’hiver, le second l’été. Pour ne pas surcharger cette lettre (que c’est bien de ne pas appeler cela «message»), je te livre le premier. Le deuxième sera pour une autre fois, si tu veux bien. Normalement, les tercets sont espacées et chaque phrase détachée. Il m’a été inspiré par la découverte d’un village abandonné du côté de Banon. Le voici :
Le rideau s’ouvre / froid à pierre fendre /les ruines racontent
Village pétrifié / fontaine muette / linceul de lichen
Façades crevées / fenêtres aveugles / lits de poussière
Assaut des ronces / errance des chemins / éboulement des pierres
Fuite des collines / charge des nuages/ forêt rouillée
Lune indifférente / désert bleu / plateaux oubliés
Villes empestées / hussards pavanant / brigades à cheval
Chien galeux / grand troupeau / loup menaçant
Gendarmes à la porte / soldat disparu / épouse effondrée
Sang noir / sueur glacée / larmes salées
Paysans obstinés / hommes perclus / femmes rompues
La neige ensevelit / la montagne crisse / la rivièregèle
Les bêtes sommeillent / les arbres font le mort / la source est bâillonnée
Je suis anxieux de connaître ton avis, toi le poète des chansons.
J’ai bien reçu la lettre de Coline ! Rien à ajouter ! Comment ne pas partager son réalisme !
J’interromps un moment pour rejoindre Monique qui m’appelle pour le dîner. Je ne peux faire attendre la compagne avec laquelle je danse un duo inédit après cinquante ans de précipitation.
Je reprends. Au menu : salade de Trévise, pâtes aux brocolis avec ail et filets d’anchois poêlés à l’huile d’olive, avec soja et crème de sésame. Cake au citron.
Dommage que tu sois aussi loin ; Monique fait des prouesses.
Pour revenir un instant à la crise actuelle et au beau texte de Coline Serreau, ne penses-tu pas que tout finira par un conflit opposant les partisans de la rupture et ceux de la continuité, même si ces derniers ne l’avouent pas directement ? Optimiste, je dirais que l’issue est incertaine.
Ella est-elle déjà couchée ? Nuit sans lune sur Marseille où d’habitude on entend la rumeur lointaine de l’autoroute.
Je t’embrasse
J.P.
31 mars
Oui, ma vieille branche, j’ai maintenant dans le nez l’odeur légère d’amande amère dégagée par les pages du bouquin de littérature, cette anthologie de Bordet, qui détaillait, d’une année à l’autre, le nom et les œuvres des romanciers et des poètes.
Te souviens-tu de ce concours de poésie, en classe seconde, animé par Blanc (dont j’ai oublié le prénom) où nous avons ferraillé pour arriver les premiers.
On nous avait demandé, en maniant l’alexandrin, de poétiser sur ce qu’il restait d’un champ de bataille après la dernière guerre. Nous avons eu de la chance de ne pas avoir à gloser sur l’accouchement de l’immaculée conception, nous qui pensions déjà que Jésus allait sortir par où il était entré. C’eût été l’excommunication assurée. Qui de nous deux est passé en tête ? Mais j’ai encore en mémoire le bel alexandrin du début de ton poème : «Oh ! Bel oiseau tombé, que t’est-il arrivé?» J’étais un peu jaloux, je ne te l’ai jamais avoué, de ce premier vers. En explication de texte, exercice le plus débile qui nous était parfois proposé sur, par exemple, une poésie : qu’est-ce que le poète a voulu dire par là ? J’aurais pu traduire par : «un zinc s’est fait péter la gueule par la DCA.» !
Alors, te dire que j’aime toujours cette façon que tu as d’organiser les mots pour créer des surprises qui musiquent à la lecture, avec cette force légère qui anime tes vers et depuis toujours ta prose.
Pour rester dans l’écriture, je retrouve dans mon ordinateur, cette bibliothèque organisatrice de mon apathie chronique, une chanson. Merveille de la mémoire informatique me signalant la date de ce texte : 9 août 2017. Une sorte de prémonition d’un marabout aux divinations aléatoires. Un petit clin d’œil à la dramaturgie de ce jour :
«Quand dînaient à l’aurore / Tous les dinosaures / On pouvait encore / Respirer de l’airpur»
Le refrain finissait par tenter d’apporter le remède :
Laissons l’air / Aux voies respiratoires / La mer aux nageoires / La Gaule aux menhirs / Retrouvons / L’air de nos ancêtres / Avant qu’à Bicêtre / Nous allionsfinir
La chanson peut être aussi de la poésie. Brassens a mis en musique Victor
Hugo ou Paul Fort, mais de nos jours où les auteurs se sont tus pour laisser la place à un peu n’importe quoi, je cherche quand même à sculpter quelque chose de pas trop bête pour paraître « actuel ».
Mon dinosaure m’a bien pris 20 minutes pour le ressusciter. Tu vois, la chanson n’est pas quelque chose de sérieux. Serge Gainsgourg considérait, au grand dam de Guy Béart, «la chanson comme un art mineur». Je le crois bien volontiers, car la poésie, mise en chansons, s’est arrêtée avec Jacques Prévert et les Feuilles Mortes demeurent peut-être le dernier poème que l’on prend pour une chanson.
Aujourd’hui encore, comme hier, le monde est une immense infirmerie. On n’a jamais pris autant conscience que la vie existe plus longtemps grâce à la médecine. Il y a trois mois on «caillassait» encore dans les banlieues indistinctement les voitures des médecins, des pompiers, des ambulances, des flics. Depuis que la peste a gagné même les cités, on applaudit à l’arrivée des secours. Le monde n’est pas que bête, il est lâche. Quand la lâcheté cède sa place à la peur, l’humanité renait par sa trouille.
C’était il y a deux ans à Paris, où 39 hôpitaux, dans l’état que nous connaissons maintenant, accueillaient 8 500 000 patients.
L’hôpital de mes études, en 1960, n’était pas celui-là. On ne parlait pas de coupes budgétaires, de remplissage des lits, d’équilibre économique. L’état n’affichait pas sa suffisance, décidant d’un pourcentage de malades à recevoir, en parlant du trou de la Sécurité sociale. Le fric, toujours le fric. On a déshabillé les structures, pour continuer à garnir l’administration du service de santé qui atteignait en 2016, 1 200 000 fonctionnaires.
Les convoque-t-on, aujourd’hui, pour prêter main-forte à des hôpitaux en surchauffe où les internes en médecine, les praticiens à la retraite et hier les vétérinaires apportent leur présence et leur dévouement ?
On transporte, par tous les moyens, des malades d’une ville à une autre, vers les pays frontaliers, comme l’Allemagne, avec 10 fois plus de lits de réanimation que la France. Et les TGV sont transformés en véhicules sanitaires. Pauvres, pauvres syndicats de la CGT à Sud-Rail, paralysant les transports pendant des semaines pour des revendications de boutiquiers, se foutant de la gueule du travailleur de base pour défendre des «privilèges» acquis, alors que tous les privilèges avaient déjà été abolis dans la nuit du 4 août 1789. Ils ont mis en évidence la morgue d’une caste, l’égoïsme d’une troupe et de leur chef, Philippe Martinez, qui derrière sa bouille stalinienne se met dans la poche, 3 500 euros tous les mois, sans la «pénibilité».
On est devenu un pays où les paroles sont vides de sens. Chacun construit sa tranquillité sur le corps blessé de l’autre. Dis-moi, Jacques, qu’est devenue la fraternité ? A-t-elle existé ne serait-ce qu’un jour? Elle réapparait un peu depuis deux mois, depuis que la liberté a disparu, alors que l’égalité n’ouvre jamais sa bouche.
J’ai entendu ce soir que nous allions entrer dans le dur. Le virus nous oblige à nous respecter. Un service quasi militaire donne ses ordres sans souci de la désobéissance. En dehors de Macron et de Véran, les ministres sont des autruches dont la tête est enfouie dans leur portefeuille. Un Michel Apathie continue d’enfiler les lieux communs, comme un bonimenteur de supermarché, et Michel Onfray vitupère encore et toujours contre l’absence de couture des bas nylon, l’assassinat des fauteuils de théâtre par les chewing-gums, collés sur le velours au cours d’un spectacle pour ado, et clame le désintérêt croissant des filles pour La Semaine de Suzette. Seul, Bernard-Henri Levy, qui n’a jamais grand-chose à dire, se tait.
Les ouragans, les tsunamis et les typhons deviennent des mots doux. Le rhume des foins évoque la volatilité champêtre des graminées. Le burn-out s’est enfui avec la mise à l’arrêt des mains et des cerveaux.
La pluie quotidienne de mauvaises nouvelles nous oblige à passer entre les gouttes. On en oublie même la présence de notre prostate. Le diable s’agite loin des exorcistes, et la grande surface demeure la seule cathédrale fréquentable.
Je suis heureux quand arrivent tes mots, quand le téléphone vibre et que ton nom apparait sur l’écran, quand le regard de ceux qui guérissent nous donne l’image du bonheur.
À demain, grand frère, la nuit égare nos détresses, fait grimper au sommet des tours l’espérance et demeure ce qui, par ces temps, nous fait exister.
Je t’embrasse
J.R.
1er avril2020
La nuit, les dinosaures dégainent leur stylo. Aujourd’hui, ils ont épinglé un poisson sur le dos des copains.
Pour enchaîner sur les chansons, et malgré ma dévotion pour le «Je t’aime moi non plus», je crois que je choisis «Bal chez Temporel...». Tu sais mieux que moi, toi le compositeur, que la chanson est un art majeur. Les hommes ont chanté avant de parler ! Écrire et mettre en musique pour embarquer les gens vers des destinations inconnues, l’espace de quelques minutes ! Les émouvoir, les réjouir ! Que de talent !
La poésie pousse n’importe où, n’importe comment. Quand on ne l’attend pas. Spontanément. Seule condition : la liberté. Savoir l’attraper avec son filet à papillons perso. Le tien est solide !
1er avril. Poisson-lune multicolore hérissé d’épines nommé Covid 21. À quand une «coronade» de fin de party sur le port de Carry-le Rouet où des foules se gavent d’oursins de Galice faute des échinodermes provençaux exterminés.
Pâques est en avril. Œufs en chocolat cachés dans les plates-bandes d’iris aux fleurs blanches et bleu-roi ourlées de jaune, dressées comme des sceptres, petits chercheurs tout juste éveillés, en pyjama et chemise de nuit. Les cloches sonnent à toute volée. C’est la résurrection. On va pouvoir rouler à tombeau ouvert.
Avril de cette année, cœur de l’invasion sans perspective d’armistice. La drôle de guerre. Les soldats mettront un rameau d’olivier béni à leur fusil, les gendarmes à leur képi, les infirmier(e)s à leur brancard, les malades à leur perfusion, les morts à leur cercueil, les écoliers à leur cartable, les papas à leur bagnole assoupie, les mamans à leur galère, les paquebots à leur cheminée, les autoroutes à leur péage, les routiers à leur GPS, les prostituées à leur soutien-gorge, les travestis à leur rasoir, les curés à leurémoi…
Le violoniste s’en est passé. Il joue. Il est suivi par les artistes de tous bords.
Ah ! Les vacances de Pâques ! Et hop ! Déferlement des souvenirs.
Dimanche pascal. L’air est tellement chargé de fragrances qu’on pourrait le mâcher à la sortie de la messe. Claude entre derrière moi. Avec elle, le printemps fait irruption dans la boutique. Botticelli, Vivaldi, ces ritals peuvent aller se rhabiller. Baisers sur les joues. Les siennes sont fraîches comme l’eau de l’Aigue-brun. Sur les miennes, le duvet de la puberté. Six baguettes, s’il vous plaît. Joyeuses Pâques, Claude ! Je n’ose pas me retourner.
Dans une de tes dernières lettres, tu évoques une journée à la Taurine. Elle est présente dans ma mémoire. La douceur était sa maîtresse. Une autre séquence me parvient, immortalisée par une photo collée sur mon album. Tu étais venu me chercher à Lourmarin avec nos amourettes respectives, Dany et Nicole au léger métissage craquant. Nous posons tranquillement dans la 4CV découvrable de ta mère que tu conduisais depuis peu. Le monde nous appartenait. Nos parents ne nous avaient pas appris qu’il serait… un ténébreux orage traversé çà et là par de brillants soleils. Plus crûment, un merdier plein de rêves dont, par bonheur, certains se sont réalisés et d’autres s’entêtent à nous transporter. Rêve ne serait-il pas le mot le plus comptabilisé dans notre correspondance ? Et tout ça, dans l’infinie beauté de la mère-nature.
Grâce à la pandémie, deux accessoires de cuisine réapparaissent sur les tables : le sablier et l’écumoire. Ou plutôt le tamis.
Le sablier pour regarder, mesurer le temps qui s’échappe, comme le sable orange qui s’écoule inexorablement dans le bombé du verre. Il est relatif, a dit un farfelu génial. Ah, oui ! Le temps, on n’y comprend plus rien. Où est passée ma boussole ?
Le Corbusier disait qu’il n’y avait pas d’architecture sans contraintes. N’y aurait-il pas de vie possible sans contraintes ? Merci. À nos crayons ! On traverse la période la plus contraignante depuis des lustres.
Hier. En bons petits soldats, nous cumulions les rendez-vous notés sur notre agenda Quo Vadis, dont le format rétrécit d’année en année en menaçant de disparaître complètement. Au fil du temps, les déplacements vers les médecins et auxiliaires de santé, les diverses démarches administratives, ont été les principales convocations. Heureusement entrecoupées de petites vacances (drôle de mot pour des retraités inactifs qui s’obstinent à se déplacer pendant les vacances scolaires), de trop rares spectacles et des dîners plus ou moins digestes entreamis.
Le temps ? Pas envie du tout de le tuer, ni de le combler, ni de le meubler. Alors, comment l’utiliser dans nos situations de détenus sanitaires, nous les privilégiés ? Comment gérer l’oisiveté forcée ? À ma connaissance, pas d’autres moyens que de se laisser porter par lui et tirer profit de ses largesses passagères.
Et pourquoi ne pas prier ? Je t’entends t’étouffer ! Une bonne prière bien profane, bien laïque, à un dieu bien à soi, fruit de notre seule invention. Le dieu de l’abeille et du romarin, des nuages et de la lune, de la mer et de l’oiseau. Une prière de contrition, en oubliant le mot péché écrit pour culpabiliser les pèlerins et les faire entrer dans le rang des décérébrés. Une prière de reconnaissance.
Exiger de soi un minimum de discipline pour ne pas clochardiser.
Donner le temps nécessaire aux tâches vitales. Ta compagne s’en est allée trop tôt, te laissant seul à bord. J’ai la chance de partager ma prison dorée avec celle de ma vie. Se lever quand même, faire sa toilette et celle de la maison, se vêtir proprement, se nourrir agréablement, faire le tour du jardin (nous avons cette rare possibilité). Et, comme tous les deux, sommes servis par un imaginaire débridé qui nous accorde la chance de nous exprimer silencieusement : travailler. L’écriture, le dessin, la peinture, la chanson ; lire, contempler, aimer, partager, pleurer, rire. Tout cela nous permet de rester debout. La vie, phénomène mystérieux, maladie mortelle et transmissible, faiseuse de merveilles, est prête à faire preuve de générosité si nous l’écoutons. Elle diffuse de mauvaises nouvelles, mais a en réserve de bonnes surprises.Amen.
Le tamis, c’est pour trier. La disparition momentanée de la vie sociale imposée par le confinement permet de se retourner. Restent les précieuses relations téléphoniques et l’internet. Les jours passant, des noms s’estompent, d’autres résistent à l’oubli. Ne sont sauvés sur la toile métallique que les bons grains. Laisser l’ivraie s’évacuer dans la bonde de l’évier. Qu’est l’ivraie ? Les ennuyeux, les coincés, les dogmatiques, les prétentieux, les mondains, les égoïstes, les convaincus, les méchants, les collabos, les profiteurs, les racistes, les machos, les négationnistes, les extrémistes, et tant d’autres qu’on a longtemps subis sans oser rompre. Les bons ? Les autres.
Hier, et c’est la raison de mon retard à te répondre, j’ai rangé mes livres et exhumé les propos de tonton Victor qui connaît Les Misérables ! Écoute-le parler de l’Europe, mon sujet favori.
« Nous aurons les États-Unis d’Europe. Nous aurons l’esprit de conquête transfiguré en esprit de découverte. Nous aurons la généreuse fraternité des nations au lieu de la fraternité féroce des empereurs (devenus les Présidents), la patrie sans la frontière, le budget sans le parasitisme, le commerce sans la douane, la circulation sans la barrière, l’éducation sans l’abrutissement, la jeunesse sans la caserne, le courage sans le combat, la justice sans l’échafaud, la parole sans le bâillon, la conscience sans le joug, la vérité sans le Dogme, Dieu sans le prêtre, le ciel sans l’enfer. Il y aura dans le monde un flot de lumière. Et qu’est-ce que c’est que toute cette lumière. C’est la liberté ».
Actes et paroles.1876
Un peu long mais ça valait le coup. Nous sommes dirigés par des nains gonflés d’orgueil. Nous sortirons un jour de cette mémorable crise. De constitution sanitaire. Il s’agira alors de choisir un nouveau mode de société. De constitution. Ou mourir.
Hugo au pouvoir !
Bientôt midi. Peut-être dors-tu encore ? Le soleil est prêt à se lever quand tu te couches.Non ?
Je t’embrasse sous forme de l’accolade chère aux Italiens, l’abbraccio.
J.P.
2 avril
En consultant « Madame Google » qui comble notre ignorance crasse et nous donne, après lecture de l’article, l’outrecuidance de nous parer en société des plumes du paon, je recherchais l’origine du «poisson d’avril».
Il y a une quantité surprenante d’explications, certaines remontent au début de l’ère chrétienne, ce qui me laisse à penser que les recherches sont extrêmement avancées dans le domaine de la farce. Je me contente d’un copier-coller, ce remarquable outil de ma paresse :
La locution «poisson d’avril» est attestée au XVe siècle : sa plus ancienne occurrence connue se trouve dans le Doctrinal du temps présent de Pierre Michault, daté de 1466 ; elle y désigne un «entremetteur, intermédiaire, jeune garçon chargé de porter les lettres d’amour de son maître».
Cet emploi est confirmé par le Livre de la Deablerie d’Eloy d’Amerval, daté de 1507-1508. Son emploi pour désigner une «tromperie, mystification traditionnelle du 1er avril» n’est attesté qu’au XVIIe siècle : sa plus ancienne occurrence connue se trouve dans La Vie de Charles V, duc de Lorraine, de Jean de Labrune, daté de 1691..
Cet emploi entre dans le Dictionnaire de l’Académie française en 1718 par l’intermédiaire de la locution «donner un poisson d’avril» qui signifie «obliger quelqu’un à faire quelque démarche inutile pour avoir lieu de se moquer delui».
Gardons avec nous Charles V, qui fait le lien avec ce que nous vivons aujourd’hui, puisqu’il fut « l’accompagnateur » en 1347 de la grande épidémie de peste noire. Je viens juste de l’apprendre, car mes connaissances historiques demeurent parcellaires et lacunaires.
Je pense à mon bon maître en écriture de chanson, le talentueux Claude Lemesle, capable de réciter, de mémoire, la liste de tous les personnages à la tête de notre pays, depuis ses origines jusqu’à Macron, en accompagnant cet «exploit» de leurs dates de naissance et de celle de leur disparition.
Sa culture de l’histoire et de la littérature, entre autres, est immense. J’ai eu le bonheur d’écrire avec lui «Le vieux» pour Serge Reggiani et entendre, un jour que je me rendais chez mon ophtalmo à Marignane, notre chanson diffusée sur France Inter.
Eh oui ! On épingle à son passé de dérisoires breloques. Aujourd’hui on n’aura pas même l’occasion de décorer l’ami de passage d’un «poisson d’avril».
Je m’en fous complètement. La seule chose que je regrette toujours, c’est d’avoir appris, à l’âge de 5 ans, l’inexistence de «Père Noël».
Colette s’est envolée trop tôt. Elle ajoute un grand vide à l’absence. Je la retrouve dans la maison jusque dans l’air qui passe, dans la résolution des mots croisés du Figaro Magazine, qu’elle attendait avec impatience pour se livrer à ce divertissement que nous partagions. Sa culture débordait la mienne. Sa passion pour la lecture me servait d’avis critique pour lire ou ne pas lire un ouvrage. Elle était la première à se plonger dans mes textes de chansons, avec des avis tranchés, sans complaisance, qui me faisaient gagner un temps fou pour remplir la corbeille à papier du bureau.
Elle était d’un caractère bien trempé, heureusement, elle a pu résister ainsi à mes fantaisies, mes incartades, mes transgressions. Elle était généreuse de paroles, de sourires et d’argent. Elle avait le cœur solide mais tendre. Un ordre qui tempérait quelque peu l’absence d’autorité que j’avais sur les objets, qui n’ont jamais obéi aux ordres que je ne leur donnaispas.
Je n’ai d’autorité sur rien ni personne, pas même sur moi. Trop de confiance m’ayant joué souvent de vilains tours. C’est pour ça que je t’aime toi, mon double, mon frère, mon ami. Quel bonheur de nous être retrouvés après des années d’éloignement, dû à nos activités professionnelles. Il a fallu la retraite pour qu’on revive ensemble l’atmosphère de Lourmarin jusqu’à la fin de tes activés d’architecte dans ce coin.





























