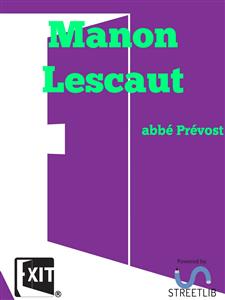Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Französisch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
"Histoire de Manon Lescaut et du chevalier des Grieux est un roman écrit par l'Abbé Prévost en 1731. Ce livre est considéré comme l'un des chefs-d'œuvre de la littérature française du XVIIIe siècle.L'histoire raconte la passion dévorante entre Manon Lescaut, une jeune fille séduisante et ambitieuse, et le chevalier des Grieux, un étudiant pauvre mais passionné. Leur amour est mis à rude épreuve par les obstacles sociaux et les choix moraux difficiles qu'ils doivent faire.Le roman est un mélange de genres, alliant la romance, le drame et l'aventure. Il est également connu pour son style élégant et sa narration captivante, qui ont inspiré de nombreux écrivains et artistes.Histoire de Manon Lescaut et du chevalier des Grieux est un livre qui a marqué son époque et qui continue d'inspirer les lecteurs d'aujourd'hui. Il est un témoignage de la complexité des relations humaines et de la force de l'amour, même dans les situations les plus difficiles.
Extrait : ""Elle me parut si charmante que moi, qui n'avais jamais pensé à la différence des sexes, ni regardé une fille avec un peu d'attention ; moi, dis-je, dont tout le monde admirait la sagesse et la retenue, je me trouvai enflammé tout d'un coup jusqu'au transport. J'avais le défaut d'être excessivement timide et facile à déconcerter ; mais loin d'être arrêté alors par cette faiblesse, je m'avançai vers la maîtresse de mon cœur."""
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 293
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EAN : 9782335005288
©Ligaran 2014
Je suis obligé de faire remonter mon lecteur au temps de ma vie où je rencontrai pour la première fois le chevalier des Grieux : ce fut environ six mois avant mon départ pour l’Espagne. Quoique je sortisse rarement de ma solitude, la complaisance que j’avais pour ma fille m’engageait quelquefois à divers petits voyages, que j’abrégeais autant qu’il m’était possible.
Je revenais un jour de Rouen où elle m’avait prié d’aller solliciter une affaire au parlement de Normandie, pour la succession de quelques terres auxquelles je lui avais laissé des prétentions du côté de mon grand-père maternel. Ayant repris mon chemin par Évreux où je couchai la première nuit, j’arrivai le lendemain pour dîner à Passy qui en est éloigné de cinq ou six lieues. Je fus surpris en entrant dans ce bourg, d’y voir tous les habitants en alarme ; ils se précipitaient de leurs maisons pour courir en foule à la porte d’une mauvaise hôtellerie devant laquelle étaient deux chariots couverts. Les chevaux, qui étaient encore attelés et qui paraissaient excédés de fatigue et de chaleur marquaient que ces deux voitures ne faisaient qu’arriver.
Je m’arrêtai un moment pour m’informer d’où venait le tumulte ; mais je tirai peu d’éclaircissement d’une populace curieuse qui ne faisait nulle attention à mes demandes, et qui s’avançait toujours vers l’hôtellerie en se poussant avec beaucoup de confusion. Enfin, un archer revêtu d’une bandoulière et le mousquet sur l’épaule ayant paru à la porte, je lui fis signe de la main de venir à moi. Je le priai de m’apprendre le sujet de ce désordre. Ce n’est rien, Monsieur, me dit-il : c’est une douzaine de filles de joie que je conduis avec mes compagnons jusqu’au Havre-de-Grâce, où nous les ferons embarquer pour l’Amérique. Il y en a quelques-unes de jolies, et c’est apparemment ce qui excite la curiosité de ces bons paysans.
J’aurais passé après cette explication si je n’eusse été arrêté par les exclamations d’une vieille femme qui sortait de l’hôtellerie en joignant les mains et criant que c’était une chose barbare, une chose qui faisait horreur et compassion. De quoi s’agit-il donc ? lui dis-je. Ah ! Monsieur, entrez, répondit-elle, et voyez si ce spectacle n’est pas capable de fendre le cœur ! La curiosité me fit descendre de mon cheval, que je laissai à mon palefrenier. J’entrai avec peine en perçant la foule, et je vis en effet quelque chose d’assez touchant.
Parmi les douze filles qui étaient enchaînées six à six par le milieu du corps, il y en avait une dont l’air et la figure étaient si peu conformes à sa condition, qu’en tout autre état je l’eusse prise pour une personne du premier rang. Sa tristesse, la saleté de son linge et de ses habits l’enlaidissaient si peu, que sa vue m’inspira du respect et de la pitié. Elle tâchait néanmoins de se tourner, autant que sa chaîne pouvait le permettre, pour dérober son visage aux yeux des spectateurs. L’effort qu’elle faisait pour se cacher était si naturel, qu’il paraissait venir d’un sentiment de modestie.
Comme les six gardes qui accompagnaient cette malheureuse bande étaient aussi dans la chambre, je pris le chef en particulier, et je lui demandai quelques lumières sur le sort de cette belle fille. Il ne put m’en donner que de fort générales. Nous l’avons tirée de l’hôpital, me dit-il, par ordre de M. le lieutenant-général de police. Il n’y a pas d’apparence qu’elle y eût été renfermée pour de bonnes actions. Je l’ai interrogée plusieurs fois sur la route ; elle s’obstine à ne me rien répondre. Mais, quoique je n’aie pas reçu ordre de la ménager plus que les autres, je ne laisse pas d’avoir quelques égards pour elle, parce qu’il me semble qu’elle vaut un peu mieux que ses compagnes. Voilà un jeune homme, ajouta l’archer, qui pourrait vous instruire mieux que moi sur la cause de sa disgrâce : il l’a suivie depuis Paris, sans cesser presque un moment de pleurer. Il faut que ce soit son frère ou son amant.
Je me tournai vers le coin de la chambre où ce jeune homme était assis. Il paraissait enseveli dans une rêverie profonde. Je n’ai jamais vu de plus vive image de la douleur. Il était mis fort simplement ; mais on distingue au premier coup d’œil un homme qui a de la naissance et de l’éducation. Je m’approchai de lui ; il se leva, et je découvris dans ses yeux, dans sa figure et dans tous ses mouvements, un air si fin et si noble, que je me sentis porté naturellement à lui vouloir du bien. Que je ne vous trouble point, lui dis-je en m’asseyant près de lui. Voulez-vous bien satisfaire la curiosité que j’ai de connaître cette belle personne, qui ne me paraît point faite pour le triste état où je la vois ?
Il me répondit honnêtement qu’il ne pouvait m’apprendre qui elle était sans se faire connaître lui-même, et qu’il avait de fortes raisons pour souhaiter de demeurer inconnu. Je puis vous dire néanmoins, ce que ces misérables n’ignorent point, continua-t-il en montrant les archers : c’est que je l’aime avec une passion si violente qu’elle me rend le plus infortuné de tous les hommes. J’ai tout employé à Paris pour obtenir sa liberté. Les sollicitations, l’adresse et la force m’ont été inutiles : j’ai pris le parti de la suivre, dût-elle aller au bout du monde. Je m’embarquerai avec elle ; je passerai en Amérique.
Mais, ce qui est de la dernière inhumanité, ces lâches coquins ajouta-t-il en parlant des archers, ne veulent pas me permettre d’approcher d’elle. Mon dessein était de les attaquer ouvertement à quelques lieues de Paris. Je m’étais associé quatre hommes qui m’avaient promis leur secours pour une somme considérable. Les traîtres m’ont laissé seul aux mains et sont partis avec mon argent. L’impossibilité de réussir par la force m’a fait mettre les armes bas. J’ai proposé aux archers de me permettre du moins de les suivre, en leur offrant de les récompenser. Le désir du gain les y a fait consentir. Ils ont voulu être payés chaque fois qu’ils m’ont accordé la liberté de parler à ma maîtresse. Ma bourse s’est épuisée en peu de temps : et maintenant que je suis sans un sou, ils ont la barbarie de me repousser brutalement lorsque je fais un pas vers elle. Il n’y a qu’un instant qu’ayant osé m’en approcher malgré leurs menaces, ils ont eu l’insolence de lever contre moi le bout du fusil. Je suis obligé, pour satisfaire leur avarice et pour me mettre en état de continuer la route à pied, de vendre ici un mauvais cheval qui m’a servi jusqu’à présent de monture.
Quoiqu’il parût faire assez tranquillement ce récit, il laissa tomber quelques larmes en le finissant. Cette aventure me parut des plus extraordinaires et des plus touchantes. Je ne vous presse pas, lui dis-je, de me découvrir le secret de vos affaires ; mais si je puis vous être utile à quelque chose, je m’offre volontiers à vous rendre service. Hélas ! reprit-il, je ne vois pas le moindre jour à l’espérance. Il faut que je me soumette à toute la rigueur de mon sort. J’irai en Amérique ; j’y serai du moins libre avec ce que j’aime. J’ai écrit à un de mes amis, qui me fera tenir quelques secours au Havre-de-Grâce. Je ne suis embarrassé que pour m’y conduire et pour procurer à cette pauvre créature ajouta-t-il en regardant tristement sa maîtresse, quelque soulagement sur la route. Eh bien, lui dis-je je vais finir votre embarras. Voici quelque argent que je vous prie d’accepter. Je suis fâché de ne pouvoir vous servir autrement.
Je lui donnai quatre louis d’or, sans que les gardes s’en aperçussent : car je jugeais bien que s’ils lui savaient cette somme ils lui vendraient plus chèrement leurs secours. Il me vint même à l’esprit de faire marché avec eux, pour obtenir au jeune amant la liberté de parler continuellement à sa maîtresse jusqu’au Havre. Je lis signe au chef de s’approcher, et je lui en fis la proposition. Il en parut honteux, malgré son effronterie. Ce n’est pas, Monsieur, répondit-il d’un air embarrassé, que nous refusions de le laisser parler à cette fille ; mais il voudrait être sans cesse auprès d’elle ; cela nous incommode : il est bien juste qu’il paie pour l’incommodité. Voyons donc, lui dis-je, ce qu’il faudrait pour vous empêcher de la sentir. Il eut l’audace de me demander deux louis. Je les lui donnai sur-le-champ. Mais prenez garde, lui dis-je, qu’il ne vous échappe quelque friponnerie : car je vais laisser mon adresse à ce jeune homme afin qu’il puisse m’en informer et comptez que j’aurai le pouvoir de vous faire punir. Il m’en coûta six louis d’or.
La bonne grâce et la vive reconnaissance avec laquelle ce jeune homme me remercia achevèrent de me persuader qu’il était né quelque chose et qu’il méritait ma libéralité. Je dis quelques mots à sa maîtresse avant que de sortir. Elle me répondit avec une modestie si douce et si charmante, que je ne pus m’empêcher de faire, en sortant, mille réflexions sur le caractère incompréhensible des femmes.
Étant retourné dans ma solitude, je ne fus point informé de la suite de cette aventure. Il se passa près de deux ans, qui me la firent oublier tout à fait, jusqu’à ce que le hasard me fit renaître l’occasion d’en apprendre à fond toutes les circonstances.
J’arrivais de Londres à Calais avec le marquis de…, mon élève. Nous logeâmes, si je m’en souviens bien, au Lion-d’Or, où quelques raisons nous obligèrent de passer le jour entier et la nuit suivante. En marchant l’après-midi dans les rues, je crus apercevoir ce même jeune homme dont j’avais fait la rencontre à Passy. Il était en fort mauvais équipage, et beaucoup plus pâle que je ne l’avais vu la première fois. Il portait sur les bras un vieux porte-manteau, ne faisant qu’arriver dans la ville.
Cependant, comme il avait la physionomie trop belle pour n’être pas reconnu facilement, je le remis aussitôt. Il faut, dis-je au marquis, que nous abordions ce jeune homme.
Sa joie fut plus vive que toute expression lorsqu’il m’eut remis à son tour. Ah ! Monsieur, s’écria-t-il en me baisant la main, je puis donc encore une fois vous marquer mon immortelle reconnaissance ! Je lui demandai d’où il venait. Il me répondit qu’il arrivait par mer du Havre-de-Grâce, où il était revenu de l’Amérique peu auparavant. Vous ne me paraissez pas fort bien en argent, lui dis-je : allez-vous-en au Lion-d’Or, où je suis logé, je vous rejoindrai dans un moment.
J’y retournai en effet, plein d’impatience d’apprendre le détail de son infortune et les circonstances de son voyage d’Amérique. Je lui fis mille caresses, et j’ordonnai qu’on ne le laissât manquer de rien. Il n’attendit point que je le pressasse de me raconter l’histoire de sa vie. Monsieur, me dit-il, vous en usez si noblement avec moi, que je me reprocherais comme une basse ingratitude d’avoir quelque chose de réservé pour vous. Je veux vous apprendre, non seulement mes malheurs et mes peines, mais encore mes désordres et mes plus honteuses faiblesses. Je suis sûr qu’en me condamnant vous ne pourrez pas vous empêcher de me plaindre.
Je dois avertir ici le lecteur que j’écrivis son histoire presque aussitôt après l’avoir entendue, et qu’on peut s’assurer par conséquent que rien n’est plus exact et plus fidèle que cette narration. Je dis fidèle jusque dans la relation des réflexions et des sentiments que le jeune aventurier exprimait de la meilleure grâce du monde. Voici donc son récit, auquel je ne mêlerai jusqu’à la fin rien qui ne soit de lui.
J’avais dix-sept ans, et j’achevais mes études de philosophie à Amiens, où mes parents, qui sont d’une des meilleures maisons de P…, m’avaient envoyé. Je menais une vie si sage et si réglée, que mes maîtres me proposaient pour l’exemple du collège. Non que je fisse des efforts extraordinaires pour mériter cet éloge ; mais j’ai l’humeur naturellement douce et tranquille : je m’appliquais à l’étude par inclination, et l’on me comptait pour des vertus quelques marques d’aversion naturelle pour le vice. Ma naissance, le succès de mes études et quelques agréments extérieurs m’avaient fait connaître et estimer de tous les honnêtes gens de la ville.
J’achevai mes exercices publics avec une approbation si générale que monsieur l’évêque, qui y assistait, me proposa d’entrer dans l’état ecclésiastique, où je ne manquerais pas, disait-il, de m’attirer plus de distinction que dans l’ordre de Malte auquel mes parents me destinaient. Ils me faisaient déjà porter la croix, avec le nom de chevalier des Grieux. Les vacances arrivant, je me préparais à retourner chez mon père, qui m’avait promis de m’envoyer bientôt à l’Académie.
Mon seul regret en quittant Amiens était d’y laisser un ami avec lequel j’avais toujours été tendrement uni. Il était de quelques années plus âgé que moi. Nous avions été élevés ensemble ; mais le bien de sa maison étant des plus médiocres, il était obligé de prendre l’état ecclésiastique et de demeurer à Amiens après moi, pour y faire les études qui conviennent à cette profession. Il avait mille bonnes qualités. Vous le connaîtrez par les meilleures, dans la suite de mon histoire, et surtout par un zèle et une générosité en amitié qui surpassent les plus célèbres exemples de l’antiquité. Si j’eusse alors suivi ses conseils, j’aurais toujours été sage et heureux. Si j’avais du moins profité de ses reproches, dans le précipice où mes passions m’ont entraîné, j’aurais sauvé quelque chose du naufrage de ma fortune et de ma réputation. Mais il n’a point recueilli d’autre fruit de ses soins que le chagrin de les voir inutiles, et quelquefois durement récompensés par un ingrat qui s’en offensait et qui les traitait d’importunités.
J’avais marqué le temps de mon départ d’Amiens. Hélas ! que ne le marquais-je un jour plus tôt ! j’aurais porté chez mon père toute mon innocence. La veille même de celui où je devais quitter cette ville, étant à me promener avec mon ami, qui s’appelait Tiberge, nous vîmes arriver le coche d’Arras, et nous le suivîmes jusqu’à l’hôtellerie où ces voitures descendent. Nous n’avions pas d’autre motif que la curiosité. Il en sortit quelques femmes, qui se retirèrent aussitôt. Mais il en resta une fort jeune, qui s’arrêta seule dans la cour, pendant qu’un homme d’un âge avancé, qui paraissait lui servir de conducteur, s’empressait pour faire tirer son équipage des paniers. Elle me parut si charmante, que moi, qui jamais n’avais pensé à la différence des sexes, ni regardé une fille avec un peu d’attention : moi, dis-je, dont tout le monde admirait la sagesse et la retenue, je me trouvai enflammé tout d’un coup jusqu’au transport. J’avais le défaut d’être excessivement timide et facile à déconcerter ; mais loin d’être arrêté alors par cette faiblesse, je m’avançai vers la maîtresse de mon cœur.
Quoiqu’elle fût encore moins âgée que moi, elle reçut mes politesses sans paraître embarrassée. Je lui demandai ce qui l’amenait à Amiens, et si elle y avait quelques personnes de connaissance. Elle me répondit ingénument qu’elle y était envoyée par ses parents pour être religieuse. L’amour me rendait déjà si éclairé depuis un moment qu’il était dans mon cœur, que je regardai ce dessein comme un coup mortel pour mes désirs. Je lui parlai d’une manière qui lui fit comprendre mes sentiments ; car elle était bien plus expérimentée que moi : c’était malgré elle qu’on l’envoyait au couvent, pour arrêter sans doute son penchant au plaisir qui s’était déjà déclaré, et qui a causé dans la suite tous ses malheurs et les miens. Je combattis la cruelle intention de ses parents par toutes les raisons que mon amour naissant et mon scolastique purent me suggérer. Elle n’affecta ni rigueur ni dédain. Elle me dit, après un moment de silence, qu’elle ne prévoyait que trop qu’elle allait être malheureuse ; mais que c’était apparemment la volonté du ciel, puisqu’il ne lui laissait nul moyen de l’éviter. La douceur de ses regards, un air charmant de tristesse en prononçant ces paroles, ou plutôt l’ascendant de ma destinée qui m’entraînait à ma perte, ne me permirent pas de balancer un moment sur ma réponse. Je l’assurai que si elle voulait faire quelque fond sur mon honneur et sur la tendresse infinie qu’elle m’inspirait déjà, j’emploierais ma vie pour la délivrer de la tyrannie de ses parents et pour la rendre heureuse. Je me suis étonné mille fois, en y réfléchissant, d’où me venait alors tant de hardiesse et de facilité à m’exprimer ; mais on ne ferait pas une divinité de l’amour, s’il n’opérait souvent des prodiges. J’ajoutai mille choses pressantes.
Ma belle inconnue savait bien qu’on n’est point trompeur à mon âge : elle me confessa que si je voyais quelque jour à la pouvoir mettre en liberté elle croirait m’être redevable de quelque chose de plus cher que la vie. Je lui répétai que j’étais prêt à tout entreprendre ; mais n’ayant point assez d’expérience pour imaginer tout d’un coup les moyens de la servir, je m’en tenais à cette assurance générale, qui ne pouvait être d’un grand secours pour elle et pour moi. Son vieil argus étant venu nous rejoindre, mes espérances allaient échouer, si elle n’eût eu assez d’esprit pour suppléer à la stérilité du mien. Je fus surpris, à l’arrivée de son conducteur, qu’elle m’appelât son cousin, et que, sans paraître déconcertée le moins du monde, elle me dit que, puisqu’elle était assez heureuse pour me rencontrer à Amiens, elle remettait au lendemain son entrée dans le couvent, afin de se procurer le plaisir de souper avec moi. J’entrai fort bien dans le sens de cette ruse : je lui proposai de se loger dans une hôtellerie dont le maître, qui s’était établi à Amiens après avoir été longtemps cocher de mon père, était dévoué entièrement à mes ordres.
Je l’y conduisis moi-même, tandis que le vieux conducteur paraissait un peu murmurer, et que mon ami Tiberge, qui ne comprenait rien à cette scène, me suivait sans prononcer une parole. Il n’avait point entendu notre entretien. Il était demeuré à se promener dans la cour pendant que je parlais d’amour à ma belle maîtresse. Comme je redoutais sa sagesse, je me défis de lui par une commission dont je le priai de se charger. Ainsi j’eus le plaisir, en arrivant à l’auberge, d’entretenir seul la souveraine de mon cœur.
Je reconnus bientôt que j’étais moins enfant que je ne le croyais. Mon cœur s’ouvrit à mille sentiments de plaisir dont je n’avais jamais eu d’idée. Une douce chaleur se répandit dans toutes mes veines. J’étais dans une espèce de transport qui m’ôta pour quelque temps la liberté de la voix, et qui ne s’exprimait que par mes yeux.
Mademoiselle Manon Lescaut, c’est ainsi qu’elle me dit qu’on la nommait, parut fort satisfaite de cet effet de ses charmes. Je crus apercevoir qu’elle n’était pas moins émue que moi. Elle me confessa qu’elle me trouvait aimable et qu’elle serait ravie de m’avoir obligation de sa liberté. Elle voulut savoir qui j’étais, et cette connaissance augmenta son affection, parce qu’étant d’une naissance commune, elle se trouva flattée d’avoir fait la conquête d’un amant tel que moi. Nous nous entretînmes des moyens d’être l’un à l’autre.
Après quantité de réflexions, nous ne trouvâmes point d’autre voie que celle de la fuite. Il fallait tromper la vigilance du conducteur, qui était un homme à ménager, quoiqu’il ne fût qu’un domestique. Nous réglâmes que je ferais préparer pendant la nuit une chaise de poste, et que je reviendrais de grand matin à avant qu’il fût éveillé ; que nous nous déroberions secrètement, et que nous irions droit à Paris, où nous nous ferions marier en arrivant. J’avais environ cinquante écus, qui étaient le fruit de mes petites épargnes : elle en avait à peu près le double. Nous nous imaginâmes, comme des enfants sans expérience, que cette somme ne finirait jamais, et nous ne comptâmes pas moins sur le succès de nos autres mesures.
Après avoir soupé avec plus de satisfaction que je n’en avais jamais ressenti, je me retirai pour exécuter notre projet. Mes arrangements furent d’autant plus faciles, qu’ayant eu dessein de retourner le lendemain chez mon père, mon petit équipage était déjà préparé. Je n’eus donc nulle peine à faire transporter ma malle et à faire tenir une chaise prête pour cinq heures du matin, qui était le temps où les portes de la ville devaient être ouvertes ; mais je trouvai un obstacle dont je ne me défiais point et qui faillit rompre entièrement mon dessein.
Tiberge, quoique âgé seulement de trois ans plus que moi, était un garçon d’un sens mûr et d’une conduite fort réglée. Il m’aimait avec une tendresse extraordinaire. La vue d’une aussi jolie fille que mademoiselle Manon, mon empressement à la conduire, et le soin que j’avais eu de me défaire de lui en l’éloignant, lui firent naître quelques soupçons de mon amour. Il n’avait osé revenir à l’auberge où il m’avait laissé, de peur de m’offenser par son retour ; mais il était allé m’attendre en mon logis, où je le trouvai en arrivant, quoiqu’il fût dix heures du soir. Sa présence me chagrina. Il s’aperçut facilement de la contrainte qu’elle me causait. Je suis sûr, me dit-il sans déguisement, que vous méditez quelque dessein que vous me voulez cacher ; je le vois à votre air. Je lui répondis assez brusquement que je n’étais pas obligé de lui rendre compte de tous mes desseins. Non, reprit-il ; mais vous m’avez toujours traité en ami, et cette qualité suppose un peu de confiance et d’ouverture. Il me pressa si fort et si longtemps de lui découvrir mon secret, que, n’ayant jamais eu de réserve avec lui, je lui fis l’entière confidence de ma passion. Il la reçut avec une apparence de mécontentement qui me fit frémir. Je me repentis surtout de l’indiscrétion avec laquelle je lui avais découvert le dessein de ma fuite. Il me dit qu’il était trop parfaitement mon ami pour ne pas s’y opposer de tout son pouvoir ; qu’il voulait me représenter d’abord tout ce qu’il croyait capable de m’en détourner : mais que si je ne renonçais pas ensuite à cette misérable résolution, il avertirait des personnes qui pourraient l’arrêter à coup sûr. Il me tint là-dessus un discours sérieux qui dura plus d’un quart d’heure, et qui finit encore par la menace de me dénoncer, si je ne lui donnais ma parole de me conduire avec plus de sagesse et de raison.
J’étais au désespoir de m’être trahi si mal à propos. Cependant, l’amour m’ayant ouvert extrêmement l’esprit depuis deux ou trois heures, je fis attention que je ne lui avais pas découvert que mon dessein devait s’exécuter le lendemain, et je résolus de le tromper à la faveur d’une équivoque. Tiberge, lui dis-je j’ai cru jusqu’à présent que vous étiez mon ami, et j’ai voulu vous éprouver par cette confidence. Il est vrai que j’aime, je ne vous ai pas trompé ; mais, pour ce qui regarde ma fuite, ce n’est point une entreprise à former au hasard. Venez me prendre demain à neuf heures ; je vous ferai voir, s’il se peut, ma maîtresse, et vous jugerez si elle mérite que je fasse cette démarche pour elle. Il me laissa seul, après mille protestations d’amitié.
J’employai la nuit à mettre ordre à mes affaires et m’étant rendu à l’hôtellerie de mademoiselle Manon vers la pointe du jour, je la trouvai qui m’attendait. Elle était à sa fenêtre qui donnait sur la rue : de sorte que, m’ayant aperçu, elle vint m’ouvrir elle-même. Nous sortîmes sans bruit. Elle n’avait point d’autre équipage que son linge, dont je me chargeai moi-même. La chaise était en état de partir : nous nous éloignâmes aussitôt de la ville.
Je rapporterai dans la suite quelle fut la conduite de Tiberge lorsqu’il s’aperçut que je l’avais trompé. Son zèle n’en devint pas moins ardent. Vous verrez à quel excès il le porta, et combien je devrais verser de larmes en songeant quelle en a toujours été la récompense.
Nous nous hâtâmes tellement d’avancer, que nous arrivâmes à Saint-Denis avant la nuit. J’avais couru à cheval à côté de la chaise, ce qui ne nous avait guère permis de nous entretenir qu’en changeant de chevaux ; mais lorsque nous nous vîmes si proche de Paris, c’est-à-dire presque en sûreté, nous prîmes le temps de nous rafraîchir, n’ayant rien mangé depuis notre départ d’Amiens. Quelque passionné que je fusse pour Manon, elle sut me persuader qu’elle ne l’était pas moins pour moi. Nous étions si peu réservés dans nos caresses, que nous n’avions pas la patience d’attendre que nous fussions seuls. Nos postillons et nos hôtes nous regardaient avec admiration, et je remarquais qu’ils étaient surpris de voir deux enfants de notre âge qui paraissaient s’aimer jusqu’à la fureur.
Nos projets de mariage furent oubliés à Saint-Denis ; nous fraudâmes les droits de l’Église, et nous nous trouvâmes époux sans y avoir fait réflexion. Il est sûr que du naturel tendre et constant dont je suis, j’étais heureux pour toute ma vie, si Manon m’eût été fidèle. Plus je la connaissais, plus je découvrais en elle de nouvelles qualités aimables. Son esprit, son cœur, sa douceur et sa beauté, formaient une chaîne si forte et si charmante, que j’aurais mis tout mon bonheur à n’en sortir jamais. Terrible changement ! ce qui fait mon désespoir a pu faire ma félicité ! Je me trouve le plus malheureux de tous les hommes, par cette même constance dont je devais attendre le plus doux de tous les sorts et les plus parfaites récompenses de l’amour.
Nous prîmes un appartement meublé à Paris ; ce fut dans la rue V…, et, pour mon malheur, auprès de la maison de M. de B…, célèbre fermier-général. Trois semaines se passèrent pendant lesquelles j’avais été si rempli de ma passion, que j’avais peu songé à ma famille et au chagrin que mon père avait dû ressentir de mon absence. Cependant, comme la débauche n’avait nulle part à ma conduite et que Manon se comportait aussi avec beaucoup de retenue, la tranquillité où nous vivions servit à me faire rappeler peu à peu l’idée de mon devoir.
Je résolus de me réconcilier, s’il était possible, avec mon père. Ma maîtresse était si aimable, que je ne doutai point qu’elle ne pût lui plaire si je trouvais moyen de lui faire connaître sa sagesse et son mérite ; en un mot, je me flattai d’obtenir de lui la liberté de l’épouser, ayant été désabusé de l’espérance de le pouvoir sans son consentement. Je communiquai ce projet à Manon, et je lui fis entendre qu’outre les motifs de l’amour et du devoir, celui de la nécessité pouvait y entrer aussi pour quelque chose, car nos fonds étaient extrêmement altérés, et je commençais à revenir de l’opinion qu’ils étaient inépuisables.
Manon reçut froidement cette proposition. Cependant, les difficultés qu’elle y opposa n’étant prises que de sa tendresse même et de la crainte de me perdre, si mon père n’entrait point dans notre dessein après avoir connu le lieu de notre retraite, je n’eus pas le moindre soupçon du coup cruel qu’on se préparait à me porter. À l’objection de la nécessité elle répondit qu’il nous restait encore de quoi vivre quelques semaines, et qu’elle trouverait après cela des ressources dans l’affection de quelques parents à qui elle écrirait en province. Elle adoucit son refus par des caresses si tendres et si passionnées, que moi, qui ne vivais qu’en elle et qui n’avais pas la moindre défiance de son cœur, j’applaudis à toutes ses réponses et à toutes ses résolutions.
Je lui avais laissé la disposition de notre bourse et le soin de payer notre dépense ordinaire. Je m’aperçus peu après que notre table était mieux servie, et qu’elle s’était donné quelques ajustements d’un prix considérable. Comme je n’ignorais pas qu’il devait nous rester à peine douze ou quinze pistoles, je lui marquai mon étonnement de cette augmentation apparente de notre opulence. Elle me pria en riant d’être sans embarras. Ne vous ai-je pas promis, me dit-elle, que je trouverais des ressources ? Je l’aimais avec trop de simplicité pour m’alarmer facilement.
Un jour que j’étais sorti l’après-midi, et que je l’avais avertie que je serais dehors plus longtemps qu’à l’ordinaire, je fus étonné qu’à mon retour on me fit attendre deux ou trois minutes à la porte. Nous n’étions servis que par une petite fille qui était à peu près de notre âge. Étant venue m’ouvrir, je lui demandai pourquoi elle avait tardé si longtemps. Elle me répondit d’un air embarrassé qu’elle ne m’avait point entendu frapper. Je n’avais frappé qu’une fois ; je lui dis : Mais si vous ne m’avez pas entendu, pourquoi êtes-vous donc venue m’ouvrir ? Cette question la déconcerta si fort, que, n’ayant point assez de présence d’esprit pour y répondre, elle se mit à pleurer, en m’assurant que ce n’était point sa faute, et que madame lui avait défendu d’ouvrir la porte jusqu’à ce que M. de B… fût sorti par l’autre escalier qui répondait au cabinet. Je demeurai si confus que je n’eus point la force d’entrer dans l’appartement. Je pris le parti de descendre sous prétexte d’une affaire, et j’ordonnai à cette enfant de dire à sa maîtresse que je retournerais dans le moment, mais de ne pas faire connaître qu’elle m’eût parlé de M. de B…
Ma consternation fut si grande que je versai des larmes en descendant l’escalier, sans savoir encore de quel sentiment elles partaient. J’entrai dans le premier café et, m’y étant assis près d’une table, j’appuyai la tête sur mes deux mains pour y développer ce qui se passait dans mon cœur. Je n’osais rappeler ce que je venais d’entendre ; je voulais le considérer comme une illusion, et je fus près, deux ou trois fois, de retourner au logis sans marquer que j’y eusse fait attention. Il me paraissait si impossible que Manon m’eût trahi, que je craignais de lui faire injure en la soupçonnant. Je l’adorais, cela était sûr : je ne lui avais pas donné plus de preuves d’amour que je n’en avais reçu d’elle : pourquoi l’aurais-je accusée d’être moins sincère et moins constante que moi ? Quelle raison aurait-elle eue de me tromper ? Il n’y avait que trois heures qu’elle m’avait accablé de ses plus tendres caresses, et qu’elle avait reçu les miennes avec transport ; je ne connaissais pas mieux mon cœur que le sien. Non, non, repris-je, il n’est pas possible que Manon me trahisse ! elle n’ignore pas que je ne vis que pour elle ; elle sait trop bien que je l’adore ! Ce n’est pas là un sujet de me haïr.
Cependant la visite et la sortie furtive de M. de B… me causaient de l’embarras. Je me rappelais aussi les petites acquisitions de Manon, qui me semblaient surpasser nos richesses présentes. Cela paraissait sentir les libéralités d’un nouvel amant. Et cette confiance qu’elle m’avait marquée pour des ressources qui m’étaient inconnues ! J’avais peine à donner à tant d’énigmes un sens aussi favorable que mon cœur le souhaitait.
D’un autre côté, je ne l’avais presque pas perdue de vue depuis que nous étions à Paris. Occupations, promenades, divertissements, nous avions toujours été l’un à côté de l’autre ; mon Dieu ! un instant de séparation nous aurait trop affligés ! Il fallait nous dire sans cesse que nous nous aimions : nous serions morts d’inquiétude sans cela. Je ne pouvais donc imaginer presque un seul moment où Manon pût s’être occupée d’un autre que moi.
À la fin, je crus avoir trouvé le dénouement de ce mystère. M. de B…, dis-je en moi-même, est un homme qui fait de grosses affaires et qui a de grandes relations ; les parents de Manon se seront servis de cet homme pour lui faire tenir quelque argent. Elle en a peut-être déjà reçu de lui : il est venu aujourd’hui lui en apporter encore. Elle s’est fait sans doute un jeu de me le cacher, pour me surprendre agréablement. Peut-être m’en aurait-elle parlé si j’étais rentré à l’ordinaire, au lieu de venir ici m’affliger. Elle ne me le cachera pas du moins lorsque je lui en parlerai moi-même.
Je me remplis si fortement de cette opinion, qu’elle eut la force de diminuer beaucoup ma tristesse. Je retournai sur-le-champ au logis. J’embrassai Manon avec ma tendresse ordinaire. Elle me reçut fort bien. J’étais tenté d’abord de lui découvrir mes conjectures, que je regardais plus que jamais comme certaines ; je me retins, dans l’espérance qu’il lui arriverait peut-être de me prévenir en m’apprenant tout ce qui s’était passé.
On nous servit à souper. Je me mis à table d’un air fort gai ; mais, à la lumière de la chandelle qui était entre elle et moi, je crus apercevoir de la tristesse sur le visage et dans les yeux de ma chère maîtresse. Cette pensée m’en inspira aussi. Je remarquai que ses regards s’attachaient sur moi d’une autre façon qu’ils n’avaient accoutumé. Je ne pouvais démêler si c’était de l’amour ou de la compassion quoiqu’il me parût que c’était un sentiment doux et languissant. Je la regardai avec la même attention : et peut-être n’avait-elle pas moins de peine à juger de la situation de mon cœur par mes regards. Nous ne pensions ni à parler ni à manger. Enfin je vis tomber des larmes de ses beaux yeux : perfides larmes !
Ah Dieu ! m’écriai-je, vous pleurez, ma chère Manon : vous êtes affligée jusqu’à pleurer, et vous ne me dites pas un seul mot de vos peines. Elle ne me répondit que par quelques soupirs qui augmentèrent mon inquiétude. Je me levai en tremblant ; je la conjurai, avec tous les empressements de l’amour, de me découvrir le sujet de ses pleurs : j’en versais moi-même en essuyant les siens ; j’étais plus mort que vif. Un barbare aurait été attendri des témoignages de ma douleur et de ma crainte.
Dans le temps que j’étais ainsi tout occupé d’elle, j’entendis le bruit de plusieurs personnes qui montaient l’escalier. On frappa doucement à la porte. Manon me donna un baiser, et, s’échappant de mes bras, elle entra rapidement dans le cabinet qu’elle ferma aussitôt sur elle. Je me figurai qu’étant un peu en désordre, elle voulait se cacher aux yeux des étrangers qui avaient frappé. J’allai leur ouvrir moi-même.
À peine avais-je ouvert, que je me vis saisir par trois hommes que je reconnus pour les laquais de mon père. Ils ne me firent point de violence ; mais deux d’entre eux m’ayant pris par les bras, le troisième visita mes poches, dont il tira un petit couteau qui était le seul fer que j’eusse sur moi. Ils me demandèrent pardon de la nécessité où ils étaient de me manquer de respect ; ils me dirent naturellement qu’ils agissaient par l’ordre de mon père, et que mon frère aîné m’attendait en bas dans un carrosse. J’étais si troublé, que je me laissai conduire sans résister et sans répondre. Mon frère était effectivement à m’attendre. On me mit dans le carrosse auprès de lui ; et le cocher, qui avait ses ordres, nous conduisit à grand train jusqu’à Saint-Denis. Mon frère m’embrassa tendrement ; mais il ne me parla point ; de sorte que j’eus tout le loisir dont j’avais besoin pour rêver à mon infortune.
J’y trouvai d’abord tant d’obscurité, que je ne voyais pas de jour à la moindre conjecture. J’étais trahi cruellement ; mais par qui ? Tiberge fut le premier qui me vint à l’esprit. Traître ! disais-je, c’est fait de ta vie si mes soupçons se trouvent justes. Cependant je fis réflexion qu’il ignorait le lieu de ma demeure, et qu’on ne pouvait par conséquent l’avoir appris de lui. Accuser Manon, c’est de quoi mon cœur n’osait se rendre coupable. Cette tristesse extraordinaire dont je l’avais vue comme accablée, ses larmes, le tendre baiser qu’elle m’avait donné en se retirant, me paraissaient bien une énigme ; mais je me sentais porté à l’expliquer comme un pressentiment de notre malheur commun ; et, dans le temps que je me désespérais de l’accident qui m’arrachait à elle, j’avais la crédulité de m’imaginer qu’elle était encore plus à plaindre que moi.