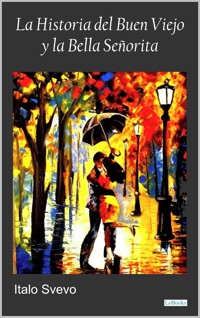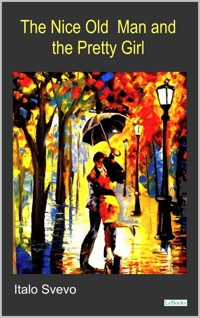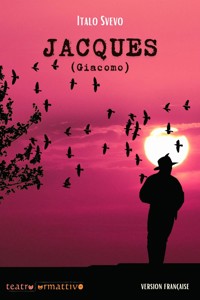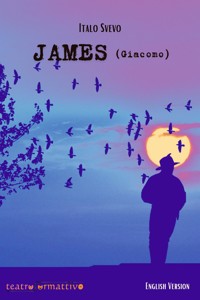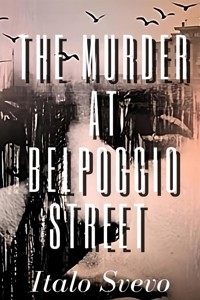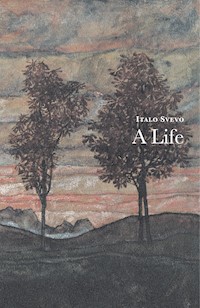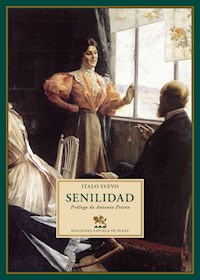Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: A verba futuroruM
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Pionnier du roman moderne, Svevo nous plonge dans la psyché tourmentée de Zéno Cosini, anti-héros pathétique et drôle qui nous invite à regarder à la loupe ses défauts… et les tares de la société italienne à la veille de la première guerre mondiale.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 771
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Couverture
Italo Svevo
LA CONSCIENCE DE ZENO
I - Préface
Je suis le médecin dont il est parlé en termes parfois peu flatteurs dans le récit qui va suivre. Quiconque a des notions de psychanalyse saura localiser l’antipathie que nourrit le patient à mon adresse. Je ne parlerai pas ici de psychanalyse ; il en sera assez question dans ce livre. Il faut que je m’excuse d’avoir poussé mon malade à écrire son autobiographie ; les psychanalystes fronceront les sourcils à pareille nouveauté. Mais il était vieux et j’espérais que cet effort d’évocation rendrait vigueur à ses souvenirs et que l’autobiographie serait un bon prélude à son traitement. Aujourd’hui encore, cette idée me semble juste, elle m’a donné des résultats inespérés qui auraient été plus considérables encore si le malade, au moment le plus intéressant, ne s’était soustrait à la cure, me dérobant ainsi les fruits de la longue et minutieuse étude que j’avais faite de ces Mémoires. Je les publie par vengeance et j’espère qu’il en sera furieux. Qu’il sache cependant que je suis prêt à partager avec lui les sommes importantes que je ne manquerai pas de retirer de cette publication. Je n’y mets qu’une condition : qu’il reprenne le traitement. Il semblait si curieux de lui-même ! S’il savait toutes les surprises que lui réserverait le commentaire du tas de vérités et de mensonges qu’il a accumulés dans les pages que voici !
Docteur S.
II - Préambule
Mon enfance, voir mon enfance ? Plus de dix lustres me séparent d’elle et mes yeux presbytes pourraient peut-être y parvenir si la lumière qui en émane n’était interceptée par des obstacles de tous genres, hautes montagnes en vérité : toutes les années et certaines heures de ma vie. Le docteur m’a recommandé de ne pas m’obstiner à regarder si loin. Les événements récents sont également précieux pour ces messieurs et en particulier les imaginations et les rêves de la nuit précédente. Mais il faudrait un peu d’ordre en tout ceci. Pour pouvoir commencer ab ovo, dès que j’eus laissé le docteur qui va quitter Trieste pour longtemps, et uniquement en vue de faciliter sa tâche, j’achetai et lus un traité de psychanalyse. Il n’est pas difficile à comprendre, mais très ennuyeux. Après déjeuner, confortablement installé dans un fauteuil club, me voici un crayon et une feuille de papier à la main. Mon front n’a pas une ride, je viens d’éliminer tout effort de mon esprit. Ma pensée m’apparaît dissociée de moi-même. Je la vois. Elle monte, elle descend… mais c’est là sa seule activité. Pour lui rappeler qu’elle est la pensée et qu’elle a pour mission de se manifester, je saisis mon crayon. Et voici mon front qui se charge de rides parce que chaque mot se compose de lettres ; le présent impérieux renaît et me voile le passé. Hier, j’avais essayé d’un abandon total. L’expérience s’acheva dans le sommeil le plus profond, sans autre résultat qu’un bon repos et la curieuse sensation d’avoir vu en dormant quelque chose d’important. Mais cette chose était oubliée, à jamais perdue. Aujourd’hui, grâce à ce crayon que je garde à la main, je demeure éveillé. Je vois, j’entrevois des images bizarres qui ne peuvent avoir aucun rapport avec mon passé ; une locomotive qui halète dans une montée en tirant d’innombrables voitures ; qui sait d’où elle vient, où elle va, pourquoi elle se trouve là en ce moment ! Dans mon assoupissement, je me souviens que mon livre assure qu’avec ce système on peut arriver à se rappeler sa petite enfance, celle des langes. Aussitôt un bébé au maillot m’apparaît, mais pourquoi serait-ce moi ? Il ne me ressemble en rien, je croirais plutôt que c’est celui auquel ma belle-sœur a donné le jour il y a quelques semaines et qu’on nous a montré comme un miracle à cause de la petitesse de ses mains et de la grandeur de ses yeux. Pauvre enfant ! Ah ! il s’agit bien de me rappeler mon enfance ! Je ne trouve même pas le moyen de te prévenir, toi qui vis la tienne, de l’importance qu’il y aurait à ne pas l’oublier, aussi bien pour le profit de ton intelligence que pour celui de ta santé. Quand réussiras-tu à savoir qu’il serait bon de retenir par cœur ta vie, y compris les portions de cette vie qui te répugneront ? Pour l’instant, inconsciemment, tu vas découvrant ton jeune organisme à la recherche du plaisir et tes découvertes délicieuses t’achemineront vers la douleur et la maladie où te pousseront ceux-là mêmes qui t’en voudraient préservé. Que faire ? Impossible de protéger ton berceau ! En toi, ô nouveau né, ont lieu de mystérieuses combinaisons. Chaque minute qui passe y jette un réactif. Il y a pour toi bien des risques de maladies, parce qu’il est impossible que toutes ces minutes soient pures. Et d’ailleurs, mon petit, tu es du même sang que certains êtres que je connais. Les minutes qui s’écoulent en ce moment pourraient bien être pures, les siècles qui t’ont préparé ne l’étaient certes pas. Me voilà fort éloigné des images qui précèdent le sommeil. Je tenterai demain un nouvel essai.
III - Dernières cigarettes
Le docteur à qui j’en ai parlé m’a conseillé de commencer mon travail par une analyse historique de mon goût pour le tabac. — Écrivez ! écrivez ! Vous verrez comme vous arriverez à vous voir tout entier ! Je crois que sur ce sujet : le tabac, je puis écrire ici à mon bureau sans aller rêver sur le fauteuil. Je ne sais par où commencer et j’invoque l’assistance des cigarettes, toutes si pareilles à celle que j’ai aux lèvres. Aujourd’hui, je découvre tout de suite quelque chose que j’avais oublié. Les premières cigarettes que j’ai fumées ne se trouvent plus dans le commerce. Vers 1870, on avait, en Autriche, des cigarettes qui se vendaient dans des boîtes en carton timbrées de l’aigle bicéphale. Ah ! ah !… autour d’une de ces boîtes se groupent aussitôt plusieurs personnes et assez de leur physionomie pour que leur nom me revienne à la mémoire, pas assez cependant pour que cette rencontre imprévue m’émeuve. J’essaie d’obtenir davantage et je m’en vais dans mon fauteuil. Les apparitions pâlissent et des bouffons qui se moquent de moi prennent leur place. Découragé, je regagne mon bureau. Une de ces apparitions, à la voix un peu enrouée, c’est Joseph, un garçon de mon âge, et l’autre, mon frère, d’un an plus jeune que moi et mort depuis bien des années déjà. Joseph recevait, je crois, beaucoup d’argent de son père et il nous distribuait de ces cigarettes. Mais je suis certain qu’il en offrait beaucoup plus à mon frère qu’à moi. D’où la nécessité où je me trouvais de m’en procurer d’autres tout seul. C’est à cette occasion que je me fis voleur. En été, mon père laissait sur une chaise, dans la salle à manger, son gilet dont les goussets contenaient toujours de la petite monnaie : j’y prenais les dix sous qu’il fallait pour acheter la précieuse petite boîte et je fumais l’une après l’autre les dix cigarettes qu’elle contenait, pour ne pas conserver le fruit compromettant de mon larcin. Tout cela reposait dans ma conscience à portée de ma main. Si ces souvenirs ne se réveillent qu’aujourd’hui, c’est que j’ignorais jusqu’à présent leur importance éventuelle. Voilà en tout cas enregistrée l’origine de cette mauvaise habitude et (qui sait ?) peut-être en suis-je déjà guéri. Pour essayer, je vais allumer une dernière cigarette. Peut-être la jetterai-je aussitôt, dégoûté… Je me rappelle qu’un jour mon père me surprit, son gilet à la main. Avec une effronterie que je n’aurais pas aujourd’hui et qui après si longtemps me dégoûte encore (qui sait si ce dégoût n’aura pas une grande importance dans ma cure ?), je lui expliquai que la curiosité m’était venue d’en compter les boutons. Mon père se mit à rire de mes dispositions pour la profession de mathématicien ou de tailleur et ne s’aperçut pas que j’avais les doigts dans un des goussets. À mon honneur, je puis dire que ce rire, provoqué par mon innocence, alors que cette innocence n’existait plus, suffit à tout jamais à me détourner du vol. Ou plutôt… j’eus encore l’occasion de voler, mais sans le savoir. Mon père abandonnait partout dans la maison des cigares Virginia à moitié fumés, en équilibre au bord des tables et des commodes. Je croyais que c’était là sa façon de les jeter et je croyais même savoir que notre vieille servante, Catina, les faisait disparaître. Je les fumais en cachette. À la minute précise où je m’en emparais, une nausée m’envahissait. Je savais quel malaise ils allaient me donner. Après quoi je me mettais à fumer jusqu’au moment où mon front se couvrait de sueurs froides et où mon estomac se soulevait. On ne dira pas qu’étant enfant, je manquais d’énergie. Je sais parfaitement comment mon père me guérit aussi de cette habitude. Un jour d’été, après une excursion scolaire, j’étais rentré à la maison, fatigué et tout en sueur. Ma mère m’avait aidé à me déshabiller, puis, enveloppé d’un peignoir, m’avait étendu pour dormir sur un sofa où elle était assise elle-même, occupée à quelque travail de couture. Je touchais au sommeil, mais j’avais encore les yeux emplis de la clarté solaire et je tardais à perdre conscience. La douceur qui à cet âge accompagne le repos après une grande fatigue m’apparaît avec la précision d’une image isolée, aussi nette, aussi distincte que si j’avais là, à côté de moi, ce cher corps qui n’existe plus. Je me rappelle cette grande pièce fraîche où nous jouions enfants et qui aujourd’hui, où l’on est avare d’espace, a été divisée en deux. Dans cette scène, mon frère n’apparaît pas, ce qui m’étonne. Je me dis qu’il avait dû lui aussi prendre part à l’excursion et par conséquent avoir sa part de ce repos. Est-il endormi à l’autre bout du grand sofa ? Je regarde, ce bout-là me semble vide. Je ne vois que moi, la douceur du repos, ma mère, puis mon père dont j’entends les paroles. Il était entré et tout d’abord ne m’avait pas vu, car il avait appelé à voix haute : — Maria ! Maman, d’un geste accompagné d’un léger bruit de lèvres, me désigna. Elle me croyait au fond du sommeil, alors qu’en pleine conscience je nageais à sa surface. J’étais si heureux de voir mon père se gêner pour moi que je ne bougeai pas. Mon père se plaignit à voix basse : — Je crois que je deviens fou. Je suis presque sûr d’avoir laissé, il y a une demi-heure, une moitié de cigare sur cette commode et je ne la retrouve plus. Ça ne va plus du tout. Les choses m’échappent. À voix basse également, mais d’un ton où se trahissait un rire retenu seulement par la crainte de m’éveiller, ma mère répondit : — Et pourtant, depuis le déjeuner personne n’est entré dans cette pièce. Mon père murmura : — Je le sais bien et c’est pourquoi j’ai l’impression que je deviens fou ! Il tourna le dos et sortit. J’entrouvris les yeux pour regarder ma mère. Elle avait repris sa couture, mais continuait à sourire. Certainement elle ne pensait pas que mon père fût menacé de folie, puisqu’elle souriait ainsi de ses craintes. Ce sourire m’est resté si présent que je l’ai reconnu du coup le jour où je l’ai retrouvé sur les lèvres de ma femme. Plus tard, ce ne fut plus le manque d’argent qui me rendit malaisée la satisfaction de mon vice ; mais les interdictions servirent à l’exciter. Je me rappelle avoir fumé beaucoup, caché dans tous les endroits possibles. À cause du grand dégoût physique qui le suivit, je me rappelle un séjour d’une demi-heure dans une cave obscure avec deux autres gamins dont je ne retrouve dans ma mémoire que les vêtements enfantins : deux paires de culottes courtes qui tiennent debout parce qu’il y a eu dedans deux corps que le temps a effacés. Nous avions une grande quantité de cigarettes et nous voulions voir qui en fumerait le plus en trente minutes. Je sortis vainqueur de l’épreuve, et dissimulai héroïquement le malaise que cette étrange gageure m’avait procuré. Nous sortîmes ensuite au soleil et à l’air. Pour éviter un étourdissement, je dus fermer les yeux. Un peu remis, je vantai ma victoire. Un des petits bonshommes me dit alors : — Ça m’est égal d’avoir perdu ; moi, je ne fume que tant que j’en ai envie. Je me rappelle cette saine parole, mais j’ai oublié la petite frimousse, saine elle aussi, bien sûr, qui devait être tournée vers moi à ce moment-là. À cette époque j’ignorais si j’aimais ou détestais les cigarettes, leur saveur et l’état où me mettait la nicotine. Quand j’appris que je détestais tout cela, ce fut bien pis. Je l’appris vers ma vingtième année. Vers cet âge, je souffris durant plusieurs semaines d’un violent mal de gorge accompagné de fièvre. Le médecin m’ordonna de garder le lit et de m’abstenir de fumer : interdiction absolue. Je me rappelle ce mot : absolue ! Il m’avait frappé, la fièvre le colora : un vide énorme et rien pour résister à la pression formidable qui se produit tout de suite autour d’un vide. Quand le docteur fut parti, mon père (ma mère était morte depuis de longues années déjà) me tint un moment compagnie, un gros cigare aux lèvres. En me quittant, il passa doucement sa main sur mon front brûlant et me dit : — Défense de fumer, hein ! Une affreuse inquiétude s’empara de moi. Je pensais : “Puisque tout cela me fait du mal, je ne fumerai plus, mais d’abord je veux fumer une dernière fois.” J’allumai une cigarette et mon inquiétude s’envola, malgré la fièvre qui montait et le tison ardent qui, à chaque bouffée, brûlait mes amygdales. Je fumai la cigarette jusqu’au bout, avec le soin de l’homme qui accomplit un vœu. Et malgré d’atroces souffrances, j’en fumai beaucoup d’autres durant ma maladie. Mon père allait et venait, toujours le cigare aux lèvres, et me disait : — Très bien ! Quelques jours encore sans fumer et te voilà guéri ! Cette phrase suffisait à me faire souhaiter qu’il me laissât tout de suite, oh ! tout de suite et que je pusse me jeter sur une cigarette. Je faisais même semblant de dormir pour le pousser à s’en aller plus vite. Cette maladie me procura le deuxième de mes tourments : l’effort pour me libérer du premier. Mes journées finirent par être remplies de cigarettes et de décisions de ne plus fumer et, pour tout dire tout de suite, de temps à autre il en est encore ainsi. La ronde des dernières cigarettes, qui a commencé quand j’avais vingt ans, n’a pas encore achevé de tourner. Ma décision est moins énergique, ma faiblesse trouve dans mon vieux cœur plus d’indulgence. Quand on est vieux, on sourit de la vie et de tout ce qu’elle contient. Je puis même dire que depuis quelque temps je fume bien des cigarettes… qui ne sont pas les “dernières”. Sur la page de garde d’un dictionnaire, je trouve cette inscription en belle calligraphie, encadrée de quelques fioritures : “Aujourd’hui, 2 février 1886, j’abandonne l’étude du droit pour celle de la chimie. Dernière cigarette !” Cette dernière cigarette-là était de grande importance. Je me rappelle tous les espoirs qui l’accompagnèrent. L’étude du droit canon, si éloigné de la vie, m’avait excédé et je courais à une science qui est la vie même, bien qu’enfermée dans des cornues. Cette dernière cigarette exprimait mon désir d’activité (manuelle aussi bien que cérébrale) et de pensée sereine, sobre, solide. Pour échapper à la série des combinaisons à base de carbone auxquelles je ne croyais pas, je revins au droit. Hélas ! Ce fut une erreur, marquée elle aussi par une dernière cigarette dont je trouve la date notée sur un livre. Date importante elle aussi ; je me résignais à revenir aux disputes sur le tien et le mien avec les meilleures intentions du monde, renonçant finalement aux séries du carbone. Je m’étais montré peu fait pour la chimie et ma maladresse manuelle y était pour quelque chose. Comment aurais-je pu n’être pas maladroit en continuant, ainsi que je le faisais, à fumer comme un Turc ? À présent que je suis là, en train de m’analyser, un doute m’assaille : peut-être n’ai-je tant aimé les cigarettes que pour pouvoir rejeter sur elles la faute de mon incapacité ? Qui sait si, cessant de fumer, je serais devenu l’homme idéal et fort que j’espérais ? Ce fut peut-être ce doute qui me cloua à mon vice : c’est une façon commode de vivre que de se croire grand d’une grandeur latente. Je hasarde cette hypothèse pour expliquer ma faiblesse juvénile, mais sans en être fermement convaincu. À présent que je suis vieux et que personne n’exige rien de moi, je vais toujours de cigarettes en bonnes résolutions et de bonnes résolutions en cigarettes. À quoi riment aujourd’hui ces résolutions ? Comme le vieil hygiéniste que décrit Goldoni, voudrais-je mourir bien portant après avoir passé toute ma vie malade ? Une fois, étant étudiant, comme je changeais de chambre, je fus obligé de faire retapisser à mes frais les murs de celle que je quittais et que j’avais couverts de dates. Il est probable que si j’abandonnais cette chambre, c’est qu’elle était devenue un cimetière de bonnes intentions et que je ne croyais plus possible en ce lieu d’en former de nouvelles. J’estime qu’une cigarette a une saveur plus intense quand c’est la dernière. Toutes les autres ont aussi leur saveur particulière, mais moins intense. La saveur que prend la dernière lui vient du sentiment qu’on a d’une victoire sur soi-même et de l’espoir d’un avenir prochain de force et de santé. Les autres ont leur importance, parce qu’en les allumant, on affirme sa liberté et l’avenir de force et de santé demeure, mais s’éloigne un peu. Les dates sur les murs de ma chambre étaient de couleurs variées ; certaines étaient peintes à l’huile. Ma décision, affirmée chaque fois avec la confiance la plus ingénue, trouvait une expression adéquate dans la vivacité de la couleur qui devait faire pâlir l’inscription consacrée à la décision précédente. Certaines dates avaient ma préférence à cause de la concordance des chiffres. Je me rappelle une date du siècle passé qui me sembla devoir clore à jamais le cercueil où je prétendais ensevelir mon vice : “Neuvième jour du neuvième mois de 1899.” Date significative, n’est-il pas vrai ? Le siècle nouveau m’apporta des dates bien autrement musicales : “Premier jour du premier mois de 1901.” Aujourd’hui encore, il me semble que si cette date pouvait se répéter, je saurais commencer une nouvelle vie. Mais les dates ne manquent pas dans les calendriers et avec un peu d’imagination, il n’en est pas une qui ne puisse s’adapter à une bonne intention. Je me rappelle celle-ci parce qu’elle me sembla contenir un impératif suprêmement catégorique : “Troisième jour du sixième mois de 1912, 24 heures.” Quelle résonance ! Chaque chiffre semble doubler la mise… L’année 1913 me procura un instant d’hésitation. Il manquait un treizième mois pour l’accorder avec le millésime. Mais qu’on n’aille pas croire qu’il faille tant d’accords dans une date pour donner tout son relief à une dernière cigarette. Bien des dates que je retrouve sur mes livres ou mes cahiers préférés se font remarquer par leurs dissonances. Par exemple, le troisième jour du second mois de 1905, six heures ! Cette date a son rythme cependant, pour peu qu’on y réfléchisse : chaque chiffre nie le précédent. De nombreux événements, que dis-je, tous les événements sans exception, depuis la mort de Pie IX jusqu’à la naissance de mon fils, me parurent dignes d’être consacrés par mon ferme propos habituel. Tout le monde dans la famille est émerveillé de ma mémoire des anniversaires joyeux ou tristes et j’en tire une réputation de grande bonté ! Pour diminuer son apparence grossière, j’essayai de donner un contenu philosophique à la maladie de la dernière cigarette. On prend une fière attitude et l’on dit : “Jamais plus !” Mais que devient cette fière attitude si on tient la promesse ? Pour la garder, il faut avoir à renouveler le serment. Et d’ailleurs, le temps, pour moi, n’est pas cette chose impensable qui ne s’arrête jamais. Pour moi, le temps revient. Rien que pour moi.
*
La maladie est une conviction et je suis né avec cette conviction. Je ne me rappellerais pas grand-chose de celle de mes vingt ans si je ne l’avais à cette époque décrite à un médecin. Il est curieux qu’on se rappelle mieux les mots qu’on a dits que les sentiments qui n’ont pas franchi nos lèvres. J’étais allé chez ce médecin parce qu’on m’avait dit qu’il guérissait les maladies nerveuses à l’électricité. Je pensais pouvoir puiser dans l’électricité la force suffisante pour cesser de fumer. Ce docteur avait un gros ventre et sa respiration asthmatique accompagnait les grésillements de la machine électrique mise en branle dès la première séance. Je fus déçu, car j’avais espéré que le docteur en m’étudiant découvrirait le poison qui corrompait mon sang. Mais il me jugea de constitution saine et comme je m’étais plaint de mal digérer et de mal dormir, il supposa que mon estomac manquait d’acides et que chez moi les mouvements péristaltiques (il répéta tellement ce mot que je ne l’ai plus oublié) étaient ralentis. Là-dessus il m’ordonna un certain acide dont les effets furent désastreux, car je souffre depuis lors d’une acidité excessive. Quand j’eus compris qu’il n’arriverait jamais tout seul à découvrir la nicotine dans mon sang, je voulus l’aider et j’exprimai le soupçon que mon indisposition provenait peut-être de là. Il haussa pesamment les épaules : — Mouvements péristaltiques… Acide… La nicotine n’y est pour rien ! Il me fit soixante-dix applications électriques et elles auraient continué si je n’avais jugé que c’était suffisant. Plutôt que d’en espérer des miracles, je courais à ces séances avec l’espoir de convaincre le docteur de me défendre le tabac. Qui sait comment les choses auraient tourné si j’avais été fortifié dans mes bonnes intentions par une interdiction médicale ? Voici la description de ma maladie telle que je la fis au docteur : — Je ne peux pas travailler, et les rares fois où je vais au lit de bonne heure, je reste éveillé jusqu’aux premières cloches du matin. C’est pourquoi j’hésite entre le droit et la chimie ; ce sont deux disciplines qui exigent un travail qui commence à heure fixe et je ne sais à quelle heure je pourrai être levé. — L’électricité guérit toutes les insomnies, déclarait mon Esculape, fixant les yeux sur son cadran au lieu de regarder son malade. J’en vins à causer avec lui comme s’il avait pu comprendre la psychanalyse dont j’étais un modeste précurseur. Je lui racontai mes malheurs avec les femmes. Une seule ne me suffisait pas, et plusieurs, pas davantage. Je les désirais toutes ! Dans la rue mon agitation était effroyable : toutes les femmes qui passaient m’appartenaient. Je les dévisageais avec insolence par besoin de me sentir brutal. En pensée je les déshabillais, complètement, les bottines exceptées, je les emportais dans mes bras ; quand je les abandonnais, elles n’avaient plus rien de secret pour moi. Vaine sincérité, vains discours ! Le docteur haletait : — J’espère bien que mes applications électriques ne vous guériront pas de cette maladie-là. Il ne manquerait plus que ça ! Je ne toucherais plus une bobine de Rhumkorff si je redoutais de tels effets. Il me raconta une anecdote qu’il trouvait des plus plaisantes. Un malade atteint de la même maladie que moi était allé trouver un médecin célèbre, en le priant de le guérir, et le médecin, y ayant parfaitement réussi, dut émigrer, sinon l’autre l’aurait envoyé ad patres. Je hurlais : — Mon excitation n’est pas saine. Elle vient du poison qui enflamme mon sang ! Le docteur murmurait avec tristesse : — Personne n’est content de son sort ! Ce fut pour le convaincre que je fis ce qu’il refusait de faire et que j’étudiai mon mal, en rassemblant tous les symptômes : — Ma distraction ! Elle aussi m’empêche de travailler. Quand je préparais à Graz le premier examen d’État, j’avais noté avec le plus grand soin tous les textes dont je devais avoir besoin dans tout le cours de mes études. Cela finit ainsi : quelques jours avant l’examen, je m’aperçus que j’avais étudié des matières dont je n’avais pas besoin avant quelques années. Je dus ajourner mon examen. Il est vrai que ces matières-là, je ne les avais guère travaillées, à cause d’une fillette du voisinage qui, d’ailleurs, ne m’accordait rien de plus qu’une coquetterie assez effrontée. Quand elle paraissait à sa fenêtre, je ne voyais plus ce que je lisais. Se comporter ainsi, n’est-ce pas le fait d’un imbécile ? Je me rappelle ce joli minois clair à la fenêtre, l’ovale de ce visage encadré de frisons fous, si blonds. Je la regardais, je rêvais d’écraser sur mon oreiller cette blancheur, ces flammes d’or… Esculape murmura : — Les coquetteries, il y a toujours quelque chose de bon derrière. À mon âge, vous ne penserez plus à la bagatelle. Je sais aujourd’hui avec certitude qu’il n’entendait rien à la bagatelle. J’ai cinquante-sept ans, et je suis sûr, si je ne cesse pas de fumer ou si la psychanalyse ne me guérit pas, que mon dernier regard, à mon lit de mort, sera l’expression de mon désir pour mon infirmière, à condition que ce ne soit pas ma femme et que ma femme ait permis qu’elle soit jolie ! Je fus aussi sincère qu’à confesse. Les femmes ne me plaisaient pas en bloc, mais… en détail ! Chez toutes, j’aimais les petits pieds bien chaussés, chez un grand nombre, le cou, frêle ou puissant, les seins légers. Je continuais l’énumération des parties anatomiques du corps féminin quand le docteur m’interrompit : — Eh bien, mais toutes ces parties font une femme entière. Je prononçai alors cette parole importante : — L’amour sain est celui qui embrasse une femme seule et toute une femme, y compris son caractère et son intelligence. Jusqu’alors, je n’avais assurément pas connu pareil amour. Du reste, quand cela m’arriva, je n’y trouvai pas la guérison ; mais je tiens à rappeler ici que j’avais dépisté la maladie là où un homme de l’art ne voyait que la santé, et mon diagnostic se vérifia par la suite. Chez un de mes amis, non médecin, je rencontrai une compréhension plus juste de mon mal. Lui non plus ne me rendit pas la santé, mais grâce à lui il y eut, dans ma vie, une note nouvelle, qui résonne toujours. Mon ami était un homme riche qui occupait noblement ses loisirs à des études et à des travaux littéraires. Il parlait beaucoup mieux qu’il n’écrivait, en sorte que le monde ignore quel excellent lettré il fut. Il était gros et gras, et je le connus au moment où il suivait un traitement énergique pour maigrir. En peu de jours, il avait obtenu un si beau résultat que bien des gens le recherchaient dans l’espoir de bien jouir de leur bonne santé auprès d’un malade comme lui. Pour moi, je l’enviais parce qu’il savait ce qu’il voulait et je m’attachai à lui aussi longtemps que dura sa cure. Il me laissait toucher son ventre, qui diminuait de jour en jour. La jalousie me rendait malveillant, et comme je lui disais, pour affaiblir sa résolution : “Mais une fois la cure finie, que ferez-vous de toute cette peau ?” il me répondit avec un grand calme, que son visage émacié rendait comique : — Encore deux jours et la cure de massage commencera. Sa cure avait été ordonnée à l’avance dans tous ses détails et il se conformait ponctuellement à son programme. De là vint que je mis en lui toute ma confiance et que je lui décrivis ma maladie. Je me rappelle aussi cette description-là. Je lui expliquai comment il m’eût été plus facile de renoncer à manger trois fois par jour que de ne pas fumer ces innombrables cigarettes, qui m’obligeaient à prendre des résolutions fatigantes, à tout instant renouvelées. Ces résolutions m’interdisaient toute autre activité : seul Jules César pouvait faire plusieurs choses à la fois. Il est vrai que personne ne me demanderait de faire quoi que ce fût tant que vivrait mon fondé de pouvoir Olivi, mais était-ce possible qu’un garçon comme moi ne fût bon en ce monde qu’à rêver et à jouer du violon, art pour lequel je n’avais d’ailleurs aucune aptitude ? Le gros homme amaigri ne donna pas aussitôt sa réponse. Il la médita longuement. Puis, du ton doctoral qui convenait à son esprit méthodique et à son incontestable supériorité en ces matières, il m’exposa que ma vraie maladie ce n’était pas la cigarette mais bien la résolution. Au cours des années, selon lui, deux êtres s’étaient formés en moi, dont l’un commandait et dont l’autre n’était qu’un esclave. À peine la vigilance du premier se relâchait-elle, que l’autre agissait à sa guise ; c’est pourquoi il fallait donner à l’esclave, épris de liberté, une liberté absolue, et, en même temps, regarder mon vice en face, comme un objet nouveau et que je n’aurais jamais vu. Il ne fallait pas le combattre, mais le traiter par le mépris, l’oublier, en quelque sorte, lui tourner le dos sans façon comme à une compagnie indigne de moi. Bien simple, n’est-ce pas ? Je crus que c’était simple en effet. Au prix d’un grand effort, j’éliminai de mon esprit toute décision, si bien que je réussis à ne pas fumer pendant plusieurs heures. Ma bouche nettoyée retrouva une saveur innocente : j’étais comme l’enfant qui vient de naître. J’eus alors envie d’une cigarette. Je la fumai, puis, saisi de remords, je renouvelai la résolution que j’avais voulu abolir. Par un chemin un peu plus long, j’aboutissais au même point. Un jour, cette canaille d’Olivi me donne une idée : parier pour fortifier ma décision. Je pense qu’Olivi n’a jamais changé. Comme je le vois aujourd’hui, je l’ai toujours vu : un peu voûté, mais solide. Il a maintenant quatre-vingts ans. Il a travaillé et travaille pour moi, mais je ne l’en aime pas davantage, car c’est lui qui m’a empêché de travailler comme il le fait lui-même. — Parions ! Le premier qui fumera paiera la somme convenue, et chacun reprendra sa liberté. Ainsi, l’administrateur qu’on m’avait imposé pour m’empêcher de dilapider l’héritage de mon père, s’attaquait à celui de ma mère, dont je disposais librement. L’expérience du pari s’avéra désastreuse. Je n’étais plus alternativement maître et esclave, mais seulement esclave, et de cet Olivi du diable. Je me remis aussitôt à fumer ; puis l’idée me vint de le filouter en continuant à fumer en cachette. Mais alors pourquoi avoir parié ? Je me fixai, pour une dernière cigarette, une date ayant quelque rapport avec celle de notre convention. Ainsi je me donnais l’illusion d’être en règle. Après quoi, je me révoltais de nouveau et je fumais à en perdre le souffle. Pour en finir, j’avouai tout à Olivi. Le vieux encaissa l’argent, le sourire aux lèvres et, aussitôt après, tira de sa poche un gros cigare qu’il alluma et fuma avec volupté. Je n’eus jamais le soupçon qu’il avait triché lui aussi. Évidemment… les autres ne sont pas faits comme moi. Mon fils venait d’avoir trois ans quand ma femme eut une bonne idée. Elle me conseilla, pour me guérir de mon vice, de m’enfermer quelque temps dans une maison de santé. J’acceptai aussitôt, d’abord parce que je voulais que mon fils, quand il serait en âge de me juger, me trouvât équilibré et calme, et en second lieu pour la raison plus urgente qu’Olivi était souffrant et menaçait de m’abandonner ; je pouvais être obligé de prendre d’un moment à l’autre la direction de mes affaires et je me jugeais inapte à une grande activité avec toute cette nicotine dans le corps. Nous avions d’abord pensé à nous rendre en Suisse, pays classique des maisons de santé, mais nous apprîmes qu’il y avait à Trieste un Dr Muli qui venait d’ouvrir un établissement de ce genre. Je chargeai ma femme d’aller le voir et il lui offrit de mettre à ma disposition un petit appartement bien clos où je serais surveillé par une infirmière aidée de plusieurs autres personnes. En me rapportant cela, tantôt ma femme souriait, tantôt elle riait aux éclats. L’idée de me faire enfermer l’amusait et je riais de bon cœur avec elle. C’était la première fois qu’elle s’associait à mes tentatives de guérison. Jusque-là elle n’avait jamais pris ma maladie au sérieux et elle prétendait que fumer n’était qu’une manière un peu étrange, mais point trop ennuyeuse de vivre. Je crois qu’elle avait été agréablement surprise après notre mariage de ne m’entendre jamais regretter ma liberté, occupé comme je l’étais à regretter cent autres choses. Nous allâmes à la maison de santé le jour où Olivi me déclara qu’en aucun cas il ne resterait chez moi au-delà du mois suivant. Nous avions mis un peu de linge dans une malle et le soir venu nous nous rendîmes chez le docteur Muli. Il nous reçut en personne sur le seuil. À cette époque, le docteur Muli était un très joli garçon. On était au fort de l’été et ce petit homme nerveux, au visage bruni par le soleil où luisaient d’un éclat plus vif les yeux noirs, était l’image même de l’élégance, tout vêtu de blanc du col aux souliers. Il provoquait mon admiration, mais de toute évidence, je provoquais moi-même la sienne, et je devinais bien pourquoi. Un peu embarrassé, je lui dis : — Je vois bien que vous ne croyez ni à la sincérité de cette cure, ni au sérieux avec lequel je l’entreprends. Avec un léger sourire qui pourtant me blessa, le docteur me répondit : — Pourquoi ? Il est peut-être exact que les cigarettes vous sont plus nuisibles que nous ne l’admettons, nous autres médecins. Ce que je ne comprends pas, c’est uniquement ceci : pourquoi, au lieu de cesser de fumer complètement d’une minute à l’autre, ne vous êtes-vous pas plutôt résolu à diminuer le nombre des cigarettes que vous fumiez ? On peut très bien fumer, il suffit de ne pas exagérer. À la vérité, à force de vouloir cesser complètement de fumer, je n’avais jamais envisagé l’éventualité de fumer moins. Mais au moment où il m’était donné, ce conseil ne pouvait qu’affaiblir ma décision. Je répondis résolument : — Puisque c’est décidé, laissez-moi tenter cette cure. — Tenter ? Le docteur se mit à rire d’un air supérieur. Si vous la commencez, la cure réussira. À moins que vous n’usiez de votre force musculaire contre la pauvre Giovanna, vous ne pourrez sortir d’ici. Les formalités pour vous délivrer dureraient si longtemps que vous auriez dans l’intervalle le loisir d’oublier votre vice. Nous nous trouvions dans l’appartement qui m’était destiné et où nous étions arrivés en redescendant au rez-de-chaussée après être montés au second étage. — Vous voyez ? Cette porte fermée au verrou empêche de communiquer avec l’autre côté du rez-de-chaussée où se trouve la sortie sur la rue. Et Giovanna n’en a même pas les clefs. Pour sortir elle doit monter au second étage et redescendre ; elle n’a que les clefs de la porte qui s’est ouverte pour nous sur ce palier ; d’ailleurs, au second étage, il y a toujours de la surveillance. Ce n’est pas mal, n’est-ce pas, pour une maison de santé destinée à des enfants et à des femmes en couches ? Et il se mit à rire, peut-être à l’idée de m’avoir emprisonné avec des enfants. Il appela Giovanna et me la présenta. C’était une petite bonne femme d’un âge impossible à préciser et qui pouvait aller de quarante à soixante ans. Elle avait de petits yeux qui brillaient intensément sous des cheveux complètement gris. Le docteur lui dit : — Voici le monsieur avec qui vous devez être prête à boxer. Elle me considéra d’un œil scrutateur, son visage s’empourpra et elle s’écria d’une voix stridente : — Je ferai mon devoir, mais je ne peux certainement pas lutter avec vous. Si vous me menacez, j’appellerai l’infirmier qui est un hercule et, s’il ne vient pas tout de suite, je vous laisserai aller où il vous plaira ; je n’ai pas l’intention de risquer ma peau ! J’appris plus tard que le docteur lui avait confié cette mission en lui promettant une indemnité assez forte et c’est ce qui avait contribué à l’épouvanter. Ces paroles, sur le moment, m’irritèrent. Je m’étais mis volontairement dans de beaux draps ! — Mais votre peau ne risque rien ! hurlai-je. Qui touchera à votre peau ? Je m’adressai au docteur : — Je voudrais que cette femme soit priée de ne pas m’embêter ! J’ai apporté avec moi quelques livres et je voudrais être laissé en paix. Le docteur intervint et adressa quelques conseils à Giovanna. Pour s’excuser, celle-ci continua à me harceler : — J’ai des filles, j’en ai deux encore en bas âge et je dois gagner ma vie. — Je ne daignerai pas vous tuer, répliquai-je sur un ton bien certainement peu propre à rassurer la pauvre femme. Le docteur la fit sortir en la chargeant d’aller chercher je ne sais quoi à l’étage au-dessus et pour m’apaiser il me proposa de la remplacer par quelqu’une d’autre en ajoutant : — Ce n’est pas une méchante femme et quand je lui aurai recommandé de se montrer plus discrète, elle ne donnera plus lieu à aucune plainte.
Désireux de montrer que je n’accordais aucune importance à la personne chargée de me surveiller, je me déclarai disposé à la supporter. Je sentais le besoin de me calmer, je tirai de ma poche l’avant-dernière cigarette et la fumai avec avidité. J’expliquai au docteur que je n’en avais que deux sur moi et que je voulais cesser de fumer à minuit tapant. Ma femme prit congé de moi en même temps que le docteur. Elle me dit en souriant : — Puisque ta décision est prise, sois fort. Son sourire que j’aimais tant me parut une moquerie et ce fut à cet instant précis que se glissa dans mon âme le premier germe d’un sentiment nouveau qui devait faire misérablement échouer dès ses débuts une tentative entreprise avec tant de sérieux. Je sentis aussitôt que j’avais mal, mais je ne me rendis compte de ce qui me faisait souffrir que quand je fus seul. C’était une folle jalousie, la plus amère jalousie, et c’était le jeune docteur qui la provoquait. Il était beau, il était libre ! On le surnommait la Venere de’ Medici. Pourquoi ma femme ne l’aurait-elle pas aimé ? En la suivant, quand ils m’avaient quitté, il avait regardé les pieds élégamment chaussés de ma femme. C’était la première fois depuis mon mariage que j’éprouvais de la jalousie. Quelle tristesse ! Ce sentiment était certainement provoqué par cet abject état de prisonnier où je me trouvais ! Je luttai. Le sourire de ma femme était son sourire ordinaire et non pas le sourire moqueur de quelqu’un qui a su débarrasser le plancher d’un mari gênant. Sans aucun doute, c’était elle qui m’avait fait enfermer, bien que n’accordant aucune importance à mon vice ; mais sans aucun doute aussi, elle l’avait fait pour me complaire. Est-ce que j’allais oublier qu’il n’était pas tellement facile d’être amoureux de ma femme ? Si le docteur avait regardé ses pieds, c’était certainement pour voir quelles bottines il devait acheter à sa maîtresse. Je fumai là-dessus ma dernière cigarette ; il n’était pas minuit, onze heures seulement, une heure impossible pour une dernière cigarette. J’ouvris un livre. Je lisais sans comprendre, j’avais proprement des visions. La page où je fixais mon regard se couvrait de la photographie du docteur Muli dans toute la gloire de sa beauté et de son élégance. Je ne pus résister. J’appelai Giovanna. Le calme me viendrait peut-être en bavardant. Elle vint et me regarda tout de suite d’un œil défiant. Elle glapit de sa voix aiguë : — N’espérez pas me faire manquer à mon devoir. Pour l’apaiser, je fis un mensonge, je l’assurai que j’étais loin d’y penser, que je n’avais plus envie de lire et que je préférais converser un peu avec elle. Je la fis asseoir en face de moi. Elle me dégoûtait avec son air de vieille et ses yeux jaunes, mobiles comme ceux de tous les animaux faibles. Je m’attendrissais sur moi, sur la compagnie que je devais subir. Il est vrai que même en liberté je ne sais pas choisir les compagnons qui me conviendraient le mieux ; d’habitude, ce sont eux qui me choisissent, exactement comme le fit ma femme. Je priai Giovanna de me distraire, mais elle me déclara qu’elle n’avait rien à me dire qui valût de retenir mon attention ; je lui demandai alors de me parler de sa famille, en ajoutant que presque tout le monde ici-bas en avait au moins une. Elle obéit et commença par me raconter qu’elle avait dû mettre ses deux filles à l’Institut de la Charité. Je goûtais ce début ; cette façon de se débarrasser de dix-huit mois de gestation me faisait rire. Mais elle aimait trop la polémique et je ne l’écoutai plus lorsqu’elle voulut me prouver qu’elle n’aurait pas pu faire autrement, vu le peu qu’elle gagnait, et que le docteur avait eu tort quelques jours plus tôt en lui déclarant que deux couronnes par jour devaient lui suffire puisque l’Institut de la Charité entretenait toute sa famille. Elle hurlait : — Et le reste ? La nourriture et les vêtements, ce n’est pas tout !… Et elle dénombrait une foule de choses qu’elle devait procurer elle-même à ses filles et que j’ai oubliées, d’autant que, pour me protéger de cette voix stridente, je m’appliquais à penser à autre chose. Mais je n’en avais pas moins le tympan blessé et il me sembla que j’avais droit à une compensation : — On ne pourrait pas avoir une cigarette, une seule ? Je la paierais bien dix couronnes, mais demain, car je n’ai pas un sou sur moi. Giovanna fut tout à fait épouvantée de ma proposition. Elle se mit à crier ; elle parlait d’appeler tout de suite l’infirmier ; elle quitta son siège pour s’en aller. Pour la faire taire, je renonçai aussitôt à mon projet et, pour dire quelque chose et me donner une contenance, je demandai : — Mais au moins, dans cette prison, il doit bien y avoir quelque chose à boire ? Giovanna fut prompte à me répondre et à mon étonnement, ce fut sur le ton de la conversation la plus posée, sans crier : — Mais certainement ! Le docteur, avant de sortir, m’a même remis cette bouteille de cognac. Voici la bouteille encore bouchée. Voyez, elle est intacte. Je me trouvais dans un tel état que je ne vis d’autre issue à ma situation que dans l’ivresse. Voilà où m’avait conduit ma confiance en ma femme ! À ce moment précis, mon vice ne me paraissait pas valoir l’effort auquel je m’étais laissé conduire. Il y avait une demi-heure déjà que je ne fumais plus et je n’y prenais pas garde, la pensée tout occupée par ma femme et le Dr Muli. J’étais donc complètement guéri, mais irrémédiablement ridicule ! Je débouchai la bouteille, et me versai un petit verre. Giovanna me regardait, bouche bée, mais j’hésitai à lui en offrir un. — Est-ce que je pourrai en avoir d’autre quand j’aurai vidé cette bouteille ? Giovanna, toujours sur le ton le plus affable de la conversation, me rassura : — Tant que vous en voudrez ! Pour satisfaire un de vos désirs, la dame qui a les clés de la réserve devrait se lever, fût-ce à minuit ! Je n’ai jamais été avare et Giovanna eut aussitôt son petit verre plein à ras bord. Elle n’avait pas fini de dire merci que son verre était déjà vide et qu’elle dardait un regard luisant vers la bouteille. Ce fut elle en vérité qui me donna l’idée de la saouler. Mais ce ne fut pas facile. Je ne saurais répéter exactement ce qu’elle me dit dans son pur dialecte triestin après avoir avalé pas mal de petits verres, mais j’eus l’impression d’avoir à mes côtés une personne que j’aurais pu écouter avec plaisir, sans les préoccupations qui m’en détournaient. Tout d’abord, elle me confia que c’était exactement comme cela qu’elle aimait travailler. Tout le monde, disait-elle, devrait avoir le droit de passer chaque jour une heure ou deux dans un bon fauteuil, en face d’une bonne bouteille d’eau-de-vie – de celles qui ne font pas de mal. J’essayai de parler à mon tour. Je lui demandai si, du vivant de son mari, son travail était organisé de cette façon. Elle se mit à rire. De son vivant, son mari l’avait plus battue que caressée et, en comparaison de ce qu’elle avait travaillé avec lui, tout maintenant pouvait lui paraître du repos, même avant mon arrivée dans cette maison de santé. Puis Giovanna devint pensive et me demanda si je croyais que les morts voient ce que font les vivants. Brièvement, je fis un signe affirmatif. Mais elle voulut savoir si les morts, en arrivant dans l’au-delà, y apprenaient tout ce qui était arrivé en ce bas monde de leur vivant. Cette question réussit un moment à me distraire. Elle m’avait été adressée d’une voix de plus en plus suave ; c’est que, pour ne pas se faire entendre des morts, Giovanna avait baissé la voix. — Ainsi donc, lui dis-je, vous avez trompé votre mari ? Elle me supplia de ne pas crier et m’avoua ensuite qu’elle l’avait trompé, mais seulement dans les premiers mois de leur mariage. Ensuite, elle s’était habituée aux coups et s’était mise à aimer son homme. Pour ranimer la conversation, je demandai : — C’est donc l’aînée de vos filles qui est de votre amant ? Toujours à voix basse, elle voulut bien l’admettre en se fondant sur certaines ressemblances. Elle regrettait beaucoup d’avoir trahi son mari. Elle l’affirmait, mais toujours en riant, car ce sont des choses dont on rit, même quand on les regrette. Mais elle le regrettait seulement depuis qu’il était mort, parce que, avant, comme il n’en savait rien, la chose ne pouvait avoir aucune importance. Poussé par une sorte de sympathie fraternelle, j’essayai d’adoucir sa douleur et lui dis que je croyais bien que les morts savaient tout, mais qu’ils se moquaient de certaines choses. — Seuls les vivants en souffrent ! m’écriai-je en frappant du poing sur la table. Je relevai ma main toute contusionnée ; rien de mieux qu’une douleur physique pour éveiller de nouvelles idées. J’entrevis une possibilité : pendant que je me torturais à l’idée que ma femme profitait de ma réclusion pour me tromper, le docteur se trouvait peut-être dans la maison de santé ; dans ce cas, toute tranquillité m’était rendue. Je priai Giovanna d’aller voir, en lui disant que j’éprouvais le besoin de parler au docteur et en lui promettant pour récompense la bouteille entière. Elle protesta qu’elle n’aimait pas boire autant, mais elle m’obéit sans retard et je l’entendis se hisser en titubant le long de l’escalier de bois jusqu’au deuxième étage pour sortir de notre prison. Elle redescendit aussitôt, mais elle glissa bruyamment et en poussant des cris : — Que le diable t’emporte ! murmurai-je avec ferveur. Si elle s’était rompu le cou, ma situation aurait été simplifiée de beaucoup. Mais elle vint à moi en souriant, elle était dans cet état où l’on ne sent plus trop la douleur. Elle me raconta qu’elle avait parlé à l’infirmier qui allait se coucher, mais même au lit, il restait à sa disposition dans le cas où je deviendrais mauvais. Elle leva la main et de l’index tendu accompagna ces mots d’un geste de menace atténué par un sourire. Puis, plus sèchement, elle ajouta que le docteur n’était pas rentré, depuis qu’il était sorti avec ma femme. Depuis ce moment-là, exactement ! Pendant plusieurs heures, l’infirmier avait espéré qu’il rentrerait parce qu’un malade avait besoin de lui. Mais à présent il ne l’espérait plus. Je la dévisageais, cherchant à savoir si le sourire qui contractait son visage était stéréotypé ou s’il était entièrement neuf, s’il provenait du fait que le docteur se trouvait avec ma femme au lieu d’être avec moi, son malade. Je fus envahi par une colère qui me faisait tourner la tête. Je dois avouer que, comme toujours, deux hommes luttaient en moi ; l’un, le plus raisonnable, me disait : “Imbécile ! Pourquoi penser que ta femme te trompe ? Elle n’aurait nul besoin de t’enfermer pour en trouver l’occasion.” L’autre, et c’était certainement celui qui voulait fumer, me traitait aussi d’imbécile, mais me criait : “Tu ne sais donc pas l’avantage que procure l’absence du mari ? Avec le docteur que tu paies !” Giovanna, tout en continuant à boire, dit : — J’ai oublié de fermer la porte du second étage. Mais je ne veux pas remonter ces deux étages. D’ailleurs, il y a toujours du monde là-haut, et si vous tentiez de vous sauver, vous en seriez pour vos frais. — Pour sûr, fis-je avec le minimum d’hypocrisie qu’il fallait pour tromper la pauvre femme. Puis je bus aussi du cognac, en disant que si j’avais toute cette eau-de-vie à ma disposition, je me moquais des cigarettes. Elle me crut aussitôt et je lui racontai alors que ce n’était pas moi qui ne voulais plus fumer, mais ma femme qui le voulait. Il fallait savoir qu’après avoir fumé une dizaine de cigarettes, je devenais terrible. Toutes les femmes qui étaient alors à ma portée se trouvaient en danger. Giovanna se mit à rire bruyamment, en se laissant aller sur sa chaise : — Et c’est votre femme qui vous empêche de fumer les dix cigarettes qu’il faut pour ça ? — Mais oui. Du moins, elle m’en empêchait. Giovanna n’était pas sotte quand elle avait tant de cognac dans le corps. Elle fut prise d’une crise d’hilarité qui manqua la faire tomber de son siège, mais chaque fois que le souffle le lui permettait, en paroles entrecoupées, elle s’employait à dépeindre un magnifique petit tableau inspiré par ma maladie : — Dix cigarettes… une demi-heure… on met le réveil… et puis… Je la repris : — Pour dix cigarettes, il me faut une heure environ. Puis pour en obtenir le plein effet, il faut encore une autre heure, à dix minutes près… Brusquement, Giovanna reprit son sérieux et se leva de sa chaise sans grand effort. Elle dit qu’elle allait se coucher parce qu’elle se sentait un léger mal de tête. Je l’invitai à emporter la bouteille ; j’avais, quant à moi, assez de cette eau-de-vie. Hypocritement, j’ajoutai que je désirais pour le lendemain qu’on me procure du bon vin. Mais elle ne pensait pas au vin. Avant de sortir, la bouteille sous le bras, elle me regarda et me lança une œillade qui m’épouvanta. J’avais laissé la porte ouverte et quelques instants plus tard tomba au milieu de la pièce un paquet que je ramassai aussitôt : il contenait onze cigarettes. Pour atteindre plus sûrement son but, Giovanna avait voulu se montrer généreuse. Des cigarettes hongroises, ordinaires. Mais la première que je grillai fut excellente. Je me sentais grandement soulagé. Je crus d’abord que je me réjouissais d’avoir réussi à m’évader de cette maison, bonne pour garder des enfants, mais non pas un homme tel que moi. Puis, je découvris que je jouais aussi un bon tour à ma femme et il me semblait que je lui rendais la monnaie de sa pièce. S’il en avait été autrement, pourquoi ma jalousie aurait-elle fait place à une curiosité si supportable ? Je restai tranquille à ma place à fumer ces cigarettes écœurantes. Au bout d’une demi-heure environ, je me souvins qu’il fallait fuir de cette maison où Giovanna attendait sa récompense. J’ôtai mes souliers et sortis dans le corridor. La porte de la chambre de Giovanna était entrouverte et, à en juger par sa respiration bruyante et régulière, elle me parut dormir. Je montai avec précaution jusqu’au second étage et avant de franchir cette porte, orgueil du docteur Muli, je remis mes chaussures. Je sortis sur le palier et commençai à descendre lentement pour ne pas éveiller les soupçons. J’étais arrivé au palier du premier quand une jeune fille, qui portait non sans élégance une blouse d’infirmière, me suivit pour me demander courtoisement : — Vous cherchez quelqu’un ? Elle était charmante et j’aurais volontiers fini auprès d’elle mes dix cigarettes. Je lui décochai un sourire un peu agressif : — Le Dr Muli n’est pas là ? — À pareille heure, il n’y est jamais. — Vous ne pourriez pas me dire où j’aurais une chance de le trouver en ce moment ? J’ai chez moi un malade qui aurait besoin de lui. Courtoisement, elle me donna l’adresse du docteur et je la répétai plusieurs fois pour lui faire croire que je ne voulais pas l’oublier. Je ne me serais pas hâté de m’en aller si, un peu ennuyée, elle ne m’avait tourné le dos. Littéralement on me jetait hors de ma prison. Au rez-de-chaussée, une femme fut prompte à m’ouvrir la porte. Je n’avais pas un sou sur moi ; je murmurai : — Je vous donnerai un pourboire la prochaine fois. On ne peut jamais connaître l’avenir. Dans ma vie, les choses se répètent : il n’était pas impossible que je fusse appelé à repasser par là. La nuit était claire et chaude. Je quittai mon chapeau pour mieux sentir la brise de la liberté. Je regardai les étoiles avec admiration comme si je les avais conquises à l’instant. Le lendemain, libéré de la maison de santé, j’allais cesser de fumer. En attendant, dans un débit encore ouvert, je me procurai de bonnes cigarettes ; il ne m’était vraiment pas possible de terminer ma carrière de fumeur avec une des cigarettes de cette pauvre Giovanna. Le garçon qui me servit me connaissait et me les laissa à crédit. Arrivé à ma villa, je sonnai furieusement. D’abord, ce fut la bonne qui se mit à la fenêtre, puis, au bout d’un certain temps, que je trouvai long, ma femme. J’attendis qu’elle apparût en pensant avec une certaine froideur : “On dirait bien que le docteur Muli est là.” Mais en me reconnaissant, ma femme fit retentir la rue déserte d’un éclat de rire si sincère qu’il aurait suffi à effacer tout soupçon. Je m’attardai à faire dans la maison un tour d’inquisiteur. Ma femme, à qui j’avais promis de raconter le lendemain mes aventures qu’elle croyait deviner, me demanda : — Pourquoi ne vas-tu pas au lit ? Pour m’excuser, je répondis : — Il me semble que tu as profité de mon absence pour changer cette armoire de place. Il est vrai que je crois que les objets chez moi sont constamment changés de place, et il est vrai d’ailleurs que ma femme les déplace souvent, mais à cet instant, je regardais dans tous les coins si l’élégante petite personne du docteur Muli ne s’y dissimulait pas. Ma femme m’apprit une bonne nouvelle. En revenant de la maison de santé, elle avait rencontré le fils d’Olivi qui lui avait raconté que son père allait beaucoup mieux après avoir pris une drogue ordonnée par un nouveau médecin. En m’endormant, je pensais que j’avais bien fait de quitter la maison de santé ; j’avais devant moi tout le temps nécessaire pour une cure lente. Mon fils qui dormait dans la chambre voisine n’était pas encore près de me juger et de m’imiter. Non, il n’y avait absolument pas besoin de se hâter.
IV - La mort de mon père
Le docteur est parti et je ne sais vraiment pas s’il y a lieu de faire la biographie de mon père. Je crains de me laisser entraîner à trop de détails et, de proche en proche, à une analyse qu’on pourrait juger, elle aussi, nécessaire à ma guérison. Ce serait rendre la cure impossible. Mais je reprends courage à l’idée que si mon père avait eu besoin d’un traitement psychanalytique, c’eût été pour une maladie sans aucun rapport avec la mienne. De toute façon, pour ne pas perdre de temps, je ne dirai de lui que ce qui pourra servir à raviver le souvenir de moi-même. “15. IV. 1890, 4 h 1/2. Mon père meurt. U.S.” Pour qui l’ignorerait, ces deux dernières lettres ne signifient pas United States, mais Ultima Sigaretta : dernière cigarette. Telle est la note que je trouve sur un volume de philosophie positive d’Ostwald, sur lequel, plein d’espérance, j’ai passé des heures, mais auquel je n’ai rien compris. On ne le croirait pas, eh bien, sous cette forme indécente, cette note enregistre l’événement le plus important de ma vie. Je n’avais pas quinze ans quand ma mère mourut. Je composai des vers à sa mémoire, mais composer des vers, ce n’est pas pleurer. J’avais le sentiment qu’à compter de ce jour commencerait pour moi une vie de travail, une vie sérieuse, intense, dont ma douleur me montrait le chemin. En outre, un sentiment religieux encore vif atténuait et adoucissait mon infortune. Ma mère continuait à vivre et bientôt elle allait jouir de mes succès qu’elle contemplerait de l’autre monde. Agréable commodité ! Je me rappelle exactement mon état d’esprit d’alors. Par la mort de ma mère et par la salutaire émotion que cette mort me procurait, tout, en moi, devait devenir meilleur. En revanche, la mort de mon père fut une vraie, une grande catastrophe. Le paradis n’existait plus et moi, à trente ans, j’étais un homme fini. Moi aussi ! Pour la première fois, je m’aperçus que la partie la plus importante, la partie décisive de ma vie gisait derrière moi, irrémédiablement. Ma douleur n’était pas seulement égoïste, comme ces mots le feraient croire. Loin de là ! Je pleurais sur lui et sur moi, et sur moi seul, parce qu’il était mort, lui. Jusqu’alors j’avais été de cigarette en cigarette – et d’une faculté à l’autre – avec une confiance indestructible en mes capacités. Je crois que cette confiance qui me rendait la vie bien douce, je l’aurais encore aujourd’hui si mon père n’était pas mort. Mais, lui mort, je n’avais plus un lendemain où situer ma résolution.