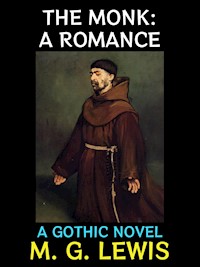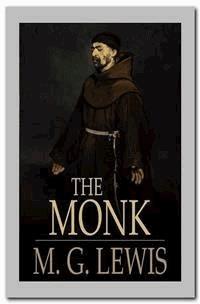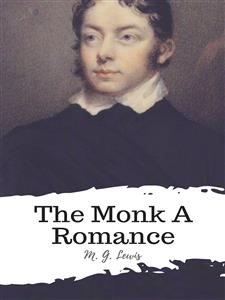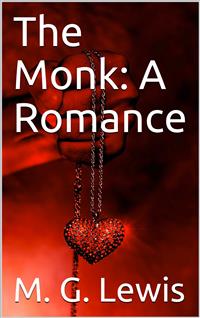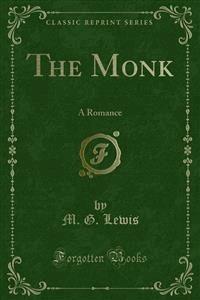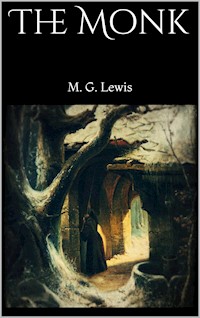0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Philaubooks
- Sprache: Französisch
"Dans le domaine littéraire, le merveilleux seul est capable de féconder des œuvres ressortissant à un genre inférieur tel que le roman et d’une façon générale tout ce qui participe de l’anecdote. Le Moine, de Lewis, en est une preuve admirable. Le souffle du merveilleux l’anime tout entier. Bien avant que l’auteur ait délivré ses principaux personnages de toute contrainte temporelle, on les sent prêts à agir avec une fierté sans précédent. Cette passion de l’éternité qui les soulève sans cesse prête des accents inoubliables à leur tourment et au mien. J’entends que ce livre n’exalte, du commencement à la fin, et le plus purement du monde, que ce qui de l’esprit aspire à quitter le sol et que, dépouillé d’une partie insignifiante de son affabulation romanesque, à la mode du temps, il constitue un modèle de justesse, et d’innocente grandeur."
Manifeste du surréalisme, André Breton.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Le moine
M. G. Lewis
Traduction parLéon De Wailly
philaubooks
Table des matières
Notice du traducteur.
Avertissement de l’auteur.
Préface
Tome I
Chapitre 1
Chapitre 2
Chapitre 3
Chapitre 4
Chapitre 5
Tome II
Chapitre 6
Chapitre 7
Chapitre 8
Chapitre 9
Chapitre 10
Chapitre 11
Chapitre 12
Couverture
Copyright © 2019 Philaubooks, pour ce livre numérique, à l’exclusion du contenu appartenant au domaine public ou placé sous licence libre.
ISBN : 979-10-372-0085-3
Notice du traducteur.
Matthew Gregory Lewis Par George Lethbridge Saunders.
L’auteur du Moine, Matthew-Gregory Lewis, né en 1773, était fils unique de Matthew Lewis, qui occupa longtemps le poste élevé et lucratif de secrétaire suppléant au ministère de la guerre, et de miss Sewell, dont la famille possédait des biens considérables à la Jamaïque. Au sortir de l’école de Westminster, son père l’envoya dans une université d’Allemagne pour apprendre la langue du pays. Le diable, à cette époque, était fort honoré dans la littérature allemande : notre auteur apprenti se prosterna, comme tout le monde, devant le pied fourchu, et lui voua, dès lors, un culte dont il ne s’est point départi.
Le Moine fut la première et la plus riche de ses offrandes. Lorsqu’il le composa, il n’avait guère plus de vingt ans, comme il nous l’apprend lui-même dans une préface en vers qu’on trouvera traduite ci-après. Ce roman, à son apparition, fit sensation de plus d’une manière ; car, tandis que le public, d’accord avec les connaisseurs, applaudissait à l’intérêt puissant de la composition et à la sombre vigueur du coloris, une des sociétés protectrices de la morale, alarmée de la vivacité de certains détails, alarmée peut-être aussi d’un passage sur le danger de mettre la Bible complète aux mains des jeunes filles, menaçait l’auteur d’un procès, et le procureur-général avait même commencé devant la cour du banc du roi à réaliser cette menace.
Ne se souciant pas d’accepter la lutte inégale que Byron plus tard devait soutenir à ses risque et péril, Lewis laissa les défenseurs officieux de la morale s’évertuer à retirer de la circulation les preuves de son méfait, et, dégoûté sans doute par ces tracasseries, il tourna ses vues vers la politique, et vint peu de temps après représenter au parlement le bourg de Hindon. Mais la politique n’était point son fait : ni la nature ni l’éducation ne l’avaient doué de cet aplomb qui est la base indispensable de toute éloquence ; et, après avoir joué aux communes un rôle parfaitement obscur, il rentra dans la carrière des lettres, où désormais le retinrent de nombreux et brillants succès.
Le Moine, qui, par l’ampleur des proportions et par le peu de fini des détails, tient plus de la décoration que du tableau, annonçait surtout un talent dramatique. En effet, ce fut par le théâtre que Lewis fit sa rentrée, et la réussite éclatante de son Castle spectre (le Spectre du château) justifia pleinement sa tentative. Deux débuts si heureux dans deux genres plus différents qu’ils ne paraissent l’être, lui indiquaient clairement les routes à suivre : il partagea son temps entre le roman et le drame, et, dans l’un comme dans l’autre, il resta fidèle à ses premières amours pour le terrible et le merveilleux. On peut le voir aux titres seuls de ses ouvrages, dont on trouvera la liste à la fin de cette notice.
Il n’était âgé que de trente-neuf ans, et il avait encore devant lui un long avenir littéraire, lorsque la mort de son père le laissa possesseur de riches plantations dans les Indes occidentales. Malgré la fougue de sa jeune imagination et les reproches qu’elle lui avait valus, Lewis était, dans sa conduite, un homme tout aussi vertueux que ses accusateurs.
Ce n’est pas qu’il fût exempt de faiblesses. Il était extrêmement petit, d’une taille de nain, comme il le dit lui-même ; et peut-être cette exiguïté physique n’avait pas été sans influence sur le moral : il était resté un peu enfant gâté. Byron, qui, à la vérité, n’est pas toujours l’indulgence même, le taxe d’un esprit de contradiction qui le rendait très fatigant. Walter Scott, avec plus de bienveillance et de bonhomie, lui reproche pourtant de citer continuellement des noms de ducs et de duchesses, et s’étonne de cette manie bourgeoise dans un homme de mérite, dans un homme qui, toute sa vie, avait fréquenté la bonne société et même la fashion.
« Mais, » ajoute-t-il, « avons-nous beaucoup d’amis qui n’aient que des ridicules ? Lewis était une des meilleures créatures qui aient existé. Son père et sa mère vivaient séparés, et le vieux Lewis, qui avait alloué à Matthew une pension assez forte, la réduisit de moitié lorsqu’il sut que celui-ci la partageait avec sa mère ; mais Matthew restreignit en proportion ses dépenses personnelles, et, tel qu’il était, son revenu fut employé comme auparavant. Il faisait beaucoup de bien à la dérobée. »
Dans cet héritage, où d’autres n’auraient vu qu’un accroissement de bien-être et de jouissances, il trouva des devoirs à remplir. Il était devenu maître de plusieurs centaines d’esclaves : comment étaient-ils traités ? Son cœur s’attendrit ; sa conscience s’alarma. Il ne voulut pas se rendre complice par sa négligence de toutes les atrocités qui pouvaient être commises en son nom. C’était un long voyage, un climat malsain ; mais l’humanité lui prescrivait de partir : il partit, donnant un bel exemple et bien peu suivi à tous les propriétaires absents de l’Irlande et autres lieux.
Après un séjour suffisant pour tout voir de l’œil du maître, et après une réforme aussi complète que possible des abus, il revint en Angleterre. Mais ses ordres pouvaient n’avoir pas été ponctuellement exécutés : il alla de nouveau l’année suivante à la Jamaïque.
Ce fut en 1818, au retour de ce second voyage qui avait fort altéré sa santé, qu’il mourut sur mer au moment où il traversait le golfe de la Floride. Mais que les sectateurs de l’absentéisme ne se fassent pas de cette mort un argument pour justifier leur égoïsme ; car, à ce qu’il paraît, ce n’est point le climat, c’est une idée fausse qui a tué Lewis. Contre tout avis, il persista à prendre chaque jour de l’émétique pour se préserver du mal de mer. C’était deviner l’homéopathie. Or, sans vouloir dénigrer ce système médical, nous le croyons destiné à faire plus de victimes, nous ne disons pas que la philanthropie, mais que l’humanité.
Sons le titre de Journal d’un propriétaire de l’Inde occidentale, Lewis a écrit une relation intéressante de son voyage à la Jamaïque ; et cette relation, qui est restée quinze ans sans être publiée, contient de curieux et rassurants détails sur la position des nègres, constate le bien et le mal avec impartialité, et abonde en idées excellentes, assaisonnées d’un enjouement spirituel.
Mais, quel que soit le mérite de cette publication posthume, qu’on loue volontiers en Angleterre aux dépens de son aînée, quel qu’ait été le succès des divers autres ouvrages de Lewis, le Moine est resté son titre populaire : il est même devenu son prénom, Monk Lewis (le Moine Lewis). L’enfant, chose bizarre, se trouve être le parrain de son père ; et ce baptême, la postérité l’a déjà confirmé. Lewis sera toujours Monk Lewis, non pas seulement parce que le public, lorsqu’il a classé un écrivain, se donne rarement la peine de réviser ses arrêts, mais parce que, après nombre d’imitations plus ou moins illustres et plus ou moins flagrantes, le Moine est resté aux premiers rangs de l’école satanique, grâce à la terreur grandiose de l’ensemble, à la peinture énergique des passions, et en particulier à la conception du rôle habilement gradué de Mathilde, ce démon séduisant, dont la mission est de corrompre le prieur.
Les ouvrages de mérite n’ont que trop souvent de la peine à percer : ne les laissons point retomber dans l’oubli. Le troupeau des imitateurs, en venant puiser aux sources, les trouble et les comble de graviers : il est juste, il est utile, au point de vue de l’histoire littéraire, de les déblayer de temps en temps, et de les remettre en lumière. Toutefois, ce sentiment de justice aurait cédé à la crainte de reproduire un livre immoral ; mais, malgré les anathèmes lancés contre lui, le Moine ne nous a pas paru tel. Outre que l’intention générale en est irréprochable — ce qui ne nous aurait pas suffi, car nous ne sommes pas de ceux qui croient que le but final justifie tous les écarts du voyage — dans les détails mêmes nous n’avons rien vu qui méritât l’accusation d’immoralité. Il est difficile qu’un auteur de vingt ans soit en état de se rendre coupable d’un délit aussi grave. Qualités et défauts, tout manque de profondeur à cet âge. Le Moine, il est vrai, contient des passages un peu vifs ; mais autre chose est d’éveiller les sens, ou de corrompre le cœur.
Où en serait la littérature de tous les temps et de tous les pays si, dans le même ouvrage, le discernement des lecteurs ne consentait pas à faire la part du bon et du mauvais ? Le temps où on brûlait les livres est passé ; mais il ne faut pas non plus qu’on les étouffe. Le talent ne court pas tellement les rues, même à Londres, qu’on doive tolérer ces holocaustes offerts par le cant sur les autels de la morale. Tous les honnêtes gens en France s’accordent à déplorer le cynisme de ces dernières années ; mais, par peur du cynisme, ils ne se jetteront pas dans les bras de l’hypocrisie. Si l’un est d’un exemple plus dangereux, l’autre a quelque chose de lâche qui répugne encore davantage. Pourquoi opter ? pourquoi détruire tout une moisson pour quelques mauvaises herbes ? Certaines fautes contre le goût, contre la décence, ne constituent pas un livre immoral. Qu’on interdise ces sortes de lectures aux jeunes filles ; mais il est impossible que les hommes faits n’aient pas une bibliothèque qui ne soit pas celle des enfants.
Il a déjà paru deux traductions du Moine : la première, intitulée le Jacobin espagnol(Paris, Favre, an vi, 4 vol. in-18) ; la seconde, sous son vrai titre (Paris, Maradan, an x, même format). Nous ne connaissons que cette dernière, que la France littéraire de Quérand attribue à MM. Deschamps, Després, Benoit et Lamare ; elle passe pour être la meilleure, et elle a eu plusieurs éditions. Elle est faite dans le système de dédaigneuse inexactitude et de fausse dignité de style qui prévalait alors : les capucins sont transformés en dominicains, les veilleuses en lampes antiques, etc…
C’est la faute du temps plus que celle des auteurs. Mais aujourd’hui que la paix a émancipé les traducteurs en éclairant le public, l’inexactitude serait sans excuse : les traducteurs sont des interprètes et non des juges ; ils ne doivent plus l’oublier. On s’occupe beaucoup, et avec raison, en ce moment des questions de propriété littéraire : mais c’est aussi bien intellectuellement que pécuniairement parlant qu’un ouvrage est la propriété de son auteur ; et de toutes les contrefaçons, celle qui lui sera le plus antipathique, ce sera toujours une traduction infidèle.
Pénétré de cette idée, nous nous sommes astreint à la fidélité la plus rigoureuse. Notre intention a été qu’un Anglais et un Français, ne sachant l’un et l’autre que leur langue maternelle, pussent s’entendre sur les défauts comme sur les beautés de l’original. Nous ne pouvions, du reste, choisir un ouvrage plus propre à mettre en évidence tous nos scrupules à cet égard ; car le style du Moine est d’une négligence et d’une diffusion qui pouvaient autoriser bien des licences : mais ces défauts ne l’ont point empêché d’obtenir dans le principe un immense succès, et nous avons persisté à nous abstenir de toutes corrections.
Liste des ouvrages de M. G. Lewis.
Le Moine (the Monk), 1795. 3 vol. in-12.
Les Vertus de Village (the Village Virtues), drame, 1796.
Le Ministre (the Minister), tragédie d’après Schiller, 1797.
Le Spectre du château (the Castle Spectre), drame, 1798.
Rolla, tragédie, 1799.
L’Amour du gain (the Love of gain), poème imité de la treizième satire de Juvénal, 1799.
L’Habitant des Indes orientales (the East Indian), comédie en 5 actes, 1800.
Adelmorn, ou le Proscrit (Adelmorn, or the Outlaw), drame romantique, 1801.
Alphonse, roi de Castille (Alphonso, king of Castile), tragédie, 1801.
Contes merveilleux (Tales of wonder), 1801. 2 vol. in-8.
Le Bravo de Venise (the Bravo of Venice), roman traduit de l’allemand, 1804.
Rugantino, mélodrame. 1805.
Adelgitha, ou les Fruits d’une seule erreur (Adelgitha, or the Fruits of a single error), tragédie en 5 actes, 1806.
Les Tyrans féodaux, ou les comtes de Carlsheim et de Sargens (Feudal tyrants, or the counts of Carlsheim and Sargens), roman d’après l’allemand, 1806. 4 vol. in-12.
Contes terribles (Tales of terror). 3 vol.
Contes romanesques (Romantic tales), 1808. 4 vol. in-12.
Veroni, drame, 1809.
Chant sur la mort de sir John Moore (Monody on the death of sir John Moore), 1809. in-4.
Une heure, ou le Chevalier et le Démon du bois (One o’clock, or the Knight and the wood Demon), romance, 1811.
Timour le Tartare (Timour the Tartar) mélodrame, 1812.
Poèmes (Poems), 1812. In-12.
Riche et Pauvre (Rich and Poor), opéra-comique, 1812.
Journal d’un propriétaire de l’Inde occidentale (Journal of a west India proprietor).
Avertissement de l’auteur.
La première idée de ce roman m’a été suggérée par l’histoire de Santon Barsisa, relatée dans le Guardian. — La Nonne sanglante est une tradition à laquelle on continue d’ajouter foi dans plusieurs parties de l’Allemagne ; et j’ai ouï dire que les ruines du Château de Lauestein, où elle est censée revenir, se voient encore sur les confins de la Thuringe. — Le Roi des eaux, de la troisième à la douzième stance, est un fragment d’une ballade danoise ; — et celle de Belerma et Durandarte est traduite de quelques strophes qui se trouvent dans un recueil de vieille poésie espagnole, lequel contient aussi la chanson populaire de Gayferos et Melesindra, dont il est parlé dans Don Quichotte. — Voilà ma confession pleine et entière des plagiats dont je me sais coupable ; mais je ne doute pas qu’on n’en puisse découvrir bien d’autres dont, en ce moment, je n’ai pas le moindre soupçon.
Préface
IMITATION D’HORACE.
Epître 20. — 1.
Il me semble, ô livre vain et sans jugement ! que je te vois lancer un regard de désir là où les réputations s’acquièrent et se perdent dans la fameuse rue appelée Pater-Noster. Furieux que ta précieuse olla podrida soit ensevelie dans un portefeuille oublié, tu dédaignes la serrure et la clef prudentes, et tu aspires à te voir, bien relié et doré, figurer aux vitres de Stockdale, de Hookham ou de Debrett.
Va donc, et passe cette borne dangereuse d’où jamais livre ne peut revenir ; et quand tu te trouveras condamné, méprisé, négligé, blâmé et critiqué, injurié de tous les lecteurs de ta chute (si tant est que tu en aies un seul), tu déploreras amèrement ta folie, et tu soupireras après moi, mon logis et le repos.
Maintenant, faisant l’office de magicien, voici la destinée future que je te prophétise : dès que ta nouveauté sera passée, et que tu ne seras plus jeune et neuf, jetées dans quelque sombre et sale coin, moisies et toutes couvertes de toiles d’araignée, tes feuilles seront la proie des vers ; ou bien, envoyées chez l’épicier, et condamnées à subir les brocards du public, elles garniront le coffre ou envelopperont la chandelle.
Mais dans le cas où tu obtiendrais l’approbation et où quelqu’un, par une transition naturelle, serait tenté de t’interroger sur moi et sur ma condition, apprends au questionneur que je suis un homme ni très pauvre, ni très riche ; de passions fortes, d’un caractère pétulant, d’une tournure sans grâce et d’une taille de nain ; peu approuvé, n’approuvant guère ; extrême dans la haine et dans l’amour ; abhorrant tous ceux qui me déplaisent, adorant ceux pour qui je me prends de fantaisie ; jamais long à former un jugement, et la plupart du temps jugeant mal ; solide en amitié, mais croyant toujours les autres traîtres et trompeurs, et pensant que dans l’ère présente l’amitié est une pure chimère ; plus emporté qu’aucune créature vivante ; orgueilleux, entêté et rancunier ; mais cependant, pour ceux qui me témoignent de l’affection, prêt à aller à travers feu et fumée.
Si encore on te demandait : « Je vous prie, quel peut être l’âge de l’auteur ? » tes fautes, à coup sûr, l’indiqueront : j’ai à peine vu ma vingtième année, qui, cher lecteur, sur ma parole, arriva lorsque George III occupait le trône d’Angleterre.
À présent donc, poursuis ta course aventureuse ; allez, mes délices — cher livre, adieu !
M. G. L.
La Haye, 28 octobre 1794.
Tome I
1
Le seigneur Angelo est austère ; il se tient en garde contre d’envie ; c’est à peine s’il avoue que son sang circule, ou qu’il a plus d’appétit pour le pain que pour la pierre.
Mesure pour Mesure. Shakespeare.
Il y avait à peine cinq minutes que la cloche du couvent sonnait, et déjà la foule se pressait dans l’église des Capucins. N’allez pas croire que cette affluence eût la dévotion pour cause, ou la soif de s’instruire. Ce n’étaient là que de rares exceptions : dans une ville telle que Madrid, où la superstition règne en despote, on chercherait inutilement la vraie piété. L’auditoire assemblé dans l’église des Capucins y était attiré par des raisons diverses, mais toutes étrangères au motif ostensible. Les femmes venaient pour se montrer, et les hommes pour voir les femmes : ceux-ci par curiosité d’entendre un si fameux prédicateur ; ceux-là faute de meilleure distraction avant l’heure de la comédie ; d’autres encore, parce qu’on leur avait assuré qu’il n’était pas possible de trouver des places dans l’église ; enfin la moitié de Madrid était venue dans l’espoir d’y rencontrer l’autre. Les seules personnes qui eussent réellement envie d’entendre le sermon, étaient quelques dévotes surannées, et une demi-douzaine de prédicateurs rivaux, bien déterminés à le critiquer et à le tourner en ridicule. Quant au reste des assistants, le sermon aurait pu être supprimé sans qu’ils fussent désappointés, et même très probablement sans qu’ils s’aperçussent de la suppression.
Quoi qu’il en soit, il est certain du moins que jamais l’église des Capucins n’avait reçu une plus nombreuse assemblée. Tous les coins étaient remplis, tous les sièges étaient occupés ; même les statues qui décoraient les longues galeries avaient été mises à contribution : des enfants s’étaient suspendus aux ailes des chérubins ; saint François et saint Marc portaient chacun un spectateur sur leurs épaules, et sainte Agathe se trouvait avoir double charge. Aussi, malgré toute leur diligence, nos deux nouvelles venues, en entrant dans l’église, eurent beau regarder alentour : pas une place.
Néanmoins la vieille continua d’avancer. En vain des exclamations de mécontentement s’élevaient contre elle de tout côté ; en vain on l’apostrophait avec — « Je vous assure, señora, qu’il n’y a pas de place ici. » — « Je vous prie, señora, de ne pas me pousser si rudement. » — « Señora, vous ne pouvez pas passer par ici. Mon Dieu ! comment peut-on être si peu sans gêne ! » la vieille était obstinée, et elle allait toujours. À force de persévérance, et grâce à deux bras musculeux, elle s’ouvrit un passage au travers de la foule, et parvint à se pousser au beau milieu de l’église, à une très petite distance de la chaire. Sa compagne l’avait suivie timidement et en silence, ne faisant que profiter de ses efforts.
« Sainte Vierge ! » s’écria la vieille d’un air désappointé, tout en cherchant de l’œil autour d’elle ; « Sainte Vierge ! quelle chaleur ! quelle foule ! qu’est-ce que cela veut dire ? Je crois qu’il faudra nous en retourner : il n’y a pas l’ombre d’un siège vacant, et je ne vois personne d’assez obligeant pour nous offrir le sien. »
Cette insinuation peu équivoque éveilla l’attention de deux cavaliers qui occupaient des tabourets à droite, et avaient le dos appuyé contre la septième colonne à compter de la chaire. Tous deux étaient jeunes et richement vêtus. À cet appel fait à leur politesse par une voix de femme, ils suspendirent leur conversation pour regarder qui parlait. La vieille avait relevé son voile pour faciliter ses recherches dans la cathédrale. Ses cheveux étaient roux, et elle louchait. Les cavaliers se retournèrent et reprirent leur conversation.
« De grâce, » repartit la compagne de la vieille, « de grâce, Léonella, retournons tout de suite chez nous ; la chaleur est excessive, et je me meurs de peur au milieu de cette foule. »
Ces paroles avaient été prononcées avec une douceur sans égale. Les cavaliers interrompirent de nouveau leur entretien ; mais, cette fois, ils ne se contentèrent pas de regarder : tous deux se levèrent involontairement de leurs sièges, et se tournèrent vers celle qui venait de parler.
C’était une personne dont la tournure élégante et délicate inspira aux jeunes gens la curiosité de voir sa figure. Ils n’eurent pas cette satisfaction. Ses traits étaient cachés par un voile épais ; mais sa lutte avec la foule l’avait suffisamment dérangé pour découvrir un cou qui aurait pu rivaliser de beauté avec celui de la Vénus de Médicis. Il était d’une blancheur éblouissante, et encore embelli par de longs flots de cheveux blonds qui descendaient en boucles jusqu’à sa ceinture. Sa taille, plutôt au-dessous qu’au-dessus de la moyenne, était légère et aérienne comme celle d’une hamadryade. Son sein était soigneusement voilé. Sa robe était blanche, nouée d’une ceinture bleue, et laissait tout juste apercevoir un petit pied mignon et des mieux faits. Un chapelet à gros grains pondait à son bras, et son visage était couvert d’un voile d’épaisse gaze noire. Telle était la femme à laquelle le plus jeune des cavaliers offrit son siège, ce qui força l’autre de faire la même politesse à la vieille dame.
Celle-ci accepta l’offre avec de grandes démonstrations de reconnaissance, mais sans faire beaucoup de façons ; la jeune suivit son exemple, mais ne fit pour tout compliment qu’une révérence simple et gracieuse. Don Lorenzo (tel était le nom du cavalier dont elle avait accepté le siège) se mit près d’elle ; mais il avait auparavant dit quelques paroles à l’oreille de son ami, qui comprit à demi-mot, et tâcha de faire oublier à la vieille son aimable pupille.
« Vous êtes sans doute arrivée depuis peu à Madrid ? » dit Lorenzo à sa charmante voisine, « tant d’attraits n’auraient pu rester longtemps inaperçus ; et si ce n’était pas aujourd’hui votre première apparition, la jalousie des femmes et l’adoration des hommes vous auraient fait remarquer. »
Il s’arrêta dans l’espoir d’une réponse. Comme sa phrase n’en exigeait pas absolument, la dame n’ouvrit point les lèvres : après quelques instants, il reprit :
« Ai-je tort de supposer que vous êtes étrangère à Madrid ? »
La dame hésita ; et enfin, d’une voix si basse qu’elle était à peine intelligible, elle fit un effort et répondit : « Non, señor. »
« Votre intention est-elle d’y rester quelque temps ? »
« Oui, señor. »
« Je m’estimerais heureux, s’il était en mon pouvoir de contribuer à vous en rendre le séjour agréable. Je suis bien connu à Madrid, et ma famille n’est pas sans crédit à la cour. Si je puis vous être de quelque utilité, disposez de moi ; ce sera me faire honneur et plaisir. » — « Assurément, » se dit-il, « elle ne peut pas répondre à cela par un monosyllabe : cette fois il faut qu’elle me dise quelque chose. »
Lorenzo se trompait : la dame salua de la tête pour toute réponse.
Pour le coup, il avait reconnu que sa voisine n’aimait guère à causer ; mais ce silence provenait-il d’orgueil, de réserve, de timidité ou de bêtise, c’est ce qu’il ne pouvait encore décider.
Après une pause de quelques minutes : « C’est sans doute parce que vous êtes étrangère, » dit-il, « et encore peu au fait de nos usages, que vous continuez à porter votre voile ? Permettez-moi de vous le retirer. »
En même temps il avançait sa main vers la gaze ; la dame l’arrêta.
« Je n’ôte jamais mon voile en public, señor. »
« Et où est le mal, je vous prie ? » interrompit sa compagne, non sans aigreur. « Ne voyez-vous pas que toutes les autres dames ont quitté le leur, par respect pour le saint lieu où nous sommes ? J’ai déjà moi-même ôté le mien ; et certes, si j’expose mes traits à tous les regards, vous n’avez aucune raison de prendre ainsi l’alarme. Bienheureuse Marie ! que d’embarras pour la figure d’une enfant ! Allons, allons, petite fille ! découvrez-la. Je vous garantis que personne ne vous l’emportera. »
« Chère tante, ce n’est pas l’usage en Murcie. »
« En Murcie, vraiment ! Sainte Barbara ! qu’importe ? Vous êtes toujours à me rappeler cette infâme province. C’est l’usage à Madrid, c’est là tout ce qui doit nous occuper. Je vous prie donc d’ôter votre voile à l’instant même : obéissez-moi tout de suite, Antonia ; vous savez que je ne peux pas souffrir qu’on raisonne. »
La nièce se tut, mais elle ne mit plus obstacle aux tentatives de Lorenzo, qui, fort de l’approbation du la tante, se hâta d’écarter la gaze. Quelle tête de séraphin se présenta à son admiration ! Cependant elle était plus séduisante que belle ; le charme était moins dans la régularité du visage, que dans la douceur et la sensibilité de la physionomie. À les détailler, ses traits, pour la plupart, étaient loin d’être parfaits ; mais l’ensemble en était adorable. Sa peau, quoique blanche, n’était pas sans quelques taches ; ses yeux n’étaient pas très grands, ni ses paupières remarquablement longues. Mais aussi ses lèvres avaient toute la fraîcheur de la rose : son cou, sa main, son bras, étaient admirables de proportions ; ses paisibles yeux bleus avaient toute la douceur du ciel, et leur cristal étincelait de tout l’éclat des diamants. Elle paraissait âgée d’à peine quinze ans. Un malin sourire qui se jouait sur ses lèvres, annonçait en elle une vivacité qu’une timidité excessive comprimait encore. Ses regards étaient pleins d’un embarras modeste, et chaque fois qu’ils rencontraient par hasard ceux de Lorenzo, elle les baissait aussitôt ; ses joues se couvraient de rougeur, et elle se mettait à dire son chapelet, quoique sa contenance montrât clairement qu’elle ne savait pas ce qu’elle faisait.
Lorenzo la contemplait avec un mélange de surprise et d’admiration. Mais la tante jugea nécessaire de faire l’apologie de la mauvaise honte d’Antonia.
« C’est une enfant, » dit-elle, « qui n’a rien vu du monde. Elle a été élevée dans un vieux château en Murcie, sans autre société que celle de sa mère, qui, Dieu lui fasse paix, la bonne âme ! n’a pas plus de bon sens qu’il n’en faut pour porter sa soupe à sa bouche ; et pourtant c’est ma propre sœur, ma sœur de père et de mère ! »
« Et elle a si peu de bon sens ! » dit don Christoval avec un étonnement simulé. « Voilà qui est extraordinaire ! »
« N’est-ce pas, señor, que c’est étrange ? Mais c’est un fait, et malgré cela, voyez le bonheur de certaines gens ! Un jeune gentilhomme, d’une des premières familles, ne se mit-il pas en tête qu’Elvire avait des prétentions à la beauté ! Quant à des prétentions, le fait est qu’elle n’en manquait pas ; mais, quant à la beauté ! — si j’avais pris pour m’embellir la moitié autant de peine — Mais ce n’est pas de cela qu’il s’agit. Comme je vous le disais, señor, un jeune gentilhomme tomba amoureux d’elle, et l’épousa à l’insu de son père. Leur union resta secrète près de trois ans ; mais enfin la nouvelle en vint aux oreilles du vieux marquis, lequel, comme vous pouvez bien le supposer, n’en fut pas très charmé. Il prit la poste et se rendit en toute hâte à Cordoue, résolu de s’emparer d’Elvire et de l’envoyer n’importe où, pourvu qu’il n’en entendît plus parler. Bienheureux Saint Paul ! comme il tempêta quand il vit qu’elle lui avait échappé, qu’elle avait rejoint son mari, et qu’ils s’étaient embarqués ensemble pour les Indes ! Il jura contre nous tous, comme s’il eût été possédé du malin esprit ; il fit jeter mon père on prison, mon père, le cordonnier le plus honnête et le plus laborieux qui fût à Cordoue ; et à son départ, il eut la cruauté de nous prendre le petit garçon de ma sœur, alors à peine âgé de deux ans, et que, dans la précipitation de la fuite, elle avait été obligée de laisser derrière elle. Je présume que le pauvre petit misérable fut cruellement traité par lui, car, peu de mois après, nous reçûmes la nouvelle de sa mort. »
« C’était, señora, un terrible homme que ce vieillard ! »
« Horrible ! et si totalement dénué de goût ! Le croiriez-vous, señor ? quand je m’efforçai de l’apaiser, il me traita de maudite sorcière, et il souhaita que, pour punir le comte, ma sœur devînt aussi laide que moi ! Laide ! en vérité ! il est adorable ! »
« On n’est pas plus ridicule ! » s’écria don Christoval. « Sans aucun doute le comte eût été trop heureux de pouvoir échanger une sœur contre l’autre. »
« Oh ! Jésus ! señor, vous êtes réellement trop poli ! Néanmoins, je suis enchantée, ma foi, que le comte ait été d’un autre avis. Elviro a fait là une si brillante affaire ! Après être restée à bouillir et à rôtir aux Indes pendant treize longues années, son mari meurt, et elle revient en Espagne, sans un toit pour abriter sa tête, sans argent pour s’en procurer. Antonia, que voici, était toute petite alors, et c’était le seul enfant qui lui restât. Elle trouva son beau-père remarié ; il était toujours furieux contre le comte, et sa seconde femme lui avait donné un fils, qui, à ce qu’on dit, est un fort beau jeune homme. Le vieux marquis refusa de voir ma sœur et son enfant ; mais il lui fit savoir que, sous la condition de ne jamais entendre parler d’elle, il lui assignerait une petite pension, et lui permettrait de vivre dans un vieux château qu’il possédait en Murcie. Ce château avait été l’habitation favorite de son fils aîné ; mais, depuis que ce fils s’était enfui d’Espagne, le vieux marquis ne pouvait plus souffrir cette résidence, et la laissait tomber en ruine. Ma sœur accepta la proposition ; elle se retira en Murcie, et elle y est restée jusqu’au mois dernier. »
« Et quel motif l’amène à Madrid ? » s’informa don Lorenzo, qui admirait trop la jeune Antonia pour ne pas prendre un vif intérêt au récit de la vieille bavarde.
« Hélas ! señor, son beau-père vient de mourir, et l’intendant du domaine de Murcie a refusé de lui payer plus longtemps sa pension. Elle vient à Madrid dans l’intention de supplier le nouvel héritier de la lui continuer ; mais je crois qu’elle aurait bien pu s’épargner cette peine. Vous autres jeunes seigneurs, vous savez toujours que faire de votre argent, et vous êtes rarement disposés à vous en priver pour de vieilles femmes. J’avais conseillé à ma sœur d’envoyer Antonia avec sa pétition : mais elle n’a pas voulu m’écouter. Elle est si obstinée ! aussi elle se trouvera mal de n’avoir pas suivi mon idée. L’enfant a un joli petit minois, et peut-être bien qu’elle aurait obtenu beaucoup. »
« Ah ! señora ! » interrompit don Christoval prenant un air passionné, « s’il faut un joli minois, pourquoi votre sœur n’a-t-elle pas recours à vous ? »
« Oh ! Jésus ! señor, je vous jure que je suis tout accablée de vos galanteries. Mais je connais trop bien le danger de pareilles commissions, pour me mettre à la merci d’un jeune gentilhomme. Non, non ; jusqu’ici j’ai préservé ma réputation de toute atteinte, et j’ai toujours su tenir les hommes à distance. »
« Oh ! pour cela, señora, je n’en doute nullement. Mais, permettez-moi de vous le demander, vous avez donc de l’aversion pour le mariage ? »
« Voilà une question un peu personnelle. Je ne puis pourtant m’empêcher d’avouer que s’il se présentait un aimable cavalier — »
Ici elle voulut lancer à don Christoval un regard tendre et significatif ; mais comme malheureusement elle louchait abominablement, l’œillade tomba sur Lorenzo, qui prit le compliment pour lui, et y répondit par un profond salut.
« Puis-je vous demander, » dit-il, « le nom du marquis ? »
« Le marquis de Las Cisternas. »
« Je le connais intimement. Il n’est point à Madrid pour le moment, mais on l’attend de jour en jour. C’est le meilleur des hommes ; et si l’aimable Antonia veut me permettre d’être son avocat auprès de lui, je me flatte d’être en état de lui faire gagner sa cause. »
Antonia leva ses veux bleus, et le remercia silencieusement de cette offre par un sourire d’une douceur inexprimable. La satisfaction de Léonella fut beaucoup plus bruyante. Le fait est que, comme généralement sa nièce était fort silencieuse en sa présence, elle regardait comme un devoir de parler assez pour deux ; et ce devoir, elle s’en acquittait sans peine, car il était bien rare qu’elle se trouvât à court de paroles.
« Oh ! señor ! » s’écria-t-elle, « toute notre famille vous en aura les plus grandes obligations ! J’accepte votre offre avec toute la reconnaissance possible, et je vous rends mille grâces de votre générosité. Antonia, pourquoi ne parlez-vous pas, ma chère ? Monsieur vous dit toutes sortes de choses civiles, et vous restez comme une statue, et vous ne prononcez pas une seule syllabe de remerciements, ni bonne, ni mauvaise ! »
« Ma chère tante, je sens que — »
« Fi donc ! ma nièce, que de fois je vous ai dit qu’il ne fallait jamais interrompre une personne qui parle ! quand m’avez-vous vue faire une pareille chose ? Sont-ce là vos manières de Murcie ? Miséricorde ! jamais je ne ferai de cette fille-là rien qui ressemble à une personne bien élevée. Mais je vous prie, señor, » continua-t-elle en s’adressant à don Christoval, « apprenez-moi pourquoi il y a tant de monde aujourd’hui dans cette cathédrale. »
« Est-il possible que vous ignoriez qu’Ambrosio, le prieur de ce monastère, prononce ici un sermon tous les jeudis ? Madrid entier retentit de ses louanges. Il n’a encore prêché que trois fois ; mais tous ceux qui l’ont entendu sont tellement ravis de son éloquence, qu’il est aussi difficile de se procurer des places à l’église qu’à la première représentation d’une nouvelle comédie. Sa réputation a dû certainement parvenir jusqu’à vous. »
« Hélas ! señor, jusqu’à hier je n’avais pas eu le bonheur de voir Madrid ; et à Cordoue nous sommes si peu informés de ce qui se passe dans le reste du monde, que jamais le nom d’Ambrosio n’a été prononcé dans ses murs. »
« Vous le trouverez ici dans toutes les bouches. Ce moine semble avoir fasciné tous les habitants ; et n’ayant point moi-même assisté à ses sermons, je suis étonné de l’enthousiasme qu’il excite. Jeune et vieux, homme et femme, c’est une adoration générale et sans exemple. Nos grands l’accablent de présents ; leurs femmes refusent tout autre confesseur, et il est connu par toute la ville sous le nom de l’homme de Dieu. »
« Je ne vous demande pas, señor, s’il est de noble origine ? »
« On l’ignore jusqu’à présent. Le dernier prieur des capucins le trouva, encore enfant, à la porte du monastère ; toutes les recherches que l’on a faites pour découvrir qui l’avait laissé là ont été inutiles, et lui-même n’a pu donner aucun indice sur ses parents. Il a été élevé dans le couvent, et il y est resté depuis, il a montré de bonne heure un goût décidé pour l’étude et pour la retraite, et aussitôt qu’il a été en âge, il a prononcé ses vœux. Personne ne s’est jamais présenté pour le réclamer, ou pour éclaircir le mystère qui couvre sa naissance ; et les moines, qui y trouvent leur compte à cause de la vogue qu’il procure à leur maison, n’ont pas hésité à publier que c’est un présent que leur a fait la Vierge. En vérité, la singulière austérité de sa vie prête quelque appui à cette version. Il est maintenant âgé de trente ans, et chacune de ses heures s’est passée dans l’étude, dans un isolement absolu du monde, et dans la mortification de la chair. Avant d’être nommé supérieur de sa communauté, il y a de cela trois semaines, il n’était jamais sorti des murs du couvent ; même à présent il ne les quitte que le jeudi, lorsqu’il vient dans cette cathédrale prononcer un sermon qui attire tout Madrid. Sa science, dit-on, est des plus profondes, son éloquence des plus persuasives ; dans le cours entier de sa vie, il n’a pas, que l’on sache, transgressé une seule règle de son ordre ; on ne découvre pas la plus petite tache à sa réputation ; et il passe pour observer si strictement son vœu de chasteté, qu’il ne sait pas en quoi consiste la différence qu’il y a entre l’homme et la femme. Aussi les gens du peuple le regardent comme un saint. »
« Un saint pour cela ? » dit Antonia. « Alors je suis donc une sainte ? »
« Bienheureuse Barbara ! » s’écria Léonella, « quelle question ! fi donc ! petite fille, fi donc ! ce ne sont pas là des sujets convenables pour de jeunes personnes. Vous ne devriez pas avoir l’air de vous souvenir qu’il existe sur la terre rien de semblable à un homme, et vous devriez supposer que tout le monde est du même sexe que vous. Il serait beau de vous voir donner à entendre aux gens que vous savez que les hommes n’ont point de gorge, point de hanches, point de — »
L’ignorance d’Antonia aurait été bientôt dissipée par la leçon de sa tante ; mais heureusement un murmure général dans l’église annonça l’arrivée du prédicateur. Dona Léonella se leva pour le mieux voir, et Antonia suivit son exemple.
C’était un homme d’un port noble et d’un aspect imposant. Sa taille était haute, et sa figure remarquablement belle ; il avait un nez aquilin, de grands yeux noirs et étincelants, et d’épais sourcils qui se touchaient presque ; son teint était d’un brun foncé, mais transparent ; l’étude et les veilles avaient entièrement décoloré ses joues ; la tranquillité régnait sur son front sans rides ; et le contentement, exprimé dans chacun de ses traits, annonçait une âme exempte de soucis comme de crimes. Il salua humblement l’assemblée ; pourtant, même alors, il y avait dans sa physionomie et dans sa contenance une certaine sévérité qui imposait généralement, et peu de regards étaient capables de soutenir le feu des siens. Tel était Ambrosio, prieur des capucins, et surnommé l’homme de Dieu.
Antonia, qui le considérait avidement, sentit son cœur troublé d’un plaisir inconnu, et dont elle chercha vainement à se rendre compte. Elle attendait avec impatience que le sermon commençât ; et lorsque enfin le moine parla, le son de sa voix sembla la pénétrer jusqu’au fond de l’âme. Quoique aucun autre des assistants n’éprouvât d’aussi violentes sensations que la jeune Antonia, ils écoutaient tous avec intérêt et émotion. Ceux qui étaient insensibles à la morale du prêtre, étaient enchantés du talent de l’orateur ; tous sentaient leur attention irrésistiblement dominée, et le plus profond silence régnait dans la foule. Lorenzo lui-même ne put résister au charme ; il oublia qu’Antonia était assise près de lui, et n’eut plus d’oreilles que pour le prédicateur.
Dans un langage nerveux, clair et simple, le moine développa les beautés de la religion. Il donna de certains passages des Saintes Écritures une explication qui entraîna la conviction générale. Sa voix, distincte à la fois et grave, sembla chargée de toutes les menaces de la tempête, lorsqu’il déclama contre les vices de l’humanité et décrivit les châtiments qui les attendaient dans la vie future. Chaque auditeur fit un retour sur ses offenses passées, et trembla : chacun entendait rouler sur sa tête le tonnerre dont l’éclat devait l’écraser ; chacun voyait s’ouvrir sous ses pieds l’abîme de la destruction éternelle. Mais lorsque Ambrosio, changeant de thème, célébra les mérites d’une conscience sans tache, le glorieux avenir promis aux âmes exemples de reproches, et la récompense qui leur était réservée dans les régions de la gloire infinie, les assistants sentirent peu à peu se relever leurs esprits abattus, ils se jetèrent avec confiance aux pieds miséricordieux de leur juge, ils s’attachèrent avec joie aux paroles consolantes du prédicateur ; et cette voix sonore, répandant sur eux sa mélodie, les transporta dans ces contrées heureuses qu’il peignait à leur imagination sous des couleurs si vives et si brillantes.
Le sermon était fort étendu ; cependant, lorsqu’il fut terminé, les auditeurs regrettèrent qu’il n’eût pas duré plus longtemps. Quoique le moine eût cesse de parler, un silence d’admiration régnait encore dans l’église. À la fin, le charme s’étant dissipé par degrés, l’enthousiasme général se manifesta hautement. Ambrosio descendait de la chaire : on l’entoura, on le combla de bénédictions, on tomba à ses pieds, on baisa le bord de sa robe. Il passa lentement, les mains dévotement croisées sur sa poitrine, jusqu’à la porte qui donnait dans la chapelle du couvent, et où ses moines attendaient son retour. Il monta les marches, et alors, se tournant vers ceux qui le suivaient, il leur adressa quelques mots de reconnaissance et d’exhortation. Comme il parlait, son rosaire, composé de gros grains d’ambre, lui échappa de la main, et roula au milieu de la multitude. Elle s’en saisit avec avidité, et se le partagea immédiatement. Tous ceux qui purent en avoir un grain, le conservèrent comme une précieuse relique ; et quand c’eût été le chapelet du trois fois béni saint François lui-même, on ne se le serait pas disputé avec plus d’ardeur. Le prieur sourit de leur empressement, et leur ayant donné sa bénédiction, il quitta l’église. L’humilité était sur tous ses traits : était-elle aussi dans son cœur ?
Antonia le suivit des yeux avec anxiété. Il lui sembla, quand la porte se referma sur lui, qu’elle venait de perdre quelque chose d’essentiel à son bonheur ; une larme roula en silence sur sa joue.
« Il est séparé du monde ! » se dit-elle ; « peut-être ne le verrai-je plus ! »
Comme elle essuyait cette larme, Lorenzo remarqua son mouvement.
« Êtes-vous contente de notre prédicateur ? » dit-il ; « ou pensez-vous que Madrid élève trop haut son talent ? »
Le cœur d’Antonia était si plein d’admiration pour le moine, qu’elle saisît avidement l’occasion de parler de lui : d’ailleurs, ne considérant plus Lorenzo précisément comme un étranger, elle se sentait moins embarrassée par son extrême timidité.
« Oh ! il dépasse de beaucoup mon attente, » répondit-elle ; « jusqu’ici, je n’avais aucune idée du pouvoir de l’éloquence ; mais, tandis qu’il parlait, sa voix m’a inspiré tant d’intérêt, tant d’estime, je dirais presque tant d’affection pour lui, que je suis moi-même étonnée de la vivacité de mes sentiments. »
Lorenzo sourit de la force de ces expressions.
« Vous êtes jeune, et vous débutez dans la vie, » dit-il : « votre cœur, neuf au monde, et plein de chaleur et de sensibilité, reçoit avidement ses premières impressions ; sans artifice vous-même, vous ne soupçonnez pas les autres d’imposture ; et, voyant le monde à travers le prisme de votre innocence et de votre sincérité, vous vous imaginez que tout ce qui vous entoure mérite votre confiance et votre estime. Quel malheur que de si riantes visions doivent bientôt se dissiper ! quel malheur qu’il vous faille bientôt découvrir la bassesse du genre humain, et vous garder de vos semblables comme d’autant d’ennemis ! »
« Hélas ! señor, » répondit Antonia, « les infortunes de mes parents ne m’ont déjà fourni que trop d’exemples attristants de la perfidie du monde ! mais assurément cette fois, la chaleur de la sympathie ne peut m’avoir trompée. »
« Cette fois, je reconnais que non. La réputation d’Ambrosio est tout à fait sans reproche ; et un homme qui a passé toute sa vie entre les murs d’un couvent, ne peut avoir trouvé l’occasion de mal faire, quand même son penchant l’y pousserait. Mais à présent que les devoirs de sa position vont l’obliger d’entrer de temps à autre dans le monde, et le jeter sur la voie de la tentation, c’est à présent qu’il aura à montrer sa vertu dans tout son éclat. L’épreuve est dangereuse ; il est précisément à cette époque de la vie où les passions sont Le plus violentes, le le plus indomptées, plus despotiques. Sa réputation le désignera aux séductions comme une victime illustre ; la nouveauté ajoutera ses charmes aux entraînements du plaisir : et les talents même dont la nature l’a doué contribueront à sa ruine, en lui facilitant les moyens de satisfaire ses désirs. Bien peu de gens reviendraient vainqueurs d’une lutte si périlleuse. »
« Oh ! si restreint qu’en soit le nombre, Ambrosio en sera certainement. »
« Je n’en doute pas non plus : sous tous les rapports, il fait exception parmi les hommes, et l’envie chercherait en vain une tache sur sa réputation. »
« Vous me ravissez, señor, en me donnant cette assurance ! elle m’encourage à m’abandonner à la prévention favorable qu’il m’inspire, et vous ne savez pas quelle peine j’aurais eue à réprimer ce sentiment ! Ah ! très chère tante, engagez ma mère à le choisir pour notre confesseur. »
« Moi, l’y engager ! » répliqua Léonella ; « je vous promets que je n’en ferai rien. Je ne l’aime pas du tout, votre Ambrosio ; il a une mine sévère qui m’a fait trembler de la tête aux pieds. S’il était mon confesseur, je n’aurais jamais le courage de lui avouer la moitié de mes peccadilles, et alors je serais dans une jolie position ! Je n’ai jamais vu mortel avoir l’air si rigide, et j’espère bien ne pas voir son pareil de ma vie. Son portrait du diable, Dieu nous bénisse ! a failli me rendre folle de frayeur, et quand il a parlé des pécheurs, on eût dit qu’il allait les manger. »
« Vous avez raison, señora, » repartit don Cbristoval ; « trop de sévérité est, dit-on, le seul défaut d’Ambrosio. Exempt lui-même des humaines faiblesses, il n’est point assez indulgent pour celles des autres ; et bien que strictement juste et impartial dans ses décisions, son administration a déjà fourni des preuves de son inflexibilité. Mais la foule est presque dissipée : voulez-vous nous permettre de vous accompagner jusqu’à votre demeure ? »
« Ô Jésus ! señor, » s’écria Léonella, feignant de rougir, « je ne voudrais pas le souffrir pour tout au monde ! Si je rentrais escortée d’un si galant cavalier, ma sœur est si scrupuleuse, qu’elle me ferait de la morale pendant une heure ; ce serait à n’en pas voir la fin. D’ailleurs, je préfère que vous différiez quelque peu vos propositions. »
« Mes propositions ? Je vous proteste, señora — »
« Oh ! señor, je ne doute pas de votre impatience ni de la sincérité de vos protestations ; mais réellement, j’ai besoin d’un peu de répit. Ce ne serait point agir avec toute la délicatesse dont je me pique, que d’accepter votre main à première vue. »
« Accepter ma main ! Comme il est vrai que je vis et que je respire — »
« Oh ! cher señor, ne me pressez pas davantage, si vous m’aimez. Je considérerai votre obéissance comme une preuve de votre affection. Vous recevrez demain de mes nouvelles : adieu donc. Mais, cavaliers, ne puis-je vous demander vos noms ? »
« Mon ami est le comte d’Ossorio ; moi, je suis Lorenzo de Médina. »
« Il suffit. Eh bien ! don Lorenzo, je ferai part à ma sœur de votre offre obligeante, et je vous instruirai sans retard de sa réponse. Où puis-je vous l’adresser ? »
« On peut toujours me trouver au palais Médina. »
« Vous aurez de mes nouvelles ; vous pouvez y compter. Adieu, cavaliers. Señor comte, modérez, je vous en conjure, l’excessive ardeur de votre passion. Cependant, pour vous prouver que je ne m’en offense point, et pour vous empêcher de vous abandonner au désespoir, recevez cette marque de mon affection ; et, dans l’absence, accordez parfois une pensée à Léonella. »
En disant cela, elle lui tendit une main sèche et ridée, que son amoureux supposé baisa de si mauvaise grâce et d’un air de contrainte si évident, que Lorenzo eut peine à retenir son envie de rire. Léonella alors se hâta de quitter l’église : l’aimable Antonia la suivit en silence ; mais quand elle atteignit le portail, elle se tourna involontairement, et ses yeux se reportèrent sur Lorenzo. Il la salua en signe d’adieu : elle rendit la politesse, et se retira précipitamment.
« Eh bien ! Lorenzo, » dit don Christoval aussitôt qu’ils furent seuls, « vous m’avez procuré une agréable intrigue ! Pour favoriser vos projets sur Antonia, je fais obligeamment quelques honnêtetés insignifiantes à sa tante, et, en une heure, me voilà à la veille d’un mariage ! Comment me récompenserez-vous de tout ce que j’ai souffert pour vous ? Puis-je être jamais dédommagé du baiser qu’il m’a fallu donner sur la patte tannée de cette maudite sorcière ? Diavolo ! elle m’a laissé une telle odeur sur les lèvres, que je sentirai encore l’ail dans un mois d’ici ! Quand je passerai dans le Prado, on me prendra pour une omelette ambulante, ou pour quelque gros ognon monté en graine. »
« Je confesse, mon pauvre comte, » répliqua Lorenzo, « que votre service n’a pas été sans danger. Pourtant, je suis si loin de le croire au-dessus de vos forces, que je vous prierai probablement de ne pas renoncer si tôt à vos amours. »
« Je conclus de cette demande que la petite Antonia a fait quelque impression sur vous. »
« Je ne puis vous exprimer à quel point elle m’a charmé. Depuis la mort de mon père, mon oncle, le duc de Médina, m’a témoigné son désir de me voir marié ; jusqu’ici j’ai fermé l’oreille à toutes ses suggestions, et j’ai refusé de les comprendre ; mais ce que j’ai vu ce soir — »
« Eh bien ! qu’avez-vous vu ce soir ? Sérieusement, don Lorenzo, vous n’êtes pas assez fou pour songer à faire votre femme de la petite fille du cordonnier le plus honnête et le plus laborieux de Cordoue ? »
« Vous oubliez qu’elle est aussi la petite fille de feu le marquis de Las Cisternas ; mais, sans discuter la naissance et les titres, je puis vous assurer que je n’ai jamais vu de femme aussi intéressante qu’Antonia. »
« C’est fort possible ; mais vous ne pouvez pas avoir l’intention de l’épouser ? »
« Pourquoi non, mon cher comte ? J’aurai assez de fortune pour nous deux, et vous savez que mon oncle est sans préjugés sur cet article. D’après ce que je sais de Raymond de Las Cisternas, je suis certain qu’il reconnaîtra sans difficulté Antonia pour sa nièce. Je serais un misérable si je songeais à la séduire ; car, en vérité, elle semble posséder toutes les qualités que je puis souhaiter dans une femme — jeune, aimable, douce, spirituelle — »
« Spirituelle ? Elle n’a pas dit autre chose que oui et non. »
« Guère plus, j’en conviens — mais c’était toujours si à propos ! »
« Réellement ? Je vous rends les armes ! voilà un véritable argument d’amoureux, et je n’ose discuter plus longtemps avec un si profond casuiste. Si nous allions à la comédie ? »
« Cela m’est impossible. Je ne suis arrivé que d’hier au soir à Madrid, et je n’ai pas encore vu ma sœur. Vous savez que son couvent est dans cette rue, et je m’y rendais lorsque j’ai été détourné par la curiosité de savoir la cause de l’affluence qui se portait vers l’église. Je vais maintenant suivre ma première idée, et probablement je passerai la soirée avec ma sœur à la grille du parloir. »
« Votre sœur est dans un couvent, dites-vous ? Oh ! c’est vrai, je l’avais oublié. Et comment va doña Agnès ? Je m’étonne, don Lorenzo, que vous ayez pu penser à claquemurer dans un cloître une si charmante fille ! »
« Moi, don Christoval ? Pouvez-vous me soupçonner d’une telle barbarie ? Vous savez que c’est de son propre gré qu’elle a pris le voile, et que des circonstances particulières lui ont lait désirer de se retirer du monde. J’ai usé de tous les moyens qui étaient en mon pouvoir pour la détourner de cette résolution ; mes efforts ont été vains, et j’ai perdu une sœur ! »
« Vous ne vous en êtes pas trouvé plus mal : il me semble, Lorenzo, que vous avez dû considérablement gagner à cette perte ; si j’ai bonne mémoire, doña Agnès avait pour sa part dix mille piastres, dont la moitié a dû revenir à Votre Seigneurie. Par saint Iago ! je voudrais avoir cinquante sœurs dans la même catégorie. Je consentirais à les perdre toutes jusqu’à la dernière, sans un grand crève-cœur. »
« Comment, comte ? » dit Lorenzo irrité ; « vous me supposez assez bas pour avoir influencé la retraite de ma sœur ? Vous supposez que l’ignoble désir de me rendre maître de sa fortune a pu — »
« Admirable ! courage, don Lorenzo ! le voilà tout en feu ! Dieu veuille qu’Antonia calme ce bouillant caractère, ou certainement nous nous couperons la gorge avant la fin du mois ! cependant, pour prévenir, quant à présent, une si tragique catastrophe, je bats en retraite, et vous laisse le champ de bataille. Adieu, mon chevalier du mont Etna ! modérez cette disposition inflammable, et rappelez-vous que toutes les fois qu’il sera nécessaire que je fasse la cour à votre vieille coquine, vous pouvez compter sur moi. »
Il dit, et s’élança hors de la cathédrale.
« Quel écervelé ! » dit Lorenzo ; « avec un si excellent cœur, quel malheur qu’il ait si peu de solidité de jugement ! »
La nuit s’avançait rapidement. Les lampes n’étaient point encore allumées ; les faibles lueurs de la lune naissante perçaient à peine la gothique obscurité de l’église. Lorenzo se sentit incapable de quitter la place. Le vide laissé dans son cœur par l’absence d’Antonia, et le sacrifice de sa sœur que don Christoval venait de rappeler à son esprit, l’avaient livré à une mélancolie qui ne s’accordait que trop bien avec l’ombre religieuse qui l’environnait. Il était toujours appuyé contre la septième colonne à compter de la chaire ; un air doux et frais soufflait le long des galeries solitaires ; les rayons que la lune dardait à travers les vitraux de couleur, teignaient de mille nuances diverses les voûtes sculptées et les piliers massifs ; un profond silence régnait dans l’église, interrompu seulement par le bruit de quelque porte que l’on fermait dans le couvent voisin.
Le calme de l’heure et la solitude du lieu contribuèrent à nourrir la disposition mélancolique de Lorenzo ; il se jeta sur un siège placé près de lui, et s’abandonna aux prestiges de son imagination. Il pensa à son union avec Antonia ; il pensa aux obstacles que pourraient rencontrer ses désirs ; et une foule de visions changeantes lui passèrent devant l’esprit, tristes, il est vrai, mais non pénibles. Insensiblement le sommeil s’empara de lui, et le calme solennel de ses idées dans l’état de veille continua pour quelques instants d’influencer ses rêves.
Il se croyait toujours dans l’église des Capucins, mais elle n’était plus sombre ni solitaire : une multitude de lampes d’argent suspendues aux voûtes répandait à flots la lumière ; accompagné d’un chœur ravissant de voix lointaines, l’orgue emplissait l’église de mélodie ; l’autel semblait décoré pour quelque grande fête ; une compagnie brillante se tenait alentour, et Antonia était auprès, vêtue de blanc comme une fiancée, et rougissant avec tout le charme de la modestie virginale.
Partagé entre l’espoir et la crainte, Lorenzo contemplait cette scène. Soudain la porte qui conduisait au couvent s’ouvrit, et il vit s’avancer, suivi d’un long cortège de moines, le prédicateur qu’il venait d’écouter avec tant d’admiration. Le prieur imaginaire s’approcha d’Antonia.
« Et où est le fiancé ? » demanda-t-il.
Antonia sembla regarder dans l’église avec anxiété ; involontairement le jeune homme fit quelques pas hors de sa cachette ; elle le vit, et sa joue se colora de plaisir : d’un geste gracieux elle l’invita à avancer. Il ne désobéit pas à cet ordre ; il vola vers elle, et tomba à ses pieds.
Elle recula un instant ; puis le regardant avec une joie inexprimable : « Oui, » s’écria-t-elle, « mon fiancé ! l’époux qui m’est destiné ! »
Elle dit, et s’empressait de se jeter dans les bras de Lorenzo ; mais avant qu’il n’eût le temps de l’y recevoir, un inconnu s’élança entre eux : sa taille était gigantesque, son teint basané, ses yeux féroces et terribles ; sa bouche souillait des masses de feu, et sur son front était écrit en caractères lisibles ; « Orgueil ! Luxure ! Inhumanité ! »
Antonia fit un cri ; le monstre la saisit dans ses bras, et sautant sur l’autel avec elle, la tortura de ses odieuses caresses. Elle s’efforçait en vain de se soustraire à ces embrassements. Lorenzo vola à son secours ; mais au moment où il allait l’atteindre, un grand coup de tonnerre se fit entendre. Aussitôt la cathédrale parut s’écrouler en débris ; les moines prirent la fuite, avec des cris d’effroi ; les lampes s’éteignirent, l’autel s’abîma, et à sa place parut un gouffre qui vomissait des torrents de flamme. Le monstre y plongea, avec un hurlement horrible, et dans sa chute il essaya d’entraîner Antonia. Ses efforts furent vains : animée d’une vigueur surnaturelle, elle se dégagea enfin de l’étreinte du monstre ; mais il lui avait arraché sa blanche robe. Aussitôt chacune de ses épaules déploya une aile resplendissante ; elle prit son essor, et tout en s’élevant, elle cria à Lorenzo ; « Ami ! nous nous reverrons là-haut ! »
Au même instant, la voûte de la cathédrale s’ouvrit, des voix harmonieuses montèrent aux cieux ; et la gloire où Antonia était reçue se composait de rayons si éblouissants, que Lorenzo ne put en soutenir l’éclat. Sa vue s’obscurcit, et il tomba par terre.
Quand il s’éveilla, il se trouva effectivement étendu sur le pavé de l’église : elle était éclairée, et le chant des hymnes s’entendait à distance. Lorenzo fut quelque temps à se persuader que ce qu’il venait de voir n’était qu’un rêve, tant l’impression en avait été forte sur son esprit ; un peu de réflexion le convainquit de son erreur ; les lampes avaient été allumées pendant son sommeil, et la musique qu’il avait entendue était celle des moines, qui célébraient les vêpres dans la chapelle de l’abbaye.
Lorenzo se leva, et se prépara à tourner ses pas vers le couvent de sa sœur, la tête encore tout occupée de la singularité de son rêve. Il approchait du portail, lorsque son attention fut attirée par une ombre qu’il vit se mouvoir sur la muraille opposée. Il se hâta de regarder alentour, et bientôt il découvrit un homme enveloppé dans un manteau, et qui semblait examiner soigneusement si ses actions étaient observées. Il est peu de personnes qui sachent résister aux tentations de la curiosité ; l’inconnu semblait fort désireux de cacher ce qu’il venait faire dans la cathédrale, et ce fut précisément ce qui donna à Lorenzo l’envie de savoir ce que ce pouvait être.
Notre héros sentait bien qu’il n’avait aucun droit d’épier les secrets de cet inconnu.
« Je vais m’en aller, » dit Lorenzo ; et Lorenzo ne bougea pas de place.
L’ombre projetée par la colonne dérobait sa présence à l’étranger, qui continua de s’avancer avec précaution. À la fin, il tira une lettre de son manteau, et la plaça vite au-dessous d’une statue colossale de saint François ; puis, se retirant précipitamment, il s’enfonça dans une partie de l’église très éloignée de celle où était l’image du saint.
« C’est cela ! » se dit Lorcnzo ; « quelque folle affaire d’amour. Je crois que je ferai aussi bien de partir, car je n’y peux rien. »
La vérité est que jusqu’alors il ne lui était pas venu en tête qu’il y pût rien faire ; mais c’était une petite excuse qu’il croyait devoir se présenter à lui-même pour se justifier d’avoir cédé à sa curiosité. Il fit une seconde tentative pour sortir de l’église, et cette fois il en gagna le portail sans rencontrer aucun empêchement ; mais il était écrit qu’il lui rendrait encore une visite ce soir-là. Comme il descendait les marches qui conduisent à la rue, un cavalier le heurta avec une violence telle, qu’ils faillirent l’un et l’autre être renversés du coup. Lorenzo mit la main à son épée.
« Ah ça ! » dit-il, « que signifie cette brutalité ? »
« Ah ! est-ce vous, Médina ? » reprit le nouveau venu, que Lorenzo à sa voix reconnut pour don Christoval. « Vous êtes le plus heureux des mortels de n’avoir pas quitte l’église avant mon retour. Dedans, dedans ! mon cher garçon ! elles seront ici dans une minute ! »
« Qui est-ce qui sera ici ? »
« La vieille poule avec tous ses jolis petits poussins ; entrons, vous dis-je ; et puis vous saurez toute l’histoire. »
Lorenzo le suivit dans la cathédrale, et ils se cachèrent derrière la statue de saint François.
« Eh bien ! » dit notre héros, « puis-je prendre la liberté de demander ce que veulent dire cet empressement et ces transports ? »
« Oh ! Lorenzo, nous allons avoir un si merveilleux coup d’œil ! L’abbesse de Sainte-Claire et toute sa suite de nonnes arrivent ici. Il faut que vous sachiez que le pieux père Ambrosio (le seigneur l’en récompense !) ne consent sous aucun prétexte à dépasser l’enceinte de son abbaye. Comme il est absolument nécessaire que tout couvent à la mode l’ait pour confesseur, les nonnes, en conséquence, sont obligées de lui rendre visite à son monastère : puisque la montagne ne veut point aller à Mahomet, il faut bien que Mahomet aille à la montagne. Or, l’abbesse de Sainte-Claire, pour échapper à tous les regards impurs, tels que les vôtres et ceux de votre humble serviteur, juge à propos d’attendre la brune pour mener à la confession son troupeau béni : elle va être introduite dans la chapelle de l’abbaye par cette porte particulière. La portière de Sainte-Claire, qui est une digne vieille âme, et une amie intime à moi, vient de m’assurer qu’elles seraient ici dans un instant. Voilà dos nouvelles pour vous, mauvais sujet ! nous allons voir quelques uns des plus jolis minois de Madrid ! »
« La vérité est, Christoval, que nous ne verrons rien ; les nonnes sont toujours voilées. »