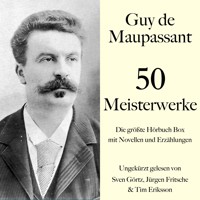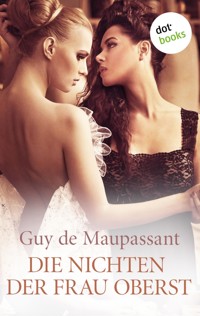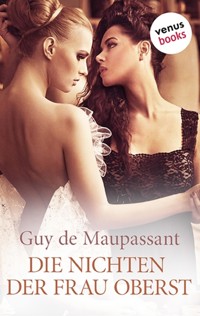2,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Notre édition complète des nouvelles de Maupassant se poursuit par ce volume, publié en 1899, six ans après la mort de l'écrivain. Presque tous ces récits avaient paru dans la presse. Certains d'entre eux ont été développés dans Une vie. Le recueil est riche en « contes cruels », qui abordent les gouffres noirs de l'être humain. On y rencontre aussi des histoires comiques. Les femmes y sont décrites comme menteuses, entièrement soumises à leur physiologie, et à leur intérêt amoureux. Les deux sexes sont incapables de se comprendre, affirme Maupassant, grand lecteur de Schopenhauer. Les hommes ne sont pas présentés de manière plus optimiste: brutaux, naïfs, odieux. Ce sont enfin les exclus de la vie ou de la société vieilles filles, enfants naturels, drogués, prêtres, femme défigurée, aveugle, paralytique: l'homme est cruel envers les faibles. La guerre est l'expression favorite de cette cruauté, que dénonce la nouvelle « Le Père Milon ».
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 136
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Le père Milon
Pages de titreLe père MilonPar un soir de printempsL’aveugleLe gâteauLe Saut du BergerVieux objetsMagnétismeUn bandit corseLa veilléeRêvesConfessions d’une femmeClair de luneUne passionCorrespondanceRouerieYveline SamorisL’ami JosephL’orphelinPage de copyrightGuy de Maupassant
Le père Milon
Le père Milon
Depuis un mois, le large soleil jette aux champs sa flamme cuisante. La vie radieuse éclôt sous cette averse de feu ; la terre est verte à perte de vue. Jusqu’aux bords de l’horizon, le ciel est bleu. Les fermes normandes semées par la plaine semblent, de loin, de petits bois, enfermées dans leur ceinture de hêtres élancés. De près, quand on ouvre la barrière vermoulue, on croit voir un jardin géant, car tous les antiques pommiers, osseux comme les paysans, sont en fleurs. Les vieux troncs noirs, crochus, tortus, alignés par la cour, étalent sous le ciel leurs dômes éclatants, blancs et roses. Le doux parfum de leur épanouissement se mêle aux grasses senteurs des étables ouvertes et aux vapeurs du fumier qui fermente, couvert de poules.
Il est midi. La famille dîne à l’ombre du poirier planté devant la porte : le père, la mère, les quatre enfants, les deux servantes et les trois valets. On ne parle guère. On mange la soupe, puis on découvre le plat de fricot plein de pommes de terre au lard.
De temps en temps, une servante se lève et va remplir au cellier la cruche au cidre.
L’homme, un grand gars de quarante ans, contemple, contre sa maison, une vigne restée nue, et courant, tordue comme un serpent, sous les volets, tout le long du mur.
Il dit enfin : « La vigne au père bourgeonne de bonne heure c’t’année. P’t-être qu’a donnera. »
La femme aussi se retourne et regarde, sans dire un mot.
Cette vigne est plantée juste à la place où le père a été fusillé.
C’était pendant la guerre de 1870. Les Prussiens occupaient tout le pays. Le général Faidherbe, avec l’armée du Nord, leur tenait tête.
Or l’état-major prussien s’était posté dans cette ferme. Le vieux paysan qui la possédait, le père Milon, Pierre, les avait reçus et installés de son mieux.
Depuis un mois l’avant-garde allemande restait en observation dans le village. Les Français demeuraient immobiles, à dix lieues de là ; et cependant, chaque nuit, des uhlans disparaissaient.
Tous les éclaireurs isolés, ceux qu’on envoyait faire des rondes, alors qu’ils partaient à deux ou trois seulement, ne rentraient jamais.
On les ramassait morts, au matin, dans un champ, au bord d’une cour, dans un fossé. Leurs chevaux eux-mêmes gisaient le long des routes, égorgés d’un coup de sabre.
Ces meurtres semblaient accomplis par les mêmes hommes, qu’on ne pouvait découvrir.
Le pays fut terrorisé. On fusilla des paysans sur une simple dénonciation, on emprisonna des femmes ; on voulut obtenir, par la peur, des révélations des enfants. On ne découvrit rien.
Mais voilà qu’un matin, on aperçut le père Milon étendu dans son écurie, la figure coupée d’une balafre.
Deux uhlans éventrés furent retrouvés à trois kilomètres de la ferme. Un d’eux tenait encore à la main son arme ensanglantée. Il s’était battu, défendu.
Un conseil de guerre ayant été aussitôt constitué, en plein air, devant la ferme, le vieux fut amené.
Il avait soixante-huit ans. Il était petit, maigre, un peu tors, avec de grandes mains pareilles à des pinces de crabe. Ses cheveux ternes, rares et légers comme un duvet de jeune canard, laissaient voir partout la chair du crâne. La peau brune et plissée du cou montrait de grosses veines qui s’enfonçaient sous les mâchoires et reparaissaient aux tempes. Il passait dans la contrée pour avare et difficile en affaires.
On le plaça debout, entre quatre soldats, devant la table de cuisine tirée dehors. Cinq officiers et le colonel s’assirent en face de lui.
Le colonel prit la parole en français.
« Père Milon, depuis que nous sommes ici, nous n’avons eu qu’à nous louer de vous. Vous avez toujours été complaisant et même attentionné pour nous. Mais aujourd’hui une accusation terrible pèse sur vous, et il faut que la lumière se fasse. Comment avez-vous reçu la blessure que vous portez sur la figure ? »
Le paysan ne répondit rien.
Le colonel reprit :
« Votre silence vous condamne, père Milon. Mais je veux que vous me répondiez, entendez-vous ? Savez-vous qui a tué les deux uhlans qu’on a trouvés ce matin près du Calvaire ? »
Le vieux articula nettement :
« C’est mé. »
Le colonel, surpris, se tut une seconde, regardant fixement le prisonnier. Le père Milon demeurait impassible, avec son air abruti de paysan, les yeux baissés comme s’il eût parlé à son curé. Une seule chose pouvait révéler un trouble intérieur, c’est qu’il avalait coup sur coup sa salive, avec un effort visible, comme si sa gorge eût été tout à fait étranglée.
La famille du bonhomme, son fils Jean, sa bru et deux petits enfants se tenaient à dix pas en arrière, effarés et consternés.
Le colonel reprit :
« Savez-vous aussi qui a tué tous les éclaireurs de notre armée qu’on retrouve chaque matin, par la campagne, depuis un mois ? »
Le vieux répondit avec la même impassibilité de brute :
« C’est mé.
– C’est vous qui les avez tués tous ?
– Tretous, oui, c’est mé.
– Vous seul ?
– Mé seul.
– Dites-moi comment vous vous y preniez. »
Cette fois l’homme parut ému ; la nécessité de parler longtemps le gênait visiblement. Il balbutia :
« Je sais-ti, mé ? J’ai fait ça comme ça s’trouvait. »
Le colonel reprit :
« Je vous préviens qu’il faudra que vous me disiez tout. Vous ferez donc bien de vous décider immédiatement. Comment avez-vous commencé ? »
L’homme jeta un regard inquiet sur sa famille attentive derrière lui. Il hésita un instant encore, puis, tout à coup, se décida.
« Je r’venais un soir, qu’il était p’t-être dix heures, le lend’main que vous étiez ici. Vous, et pi vos soldats, vous m’aviez pris pour pu de chinquante écus de fourrage avec une vaque et deux moutons. Je me dis : « Tant qu’i me prendront de fois vingt écus, tant que je leur y revaudrai ça. » Et pi, j’avais d’autres choses itou su l’cœur, que j’vous dirai. V’là qu’ j’en aperçois un d’vos cavaliers qui fumait sa pipe su mon fossé, derrière ma grange. J’allai décrocher ma faux et je r’vins à p’tits pas par derrière, qu’il n’entendit seulement rien. Et j’li coupai la tête d’un coup, d’un seul, comme un épi, qu’il n’a pas seulement dit « ouf ! » Vous n’auriez qu’à chercher au fond d’la mare : vous le trouveriez dans un sac à charbon, avec une pierre de la barrière.
« J’avais mon idée. J’pris tous ses effets d’puis les bottes jusqu’au bonnet et je les cachai dans le four à plâtre du bois Martin, derrière la cour. »
Le vieux se tut. Les officiers, interdits, se regardaient. L’interrogatoire recommença ; et voici ce qu’ils apprirent.
Une fois son meurtre accompli, l’homme avait vécu avec cette pensée : « Tuer des Prussiens ! » Il les haïssait d’une haine sournoise et acharnée de paysan cupide et patriote aussi. Il avait son idée comme il disait. Il attendit quelques jours.
On le laissait libre d’aller et de venir, d’entrer et de sortir à sa guise tant il s’était montré humble envers les vainqueurs, soumis et complaisant. Or il voyait, chaque soir, partir les estafettes ; et il sortit, une nuit, ayant entendu le nom du village où se rendaient les cavaliers, et ayant appris, dans la fréquentation des soldats, les quelques mots d’allemand qu’il lui fallait.
Il sortit de sa cour, se glissa dans le bois, gagna le four à plâtre, pénétra au fond de la longue galerie et, ayant retrouvé par terre les vêtements du mort, il s’en vêtit.
Alors, il se mit à rôder par les champs, rampant, suivant les talus pour se cacher, écoutant les moindres bruits, inquiet comme un braconnier.
Lorsqu’il crut l’heure arrivée, il se rapprocha de la route et se cacha dans une broussaille. Il attendit encore. Enfin, vers minuit, un galop de cheval sonna sur la terre dure du chemin. L’homme mit l’oreille à terre pour s’assurer qu’un seul cavalier s’approchait, puis il s’apprêta.
Le uhlan arrivait au grand trot, rapportant des dépêches. Il allait, l’œil en éveil, l’oreille tendue. Dès qu’il ne fut plus qu’à dix pas, le père Milon se traîna en travers de la route en gémissant : « Hilfe ! Hilfe ! À l’aide, à l’aide ! » Le cavalier s’arrêta, reconnut un Allemand démonté, le crut blessé, descendit de cheval, s’approcha sans soupçonner rien et, comme il se penchait sur l’inconnu, il reçut au milieu du ventre la longue lame courbée du sabre. Il s’abattit, sans agonie, secoué seulement par quelques frissons suprêmes.
Alors le Normand, radieux d’une joie muette de vieux paysan, se releva, et pour son plaisir, coupa la gorge du cadavre. Puis, il le traîna jusqu’au fossé et l’y jeta.
Le cheval, tranquille, attendait son maître. Le père Milon se mit en selle, et il partit au galop à travers les plaines.
Au bout d’une heure, il aperçut encore deux uhlans côte à côte qui rentraient au quartier. Il alla droit sur eux, criant encore : « Hilfe ! Hilfe ! » Les Prussiens le laissaient venir, reconnaissant l’uniforme, sans méfiance aucune. Et il passa, le vieux, comme un boulet entre les deux, les abattant l’un et l’autre avec son sabre et un revolver.
Puis il égorgea les chevaux, des chevaux allemands ! Puis il rentra doucement au four à plâtre et cacha un cheval au fond de la sombre galerie. Il y quitta son uniforme, reprit ses hardes de gueux et, regagnant son lit, dormit jusqu’au matin.
Pendant quatre jours, il ne sortit pas, attendant la fin de l’enquête ouverte ; mais, le cinquième jour, il repartit, et tua encore deux soldats par le même stratagème. Dès lors, il ne s’arrêta plus. Chaque nuit, il errait, il rôdait à l’aventure, abattant des Prussiens, tantôt ici, tantôt là, galopant par les champs déserts, sous la lune, uhlan perdu, chasseur d’hommes. Puis, sa tâche finie, laissant derrière lui des cadavres couchés le long des routes, le vieux cavalier rentrait cacher au fond du four à plâtre son cheval et son uniforme.
Il allait vers midi, d’un air tranquille, porter de l’avoine et de l’eau à sa monture restée au fond du souterrain, et il la nourrissait à profusion, exigeant d’elle un grand travail.
Mais, la veille, un de ceux qu’il avait attaqués se tenait sur ses gardes et avait coupé d’un coup de sabre la figure du vieux paysan.
Il les avait tués cependant tous les deux ! Il était revenu encore, avait caché le cheval et repris ses humbles habits ; mais en rentrant, une faiblesse l’avait saisi et il s’était traîné jusqu’à l’écurie, ne pouvant plus gagner la maison.
On l’avait trouvé là tout sanglant, sur la paille...
Quand il eut fini son récit, il releva soudain la tête et regarda fièrement les officiers prussiens.
Le colonel, qui tirait sa moustache, lui demanda :
« Vous n’avez plus rien à dire ?
– Non, pu rien ; l’compte est juste : j’en ai tué seize, pas un de pu, pas un de moins.
– Vous savez que vous allez mourir ?
– J’vous ai pas d’mandé de grâce.
– Avez-vous été soldat ?
– Oui. J’ai fait campagne, dans le temps. Et puis, c’est vous qu’avez tué mon père, qu’était soldat de l’Empereur premier. Sans compter que vous avez tué mon fils cadet, François, le mois dernier, auprès d’Évreux. Je vous en devais, j’ai payé. Je sommes quittes. »
Les officiers se regardaient.
Le vieux reprit :
« Huit pour mon père, huit pour mon fieu1, je sommes quittes. J’ai pas été vous chercher querelle, mé ! J’vous connais point ! J’sais pas seulement d’où qu’ vous v’nez. Vous v’là chez mé, que vous y commandez comme si c’était chez vous. Je m’suis vengé su l’s autres. J’ m’en r’pens point. »
Et, redressant son torse ankylosé, le vieux croisa ses bras dans une pose d’humble héros.
Les Prussiens se parlèrent bas longtemps. Un capitaine, qui avait aussi perdu son fils, le mois dernier, défendait ce gueux magnanime.
Alors le colonel se leva et, s’approchant du père Milon, baissant la voix :
« Écoutez, le vieux, il y a peut-être un moyen de vous sauver la vie, c’est de... »
Mais le bonhomme n’écoutait point, et, les yeux plantés droits sur l’officier vainqueur, tandis que le vent agitait les poils follets de son crâne, il fit une grimace affreuse qui crispa sa maigre face toute coupée par la balafre, et, gonflant sa poitrine, il cracha, de toute sa force, en pleine figure du Prussien.
Le colonel, affolé, leva la main, et l’homme, pour la seconde fois, lui cracha par la figure.
Tous les officiers s’étaient dressés et hurlaient des ordres en même temps.
En moins d’une minute, le bonhomme, toujours impassible, fut collé contre le mur et fusillé alors qu’il envoyait des sourires à Jean, son fils aîné, à sa bru et aux deux petits, qui regardaient, éperdus.
Fils.
Par un soir de printemps
Jeanne allait épouser son cousin Jacques. Ils se connaissaient depuis l’enfance et l’amour ne prenait point entre eux les formes cérémonieuses qu’il garde généralement dans le monde. Ils avaient été élevés ensemble sans se douter qu’ils s’aimaient. La jeune fille, un peu coquette, faisait bien quelques agaceries innocentes au jeune homme ; elle le trouvait gentil, en outre, et bon garçon, et chaque fois qu’elle le revoyait, elle l’embrassait de tout son cœur, mais sans frisson, sans ce frisson qui semble plisser la chair, du bout des mains au bout des pieds.
Lui, il pensait tout simplement : « Elle est mignonne, ma petite cousine » ; et il songeait à elle avec cette espèce d’attendrissement instinctif qu’un homme éprouve toujours pour une jolie fille. Ses réflexions n’allaient pas plus loin.
Puis voilà qu’un jour Jeanne entendit par hasard sa mère dire à sa tante (à sa tante Alberte, car la tante Lison était restée vieille fille) : « Je t’assure qu’ils s’aimeront tout de suite, ces enfants-là ; ça se voit. Quant à moi, Jacques est absolument le gendre que je rêve. »
Et immédiatement Jeanne s’était mise à adorer son cousin Jacques. Alors elle avait rougi en le voyant, sa main avait tremblé dans la main du jeune homme ; ses yeux se baissaient quand elle rencontrait son regard, et elle faisait des manières pour se laisser embrasser par lui ; si bien qu’il s’était aperçu de tout cela. Il avait compris, et dans un élan où se trouvait autant de vanité satisfaite que d’affection véritable, il avait saisi à pleins bras sa cousine en lui soufflant dans l’oreille : « Je t’aime, je t’aime ! »
À partir de ce jour, ça n’avait été que roucoulements, galanteries, etc., un déploiement de toutes les façons amoureuses que leur intimité passée rendait sans gêne et sans embarras. Au salon, Jacques embrassait sa fiancée devant les trois vieilles femmes, les trois sœurs, sa mère, la mère de Jeanne et sa tante Lison. Il se promenait avec elle, seuls tous deux, des jours entiers dans les bois, le long de la petite rivière, à travers les prairies humides où l’herbe était criblée de fleurs des champs. Et ils attendaient le moment fixé pour leur union, sans impatience trop vive, mais enveloppés, roulés dans une tendresse délicieuse, savourant le charme exquis des insignifiantes caresses, des doigts pressés, des regards passionnés, si longs que les âmes semblent se mêler ; et vaguement tourmentés par le désir encore indécis des grandes étreintes, sentant comme des inquiétudes à leurs lèvres qui s’appelaient, semblaient se guetter, s’attendre, se promettre.
Quelquefois, quand ils avaient passé tout le jour dans cette sorte de tiédeur passionnée, dans ces platoniques tendresses, ils avaient, au soir, comme une courbature singulière, et ils poussaient tous les deux de profonds soupirs, sans savoir pourquoi, sans comprendre, des soupirs gonflés d’attente.
Les deux mères et leur sœur, tante Lison, regardaient ce jeune amour avec un attendrissement souriant. Tante Lison surtout semblait tout émue à les voir.
C’était une petite femme qui parlait peu, s’effaçait toujours, ne faisait point de bruit, apparaissait seulement aux heures des repas, remontait ensuite dans sa chambre où elle restait enfermée sans cesse. Elle avait un air bon et vieillot, un œil doux et triste, et ne comptait presque pas dans la famille.
Les deux sœurs, qui étaient veuves, ayant tenu une place dans le monde, la considéraient un peu comme un être insignifiant. On la traitait avec une familiarité sans gêne que cachait une sorte de bonté un peu méprisante pour la vieille fille. Elle s’appelait Lise, étant née aux jours où Béranger régnait sur la France. Quand on avait vu qu’elle ne se mariait pas, qu’elle ne se marierait sans doute point, de Lise on avait fait Lison. Aujourd’hui elle était « tante Lison », une humble vieille proprette, affreusement timide même avec les siens, qui l’aimaient d’une affection participant de l’habitude, de la compassion et d’une indifférence bienveillante.