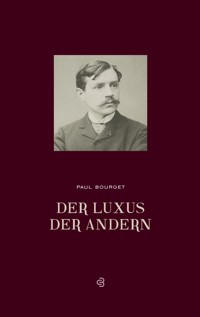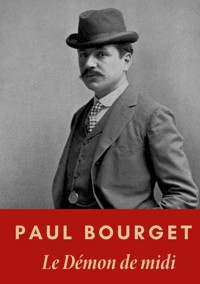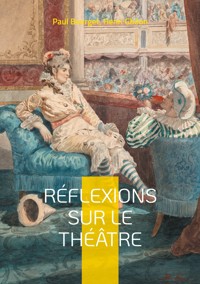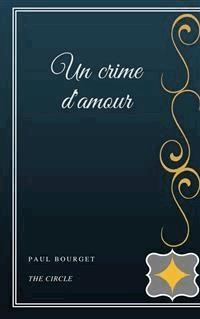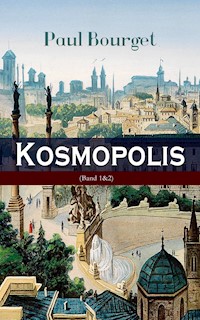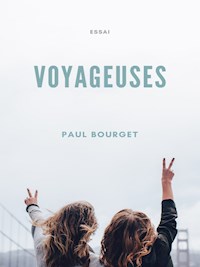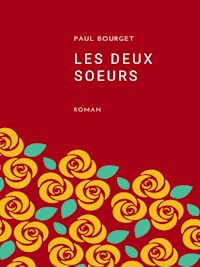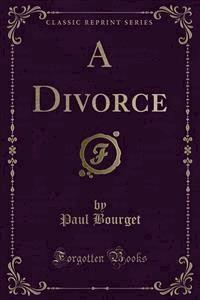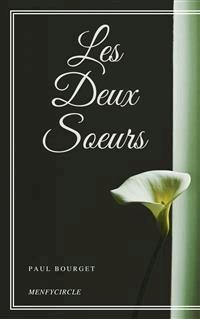
0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Paul Bourget
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Lors d'un voyage à Ragatz, pour faire prendre les eaux curatives à sa fille, Madeleine Liébeau, épouse d'un célèbre chirurgien parisien, fait la rencontre du commandant Brissonnet, jeune héros des campagnes militaires africaines venu également prendre les eaux. Elle trouve cet homme sympathique, et décide de le présenter à sa soeur aînée Agathe, veuve de fraîche date. Mais... est-elle vraiment sincère dans son projet? Ne cherche-t-elle pas à faire entrer le beau commandant dans sa famille afin de le côtoyer plus aisément? Et ce M. Brissonnet, de qui tombera-t-il finalement amoureux, de l'épouse respectable, ou de la jeune veuve? Voilà un triangle amoureux poignant que nous offre Bourget.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Les Deux Soeurs
Paul Bourget
Paul Bourget, né à Amiens le 2 septembre 1852 et mort à Paris le 25 décembre 1935, est un écrivain et essayiste français issu d’une famille originaire d’Ardèche.
Chapitre1 SUR UN QUAI DE GARE
Le train rapide qui vient de Coire et qui passe à Ragatz vers six heures du soir, était en retard de vingt-cinq minutes. Mais les deux sœurs, en train d’aller et de venir sur le quai de la petite gare, ne pensaient pas à s’en plaindre. Pour la première fois depuis ces deux semaines que Mme de Méris – l’aînée – avait rejoint l’autre, Mme Liébaut qui faisait faire à sa petite fille la cure des eaux de Ragatz, une conversation un peu plus intime s’engageait entre elles. Le sentiment de la séparation, toujours mélancolique et surtout dans le commencement du crépuscule, leur attendrissait-il le cœur ? Cédaient-elles à la douce poésie partout répandue autour d’elles dans le paysage ? Cette longue et verdoyante vallée de Ragatz où le jeune Rhin coule, si rapide et si froid, parmi les peupliers, s’étalait, sous le soleil tombant de cette fin d’une chaude journée d’août, comme une oasis de si calme félicité ! On eût dit que les contreforts des grandes Alpes apparus de tous les côtés se dressaient là pour préserver le coquet village, les fraîches prairies, les bouquets des vieux arbres contre la brutalité du monde. Et quelle noblesse dans ces profils de montagnes ! Avec quelle délicatesse de contours la chaîne du Falknis détachait sur le clair du couchant la dentelure violette de ses cimes ! Comme la gorge sauvage, en face, qui mène à Pfäfers, s’enfonçait hardiment dans la cassure des énormes rochers ! Que la ruine de Wartenstein était romantique à voir, écroulée sur la pointe abrupte de son pic ! Le vent se levait, faible encore, chargé de la fraîcheur des glaciers sur lesquels il passe, là-haut, avant de descendre dans la paisible vallée, et aucune dissonance ne troublait pour les deux sœurs le charme de cette heure. À peine si une douzaine de voyageurs attendaient, eux aussi, dans la gare, le train retardataire, à cette époque de l’année où les express rentrent presque vides à Paris. Les porteurs s’accotaient aux malles préparées sur le quai, avec un flegme tout helvétique. Dans ce silence des choses et des gens autour de leur lente promenade, le bruit le plus fort qu’elles entendissent était le rythme léger de leurs petits pieds quand elles arrivaient de la partie sablée du sol de la gare à la partie bétonnée. Elles formaient ainsi, causant avec un abandon que révélait l’accord de leur démarche, une couple d’une grâce singulière, tant la ressemblance de leurs silhouettes et de leurs visages était saisissante à cette minute. L’aînée, Agathe, avait trente ans, la cadette, Madeleine, en avait vingt-neuf. Cette différence, insignifiante, ne se reconnaissait pas à leur aspect, et elles donnaient l’impression de deux jumelles, si pareilles de traits que cette quasi-identité déconcertait les personnes qui ne les ayant pas vues souvent rencontraient l’une d’elles en l’absence de l’autre. Elles étaient toutes les deux blondes, d’un blond mêlé de reflets châtains. Elles avaient toutes les deux des yeux d’un gris bleu dans un de ces teints transparents, fragiles, qui font vraiment penser aux pétales de certaines roses. Elles avaient le même nez délicat, la même ligne mince des joues, le même arc bien marqué des sourcils, le même menton frappé d’une imperceptible fossette, et une jolie et même irrégularité de leur bouche spirituelle une lèvre supérieure coupée un peu courte, qui laissait voir au repos des dents un peu longues, joliment rangées.
À les étudier cependant, cette espèce de trompe-l’œil et comme de prestige s’évanouissait. Des détails tout physiques se remarquaient d’abord : l’aînée était d’un doigt peut-être plus petite que la cadette. La masse des cheveux de celle-ci était plus opulente, sa taille plus forte, malgré sa jeunesse, son visage un rien plus potelé. On les regardait davantage et l’on constatait très vite une dissemblance plus essentielle, si radicale qu’une fois discernée, les analogies, les identités presque de ces deux êtres faisaient ressortir cette opposition davantage encore. On devinait que deux personnalités absolument contraires vivaient, sentaient, pensaient sous ces formes si pareilles. Une âme difficultueuse, compliquée et mécontente se dissimulait derrière le regard des prunelles bleues d’Agathe, aussi fermées que celles de Madeleine étaient ouvertes, caressantes et gaies. Une défiance de nature, plus aisée à sentir qu’à bien définir, crispait chez l’aînée le pli du sourire au lieu que la cadette si avenante, si indulgente, créait partout autour d’elle cette atmosphère de bonhomie fine qui fait de la seule présence de certaines femmes une douceur dont on est tenté de les remercier. Leurs façons de s’habiller ne révélaient pas moins clairement la nuance de leurs caractères. Elles étaient, l’une et l’autre, mises avec l’élégance des Parisiennes riches d’aujourd’hui. Quelques mots résumeront ce qu’il faut bien appeler leur histoire sociale. – Nous en avons tous une, dans ces temps d’ascension hâtive, et cette histoire domine souvent toutes nos destinées de cœur, si cachée que soit cette action d’événements en apparence très étrangers à notre intime sensibilité. – Agathe et Madeleine étaient des demoiselles Hennequin, de la maison HENNEQUIN, Gazes et Rubans, l’une des plus importantes, il y a dix ans, de la rue des Jeûneurs. Ayant perdu leur père et leur mère, très jeunes, à quelques semaines de distance, leur dot d’orphelines avait été assez considérable pour leur permettre n’importe quel mariage. Agathe avait épousé un homme titré et ruiné, un comte de Méris, dont elle était veuve. Celui-ci avait, par hasard, hérité lui-même d’un oncle, avant de mourir, en sorte que la jeune femme restait seule, sans enfants, avec plus de cent vingt mille francs de rente. Madeleine, elle, s’était mariée, plus simplement et plus bourgeoisement, à un médecin de grand avenir dont la clientèle grandissait chaque jour, et le ménage n’avait pas à dépenser beaucoup moins que la veuve. Ces chiffres expliqueront, à qui connaît Paris, quelles toilettes d’un luxe léger et coûteux les deux sœurs promenaient sur ce quai de gare. C’est comme une livrée que toutes les jolies femmes revêtent aujourd’hui, à certaine hauteur de budget. Seulement si la robe de mohair noir et la mante de drap noir passementée de blanc qu’Agathe portait pour le voyage venaient d’une même maison et du même rang que le costume de serge blanche de Madeleine, l’une trouvait le moyen d’être raide, guindée, comme harnachée, là où l’autre était gracieuse et souple. Les joyaux de demi-deuil de Mme de Méris, sa chaîne en platine et en perles noires, ses broches émaillées de noir avec des diamants, soulignaient ce je ne sais quoi de prétentieux répandu sur toute sa personne. Madeleine, elle, n’avait d’autres bijoux que l’or des grandes épingles qui piquaient son large chapeau de tulle à fleurs et celui de la gourmette où s’enchâssait la montre de son bracelet. De temps à autre, et tout en causant avec la voyageuse qu’elle accompagnait à son train, – elle-même ne quittait pas encore Ragatz, – elle regardait l’heure à son poignet d’un geste qui traduisait une inquiétude. Ce n’était pas l’impatience de voir la locomotive déboucher du tunnel sur le Rhin, là-bas. Elle appréhendait au contraire que ce train où monterait sa sœur n’arrivât trop vite. Agathe lui parlait, depuis ces quelques minutes, avec une demi-ouverture du cœur, et des conversations de cet ordre étaient rares entre les deux sœurs. Elles n’en avaient pas eu une seule durant tout leur séjour commun dans la ville d’eaux. Cette singularité de leurs rapports ne tenait pas à la nature de Madeleine, très aimante, très spontanée. L’aînée en était seule responsable, par quelques-uns de ces défauts de caractère pour lesquels les formules manquent, tant ils tiennent au plus intime et au plus profond de l’être. Agathe déplaisait, comme Madeleine plaisait, par cet indéfinissable ensemble de choses que l’on appelle la personnalité. Elle le sentait. Elle l’avait toujours senti. Cette constante impression d’un secret désaccord entre elle et la vie lui avait donné cette espèce d’irritabilité qui aboutit si vite à ce qu’un humoriste anglo-saxon appelle la « dyspepsie morale ». Malgré l’apparente réussite de ses ambitions, elle avait été peu heureuse, et supportait mal le bonheur dont elle avait toujours vu au contraire sa cadette pénétrée. Elle ne l’enviait pas. Elle cachait trop de noblesse vraie sous ses dehors rêches, pour qu’un aussi vil sentiment trouvât place dans son cœur. Mais elle souffrait d’elle, et justement des traits personnels qui contrastaient le plus avec ses propres insuffisances. Elle détestait cette facile humeur de Madeleine où elle ne pouvait s’empêcher de voir un peu de vulgarité, – quoique rien ne fût moins vulgaire que cette aisance heureuse. – Elle lui reprochait cette joie de vivre où elle n’était pas loin de discerner un égoïsme, ce qui était injuste. Elle haïssait aussi des succès de société qu’elle eût pour un rien attribués à un peu de coquetterie. À quoi bon d’ailleurs analyser des relations délicates qu’il suffisait d’indiquer ? L’aventure à qui cette causerie entre les deux sœurs sert de prologue fera ressortir ces anomalies avec une netteté qu’aucun commentaire préalable n’égalerait.
Leur conversation avait commencé par une petite phrase assez irréfléchie de Madeleine. Elle avait pensé tout haut et dit à son aînée, qui devait, de Ragatz, toucher seulement barre à Paris puis aller en Normandie chez une amie à elle que sa sœur n’aimait guère :
– « Tout de même je regrette deux fois de ne pas te garder. Mais oui. Pour t’avoir d’abord, et ne pas rester seule avec ma pauvre Charlotte… » – Cette allusion à sa petite fille pour la santé de laquelle elle était aux eaux mit une lueur triste dans ses yeux si gais… « Et aussi, pour que tu n’ailles pas chez les Fugré. »
– « Je n’ai pas l’habitude de négliger mes amies quand elles sont dans la peine, et toi-même, en y réfléchissant, tu ne m’en estimerais pas… » avait répondu Agathe d’un ton qui prouvait que l’antipathie de sa cadette pour Mme de Fugré ne lui échappait pas. D’ordinaire, devant des phrases pareilles et qui risquaient d’ouvrir entre les deux sœurs une discussion, Mme Liébaut se taisait. Cette réplique-ci enfermait une allusion à une difficulté récente que Madeleine et son mari avaient eue avec un des camarades de ce dernier. Ils s’étaient brouillés avec cet homme parce qu’il avait hasardé la fortune de sa femme et de ses enfants dans d’imprudentes opérations de Bourse. Cette fâcherie avait coïncidé avec sa ruine totale. L’indignation du médecin contre le spéculateur s’était manifestée si vivement avant cette ruine, que l’orgueil blessé de celui-ci avait empêché toute réconciliation après le désastre. Mme de Méris, à ce sujet, avait assez vivement blâmé son beau-frère. Madeleine sentit le rappel de ce blâme qui, à l’époque, l’avait déjà froissée. La préoccupation qu’elle avait de l’avenir de sa sœur et son besoin de l’en entretenir, si peu que ce fût, avant son départ, la fit passer outre :
– « Si Clotilde n’est pas heureuse, tu avoueras que c’est bien sa faute, » avait-elle riposté en hochant doucement la tête, « les torts de son mari se réduisent à aimer trop sa terre, ses chevaux, sa chasse et pas assez Paris. »
– « Tu sais aussi bien que moi ce qui en est, » reprit l’aînée sur un ton d’impatience. « Il est jaloux d’elle, ignoblement jaloux. Voilà la vérité. Je le répète : ignoblement. Il a imaginé ce moyen de la séquestrer, à vingt-cinq ans, à l’âge où une jeune femme a cependant le droit de s’épanouir, surtout quand elle est aussi vraiment honnête que Clotilde. C’est abominable… »
– « Pourquoi l’a-t-elle laissé devenir jaloux ? » demanda Madeleine. « Oui. Pourquoi ?… C’était si simple ! Quand elle a vu commencer cette maladie, car c’en est une, pourquoi n’a-t-elle pas cédé à Fugré sur tous les points où il s’irritait ?… D’ailleurs, elle aurait toutes les raisons et lui tous les torts, » rectifia-t-elle afin d’empêcher la protestation de sa sœur, « je n’en redouterais pas moins ton séjour chez eux. Pour une cause ou pour une autre, les Fugré sont un mauvais ménage. Ce n’est pas dans leur compagnie que tu prendras l’idée de te remarier… »
– « De me remarier ?… » fit Agathe, et elle eut de nouveau un de ces sourires dont l’expression rendait soudain son visage si différent de celui de l’autre. Un léger tremblement agitait dans ces moments-là ses lèvres qui se creusaient davantage sur le côté droit, et cette inégalité eût défiguré une physionomie moins jolie que la sienne. « Tu n’as donc pas encore quitté cette idée-là ? » continua-t-elle. « Tu trouves que je n’en ai pas assez de ma première expérience ? »
– « Je trouve que tu tires d’un hasard très particulier des conclusions générales qui ne sont pas justes, » répondit tendrement Madeleine. « Tu es mal tombée une première fois. Ce devrait être un motif pour essayer de bien tomber une seconde. Tu étais si jeune quand tu as épousé Raoul ! Tu as été prise par ses manières, par son élégance. C’était bien naturel aussi que tu fusses attirée par le monde où il allait t’introduire… »
– « Dis-moi tout de suite que je me suis mariée par vanité, puisque ton mari et toi vous l’avez toujours pensé, » dit Agathe.
– « Jamais nous n’avons pensé cela, » répondit, vivement cette fois, Mme Liébaut. « Il n’y a aucun rapport entre ce vilain sentiment et l’innocent, le naïf attrait que la haute société exerce sur une enfant de dix-neuf ans quand elle est si jolie, si fine, si faite pour devenir tout naturellement une grande dame !… Ce que je veux dire c’est qu’à présent tu peux refaire ta vie, et que tu dois la refaire… » Elle insista sur cette fin de phrase. « C’est ma grande maxime, tu sais : on doit vouloir vivre. Pour une femme de trente ans, belle comme toi, intelligente comme toi, sensible comme toi, ce n’est pas vivre que de n’avoir rien, ni personne à aimer vraiment. Une femme qui n’est pas épouse et qui n’est pas mère, c’est une trop grande misère. Tu es ma sœur, ma chère sœur, et je ne veux pas de ce sort pour toi… »
– « Je te remercie de l’intention, » répliqua Mme de Méris avec la même ironie. Puis sérieusement : « Tu ne m’as jamais tout à fait comprise, ma pauvre Madeleine. Je ne t’en veux pas. Ce que tu appelles ta grande maxime, ce sont tes goûts. C’est ton caractère. Tu aurais épousé Raoul, toi, que tu aurais trouvé le moyen d’être heureuse… Je vois cela d’ici, comme si j’y étais », continua-t-elle en soulignant son persiflage d’un petit rire sec. « Ses brutalités seraient devenues de la franchise. Il t’aurait trahie, comme il m’a trahie. Tu te serais dit que c’était ta faute, comme tu le dis de Clotilde. Veux-tu que je précise la chose qui nous sépare, qui nous séparera toujours ? Tu as toujours accepté, tu accepteras toujours ta vie quelle qu’elle soit. Moi j’ai voulu choisir la mienne. Cela ne m’a pas réussi. Peut-être y a-t-il plus de noblesse dans certains malheurs que dans certains bonheurs… Et puis on ne se refait point. Je ne me remarierai pas pour me remarier, mets-toi cette idée dans la tête, une fois pour toutes. Je me remarierai, si je me remarie, quand je croirai avoir rencontré quelqu’un que je puisse, – je reprends ta phrase, – aimer, oui, aimer, mais vraiment, mais absolument. Va ! Les querelles de ménage de Clotilde et de Julien ne m’empêcheraient pas d’épouser ce quelqu’un qui m’eût pris le cœur, si je l’avais rencontré. Mais tes exhortations ne me feront pas non plus changer mon existence, pour la changer. Elle a ses heures de cruelle solitude, c’est vrai, cette existence. Elle n’a pas de très doux souvenirs auxquels se rattacher. C’est mon existence à moi, telle que je l’ai voulue, et sa fierté me suffit… » – « Tu te fais plus forte que tu n’es, heureusement, » répondit l’autre. « Si tu pensais réellement ce que tu dis, tu ne serais qu’une orgueilleuse, et tu ne l’es pas. Je te répète que tu es une femme, une vraie femme, et si tendre ! Tu t’en défends, mais on ne trompe pas sa petite sœur quand on est sa grande… Autorise-moi seulement à te le chercher, ce quelqu’un qui te prendrait le cœur ?… Et je le trouverai. »
Elle avait dit ces mots avec le mélange de demi-badinage et de demi-émotion, habituel aux êtres trop sensibles quand ils veulent apprivoiser un cœur qu’ils aiment et qu’ils devinent hostile. La grâce de sa voix et de son regard pour formuler sa paradoxale proposition détendit une minute la malveillance latente de Mme de Méris, qui se reprit à sourire, et, comme se prêtant à cette enfantine fantaisie, elle répliqua, sans amertume cette fois :
– « Je ne t’ai jamais empêchée de chercher, pourvu que je reste libre de refuser. »
– « Tu sais que je suis très sérieuse dans mon offre, » riposta la cadette, « et que je vais me mettre en campagne aussitôt, du moment que j’ai ton consentement. »
– « Tu l’as, dit l’aînée sur le même ton de plaisanterie affectueuse. « Mais si c’est parmi les rhumatisants et les neurasthéniques de Ragatz… »
– « Tout arrive, » interrompit Madeleine qui ajouta, en montrant à l’extrémité de la voie la silhouette de la locomotive : « même les trains suisses… »
L'express débouchait en effet du pont en tunnel construit sur le Rhin, et la petite gare changeait d’aspect. Les voyageurs plus nombreux se pressaient sur le bord du quai. Les facteurs manœuvraient les lourds haquets chargés de malles. La femme de chambre de Mme de Méris était maintenant auprès de sa maîtresse. D’une main elle tenait le nécessaire, de l’autre le paquet de châles. La rumeur des wagons roulant plus doucement avant l’arrêt définitif couvrait à peine l’éclat des voix s’interpellant à présent autour des deux sœurs qui marchaient le long du convoi. Elles ne pensaient plus qu’à découvrir le numéro du compartiment réservé à la voyageuse. Quand il fut trouvé et Agathe installée parmi les innombrables objets dont s’encombre inutilement et élégamment toute femme qui se respecte : minuscules coussins pour le dos, minuscule sac de cuir pour le livre et les flacons d’odeurs, minuscule pendule pour y mesurer la longueur du temps, – et ainsi du reste ! – elle s’accouda quelques instants à la fenêtre ouverte de la portière, pour échanger un dernier adieu avec Madeleine. Elles faisaient toutes deux à cet instant un groupe d’une exquise beauté, tournant l’une vers l’autre leurs visages si semblables de traits, se regardant avec des prunelles de nouveau si pareilles, avec la grâce jumelle de leur sourire. Comme à travers toutes sortes de complications de la part de l’aînée et toutes sortes de délicats pardons de la part de la cadette elles se chérissaient véritablement, une émotion identique les possédait, qui augmentait la similitude de leurs physionomies. Elles se trouvaient l’une et l’autre sous la lumière du soleil déjà très baissé qui dorait de reflets plus chauds la soie de leurs clairs cheveux et la transparence de leur teint si frais. Cette double et charmante apparition était si originale qu’elle aurait partout ailleurs provoqué la curiosité des témoins de ce joli adieu. Dans les dernières minutes d’un départ, de tels tableaux sont perdus. Les deux sœurs pouvaient donc se regarder et se sourire, en liberté, comme si elles n’eussent pas été dans un lieu public, exposées à toutes les indiscrétions… Soudain cependant, ce sourire s’arrêta sur les lèvres de la voyageuse. Ses yeux s’éteignirent, une rougeur colora ses joues et presque aussitôt le même changement d’expression s’accomplit pour Madeleine. L’une et l’autre venaient de constater qu’elles étaient regardées fixement par un inconnu, immobile à quelques pas d’elles. C’était un homme d’environ trente ans, lui-même d’une physionomie trop particulière pour qu’il passât aisément inaperçu. Il était assez petit, habillé avec ce rien de gaucherie qui distingue les soldats professionnels lorsqu’ils revêtent le costume civil. L’extrême énergie de son masque, tout creusé sous la barbe courte, était comme voilée, comme noyée d’une mélancolie qui ne s’accordait ni avec l’orgueil presque impérieux de son regard, ni avec le pli sévère de sa bouche. La maigreur et la nuance bronzée de son teint, où brûlaient littéralement deux yeux très bruns, presque noirs, indiquaient un état maladif, qui n’avait pourtant rien de commun avec l’épuisement des citadins, traité d’ordinaire à Ragatz. Sa physionomie militaire suggérait l’idée de quelque campagne lointaine, d’énormes fatigues supportées dans des climats meurtriers. Il tenait une lettre à la main qu’il venait, ayant manqué l’heure du courrier, jeter à la boîte du train. Et puis, la rencontre des deux femmes l’avait, pour une seconde, arrêté dans une contemplation dont il sentit lui-même l’inconvenance, car il rougit de son côté, sous son hâle, et il marcha vers le wagon de la poste, d’un pas hâtif, sans plus se retourner, tandis que la cadette disait plaisamment à l’aînée :
– « Avoue que, parmi les rhumatisants et les neurasthéniques de ces eaux, on rencontre aussi des figures de héros de roman. »
– « Tu veux dire de messieurs pas très bien élevés, » répondit Agathe.
– « Parce que celui-là te regardait dans un moment où il croyait que tu ne le voyais pas ?… » fit Madeleine. « La manière dont il a rougi, quand nous l’avons surpris, prouve qu’il n’a pas l’habitude de ces mauvaises façons. »
– « Pourquoi prétends-tu que c’était moi qu’il regardait ?… » interrogea Mme de Méris… « c’était toi. »
– « C’était toi… » reprit Mme Liébaut en riant ; « moi, il ne pouvait pas me voir. »
– « Mettons que c’était nous », répondit Agathe. Il est donc deux fois mal élevé, quoi que tu en dises, voilà tout… » Puis, riant aussi : – « Ne me présente toujours pas ce candidat à mine de jaunisse, il n’aurait pas de chances … Je n’ai aucune vocation pour le métier de garde-malade… »
Le train commençait de s’ébranler tandis qu’elle prononçait ces mots de raillerie. Elle envoya un baiser du bout de sa main gantée à sa sœur qui longtemps demeura debout sur le petit quai, maintenant désert, à regarder la file des wagons serpenter dans la vallée.
– « Pauvre Agathe ! » se disait-elle… « C’est pourtant vrai que sa vie est trop triste, trop dénudée. Elle est aigrie quelquefois, bien peu, quand on pense à ce qu’elle a traversé, à ce qu’elle traverse… Ah ! si je pouvais réellement lui trouver ce mari dont elle prétend qu’elle ne veut pas !… C’est étrange. Elle est si sensible et l’on dirait qu’elle craint de sentir, si aimante et elle a peur d’aimer… »