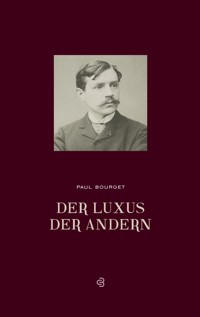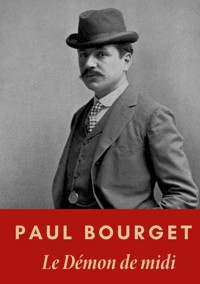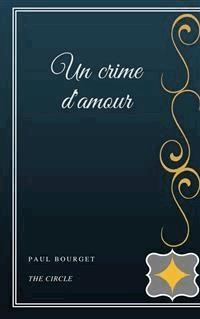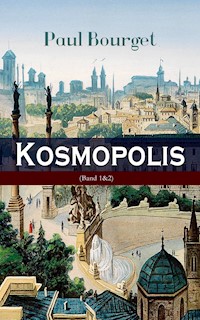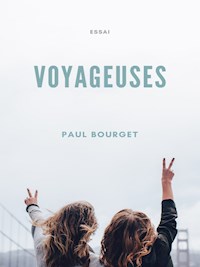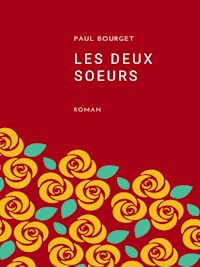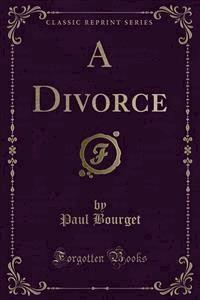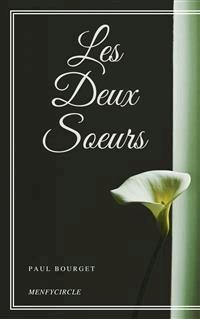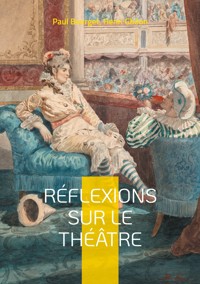
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
« Réflexions sur le théâtre » de Paul Bourget et Henri Ghéon est un ouvrage captivant qui offre une analyse approfondie de l'art dramatique et de son évolution. Ce livre, fruit de la collaboration entre deux figures majeures de la littérature française, propose une réflexion riche et nuancée sur les multiples facettes du théâtre. Les auteurs commencent par explorer les fondements de l'art théâtral, examinant son rôle dans la société et son pouvoir de transformation. Ils analysent ensuite l'évolution des formes dramatiques à travers l'histoire, offrant un panorama fascinant des différents courants et styles qui ont marqué le théâtre occidental. Un chapitre particulièrement éclairant est consacré à la dramaturgie et à l'écriture théâtrale. Bourget et Ghéon, tous deux écrivains accomplis, partagent leurs réflexions sur le processus créatif, la construction des personnages et l'art du dialogue. Leur analyse offre des insights précieux tant pour les praticiens que pour les amateurs de théâtre. Ce livre s'inscrit naturellement dans les catégories « Critique littéraire », « Arts du spectacle » et « Essais sur le théâtre » sur les plateformes de vente en ligne. Les auteurs y déploient une approche à la fois érudite et accessible, alliant profondeur d'analyse et clarté d'expression. « Réflexions sur le théâtre » ne se contente pas d'être un simple traité théorique ; c'est une véritable exploration de l'esthétique théâtrale. Bourget et Ghéon examinent les différents éléments qui composent un spectacle, de la mise en scène à l'interprétation, en passant par la scénographie et la musique. Leur analyse holistique offre une compréhension approfondie de la complexité de l'art dramatique. L'ouvrage aborde également des questions cruciales sur le rôle du théâtre dans la société moderne. Les auteurs s'interrogent sur la place du théâtre face à l'émergence de nouvelles formes de divertissement, offrant des réflexions stimulantes sur l'avenir de cet art millénaire. Un aspect fascinant du livre est son exploration de la relation entre le théâtre et les autres arts. Bourget et Ghéon montrent comment le théâtre s'est nourri et a influencé la littérature, la peinture et la musique, créant des ponts entre les différentes formes d'expression artistique.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 208
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Sommaire
Première partie: Réflexions sur le théâtre
Chapitre I: Le public contemporain.
Chapitre II: La psychologie au théâtre
Chapitre III: De l’emploi des vers au théâtre
Chapitre IV: Le naturalisme au théâtre Zola .
Chapitre V: Une hypothèse sur Shakespeare.
Chapitre VI: Alceste
Chapitre VII: Hamlet
Deuxième partie: L’art du théâtre
Chapitre I: Conditions de l’art dramatique.
Chapitre II: Des origines à l’âge classique.
Chapitre III: D’Hernani au Théâtre Libre.
Chapitre IV: Du Vieux-Colombier au Jeux pour le peuple fidèle.
Première partie
Réflexions sur le théâtre{1}
I. Le public contemporain.
Quand on désire pénétrer dans ses sources profondes une œuvre dramatique, il faut d’abord se demander pour quel public elle a été composée. Un roman d’analyse, des vers intimes, un recueil de pensées peuvent avoir été conçus dans un silence entier de l’univers autour de l’écrivain, et les préoccupations de l’effet à produire n’avoir exercé aucune influence sur l’exécution. Il semble même que ce détachement soit la condition du talent et qu’une page de prose ou de vers ait d’autant plus de chances d’être belle que l’auteur ressent à l’écrire un plaisir plus désintéressé et ne pense pas au succès. Il n’en va pas ainsi lorsqu’il s’agit d’une pièce de théâtre, à tout le moins d’une pièce composée en vue de la scène. L’auteur ne s’est pas proposé alors de transcrire la beauté d’un songe intérieur, sous l’impérieuse contrainte d’un besoin d’expression littéraire. Son but est d’imposer à l’attention de deux mille personnes réunies dans une salle une peinture de mœurs ou de passions. Quelles mœurs, sinon celles que toutes ces personnes connaissent ? Quelles passions, sinon celles qui leur sont familières ? Écrire une pièce de théâtre, c’est donc établir comme une moyenne des opinions du public pour lequel on l’écrit. Pareil sur ce point à l’orateur, le dramaturge est une vivante synthèse des idées éparses dans une foule. C’est à la fois sa gloire et sa faiblesse. Comme l’orateur, il est sublime ou il est médiocre, suivant que son public est sublime ou médiocre. Vraisemblablement, Shakespeare n’eût pas rencontré dans la solitude de sa pensée l’énergie admirable de ses chroniques sur la guerre des Deux-Roses. Il était porté, quand il écrivait ces drames d’héroïsme et de fureur, par le souffle échappé à ce peuple anglais de la Renaissance avec lequel il vivait, si l’on peut dire, en communion. La parfaite politesse des tragédies de Racine, elle aussi, décèle la parfaite politesse des aristocratiques spectateurs pour lesquels le poète ciselait ses alexandrins. Il est probable qu’un auteur dramatique possède à là fois l’imagination des espaces et celle des sentiments. La première lui permet de voir les planches, les allées et les venues des acteurs, leurs entrées et leurs sorties. La seconde lui permet de voir les émotions qui, dans la salle, correspondent aux paroles, aux gestes, aux actions des personnages de la scène. Si cette hypothèse sur l’imagination des écrivains de théâtre se trouvait vérifiée, elle expliquerait du coup pourquoi le don naturel leur est nécessaire et d’une nécessité absolue. Il n’y a point d’éducation ni de volonté qui puisse amener dans l’intelligence la production d’images d’un certain ordre, si ces images ne surgissent point par une reviviscence instinctive.
Quand de nos jours un auteur dramatique compose une pièce, quel public a-t-il devant les yeux de sa pensée, suivant la forte et si juste expression du peuple ? Telle est la question à laquelle doivent répondre ceux qui s’intéressent à l’avenir de notre art dramatique français. Toute théorie qui néglige cette question-là est hors de la réalité. La réponse est bien simple au premier abord. Cet auteur vit d’ordinaire à Paris, et il voit des Parisiens comme lui ; il connaît le détail de leurs goûts et la qualité de leurs idées, en premier lieu parce qu’il est un d’entre eux ; puis il a comme un sens particulier qui lui permet de se créer à son usage une façon de spectateur imaginaire, en qui s’incarne la salle entière. Ces Parisiens arrivent au théâtre ayant travaillé toute la journée. Le nombre des oisifs est si petit qu’il disparaît dans le grand ensemble. Ces gens qui ont peiné les uns cinq ou six heures, les autres dix, dans un bureau, dans un magasin, à la Bourse, veulent s’amuser. Si vous leur apportez quelque comédie très profondément pensée ou quelque drame surabondant de lyrisme, peut-être subiront-ils la domination du talent, mais ce ne sera là qu’une exception. La littérature ne peut pas être l’objet d’un nouvel effort pour ces cerveaux qui se sont déjà fatigués au dur effort quotidien. L’auteur dramatique se figure donc ce public de neuf heures du soir. Le lustre est allumé. Le frémissement de l’impatience commence à courir le long des fauteuils d’orchestre et des loges. Combien rencontrerez-vous, parmi ces femmes dont les toilettes chatoient et parmi ces hommes en habit noir, de personnes capables de ressentir un plaisir purement littéraire ? Pour apprécier la place d’un mot, la nuance d’un style, l’originalité d’un point de vue, la finesse d’une analyse, il faut qu’une forte éducation première ait préparé l’intelligence ou qu’une pratique continue des livres en tienne lieu. Dans cette salle de théâtre, combien ont poussé leurs études au-delà d’un baccalauréat mal passé ? Combien ont lu, depuis vingt ans, autre chose que des journaux et des romans, et pour y chercher quelle provision d’idées ? Tout au plus des renseignements de politique ou la distraction pimentée d’une heure.
Si le Parisien, qui vient au théâtre, veut s’amuser, et s’il est peu capable de se complaire dans un amusement d’un ordre très intellectuel et très délicat, il est en revanche très capable de juger le degré d’habileté scénique, d’observation exacte et d’esprit dialogué que l’auteur a mis dans son œuvre. D’habileté, — car ce Parisien a l’habitude du théâtre, et son incompétence à l’endroit du style et de la philosophie se double d’une compétence très avertie à l’endroit des combinaisons d’événements qui constituent la mise en œuvre dramatique. D’observation exacte — car dans la formidable mêlée d’intérêts qui constitue la vie à Paris, notre homme a pris l’habitude et le goût d’une certaine dissection brève, mais sûre, qui va au fond des caractères et des situations. D’esprit dialogué, — car notre homme est exercé à dire et à entendre des « mots ». Il est lui-même spirituel et ironique, ou, pour employer la vieille formule toujours vraie, il est blagueur. Sa faculté poétique est à peu près nulle. Ce n’est pas lui qui partirait pour les Indes comme un habitant de Londres, avec un Shakespeare et une Bible dans sa valise. Par contre, ce Parisien est débarrassé de beaucoup de préjugés, et comme il est infiniment nerveux il demande qu’on lui traduise son positivisme pratique en formules d’une intensité nouvelle. Nécessairement aussi, et par suite de ce positivisme et de cet énervement, il aime les allusions libertines, la basse gaieté qui chatouille ce qu’il y a de plus sensuel dans l’animal humain. Pourvu que ce libertinage soit allègre, et cette gaieté assaisonnée d’esprit, ce spectateur est heureux, son cerveau se détend, sa rate s’épanouit. Tout cela, l’auteur dramatique le sait, — et qu’il faut, pour plaire a ces blasés, une extrême ingéniosité de procédés, de la vérité voire de la brutalité dans la mise à nu des passions, et une gouaillerie hardie du drogue pour achever le succès.
Une contradiction en apparence très singulière apparaît lorsqu’on a suivi les représentions théâtres pendant plusieurs années, et particulièrement étudié le public durant les chutes des pièces. Ces mêmes Parisiens que la grivoiserie de telle chanson d’opérette fait pâmer d’admiration épanouie, n’auraient pas assez de sifflets pour un auteur qui se permettrait de railler sur la scène les « grands sentiments », comme on dit en langage de critique courante. Il a fallu que M. Alexandre Dumas déployât les plus secrètes ressources d’un talent prestigieux pour que la Visite de noces tînt les planches, — et qu’y était-il dit cependant, sinon que l’adultère est une chose vilaine et triste, terminée le plus souvent parle mépris de l’homme et par la haine de la femme ? Mais c’était dire aussi que l’amour est parfois une dangereuse duperie, et l’amour est au nombre des « grands sentiments ». Le patriotisme et la famille demeurent encore comme deux thèmes auxquels une salle de spectacle ne souffrirait pas que l’on touchât sans respect. L’écrivain qui traite, ces thèmes au contraire avec un enthousiasme, sincère ou joué, peut être assuré d’unanimes applaudissements. Le moraliste doit sourire de cette naïve anomalie. N’y a-t-il pas quelque naïveté en effet, et une étonnante inconséquence, à prétendre respecter son pays d’une part, lorsque, de l’autre, on ne respecte rien de ce qui fait la vigueur d’un pays : la chasteté des hommes, la grande et entière simplicité du cœur, le profond sérieux de la vie morale ? Mais le Parisien ne s’inquiète guère de concilier sa gouaillerie et ses générosités, ses heures cyniques et ses heures lyriques. Le défaut essentiel de notre race française est chez lui plus manifeste que chez tout autre. Il manque d’idéalisme — au sens philosophique et intime de ce mot — à un incroyable degré. Le besoin d’interpréter l’existence par une idée intérieure qui nous mette d’accord avec nous-même et avec l’univers lui demeure parfaitement étranger et presque inintelligible. Je ne doute point que même un tel reproche ne lui parût très extraordinaire. Comment aurait-on démontré aux Français de 1830 que les chansons de Béranger, avec leur mélange de sensualisme grossier et de déisme irraisonné, constituaient le plus misérable des compromis ? Saluer Dieu le verre à la main, célébrer dans un même couplet les appas de Lisette et la bonté indulgente du Très-Haut, était la mode de l’époque. Le pauvre Henri Murger, qui a écrit le Manchon de Francine, ce chef-d’œuvre de sensibilité malade, a renchéri encore sur l’auteur du Dieu des bonnes gens, en faisant de ce Dieu le complaisant témoin des baisers de Rodolphe et de Mimi, dans son Requiem d’Amour, où se trouvent d’ailleurs des strophes dignes de Henri Heine :
Embrassez-vous encor, je ne regarde pas,
est-il censé leur dire de son balcon d’azur ! Ce sont des phrases inexplicables sinon par une altération du sens des mots, produite elle-même par une altération des idées philosophiques.
Encore une fois, les Parisiens de 1882 n’ont pas changé sur ce point. Ils ne chantent plus du Béranger, mais ils sont bien les fils de ceux qui avaient dénommé ce médiocre poète le chansonnier national, et ils ont gardé en, eux, vivantes et durables, les deux tendances contraires que j’ai signalées. Ces deux tendances, l’homme qui écrit pour le théâtre les connaît bien, et il en tient soigneusement compte. Il sait leurs conséquences logiques, et pour réussir il va jusqu’au bout de ces conséquences. Le Parisien veut s’amuser, donc il ne faut pas le laisser sur une impression trop amère. Le Parisien veut que les grands sentiments soient respectés, donc il ne faut pas que les héros ou les héroïnes coupables triomphent trop complètement. C’est ainsi qu’une moyenne de moralité s’établit, sur laquelle il y aurait beaucoup à dire. Peut-être cette hypocrisie est-elle plus immorale à elle seule que les pires outrances des pires paradoxes. Ce qu’il y a de certain, c’est que pas un auteur n’a osé la braver, — exception soit faite pour M. Dumas dont l’œuvre doit toujours être considérée à part, tant elle est personnelle et unique dans ses meilleures pages : l’Ami des femmes, la Femme de Claude, la Visite de noces. On sait d’ailleurs quel succès accueillit les deux premières de ces pièces.
Ces quelques traits généraux de la physionomie du public pour le plaisir duquel travaille l’auteur dramatique auraient besoin d’être complétés par des traits plus particuliers. A chaque période de deux ou trois années correspondent certaines passions politiques et religieuses. L’écrivain dramatique en tient parfois compte pour son malheur, témoin un Daniel Rochat M. Sardou, — ou pour son bonheur, témoin un Quatre-vingt-treize Hugo. A des périodes un peu plus longues correspondent certaines vogues d’artistes, qui exercent une influence décisive sur la conception des rôles. Tel acteur est, à tel moment, pour un auteur, une série d’effets assurés sur le public. Il faut donc écrire à l’usage de ce comédien en vogue un rôle qui soit exactement dans ses moyens et qui lui permette de produire tous ses effets. L’écrivain incarne alors sa jeune première sous les traits de Mme Judic ou son jeune premier sous les traits de M. Delaunay, — je prends au hasard ces deux noms que me suggèrent de récents triomphes. — Qui pourrait analyser l’influence d’un interprète aimé du public sur l’imagination des auteurs dramatiques composerait un curieux chapitre d’histoire littéraire. Il ne faut pas croire que cette influence soit toujours mauvaise. En définitive, un acteur qui réussit longtemps et beaucoup n’obtient cette sorte de dictature sur la foule qu’à la condition d’incarner un certain type idéal que le public retrouve en lui. Son jeu résume certaines façons de comprendre les passions ou les mœurs qui flottent dans l’air de l’époque. Observer ce jeu, c’est donc observer l’époque entière, indirectement il est vrai, et comme en un miroir qui en déforme un peu l’image, mais cette observation est parfois féconde. C’est en tout cas une des manières dont l’auteur dramatique se conforme au goût du public et une des manières dont le public influe sur l’auteur dramatique.
II. La psychologie au théâtre
Quand on a remarqué l’influence du grand public sur les auteurs dramatiques de notre époque, il est curieux de constater comment cette influence les conduit à se mettre en désaccord absolu avec cet autre public tout restreint qui est celui des lettrés : prosateurs raffinés ou poètes délicats, faiseurs de romans ou forgeurs de sonnets. Il suffît pour faire cette constatation d’être assis à une table d’un café à Montmartre ou sur le boulevard, dans un fumoir de jeune écrivain ou dans un atelier de peintre, partout, enfin, où se parlent des feuilletons d’une saveur de critique dont les plus alertes chroniqueurs ne donnent pas l’idée. Fervents du naturalisme et dévots du Parnasse s’entendent avec une rare unanimité à refuser tout talent aux pièces les plus acclamées. Il est probable que les triomphateurs de la scène, forts des applaudissements écoutés et des sommes encaissées, se soucient peu du déchet littéraire qu’ils peuvent ainsi subir au regard d’écrivains dont la plupart débutent. En cela, ces triomphateurs ont à la fois raison et tort. Raison, car les intransigeants de cette critique parlée ont soin de gâter leurs théories les plus justes par leur excès. Tort aussi, car ce divorce absolu entre les écrivains du livre et ceux du théâtre est un fait nouveau qui atteste que le théâtre actuel ne répond pas suffisamment aux besoins artistiques de l’époque. Ce divorce est si profond, qu’il s’est produit, parmi la jeunesse littéraire qui grandit, une véritable hostilité contre la forme dramatique. L’insuffisance de nouvelles pièces signées de nouveaux noms ne provient pas d’autre cause. Sauf exception, un passionné de lettres s’attaquera aujourd’hui, pour son coup d’essai, à un roman ou à un recueil de vers bien plutôt qu’à un drame ou à une comédie. La difficulté de la représentation de l’œuvre scénique n’entre que pour peu de chose dans cette préférence. Car les avantages matériels du succès au théâtre compensent les difficultés et les font disparaître aux yeux du débutant qui rêve la gloire et la fortune. Les raisons sont plus profondes et valent qu’on les expose. Je voudrais dire celles que je vois nettement.
Le dix-neuvième siècle est un âge de science. C’est là une thèse répétée si souvent qu’elle en est banale. Et comme tout se tient des productions d’une époque, parce que la même idée maîtresse domine les intelligences dans leurs diverses applications, la littérature du dix-neuvième siècle est une littérature de science. Cela signifie que le goût de la notation exacte est le trait commun aux maîtres de ce temps. Formé et fond, sous l’influence de ce besoin sans cesse avivé d’exactitude, considérez comme l’art d’écrire s’est petit à petit rapproché de la sociologie avec le roman de mœurs, de la psychologie avec celui d’analyse. Pour être plus exacts, les romanciers ont introduit dans leurs récits soit des descriptions minutieuses comme des inventaires, soit une anatomie mentale des personnages, jusqu’alors inconnue ou du moins négligée. Pour être plus exacts, les poètes objectifs ont doublé leurs poèmes historiques d’une consciencieuse étude des livres spéciaux, et dans leurs poèmes intimes poursuivi la sincérité jusqu’au cynisme. C’est en vue d’une exécution plus exacte que les prosateurs ont semé leurs phrases de termes techniques et les versificateurs brisé le rythme des alexandrins, de manière à serrer de tout près le contour réel des objets à peindre. Les « Zeus » et les « Odysseus » de M. Leconte de Lisie, les « architraves » et les « linteaux » de Théophile Gautier, comme les interminables catalogues de Balzac, comme les hypothèses nosographiques de Michelet, — je prends les exemples pêle-mêle, — procèdent de cette même soif, avouée ou involontaire : un besoin de rigueur scientifique et de constatation vérifiée.
Des trois principales formes de la littérature d’imagination : la forme poétique, la forme romanesque, la forme dramatique, il semblait que la dernière dût s’accommoder de préférence à ce goût singulier d’exactitude. Le théâtre n’a-t-il pas été considéré de tout temps comme la peinture vivante des caractères, c’est-à-dire comme une psychologie en action ? L’événement a montré cependant qu’il n’en allait pas ainsi. Renouvelé par Balzac et Stendhal, le roman foisonne en œuvres renseignées fournies de menus faits comme un mémoire de naturaliste. Renouvelée par dix auteurs de grand talent, la poésie analytique abonde en recueils d’une saveur inédite et toutes les nuances de l’âme moderne s’y trouvent reproduites en des vers merveilleux de subtilité, depuis le libertinage nostalgique d’un Baudelaire jusqu’à la mélancolie métaphysique d’un Sully-Prudhomme. Le théâtre, lui, est allé se rétrécissant de plus en plus, multipliant à l’infini les combinaisons d’un petit nombre de types une fois découverts. M. Dumas mis à part, comme un novateur que nul n’a suivi, tous les autres auteurs n’ont su, avec cette forme rebelle, qu’établir des œuvres de psychologie moyenne, telle que le Gendre de M. Poirier, ou qu’aboutir à des soutenances de thèses et à des escamotages de scène. La complication mécanique, si l’on peut dire, est arrivée à son perfectionnement suprême, mais d’œuvres que le lettré puisse « sucer comme une fleur », suivant le mot de Byron, de ces œuvres qui se reprennent et se reprennent encore dans la solitude des soirées ou des matinées pour en nourrir son cœur et redoubler en soi le sentiment de la vie morale, — de ces œuvres enfin qui passent dans la substance de l’âme de celui qui les aime, — est-ce illusion ou parti pris ? j’avoue que j’en cherche et que je n’en trouve guère. Si l’on excepte des chefs-d’œuvre, comme la Visite de noces et l’Ami des femmes, quelques pièces exquises d’ironie signées des noms de MM. Meilhac et Halévy, quelques comédies supérieures, comme la Parisienne de M. Becque, mon humble avis est que dans une cinquantaine d’années c’est par nos romans et nos volumes de vers que nous comparaîtrons devant ceux qui nous auront succédé. C’est dans ces romans et dans ces vers qu’ils trouveront notre goût particulier de l’existence. C’est par ces romans et par ces vers que nous avons fait notre psychologie et celle des hommes de notre race.
Les causes abondent qui expliquent pourquoi, psychologique comme elle l’est, la littérature du dix-neuvième siècle ne pouvait que malaisément trouver une formule théâtrale qui lui convînt. Le théâtre est constitué par l’action. Il la veut énergique et il la veut rapide. Or, la vie moderne, au moins en France, rend de plus en plus rares les hommes qui agissent de cette action-là. L’hérédité nerveuse, l’éducation complexe, la douceur relative des mœurs tendent à faire de nous des êtres de réflexion ou de rêverie. Il y a du Hamlet dans chacun de nous, de ce prince douteux, inquiet, qui raisonne au lieu de frapper, et chez qui l’événement extérieur n’est qu’un contre-coup très diminué de l’événement intérieur. Un tel personnage est tout à sa place dans un roman. Une série de poèmes lyriques conviendra bien encore pour reproduire l’ondoiement de sa pensée solitaire. Il a fallu le génie de Shakespeare et la richesse de procédés familière au drame du seizième siècle anglais pour qu’un pareil héros tînt les planches. Puis la créature humaine est de nos jours domestiquée, si l’on peut dire. La lutte pour la vie ayant été soumise à une réglementation sociale de plus en plus stricte, nous sommes tous ou presque tous des êtres d’habitude, subissant un métier et profondément modifiés par lui. Dans l’existence de la plupart des Français d’aujourd’hui, il n’arrive aucune espèce d’événements. C’est pour démontrer cette vérité que Flaubert a composé sa plus douloureuse étude : l’Éducation sentimentale, — cette histoire d’une attente de plus de trente années, Pour peindre des hommes qui vivent ainsi une vie toute en détails infiniment petits, toute en impressions sans crises aiguës, il faut une accumulation d’observations infiniment petites. Car une accumulation d’influences en apparence négligeables, en réalité très importantes par leur répétition et leur persistance, a façonné l’employé qui se rend à son bureau, la femme du monde qui tient un salon, l’ouvrier qui travaille dans son atelier. A rendre cette accumulation d’influences, le roman et la poésie excellent. Laissant de côté l’Éducation, qui peut paraître excessive par son parti pris de vaste fresque sans morceau central, prenons comme types la Madame Gervaisais, des frères de Goncourt, et les Fleurs du mal, de Baudelaire. Les Goncourt, pour marquer l’envahissement de l’âme de la femme philosophe par la dévotion, Baudelaire pour caractériser un spleen si maladivement spécial, ont comme tenu un journal des heures et des minutes. Ce sont les passagères, les vagues, les mystérieuses demi-teintes de la sensation et du sentiment qu’ils étiquètent en une série de notules juxtaposées. Comme les innombrables pierres d’une mosaïque, ces notules se complètent les unes les autres et font dessin. Une nature entière se révèle à nous, avec le petit frisson quotidien qui lentement la modifie. Comment, avec le dialogue pour seul outil, l’auteur dramatique arriverait-il à rivaliser, sur ce point, le poète ou le romancier ? Il ressemble à un peintre de plafond obligé d’encadrer des anatomies compliquées dans le raccourci d’un caisson. Même quand ce raccourci est exécuté avec une puissance qui tient du prodige, — ainsi le de Ryons de l’Ami des femmes, — le personnage cesse d’être entièrement intelligible au public. Ses mots sont trop chargés de sens, et la pièce, au lieu d’être jouée, devient un livre, un roman dialogué auquel manquent seules les descriptions.
La qualité du style crée à l’auteur dramatique soucieux de psychologie une difficulté de plus. Ceux qui ont étudié de près un ou deux styles de grands écrivains savent que le rapport seul des mots révèle une sensibilité entière. Il y a des syntaxes énervées, il en est de musclées, il en est de violentes et de douces. Une phrase de Gautier par sa structure un peu massive mais sereine, une phrase de Stendhal par son allure vive et détachée, une phrase de Saint-Simon par ses enragées surcharges d’incidentes, montrent tout un homme. « Il est vraisemblable que le don d’écrire s’accompagne toujours du don d’entendre une petite voix intérieure qui dicte la phrase. Faire passer l’accent de cette voix dans les mots, c’est proprement avoir du style, et ainsi compris, le style devient en effet un élément de psychologie d’une extraordinaire valeur. Voilà qui est rendu singulièrement difficile à l’auteur dramatique, lequel doit écrire d’abord un langage parlé haut, puis un langage qui serve à une action déterminée, qui soit celui de personnages, pour la plupart vulgaires et médiocres. Ne cherchez pas un autre motif à l’étonnante insuffisance de style qui se remarque chez tant d’auteurs applaudis sur la scène contemporaine. Ils n’ont pas su se créer un dialogue à la fois très vivant et très littéraire, comme Molière, comme Beaumarchais, comme M. Dumas chez qui la portion dialoguée de l’œuvre est plus écrite que les fameuses préfaces et que les romans.