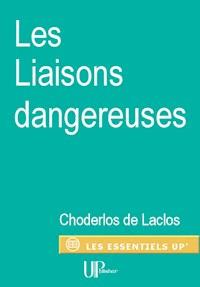Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
"Choderlos de Laclos est un roman épistolaire publié en 1782 qui a marqué l'histoire de la littérature française. Les Liaisons dangereuses raconte l'histoire de deux nobles français, la marquise de Merteuil et le vicomte de Valmont, qui se livrent à des jeux de séduction et de manipulation au sein de la haute société du XVIIIe siècle.Ce roman met en lumière les intrigues, les complots et les jeux de pouvoir qui animent la vie mondaine de l'époque. Les personnages principaux, Merteuil et Valmont, sont des manipulateurs hors pair, usant de leur charme et de leur intelligence pour parvenir à leurs fins. Leur relation est empreinte de passion, de trahison et de cruauté, et leur duel psychologique est au cœur de l'intrigue.Les Liaisons dangereuses est un roman subversif qui dépeint avec réalisme les vices et les travers de la société aristocratique de l'époque. Il aborde des thèmes tels que la morale, la sexualité, le pouvoir et la manipulation, et offre une critique acerbe de la société de l'Ancien Régime.Ce livre est un classique de la littérature française, reconnu pour sa finesse psychologique, son style élégant et sa capacité à captiver le lecteur. Les Liaisons dangereuses est un roman incontournable qui continue de fasciner les lecteurs par sa modernité et sa pertinence.""Les Liaisons dangereuses"", œuvre écrite par Laclos en 1782, est un roman épistolaire à l'agencement subtil qui reflète son intrigue tortueuse. La libertine Marquise de Merteuil veut se venger de son ancien amant en pervertissant sa future, la candide Cécile tout juste sortie du couvent. Mais son allié Valmont refuse la mission, trop occupé de son côté à séduire la dévote Madame de Tourvel."
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 702
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EAN : 9782335001006
©Ligaran 2014
Tu vois, ma bonne amie, que je te tiens parole, et que les bonnets et les pompons ne prennent pas tout mon temps ; il m’en restera toujours pour toi. J’ai pourtant vu plus de parures dans cette seule journée que dans les quatre ans que nous avons passés ensemble ; et je crois que la superbe Tanville aura plus de chagrin à ma première visite, où je compte bien la demander, qu’elle n’a cru nous en faire toutes les fois qu’elle est venue nous voir in fiocchi. Maman m’a consultée sur tout ; elle me traite beaucoup moins en pensionnaire que par le passé. J’ai une femme de chambre à moi ; j’ai une chambre et un cabinet dont je dispose, et je t’écris à un secrétaire très joli, dont on m’a remis la clef, et où je peux renfermer tout ce que je veux. Maman m’a dit que je la verrais tous les jours à son lever ; qu’il suffisait que je fusse coiffée pour dîner, parce que nous serions toujours seules, et qu’alors elle me dirait chaque jour l’heure où je devrais l’aller joindre l’après-midi. Le reste du temps est à ma disposition, et j’ai ma harpe, mon dessin et des livres comme au couvent, si ce n’est que la mère Perpétue n’est pas là pour me gronder, et qu’il ne tiendrait qu’à moi d’être toujours à rien faire ; mais comme je n’ai pas ma Sophie pour causer et pour rire, j’aime autant m’occuper.
Il n’est pas encore cinq heures ; je ne dois aller retrouver maman qu’à sept : voilà bien du temps si j’avais quelque chose à te dire ! Mais on ne m’a encore parlé de rien ; et sans les apprêts que je vois faire et la quantité d’ouvrières qui viennent toutes pour moi, je croirais qu’on ne songe pas à me marier, et que c’est un radotage de plus de la bonne Joséphine. Cependant maman m’a dit si souvent qu’une demoiselle devait rester au couvent jusqu’à ce qu’elle se mariât que puisqu’elle m’en fait sortir, il faut bien que Joséphine ait raison.
Il vient d’arrêter un carrosse à la porte et maman me fait dire de passer chez elle tout de suite. Si c’était le monsieur ? Je ne suis pas habillée, la main me tremble et le cœur me bat. J’ai demandé à la femme de chambre si elle savait qui était chez ma mère : « Vraiment, m’a-t-elle dit, c’est M. C ***. » Et elle riait. Oh ! je crois que c’est lui. Je reviendrai sûrement te raconter ce qui se sera passé. Voilà toujours son nom. Il ne faut pas se faire attendre. Adieu, jusqu’à un petit moment.
Comme tu vas te moquer de la pauvre Cécile ! Oh ! j’ai été bien honteuse. Mais tu y aurais été attrapée comme moi. En entrant chez maman, j’ai vu un monsieur en noir, debout auprès d’elle. Je l’ai salué du mieux que j’ai pu et suis restée sans pouvoir bouger de ma place. Tu juges combien je l’examinais ! « Madame, a-t-il dit à ma mère, en me saluant, voilà une charmante demoiselle, et je sens mieux que jamais le prix de vos bontés. » À ce propos si positif, il m’a pris un tremblement tel que je ne pouvais me soutenir ; j’ai trouvé un fauteuil et je m’y suis assise, bien rouge et bien déconcertée. J’y étais à peine que voilà cet homme à mes genoux. Ta pauvre Cécile alors a perdu la tête ; j’étais, comme a dit maman, tout effarouchée. Je me suis levée en jetant un cri perçant… tiens, comme ce jour du tonnerre. Maman est partie d’un éclat de rire, en me disant : « Eh bien ! qu’avez-vous ? Asseyez-vous et donnez votre pied à monsieur. » En effet, ma chère amie, le monsieur était un cordonnier. Je ne peux te rendre combien j’ai été honteuse : par bonheur, il n’y avait que maman. Je crois que, quand je serai mariée, je ne me servirai plus de ce cordonnier-là.
Conviens que nous voilà bien savantes ! Adieu, il est près de six heures, et ma femme de chambre dit qu’il faut que je m’habille. Adieu, ma chère Sophie ; je t’aime comme si j’étais encore au couvent.
P.-S. – Je ne sais par qui envoyer ma lettre : ainsi j’attendrai que Joséphine vienne.
Paris, ce 3 août 17 **.
Revenez, mon cher vicomte, revenez : que faites-vous, que pouvez-vous faire chez une vieille tante dont tous les biens vous sont substitués ? Partez sur-le-champ ; j’ai besoin de vous. Il m’est venu une excellente idée et je veux bien vous en confier l’exécution. Ce peu de mots devrait suffire et, trop honoré de mon choix, vous devriez venir avec empressement prendre mes ordres à genoux ; mais vous abusez de mes bontés, même depuis que vous n’en usez plus, et dans l’alternative d’une haine éternelle ou d’une excessive indulgence, votre bonheur veut que ma bonté l’emporte. Je veux donc bien vous instruire de mes projets : mais jurez-moi qu’en fidèle chevalier, vous ne courrez aucune aventure que vous n’ayez mis celle-ci à fin. Elle est digne d’un héros : vous servirez l’amour et la vengeance ; ce sera enfin une rouerie de plus à mettre dans vos mémoires : oui, dans vos mémoires, car je veux qu’ils soient imprimés un jour et je me charge de les écrire. Mais laissons cela et revenons à ce qui m’occupe.
Mme de Volanges marie sa fille : c’est encore un secret ; mais elle m’en a fait part hier. Et qui croyez-vous qu’elle ait choisi pour gendre ? Le comte de Gercourt. Qui m’aurait dit que je deviendrais la cousine de Gercourt ? J’en suis dans une fureur… Eh bien ! vous ne devinez pas encore ? Oh ! l’esprit lourd ! Lui avez-vous donc pardonné l’aventure de l’intendante ! Et moi, n’ai-je pas encore plus à me plaindre de lui, monstre que vous êtes ? Mais je m’apaise, et l’espoir de me venger rassérène mon âme.
Vous avez été ennuyé cent fois, ainsi que moi, de l’importance que met Gercourt à la femme qu’il aura et de la sotte présomption qui lui fait croire qu’il évitera le sort inévitable. Vous connaissez ses ridicules préventions pour les éducations cloîtrées et son préjugé, plus ridicule encore, en faveur de la retenue des blondes. En effet, je gagerais que, malgré les soixante mille livres de rente de la petite Volanges, il n’aurait jamais fait ce mariage si elle eût été brune, ou si elle n’eût pas été au couvent. Prouvons-lui donc qu’il n’est qu’un sot : il le sera sans doute un jour ; ce n’est pas là ce qui m’embarrasse, mais le plaisant serait qu’il débutât par là. Comme nous nous amuserions le lendemain en l’entendant se vanter, car il se vantera ; et puis, si une fois vous formez cette petite fille, il y aura bien du malheur si le Gercourt ne devient pas, comme un autre, la fable de Paris.
Au reste, l’héroïne de ce nouveau roman mérite tous vos soins. Elle est vraiment jolie ; cela n’a que quinze ans, c’est le bouton de rose ; gauche, à la vérité, comme on ne l’est point et nullement maniérée ; mais, vous autres hommes, vous ne craignez pas cela ; de plus, un certain regard langoureux qui promet beaucoup en vérité. Ajoutez-y que je vous la recommande, vous n’avez plus qu’à me remercier et m’obéir.
Vous recevrez cette lettre demain matin. J’exige que demain, à sept heures du soir, vous soyez chez moi. Je ne recevrai personne qu’à huit, pas même le régnant chevalier : il n’a pas assez de tête pour une aussi grande affaire. Vous voyez que l’amour ne m’aveugle pas. À huit heures je vous rendrai votre liberté, et vous reviendrez à dix souper avec le bel objet, car la mère et la fille souperont chez moi. Adieu, il est midi passé, bientôt je ne m’occuperai plus de vous.
Paris, ce 4 août 17 **.
Je ne sais encore, rien, ma bonne amie. Maman avait hier beaucoup de monde à souper. Malgré l’intérêt que j’avais à examiner, les hommes surtout, je me suis fort ennuyée. Hommes et femmes, tout le monde m’a beaucoup regardée, et puis on se parlait à l’oreille et je voyais bien qu’on parlait de moi : cela me faisait rougir ; je ne pouvais m’en empêcher. Je l’aurais bien voulu, car j’ai remarqué que quand on regardait les autres femmes, elles ne rougissaient pas, ou bien c’était le rouge qu’elles mettent qui empêche de voir celui que l’embarras leur cause, car il doit être bien difficile de ne pas rougir quand un homme vous regarde fixement.
Ce qui m’inquiétait le plus était de ne pas savoir ce qu’on pensait sur mon compte. Je crois avoir entendu pourtant deux ou trois fois le mot de jolie, mais j’ai entendu bien distinctement celui de gauche ; et il faut que cela soit bien vrai, car la femme qui le disait est parente et amie de ma mère ; elle paraît même avoir pris tout de suite de l’amitié pour moi. C’est la seule personne qui m’ait un peu parlé dans la soirée. Nous souperons demain chez elle.
J’ai encore entendu, après souper, un homme que je suis sûre qui parlait de moi, et qui disait à un autre : « Il faut laisser mûrir cela, nous verrons cet hiver. » C’est peut-être celui-là qui doit m’épouser ; mais alors ce ne serait donc que dans quatre mois ! Je voudrais bien savoir ce qui en est.
Voilà Joséphine, et elle me dit qu’elle est pressée. Je veux pourtant te raconter encore une de mes gaucheries. Oh ! je crois que cette dame a raison !
Après le souper on s’est mis à jouer. Je me suis placée auprès de maman ; je ne sais pas comment cela s’est fait, mais je me suis endormie presque tout de suite. Un grand éclat de rire m’a réveillée. Je ne sais si l’on riait de moi, mais je le crois. Maman m’a permis de me retirer, et elle m’a fait grand plaisir. Figure-toi qu’il était onze heures passées. Adieu, ma chère Sophie ; aime toujours bien ta Cécile. Je t’assure que le monde n’est pas aussi amusant que nous l’imaginions.
Paris, ce 4 août 17 **.
Vos ordres sont charmants ; votre façon de les donner est plus aimable encore ; vous feriez chérir le despotisme. Ce n’est pas la première fois, comme vous savez, que je regrette de ne plus être votre esclave ; et tout monstre que vous dites que je suis, je ne me rappelle jamais sans plaisir le temps où vous m’honoriez de noms plus doux. Souvent même je désire de les mériter de nouveau et de finir par donner, avec vous, un exemple de constance au monde. Mais de plus grands intérêts nous appellent ; conquérir est notre destin ; il faut le suivre : peut-être au bout de la carrière nous rencontrerons-nous encore ; car, soit dit sans vous fâcher, ma très belle marquise, vous me suivez au moins d’un pas égal, et depuis que, nous séparant pour le bonheur du monde, nous prêchons la foi chacun de notre côté, il me semble que dans cette mission d’amour vous avez fait plus de prosélytes que moi. Je connais votre zèle, votre ardente ferveur ; et si ce dieu-là nous jugeait sur nos œuvres, vous seriez un jour la patronne de quelque grande ville, tandis que votre ami serait au plus un saint de village. Ce langage vous étonne, n’est-il pas vrai ? Mais depuis huit jours je n’en entends, je n’en parle pas d’autre ; et c’est pour m’y perfectionner que je me vois forcé de vous désobéir.
Ne vous fâchez pas et écoutez-moi. Dépositaire de tous les secrets de mon cœur, je vais vous confier le plus grand projet que j’aie jamais formé. Que me proposez-vous ? de séduire une jeune fille qui n’a rien vu, ne connaît rien ; qui, pour ainsi dire, me serait livrée sans défense ; qu’un premier hommage ne manquera pas d’enivrer et que la curiosité mènera peut-être plus vite que l’amour. Vingt autres peuvent y réussir comme moi. Il n’en est pas ainsi de l’entreprise qui m’occupe ; son succès m’assure autant de gloire que de plaisir. L’amour qui prépare ma couronne hésite lui-même entre le myrte et le laurier, ou plutôt il les réunira pour honorer mon triomphe. Vous-même, ma belle amie, vous serez saisie d’un saint respect, et vous direz avec enthousiasme : « Voilà l’homme selon mon cœur. »
Vous connaissez la présidente Tourvel, sa dévotion, son amour conjugal, ses principes austères. Voilà ce que j’attaque ; voilà l’ennemi digne de moi ; voilà le but que je prétends atteindre ;
Et si de l’obtenir je n’emporte le prix,
J’aurai du moins l’honneur de l’avoir entrepris.
On peut citer de mauvais vers quand ils sont d’un grand poète.
Vous saurez donc que le président est en Bourgogne, à la suite d’un grand procès (j’espère lui en faire perdre un plus important). Son inconsolable moitié doit passer ici tout le temps de cet affligeant veuvage. Une messe chaque jour, quelques visites aux pauvres du canton, des prières du matin et du soir, des promenades solitaires, de pieux entretiens avec ma vieille tante et quelquefois un triste wisk devaient être ses seules distractions. Je lui en prépare de plus efficaces. Mon bon ange m’a conduit ici pour son bonheur et pour le mien. Insensé ! je regrettais vingt-quatre heures que je sacrifiais à des égards d’usage. Combien on me punirait en me forçant de retourner à Paris ! Heureusement il faut être quatre pour jouer au wisk, et comme il n’y a ici que le curé du lieu, mon éternelle tante m’a beaucoup pressé de lui sacrifier quelques jours. Vous devinez que j’ai consenti. Vous n’imaginez pas combien elle me cajole depuis ce moment, combien surtout elle est édifiée de me voir régulièrement à ses prières et à sa messe. Elle ne se doute pas de la divinité que j’y adore.
Me voilà donc, depuis quatre jours, livré à une passion forte. Vous savez si je désire vivement, si je dévore les obstacles ; mais ce que vous ignorez c’est combien la solitude ajoute à l’ardeur du désir. Je n’ai plus qu’une idée ; j’y pense le jour et j’y rêve la nuit. J’ai bien besoin d’avoir cette femme pour me sauver du ridicule d’en être amoureux, car où ne mène pas un désir contrarié ? Ô délicieuse jouissance, je t’implore pour mon bonheur et surtout pour mon repos. Que nous sommes heureux que les femmes se défendent si mal ! Nous ne serions auprès d’elles que de timides esclaves. J’ai dans ce moment un sentiment de reconnaissance pour les femmes faciles qui m’amène naturellement à vos pieds. Je m’y prosterne pour obtenir mon pardon et j’y finis cette trop longue lettre. Adieu, ma très belle amie, sans rancune.
Du château de…, 5 août 17 **.
Savez-vous, vicomte, que votre lettre est d’une insolence rare, et qu’il ne tiendrait qu’à moi de m’en fâcher ? Mais elle m’a prouvé clairement que vous aviez perdu la tête, et cela seul vous a sauvé de mon indignation. Amie généreuse et sensible, j’oublie mon injure pour ne m’occuper que de votre danger et quelque ennuyeux qu’il soit de raisonner, je cède au besoin que vous en avez dans ce moment.
Vous, avoir la présidente Tourvel ! mais quel ridicule caprice ! Je reconnais bien là votre mauvaise tête qui ne fait désirer que ce qu’elle croit ne pas pouvoir obtenir. Qu’est-ce donc que cette femme ? Des traits réguliers si vous voulez, mais nulle expression ; passablement faite, mais sans grâces ; toujours mise à faire rire avec ses paquets de fichus sur la gorge et son corps qui remonte au menton ! Je vous le dis en amie, il ne vous faudrait pas deux femmes comme celle-là pour vous faire perdre toute votre considération. Rappelez-vous donc ce jour où elle quêtait à Saint-Roch et où vous me remerciâtes tant de vous avoir procuré ce spectacle. Je crois la voir encore, donnant la main à ce grand échalas en cheveux longs, prête à tomber à chaque pas, ayant toujours son panier de quatre aunes sur la tête de quelqu’un et rougissant à chaque révérence. Qui vous eût dit alors que vous désireriez cette femme ? Allons, vicomte, rougissez vous-même et revenez à vous. Je vous promets le secret.
Et puis, voyez donc les désagréments qui vous attendent ! Quel rival vous avez à combattre ? Un mari ! Ne vous sentez-vous pas humilié à ce seul mot ? Quelle honte si vous échouez ! et même combien peu de gloire dans le succès ! Je dis plus : n’en espérez aucun plaisir. En est-il avec les prudes ? j’entends celles de bonne foi : réservées au sein même du plaisir, elles ne vous offrent que des demi-jouissances. Cet entier abandon de soi-même, ce délire de la volupté où le plaisir s’épure par son excès, ces biens de l’amour ne sont pas connus d’elles. Je vous le prédis : dans la plus heureuse supposition, votre présidente croira avoir tout fait pour vous en vous traitant comme son mari, et dans le tête-à-tête conjugal le plus tendre on reste toujours deux. Ici c’est bien pis encore ; votre prude est dévote et de cette dévotion de bonne femme qui condamne à une éternelle enfance. Peut-être surmonterez-vous cet obstacle, mais ne vous flattez pas de le détruire : vainqueur de l’amour de Dieu, vous ne le serez pas de la peur du Diable ; et quand, tenant votre maîtresse dans vos bras, vous sentirez palpiter son cœur, ce sera de crainte et non d’amour. Peut-être, si vous eussiez connu cette femme plus tôt en eussiez-vous pu faire quelque chose ; mais cela a vingt-deux ans et il y en a près de deux qu’elle est mariée. Croyez-moi, vicomte, quand une femme s’est encroûtée à ce point, il faut l’abandonner à son sort : ce ne sera jamais qu’une espèce.
C’est pourtant pour ce bel objet que vous refusez de m’obéir, que vous vous enterrez dans le tombeau de votre tante et que vous renoncez à l’aventure la plus délicieuse et la plus faite pour vous faire honneur. Par quelle fatalité faut-il donc que Gercourt garde toujours quelque avantage sur vous ? Tenez, je vous en parle sans humeur mais, dans ce moment, je suis tentée de croire que vous ne méritez pas votre réputation ; je suis tentée surtout de vous retirer ma confiance. Je ne m’accoutumerai jamais à dire mes secrets à l’amant de Mme de Tourvel.
Sachez pourtant que la petite Volanges a déjà fait tourner une tête. Le jeune Danceny en raffole. Il a chanté avec elle ; et, en effet, elle chante mieux qu’à une pensionnaire n’appartient. Ils doivent répéter beaucoup de duos, et je crois qu’elle se mettrait volontiers à l’unisson : mais ce Danceny est un enfant qui perdra son temps à faire l’amour et ne finira rien. La petite personne, de son côté, est assez farouche, et, à tout évènement, cela sera toujours beaucoup moins plaisant que vous n’auriez pu le rendre ; aussi j’ai de l’humeur et sûrement je querellerai le chevalier à son arrivée. Je lui conseille d’être doux, car, dans ce moment, il ne m’en coûterait rien de rompre avec lui. Je suis sûre que si j’avais le bon esprit de le quitter à présent, il en serait au désespoir, et rien ne m’amuse comme un désespoir amoureux. Il m’appellerait perfide, et ce mot de perfide m’a toujours fait plaisir ; c’est, après celui de cruelle, le plus doux à l’oreille d’une femme, et il est moins pénible à mériter. Sérieusement, je vais m’occuper de cette rupture. Voilà pourtant de quoi vous êtes cause ! aussi je le mets sur votre conscience. Adieu. Recommandez-moi aux prières de votre présidente.
Paris, ce 7 août 17 **.
Il n’est donc point de femme qui n’abuse de l’empire qu’elle a su prendre ! Et vous-même, vous que je nommai si souvent mon indulgente amie, vous cessez enfin de l’être, et vous ne craignez pas de m’attaquer dans l’objet de mes affections ! De quels traits vous osez peindre Mme de Tourvel !… Quel homme n’eût point payé de sa vie cette insolente audace ? À quelle autre femme qu’à vous n’eût-elle pas valu au moins une noirceur ? De grâce, ne me mettez plus à d’aussi rudes épreuves, je ne répondrais pas de les soutenir. Au nom de l’amitié, attendez que j’aie eu cette femme si vous voulez en médire. Ne savez-vous pas que la seule volupté a le droit de détacher le bandeau de l’amour ?
Mais que dis-je ? Mme de Tourvel a-t-elle besoin d’illusion ? non, pour être adorable, il lui suffit d’être elle-même. Vous lui reprochez de se mettre mal, je le crois bien : toute parure lui nuit, tout ce qui la cache la dépare. C’est dans l’abandon du négligé qu’elle est vraiment ravissante. Grâce aux chaleurs accablantes que nous éprouvons, un déshabillé de simple toile me laisse voir une taille ronde et souple. Une seule mousseline couvre sa gorge, et mes regards furtifs, mais pénétrants, en ont déjà saisi les formes enchanteresses. Sa figure, dites-vous, n’a nulle expression. Et qu’exprimerait-elle dans les moments où rien ne parle à son cœur ? Non, sans doute, elle n’a point, comme nos femmes coquettes, ce regard menteur qui séduit quelquefois et nous trompe toujours. Elle ne sait pas couvrir le vide d’une phrase par un sourire étudié ; et quoiqu’elle ait les plus belles dents du monde, elle ne rit que de ce qui l’amuse. Mais il faut voir comme, dans les folâtres jeux, elle offre l’image d’une gaîté naïve et franche ! comme, auprès d’un malheureux qu’elle s’empresse de secourir, son regard annonce la joie pure et la bonté compatissante ! Il faut voir, surtout au moindre mot d’éloge ou de cajolerie, se peindre, sur sa figure céleste, ce touchant embarras d’une modestie qui n’est point jouée !… Elle est prude et dévote, et de là vous la jugez froide et inanimée ? Je pense bien différemment. Quelle étonnante sensibilité ne faut-il pas avoir pour la répandre jusque sur son mari, et pour aimer toujours un être toujours absent ? Quelle preuve plus forte pourriez-vous désirer ? J’ai su pourtant m’en procurer une autre.
J’ai dirigé sa promenade de manière qu’il s’est trouvé un fossé à franchir ; et, quoique fort leste, elle est encore plus timide : vous jugez bien qu’une prude craint de sauter le fossé. Il a fallu se confier à moi. J’ai tenu dans mes bras cette femme modeste. Nos préparatifs et le passage de ma vieille tante avaient fait rire aux éclats la folâtre dévote ; mais, dès que je me fus emparé d’elle, par une adroite gaucherie, nos bras s’enlacèrent mutuellement. Je pressai son sein contre le mien, et, dans ce court intervalle, je sentis son cœur battre plus vite. L’aimable rougeur vint colorer son visage, et son modeste embarras m’apprit assez que son cœur avait palpité d’amour et non de crainte. Ma tante cependant s’y trompa comme vous et se mit à dire : « L’enfant a eu peur » ; mais la charmante candeur de l’enfant ne lui permit pas le mensonge et elle répondit naïvement : « Oh ! non, mais… » Ce seul mot m’a éclairé. Dès ce moment, le doux espoir a remplacé la cruelle inquiétude. J’aurai cette femme ; je l’enlèverai au mari qui la profane ; j’oserai la ravir au Dieu même qu’elle adore. Quel délice d’être tour à tour l’objet et le vainqueur de ses remords ! Loin de moi l’idée de détruire les préjugés qui l’affligent ! ils ajouteront à mon bonheur et à ma gloire. Qu’elle croie à la vertu, mais qu’elle me la sacrifie ; que ses fautes l’épouvantent sans pouvoir l’arrêter, et qu’agitée de mille terreurs elle ne puisse les oublier, les vaincre que dans mes bras. Qu’alors, j’y consens, elle me dise : « Je t’adore », elle seule, entre toutes les femmes, sera digne de prononcer ce mot. Je serai vraiment le dieu qu’elle aura préféré.
Soyons de bonne foi : dans nos arrangements, aussi froids que faciles, ce que nous appelons bonheur est à peine un plaisir. Vous le dirai-je ? je croyais mon cœur flétri, et ne me trouvant plus que des sens, je me plaignais d’une vieillesse prématurée. Mme de Tourvel m’a rendu les charmantes illusions de la jeunesse. Auprès d’elle, je n’ai pas besoin de jouir pour être heureux. La seule chose qui m’effraye est le temps que va me prendre cette aventure, car je n’ose rien donner au hasard. J’ai beau me rappeler mes heureuses témérités, je ne puis me résoudre à les mettre en usage. Pour que je sois vraiment heureux, il faut qu’elle se donne, et ce n’est pas une petite affaire.
Je suis sûr que vous admireriez ma prudence. Je n’ai pas encore prononcé le mot d’amour, mais déjà nous en sommes à ceux de confiance et d’intérêt. Pour la tromper le moins possible, et surtout pour prévenir l’effet des propos qui pourraient lui revenir, je lui ai raconté moi-même, et comme en m’accusant, quelques-uns de mes traits les plus connus. Vous ririez de voir avec quelle candeur elle me prêche. Elle veut, dit-elle, me convertir. Elle ne se doute pas encore de ce qu’il lui en coûtera pour le tenter. Elle est loin de penser qu’en plaidant, pour parler comme elle, pour les infortunées que j’ai perdues, elle parle d’avance dans sa propre cause. Cette idée me vint hier au milieu d’un de ses sermons, et je ne pus me refuser au plaisir de l’interrompre pour l’assurer qu’elle parlait comme un prophète. Adieu, ma très belle amie. Vous voyez que je ne suis pas perdu sans ressource.
P.-S. – À propos ce pauvre chevalier s’est-il tué de désespoir ? En vérité, vous êtes cent fois plus mauvais sujet que moi, et vous m’humilieriez si j’avais de l’amour-propre.
Du château de…, ce 9 août 17 **.
Si je ne t’ai rien dit de mon mariage, c’est que je ne suis pas plus instruite que le premier jour. Je m’accoutume à n’y plus penser et je me trouve assez bien de mon genre de vie. J’étudie beaucoup mon chant et ma harpe ; il me semble que je les aime mieux depuis que je n’ai plus de maître, ou plutôt c’est que j’en ai un meilleur. M. le chevalier Danceny, ce monsieur dont je t’ai parlé et avec qui j’ai chanté chez Mme de Merteuil, a la complaisance de venir ici tous les jours et de chanter avec moi des heures entières. Il est extrêmement aimable. Il chante comme un ange et compose de très jolis airs dont il fait aussi les paroles. C’est bien dommage qu’il soit chevalier de Malte ! Il me semble que s’il se mariait sa femme serait bien heureuse… Il a une douceur charmante. Il n’a jamais l’air de faire un compliment et, pourtant, tout ce qu’il dit flatte. Il me reprend sans cesse, tant sur la musique que sur autre chose ; mais il mêle à ses critiques tant d’intérêt et de gaieté qu’il est impossible de ne pas lui en savoir gré. Seulement, quand il vous regarde, il a l’air de vous dire quelque chose d’obligeant. Il joint à tout cela d’être très complaisant. Par exemple, hier, il était prié d’un grand concert, il a préféré de rester toute la soirée chez maman. Cela m’a bien fait plaisir, car quand il n’y est pas, personne ne me parle et je m’ennuie ; au lieu que quand il y est, nous chantons et nous causons ensemble. Il a toujours quelque chose à me dire. Lui et Mme de Merteuil sont les deux seules personnes que je trouve aimables. Mais adieu, ma chère amie, j’ai promis que je saurais pour aujourd’hui une ariette dont l’accompagnement est très difficile, et je ne veux pas manquer de parole. Je vais me remettre à l’étude jusqu’à ce qu’il vienne.
De…, ce 7 août 17 **.
On ne peut être plus sensible que je le suis, madame, à la confiance que vous me témoignez, ni prendre plus d’intérêt que moi à l’établissement de Mlle de Volanges. C’est bien de toute mon âme que je lui souhaite une félicité dont je ne doute pas qu’elle ne soit digne, et sur laquelle je m’en rapporte bien à votre prudence. Je ne connais point M. le comte de Gercourt ; mais, honoré de votre choix, je ne puis prendre de lui qu’une idée très avantageuse. Je me borne, madame, à souhaiter à ce mariage un succès aussi heureux qu’au mien, qui est pareillement votre ouvrage, et pour lequel chaque jour ajoute à ma reconnaissance. Que le bonheur de Mlle votre fille soit la récompense de celui que vous m’avez procuré, et puisse la meilleure des amies être aussi la plus heureuse des mères !
Je suis vraiment peinée de ne pouvoir vous offrir de vive voix l’hommage de ce vœu sincère, et faire, aussi tôt que je le désirerais, connaissance avec Mlle de Volanges. Après avoir éprouvé vos bontés vraiment maternelles, j’ai droit d’espérer d’elle l’amitié tendre d’une sœur. Je vous prie, madame, de vouloir bien la lui demander de ma part, en attendant que je me trouve à portée de la mériter.
Je compte rester à la campagne tout le temps de l’absence de M. de Tourvel. J’ai pris ce temps pour jouir et profiter de la société de la respectable Mme de Rosemonde. Cette femme est toujours charmante : son grand âge ne lui fait rien perdre ; elle conserve toute sa mémoire et sa gaieté. Son corps seul a quatre-vingt-quatre ans ; son esprit n’en a que vingt.
Notre retraite est égayée par son neveu, le vicomte de Valmont, qui a bien voulu nous sacrifier quelques jours. Je ne le connaissais que de réputation, et elle me faisait peu désirer de le connaître davantage ; mais il me semble qu’il vaut mieux qu’elle. Ici, où le tourbillon du monde ne le gâte pas, il parle raison avec une facilité étonnante, et il s’accuse de ses torts avec une candeur rare. Il me parle avec beaucoup de confiance, et je le prêche avec beaucoup de sévérité. Vous qui le connaissez, vous conviendrez que ce serait une belle conversion à faire, mais je ne doute pas, malgré ses promesses, que huit jours de Paris ne lui fassent oublier tous mes sermons. Le séjour qu’il fera ici sera au moins autant de retranché sur sa conduite ordinaire, et je crois que, d’après sa façon de vivre, ce qu’il peut faire de mieux est de ne rien faire du tout. Il sait que je suis occupée à vous écrire, et il m’a chargée de vous présenter ses respectueux hommages. Recevez aussi le mien avec la bonté que je vous connais, et ne doutez jamais des sentiments sincères avec lesquels j’ai l’honneur d’être, etc.
Du château de…, ce 9 août 17 **.
Je n’ai jamais douté, ma jeune et belle amie, ni de l’amitié que vous avez pour moi, ni de l’intérêt sincère que vous prenez à tout ce qui me regarde. Ce n’est pas pour éclairer ce point, que j’espère convenu à jamais entre nous, que je réponds à votre réponse, mais je ne crois pas pouvoir me dispenser de causer avec vous au sujet du vicomte de Valmont.
Je ne m’attendais pas, je l’avoue, à trouver jamais ce nom-là dans vos lettres. En effet, que peut-il y avoir de commun entre vous et lui ? Vous ne connaissez pas cet homme ; où auriez-vous pris l’idée de l’âme d’un libertin ? Vous me parlez de sa rare candeur : oh ! oui, la candeur de Valmont doit être en effet très rare. Encore plus faux et dangereux qu’il n’est aimable et séduisant, jamais, depuis sa plus grande jeunesse, il n’a fait un pas ou dit une parole sans avoir un projet, et jamais il n’eut un projet qui ne fût malhonnête ou criminel. Mon amie, vous me connaissez ; vous savez si des vertus que je tâche d’acquérir, l’indulgence n’est pas celle que je chéris le plus. Aussi, si Valmont était entraîné par des passions fougueuses, si, comme mille autres, il était séduit par les erreurs de son âge, blâmant sa conduite, je plaindrais sa personne et j’attendrais, en silence, le temps où un retour heureux lui rendrait l’estime des gens honnêtes. Mais Valmont n’est pas cela : sa conduite est le résultat de ses principes. Il sait calculer tout ce qu’un homme peut se permettre d’horreurs sans se compromettre ; et pour être cruel et méchant sans danger, il a choisi les femmes pour victimes. Je ne m’arrête pas à compter celles qu’il a séduites : mais combien n’en a-t-il pas perdues ?
Dans la vie sage et retirée que vous menez, ces scandaleuses aventures ne parviennent pas jusqu’à vous. Je pourrais vous en raconter qui vous feraient frémir ; mais vos regards, purs comme votre âme, seraient souillés par de semblables tableaux : sûre que Valmont ne sera jamais dangereux pour vous, vous n’avez pas besoin de pareilles armes pour vous défendre. La seule chose que j’ai à vous dire, c’est que, de toutes les femmes auxquelles il a rendu des soins, succès ou non, il n’en est point qui n’aient eu à s’en plaindre. La seule marquise de Merteuil fait l’exception à cette règle générale ; seule elle a su lui résister et enchaîner sa méchanceté. J’avoue que ce trait de sa vie est celui qui lui fait le plus d’honneur à mes yeux ; aussi a-t-il suffi pour la justifier pleinement aux yeux de tous, de quelques inconséquences qu’on avait à lui reprocher dans le début de son veuvage.
Quoi qu’il en soit, ma belle amie, ce que l’âge, l’expérience et surtout l’amitié m’autorisent à vous représenter, c’est qu’on commence à s’apercevoir dans le monde de l’absence de Valmont, et que si on sait qu’il soit resté quelque temps en tiers entre sa tante et vous, votre réputation sera entre ses mains ; malheur le plus grand qui puisse arriver à une femme. Je vous conseille donc d’engager sa tante à ne pas le retenir davantage et, s’il s’obstine à rester, je crois que vous ne devez pas hésiter à lui céder la place. Mais pourquoi resterait-il ? Que fait-il donc à cette campagne ? Si vous faisiez épier ses démarches, je suis sûre que vous découvririez qu’il n’a fait que prendre un asile plus commode pour quelques noirceurs qu’il médite dans les environs. Mais, dans l’impossibilité de remédier au mal, contentons-nous de nous en garantir.
Adieu, ma belle amie ; voilà le mariage de ma fille un peu retardé. Le comte de Gercourt, que nous attendions d’un jour à l’autre, me mande que son régiment passe en Corse, et comme il y a encore des mouvements de guerre, il lui sera impossible de s’absenter avant l’hiver. Cela me contrarie, mais cela me fait espérer que nous aurons le plaisir de vous voir à la noce, et j’étais fâchée qu’elle se fît sans vous. Adieu ; je suis, sans compliment comme sans réserve, entièrement à vous.
P.-S. – Rappelez-moi au souvenir de Mme de Rosemonde, que j’aime toujours autant qu’elle le mérite.
De…, ce 11 août 17 **.
Me boudez-vous, vicomte ? ou bien êtes-vous mort ? ou, ce qui y ressemblerait beaucoup, ne vivez-vous plus que pour votre présidente ? Cette femme, qui vous a rendu les illusions de la jeunesse, vous en rendra bientôt aussi les ridicules préjugés. Déjà vous voilà timide et esclave ; autant vaudrait être amoureux. Vous renoncez à vos heureuses témérités. Vous voilà donc vous conduisant sans principes et donnant tout au hasard ou plutôt au caprice. Ne vous souvient-il plus que l’amour est, comme la médecine, seulement l’art d’aider à la nature ? Vous voyez que je vous bats avec vos armes, mais je n’en prendrai pas d’orgueil, car c’est bien battre un homme à terre. Il faut qu’elle se donne, me dites-vous ; eh ! sans doute, il le faut ; aussi se donnera-t-elle comme les autres, avec cette différence que ce sera de mauvaise grâce. Mais pour qu’elle finisse par se donner, le vrai moyen est de commencer par la prendre. Que cette ridicule distinction est bien un vrai déraisonnement de l’amour ! Je dis l’amour, car vous êtes amoureux. Vous parler autrement, ce serait vous trahir, ce serait vous cacher votre mal. Dites-moi donc, amant langoureux, ces femmes que vous avez eues, croyez-vous les avoir violées ? Mais, quelque envie qu’on ait de se donner, quelque pressée que l’on en soit, encore faut-il un prétexte, et y en a-t-il de plus commode pour nous que celui qui nous donne l’air de céder à la force ? Pour moi, je l’avoue, une des choses qui me flattent le plus est une attaque vive et bien faite, où tout se succède avec ordre, quoique avec rapidité, qui ne nous met jamais dans ce pénible embarras de réparer nous-mêmes une gaucherie dont, au contraire, nous aurions dû profiter ; qui sait garder l’air de la violence jusque dans les choses que nous accordons et flatter avec adresse nos deux passions favorites : la gloire de la défense et le plaisir de la défaite. Je conviens que ce talent, plus rare que l’on ne croit, m’a toujours fait plaisir, même alors qu’il ne m’a pas séduite, et que quelquefois il m’est arrivé de me rendre uniquement comme récompense. Telle, dans nos anciens tournois, la beauté donnait le prix de la valeur et de l’adresse.
Mais vous, vous qui n’êtes plus vous, vous vous conduisez comme si vous aviez peur de réussir. Eh ! depuis quand voyagez-vous à petites journées et par des chemins de traverse ? Mon ami, quand on veut arriver, des chevaux de poste et la grande route ! Mais laissons ce sujet, qui me donne d’autant plus d’humeur qu’il me prive du plaisir de vous voir. Au moins écrivez-moi plus souvent que vous ne faites et mettez-moi au courant de votre progrès. Savez-vous que voilà plus de quinze jours que cette ridicule aventure vous occupe et que vous négligez tout le monde ?
À propos de négligence, vous ressemblez aux gens qui envoient régulièrement savoir des nouvelles de leurs amis malades, mais qui ne se font jamais rendre la réponse : Vous finissez votre dernière lettre par me demander si M. le chevalier est mort. Je ne réponds pas, et vous ne vous en inquiétez pas davantage. Ne savez-vous plus que mon amant est votre ami-né ? Mais rassurez-vous, il n’est point mort ou s’il l’était ce serait de l’excès de sa joie. Ce pauvre chevalier, comme il est tendre, comme il est fait pour l’amour, comme il sait sentir vivement ! La tête m’en tourne. Sérieusement, le bonheur parfait qu’il trouve à être aimé de moi m’attache véritablement à lui.
Ce même jour où je vous écrivais que j’allais travailler à notre rupture combien je le rendis heureux ! Je m’occupais pourtant tout de bon des moyens de le désespérer quand on me l’annonça. Soit caprice ou raison, jamais il ne me parut si bien. Je le reçus cependant avec humeur. Il espérait passer deux heures avec moi, avant celle où ma porte serait ouverte à tout le monde. Je lui dis que j’allais sortir ; il me demanda où j’allais, je refusai de le lui apprendre. Il insista : Où vous ne serez pas, repris-je avec aigreur. Heureusement pour lui, il resta pétrifié de cette réponse ; car, s’il eût dit un mot, il s’ensuivait immanquablement une scène qui eût amené la rupture que j’avais projetée. Étonnée de son silence, je jetai les yeux sur lui sans autre projet, je vous jure, que de voir la mine qu’il faisait. Je retrouvai sur cette charmante figure cette tristesse à la fois profonde et tendre à laquelle vous-même êtes convenu qu’il était si difficile de résister. La même cause produisit le même effet : je fus vaincue une seconde fois. Dès ce moment, je ne m’occupai plus que des moyens d’éviter qu’il pût me trouver un tort. « Je sors pour affaire, lui dis-je avec un air un peu plus doux, et même cette affaire vous regarde, mais ne m’interrogez pas. Je souperai chez moi ; revenez et vous serez instruit. » Alors il retrouva la parole, mais je ne lui permis pas d’en faire usage. « Je suis très pressée, continuai-je, laissez-moi ; à ce soir. » Il baisa ma main et sortit.
Aussitôt, pour le dédommager, peut-être pour me dédommager moi-même, je me décide à lui faire connaître ma petite maison dont il ne se doutait pas. J’appelle ma fidèle Victoire. J’ai ma migraine, je me couche pour tous mes gens et, restée enfin seule avec la véritable, tandis qu’elle se travestit en laquais, je fais une toilette de femme de chambre. Elle fait ensuite venir un fiacre à la porte de mon jardin et nous voilà parties. Arrivée dans ce temple de l’amour, je choisis le déshabillé le plus galant. Celui-ci est délicieux, il est de mon invention : il ne laisse rien voir et pourtant fait tout deviner. Je vous en promets un modèle pour votre présidente, quand vous l’aurez rendue digne de le porter.
Après ces préparatifs, pendant que Victoire s’occupe des autres détails, je lis un chapitre du Sopha, une lettre d’Héloïse et deux contes de La Fontaine, pour recorder les différents tons que je voulais prendre. Cependant mon chevalier arrive à ma porte avec l’empressement qu’il a toujours. Mon suisse la lui refuse et lui apprend que je suis malade : premier incident. Il lui remet en même temps un billet de moi, mais non de mon écriture, suivant ma prudente règle. Il l’ouvre et y trouve de la main de Victoire : « À neuf heures précises, au boulevard, devant les cafés ». Il s’y rend, et là un petit laquais qu’il ne connaît pas, qu’il croit au moins ne pas connaître, car c’était toujours Victoire, vient lui annoncer qu’il faut renvoyer sa voiture et le suivre. Toute cette marche romanesque lui échauffait la tête d’autant, et la tête échauffée ne nuit à rien. Il arrive enfin, et la surprise et l’amour causaient en lui un véritable enchantement. Pour lui donner le temps de se remettre, nous nous promenons un moment dans le bosquet, puis je le ramène vers la maison. Il voit d’abord deux couverts mis, ensuite un lit fait. Nous passions jusqu’au boudoir, qui était dans toute sa parure. Là, moitié réflexion, moitié sentiment, je passai mes bras autour de lui et me laissai tomber à ses genoux : « Ô mon ami ! lui dis-je, pour vouloir te ménager la surprise de ce moment, je me reproche de t’avoir affligé par l’apparence de l’humeur, d’avoir pu un instant voiler mon cœur à tes regards. Pardonne-moi mes torts ; je veux les expier à force d’amour ». Vous jugez de l’effet de ce discours sentimental. L’heureux chevalier me releva, et mon pardon fut scellé sur cette même ottomane où vous et moi scellâmes si gaiement et de la même manière notre éternelle rupture.
Comme nous avions six heures à passer ensemble, et que j’avais résolu que tout ce temps fût pour lui également délicieux, je modérai ses transports et l’aimable coquetterie vint remplacer la tendresse. Je ne crois pas avoir jamais mis tant de soin à plaire, ni avoir été jamais aussi contente de moi. Après le souper, tour à tour enfant et raisonnable, folâtre et sensible, quelquefois même libertine, je me plaisais à le considérer comme un sultan au milieu de son sérail, dont j’étais tour à tour les favorites différentes. En effet, ses hommages réitérés, quoique toujours reçus par la même femme, le furent toujours par une maîtresse nouvelle.
Enfin, au point du jour, il fallut se séparer et, quoi qu’il dit, quoi qu’il fît même pour me prouver le contraire, il en avait autant besoin que peu d’envie. Au moment où nous sortîmes, et pour dernier adieu, je pris la clef de cet heureux séjour et la lui remettant entre les mains : « Je ne l’ai eue que pour vous, lui dis-je, il est juste que vous en soyez maître ; c’est au sacrificateur à disposer du temple. » C’est par cette adresse que j’ai prévenu les réflexions qu’aurait pu lui faire naître la propriété, toujours suspecte, d’une petite maison. Je le connais assez pour être sûre qu’il ne s’en servira que pour moi, et si la fantaisie me prenait d’y aller sans lui, il me reste bien une double clef. Il voulait à toute force prendre jour pour y revenir ; mais je l’aime trop encore pour vouloir l’user si vite. Il ne faut se permettre d’excès qu’avec les gens qu’on veut quitter bientôt. Il ne sait pas cela, lui ; mais, pour son bonheur, je le sais pour deux.
Je m’aperçois qu’il est trois heures du matin et que j’ai écrit un volume, ayant le projet de n’écrire qu’un mot. Tel est le charme de la confiante amitié, c’est elle qui fait que vous êtes toujours ce que j’aime le mieux ; mais, en vérité, le chevalier est ce qui me plaît davantage.
De…, ce 12 août 17 **.
Votre lettre sévère m’aurait effrayée, madame, si par bonheur je n’avais trouvé ici plus de motifs de sécurité que vous ne m’en donnez de crainte. Ce redoutable M. de Valmont, qui doit être la terreur de toutes les femmes, paraît avoir déposé son arme meurtrière avant d’entrer dans ce château. Loin d’y former des projets, il n’y a pas même porté de prétentions, et la qualité d’homme aimable, que ses ennemis même lui accordent, disparaît presque ici pour ne lui laisser que celle de bon enfant. C’est apparemment l’air de la campagne qui a produit ce miracle. Ce que je vous puis assurer, c’est qu’étant sans cesse avec moi, paraissant même s’y plaire, il ne lui est pas échappé un mot qui ressemble à l’amour, pas une de ces phrases que tous les hommes se permettent, sans avoir, comme lui, ce qu’il faut pour les justifier. Jamais il n’oblige à cette réserve dans laquelle toute femme qui se respecte est forcée de se tenir aujourd’hui, pour contenir les hommes qui l’entourent. Il sait ne point abuser de la gaieté qu’il inspire. Il est peut-être un peu louangeur, mais c’est avec tant de délicatesse qu’il accoutumerait la modestie même à l’éloge. Enfin, si j’avais un frère, je désirerais qu’il fût tel que M. de Valmont se montre ici. Peut-être beaucoup de femmes lui désireraient une galanterie plus marquée, et j’avoue que je lui sais un gré infini d’avoir su me juger assez bien pour ne pas me confondre avec elles.
Ce portrait diffère beaucoup sans doute de celui que vous me faites, et, malgré cela, tous deux peuvent être ressemblants en fixant les époques. Lui-même convient d’avoir eu beaucoup de torts et on lui en aura bien aussi prêté quelques-uns. Mais j’ai rencontré peu d’hommes qui parlassent des femmes honnêtes avec plus de respect, je dirais presque d’enthousiasme. Vous m’apprenez qu’au moins sur cet objet il ne se trompe pas. Sa conduite avec Mme de Merteuil en est une preuve. Il nous en parle beaucoup, et c’est toujours avec tant d’éloges et l’air d’un attachement vrai, que j’ai cru, jusqu’à la réception de votre lettre, que ce qu’il appelait amitié entre eux deux était bien réellement de l’amour. Je m’accuse de ce jugement téméraire, dans lequel j’ai eu d’autant plus de tort que lui-même a pris le soin de la justifier. J’avoue que je ne regardais que comme finesse ce qui était de sa part une honnête sincérité. Je ne sais, mais il me semble que celui qui est capable d’une amitié aussi suivie pour une femme aussi estimable n’est pas un libertin sans retour. J’ignore au reste si nous devons la conduite sage qu’il tient ici à quelques projets dans les environs, comme vous le supposez. Il y a bien quelques femmes aimables à la ronde, mais il sort peu, excepté le matin, et alors il dit qu’il va à la chasse. Il est vrai qu’il rapporte rarement du gibier, mais il assure qu’il est maladroit à cet exercice. D’ailleurs, ce qu’il peut faire au dehors m’inquiète peu, et si je désirais le savoir, ce ne serait que pour avoir une raison de plus de me rapprocher de votre avis ou de vous ramener au mien.
Sur ce que vous me proposez de travailler à abréger le séjour que M. de Valmont compte faire ici, il me paraît bien difficile d’oser demander à sa tante de ne pas avoir son neveu chez elle, d’autant qu’elle l’aime beaucoup. Je vous promets pourtant, mais seulement par déférence et non par besoin, de saisir l’occasion de faire cette demande, soit à elle, soit à lui-même. Quant à moi, M. de Tourvel est instruit de mon projet de rester ici jusqu’à son retour, et il s’étonnerait, avec raison, de la légèreté qui m’en ferait changer.
Voilà, madame, de bien longs éclaircissements, mais j’ai cru devoir à la vérité un témoignage avantageux à M. de Valmont, et dont il me paraît avoir grand besoin auprès de vous. Je n’en suis pas moins sensible à l’amitié qui a dicté vos conseils. C’est à elle que je dois aussi ce que vous me dites d’obligeant à l’occasion du retard du mariage de Mlle votre fille. Je vous en remercie bien sincèrement ; mais, quelque plaisir que je me promette à passer ces moments avec vous, je les sacrifierais de bien bon cœur au désir de savoir Mlle de Volanges plus tôt heureuse, si pourtant elle peut jamais l’être plus qu’auprès d’une mère aussi digne de toute sa tendresse et de son respect. Je partage avec elle ces deux sentiments qui m’attachent à vous, et je vous prie d’en recevoir l’assurance avec bonté.
J’ai l’honneur d’être, etc.
De…, ce 13 août 17 **.
Maman est incommodée, madame, elle ne sortira point et il faut que je lui tienne compagnie ; ainsi, je n’aurai pas l’honneur de vous accompagner à l’Opéra. Je vous assure que je regrette bien plus de ne pas être avec vous que le spectacle. Je vous prie d’en être persuadée. Je vous aime tant ! Voudriez-vous bien dire à M. le chevalier Danceny que je n’ai point le recueil dont il m’a parlé, et que, s’il peut me l’apporter demain, il me fera grand plaisir ? S’il vient aujourd’hui, on lui dira que nous n’y sommes pas, mais c’est que maman ne veut recevoir personne. J’espère qu’elle se portera mieux demain.
J’ai l’honneur d’être, etc.
De…, ce 3 août 17 **.
Je suis très fâchée, ma belle, et d’être privée du plaisir de vous voir et de la cause de cette privation. J’espère que cette occasion se retrouvera. Je m’acquitterai de votre commission auprès du chevalier Danceny, qui sera sûrement très fâché de savoir votre maman malade. Si elle veut me recevoir demain, j’irai lui tenir compagnie. Nous attaquerons, elle et moi, le chevalier de Belleroche au piquet ; et, en lui gagnant son argent, nous aurons, par surcroît de plaisir, celui de vous entendre chanter avec votre aimable maître, à qui je le proposerai. Si cela convient à votre maman et à vous, je réponds de moi et de mes deux chevaliers. Adieu, ma belle ; mes compliments à ma chère Mme de Volanges. Je vous embrasse bien tendrement.
De…, ce 13 août 17 **.
Je ne t’ai pas écrit hier, ma chère Sophie, mais ce n’est pas le plaisir qui en est cause, je t’en assure bien. Maman était malade et je ne l’ai pas quittée de la journée. Le soir, quand je me suis retirée, je n’avais cœur à rien du tout, et je me suis couchée bien vite pour m’assurer que la journée était finie ; jamais je n’en avais passé de si longue. Ce n’est pas que je n’aime bien maman, mais je ne sais pas ce que c’était. Je devais aller à l’Opéra avec Mme de Merteuil ; le chevalier Danceny devait y être. Tu sais bien que ce sont les deux personnes que j’aime le mieux. Quand l’heure où j’aurais dû y être aussi est arrivée, mon cœur s’est serré malgré moi. Je me déplaisais à tout et j’ai pleuré, pleuré sans pouvoir m’en empêcher. Heureusement, maman était couchée et ne pouvait pas me voir. Je suis bien sûre que le chevalier Danceny aura été fâché aussi, mais il aura été distrait par le spectacle et par tout le monde ; c’est bien différent.
Par bonheur, maman va mieux aujourd’hui, et Mme de Merteuil viendra avec une autre personne et le chevalier Danceny ; mais elle arrive toujours bien tard, Mme de Merteuil, et quand on est si longtemps toute seule, c’est bien ennuyeux. Il n’est encore que onze heures. Il est vrai qu’il faut que je joue de la harpe, et puis ma toilette me prendra un peu de temps, car je veux être bien coiffée aujourd’hui. Je crois que la mère Perpétue a raison, et qu’on devient coquette dès qu’on est dans le monde. Je n’ai jamais eu tant d’envie d’être jolie que depuis quelques jours, et je trouve que je ne le suis pas autant que je le croyais, et puis, auprès des femmes qui ont du rouge, on perd beaucoup. Mme de Merteuil, par exemple, je vois bien que tous les hommes la trouvent plus jolie que moi ; cela ne me fâche pas beaucoup, parce qu’elle m’aime bien, et puis elle assure que le chevalier Danceny me trouve plus jolie qu’elle. C’est bien honnête à elle de me l’avoir dit ! elle avait même l’air d’en être bien aise. Par exemple, je ne conçois pas ça. C’est qu’elle m’aime tant ! et lui !… oh ! ça m’a fait bien plaisir ! aussi, c’est qu’il me semble que rien que le regarder suffit pour embellir. Je le regarderais toujours si je ne craignais de rencontrer ses yeux, car, toutes les fois que cela m’arrive, cela me décontenance et me fait comme de la peine, mais ça ne fait rien.
Adieu, ma chère amie, je vais me mettre à ma toilette. Je t’aime toujours comme de coutume.
Paris, ce 14 août 17 **.
Il est bien honnête à vous de ne pas m’abandonner à mon triste sort. La vie que je mène ici est réellement fatigante, par l’excès de son repos et son insipide uniformité. En lisant votre lettre et le détail de votre charmante journée, j’ai été tenté vingt fois de prétexter une affaire, de voler à vos pieds et de vous y demander, en ma faveur, une infidélité à votre chevalier, qui, après tout, ne mérite pas son bonheur. Savez-vous que vous m’avez rendu jaloux de lui ? Que me parlez-vous d’éternelle rupture ? J’abjure ce serment, prononcé dans le délire : nous n’aurions pas été dignes de le faire si nous eussions dû le garder. Ah ! que je puisse un jour me venger dans vos bras du dépit involontaire que m’a causé le bonheur du chevalier ! Je suis indigne, je l’avoue, quand je songe que cet homme, sans raisonner, sans se donner la moindre peine, en suivant tout bêtement l’instinct de son cœur, trouve une félicité à laquelle je ne puis atteindre. Oh ! je la troublerai… Promettez-moi que je la troublerai. Vous-même n’êtes-vous pas humiliée ? Vous vous donnez la peine de le tromper, et il est plus heureux que vous. Vous le croyez dans vos chaînes ! c’est bien vous qui êtes dans les siennes. Il dort tranquillement, tandis que vous veillez pour ses plaisirs. Que ferait de plus son esclave ?
Tenez, ma belle amie, tant que vous vous partagez entre plusieurs, je n’ai pas la moindre jalousie : je ne vois alors dans vos amants que les successeurs d’Alexandre, incapables de conserver entre eux tous cet empire où je régnais seul. Mais que vous vous donniez entièrement à un d’eux ! qu’il existe un autre homme aussi heureux que moi, je ne le souffrirai pas ; n’espérez pas que je le souffre. Ou reprenez-moi, ou au moins prenez-en un autre et ne trahissez pas, par un caprice exclusif, l’amitié inviolable que nous nous sommes jurée.
C’est bien assez, sans doute, que j’aie à me plaindre de l’amour. Vous voyez que je me prête à vos idées et que j’avoue mes torts. En effet, si c’est être amoureux que de ne pouvoir vivre sans posséder ce qu’on désire, d’y sacrifier son temps, ses plaisirs, sa vie, je suis bien réellement amoureux. Je n’en suis guère plus avancé. Je n’aurais même rien du tout à vous apprendre à ce sujet sans un évènement qui me donne beaucoup à réfléchir et dont je ne sais encore si je dois craindre ou espérer.
Vous connaissez mon chasseur, trésor d’intrigue et vrai valet de comédie : vous jugez bien que ses instructions portaient d’être amoureux de la femme de chambre et d’enivrer les gens. Le coquin est plus heureux que moi, il a déjà réussi. Il vient de découvrir que Mme de Tourvel a chargé un de ses gens de prendre des informations sur ma conduite, et même de me suivre dans mes courses du matin, autant qu’il le pourrait, sans être aperçu. Que prétend cette femme ? Ainsi donc la plus modeste de toutes ose encore risquer des choses qu’à peine nous oserions nous permettre ! Je jure bien… Mais, avant de songer à me venger de cette ruse féminine, occupons-nous des moyens de la tourner à notre avantage. Jusqu’ici ces courses qu’on suspecte n’avaient aucun objet ; il faut leur en donner un. Cela mérite toute mon attention, et je vous quitte pour y réfléchir. Adieu, ma belle amie.
Toujours du château de…, ce 15 août 17 **.
Ah ! ma Sophie, voici bien des nouvelles ! je ne devrais peut-être pas te les dire, mais il faut bien que j’en parle à quelqu’un ; c’est plus fort que moi. Ce chevalier Danceny… Je suis dans un trouble que je ne peux pas écrire, je ne sais par où commencer. Depuis que je t’avais raconté la jolie soirée que j’avais passée chez maman avec lui et Mme



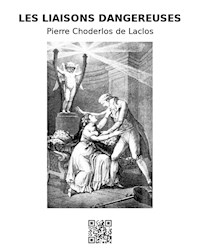


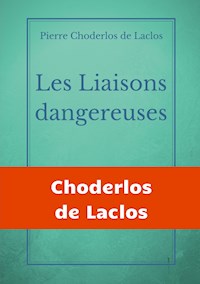


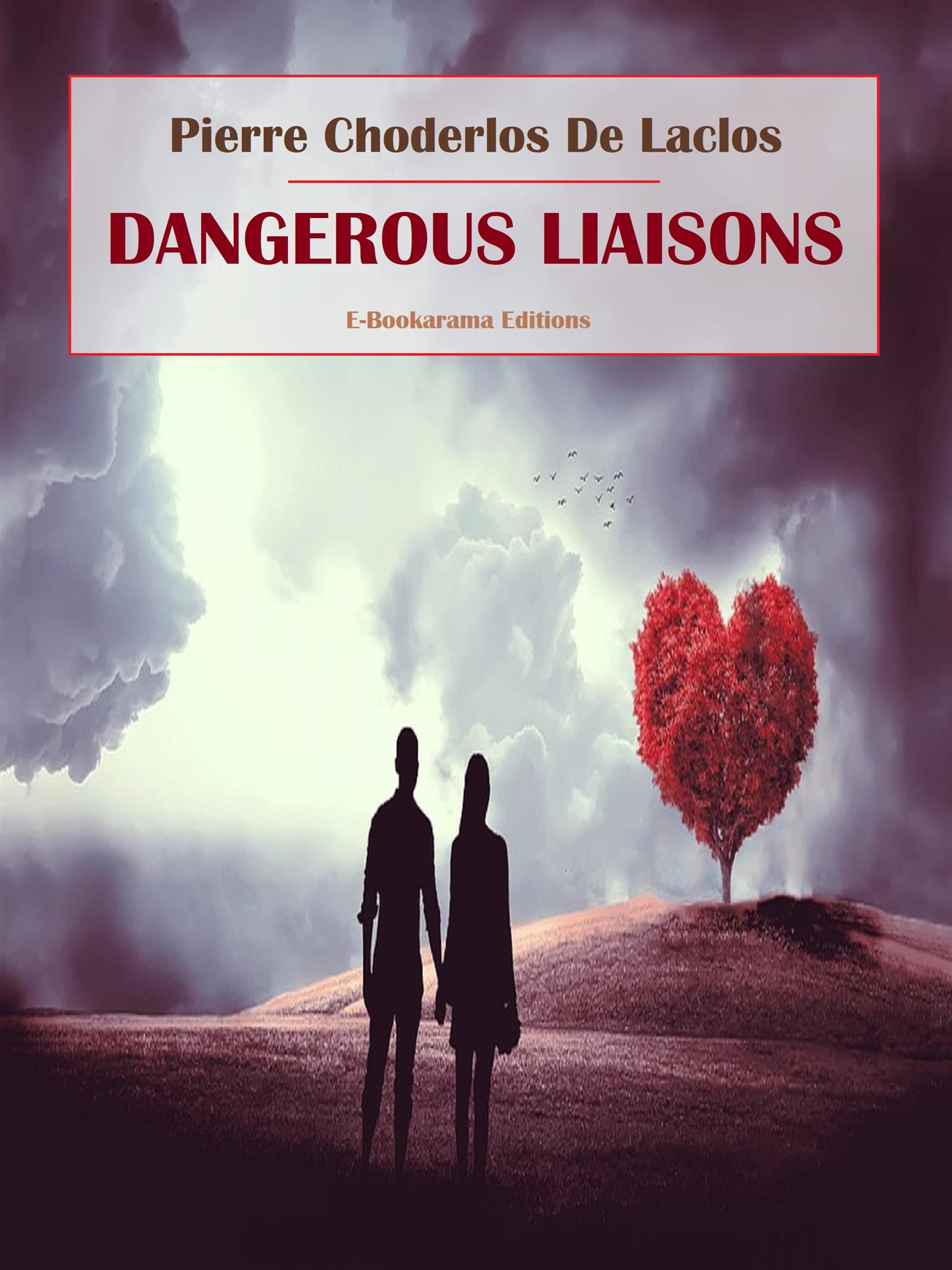
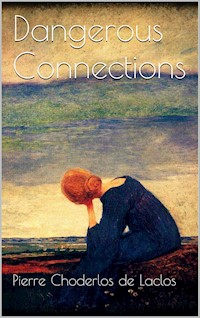
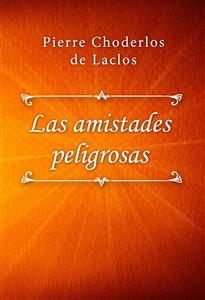
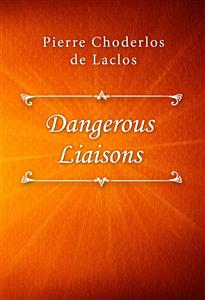
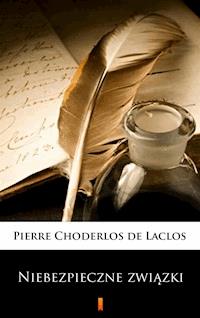
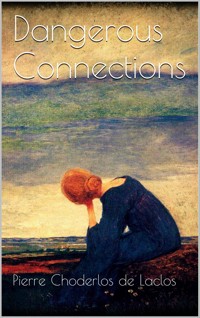
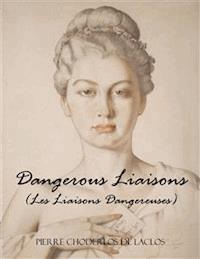
![Dangerous Liaisons (Centaur Classics) [The 100 greatest novels of all time - #41] - Pierre Choderlos de Laclos - E-Book](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/230b02a5bfc1d61b8be5086551ceb150/w200_u90.jpg)