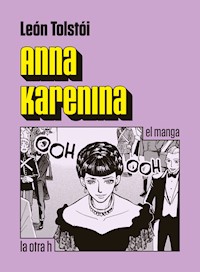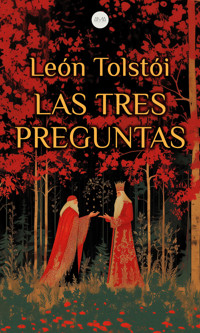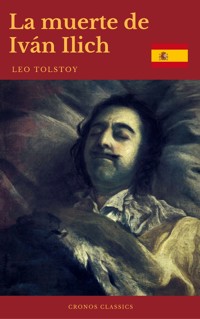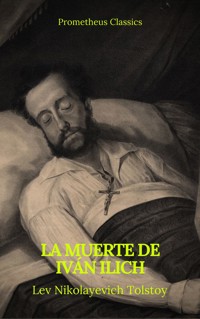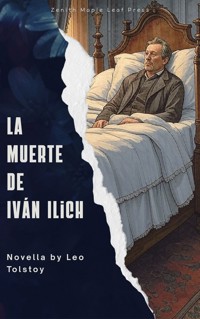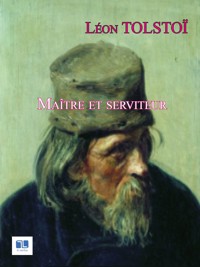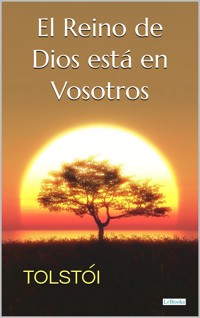Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Ce livre présente deux perspectives complémentaires sur la question de l'alimentation, provenant de deux penseurs influents de leur temps. Léon Tolstoï, célèbre auteur et penseur russe, plaide en faveur du végétarisme. Tolstoï examine les effets de la consommation de viande sur la santé, l'éthique et la spiritualité. Il argue que manger de la viande n'est pas nécessaire pour une alimentation saine et que cela contribue à la cruauté envers les animaux. Tolstoï relie ses arguments à ses convictions religieuses et morales, affirmant que le végétarisme est une étape vers une vie plus pure et plus humaine. Il décrit également l'impact environnemental de l'élevage d'animaux pour la consommation et appelle à une prise de conscience collective pour adopter des habitudes alimentaires plus éthiques. Richet analyse les excès alimentaires et leur relation avec le luxe et la société de consommation. Il examine comment les habitudes alimentaires sont influencées par la culture et l'économie, et critique les inégalités qu'elles génèrent. Richet propose des solutions pour promouvoir une alimentation plus saine et plus équitable, en soulignant l'importance de l'éducation et de la réforme sociale. Ensemble, ces deux essais offrent une réflexion approfondie sur les choix alimentaires et leur impact sur l'individu et la société. Tolstoï et Richet, par leurs approches complémentaires, encouragent les lecteurs à repenser leurs habitudes alimentaires et à envisager des modes de vie plus durables et plus justes.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 84
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Sommaire
Les Mangeurs de viande
Chapiter I
Chapiter II
Chapiter III
Chapiter IV
Chapiter V
Chapiter VI
Chapiter VII
Chapiter VIII
Chapiter IX
Chapiter X
L’alimentation et le luxe
Chapiter I
Chapiter II
Chapiter III
Chapiter IV
Chapiter V
Les Mangeurs de viande
Par Léon Tolstoï
I
Dans tous les actes de sa vie, l’homme doit apporter un esprit de méthode sans lequel le but qu’il poursuit ne saurait être atteint. Cela est vrai, qu’il s‘agisse des choses matérielles ou immatérielles. De même qu’il sera impossible au boulanger de faire du pain, s’il n’a ni pétri sa pate, ni chauffé son four, de même l’homme qui tendra vers une vie morale, ne pourra réussir qu’autant qu’il aura su acquérir les diverses qualités, dont l’ensemble fait qu’on peut dire de celui qui les possède : « C’est un homme d’une vie morale irréprochable. »
Il faudra, en outre que dans l’acquisition de ces qualités, il suive une marche logique, ordonnée ; qu’il commence par les vertus fondamentales et qu’il gravisse petit à petit, les échelons qui le mèneront au but qu’il poursuit.
Dans toutes les doctrines morales, il existe une échelle, laquelle, comme dit la sagesse chinoise, va de la terre au ciel et dont l’ascension ne peut s’accomplir autrement qu’en commençant par l’échelon le plus bas. Cette règle est prescrite aussi bien par les bramines et les bouddhistes que par les partisans de Confucius, on la retrouve également dans les doctrines des sages de la Grèce.
Tous les moralistes, aussi bien déistes que matérialistes, reconnaissent la nécessité d’une succession définie et méthodique dans l’assimilation des vertus sans lesquelles il n’y a pas de vie morale possible. Cette nécessité découle de l’essence même des choses ; il semblerait par conséquent, qu’elle dût être acceptée par tous. Mais, chose étrange ! depuis que le christianisme est devenu synonyme d’Église, la conscience de cette nécessité tend à disparaître de plus en plus et elle n’existe plus guère que chez les ascètes et les moines.
Parmi les chrétiens laïques, il est parfaitement admis qu’un homme puisse posséder des vertus supérieures sans avoir commencé par acquérir celles qui, normalement, auraient dû l’y conduire ; certains vont même plus loin et prétendent que l’existence de vices parfaitement déterminés chez un individu, ne l’empêche en aucune façon de posséder parallèlement de très hautes vertus.
Il est résulté de cela, qu’aujourd’hui, chez les laïques, la notion de la vie morale est, sinon perdue, tout au moins fort embrouillée.
II
Cela est arrivé, à mon avis, de la façon suivante.
Le christianisme, en remplaçant le paganisme, a posé en principe une morale plus exigeante ; mais cette morale, comme celle du paganisme, ne pouvait être atteinte qu’après avoir suivi tous les degrés de l’échelle des vertus.
D’après Platon, l’abstinence était la première qualité qu’il importait d’acquérir. Venaient ensuite : le courage, la sagesse et enfin la justice qui, d’après sa doctrine, était la vertu la plus haute qu’un homme pût posséder. La doctrine du Christ enseignait une autre progression : le sacrifice, la fidélité à la volonté divine et au-dessus de tout : l’amour.
Les hommes qui se sont sérieusement convertis au christianisme et qui ont cherché à mener une vie morale chrétienne n’en ont pas moins commencé par adopter le premier principe de la doctrine païenne en s’abstenant du superflu.
Qu’on n’aille pas croire que le christianisme ne faisait, dans ce cas, que s’approprier ce que le paganisme avait érigé avant lui. Qu’on ne me fasse pas ce reproche que j’abaisse le christianisme en ravalant sa haute doctrine jusqu’au bas niveau païen. Cela serait injuste ; je reconnais la doctrine chrétienne comme la plus haute qui soit et je ne la compare en rien au paganisme.
C’est justement parce que la doctrine chrétienne est supérieure à celle des païens qu’elle l’a supplantée ; mais il n’en faut pas moins reconnaître que l’une et l’autre acheminent l’homme vers la vérité et le bien, et, comme ces deux choses sont immuables, au fond la voie qui y conduit doit être unique. C’est pourquoi les premiers pas dans cette voie doivent nécessairement être les mêmes, qu’il s’agisse des chrétiens ou des païens. Qu’est-ce qui différencie donc ces deux doctrines ? C’est que, à l’encontre de la doctrine païenne qui a été établie d’une façon bornée, la doctrine chrétienne est une tendance continuelle vers la perfection.
Platon, par exemple, établit comme modèle de perfection : la justice ; le Christ choisit la perfection indéfinie : l’amour : « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. »
D’après le paganisme, avant d’arriver à la plus haute vertu, les degrés qu’on franchit ont leur importance relative : plus hauts ils sont, et plus il faut de vertu. Il résulte de la qu’au point de vue païen, on peut être plus ou moins vertueux ou plus ou moins vicieux.
D’après la doctrine chrétienne, il n’en saurait être ainsi : on est vertueux ou on ne l’est pas. On le devient plus ou moins vite ; mais on n’est réputé tel qu’autant que tous les éléments ont été acquis.
Je m’explique. Au point de vue païen, l’homme sage est vertueux ; mais celui qui, à la sagesse, ajoute le courage, l’est plus que l’autre et si, à ces deux qualités vient s’ajouter le sentiment de la justice, la perfection est atteinte. Le chrétien au contraire ne saurait être supérieur ou inférieur à un autre au point de vue moral ; mais il est d’autant plus chrétien qu’il se meut plus rapidement sur la voie de la perfection, quel que soit le degré sur lequel il se trouve à un moment donné, de sorte que la vertu stationnaire d’un pharisien est moins chrétienne que celle du larron dont l’âme est en plein mouvement vers l’idéal et qui se repent sur sa croix.
Telle est la différence entre les deux doctrines. Le paganisme considère l’abstinence comme une vertu alors que le christianisme ne l’admet que comme un moyen d’acheminement vers le sacrifice, condition première d’une vie morale.
Cependant tous les hommes ne considèrent pas la doctrine du Christ comme une tendance continuelle vers la perfection ; la majorité l’a comprise comme une doctrine rédemptrice : le rachat du péché par la grâce divine transmise par l’Église chez les catholiques et les orthodoxes et la croyance en la rédemption chez les protestants et les calvinistes. C’est cette doctrine qui a fait disparaître la sincérité et le sérieux de l’attitude des hommes vis-à-vis de la morale chrétienne. Les représentants de ces organes pourront prêcher à satiété que ces moyens de salut n’empêchent pas l’homme de tendre vers une vie morale, mais y concourent au contraire ; certaines situations engendrent en elles-mêmes certaines conclusions, et aucun argument ne pourra empêcher les hommes de les accepter.
C’est pourquoi l’homme qui est imbu de cette croyance de rédemption n’aura plus l’énergie suffisante pour assurer son salut au moyen de ses propres efforts ; il trouvera bien plus simple d’accepter le dogme qui lui est enseigné et d’attendre de la grâce divine le rachat des fautes qu’il aura pu commettre.
C’est ce qui est arrivé à la majorité des adeptes du christianisme.
III
Telle est la cause principale de ce relâchement dans les mœurs. Pourquoi s’astreindre à certaines coutumes ? Pourquoi se priver de telle ou telle chose puisque le résultat sera le même ? Pourquoi rompre avec des habitudes agréables en somme, puisque la récompense viendra quand même ?
Tout récemment a paru l’encyclique du pape sur le socialisme. Dans ce document, le chef de l’Église, après une prétendue réfutation de la doctrine socialiste sur l’illégitimité de la propriété, dit expressément que « nul assurément n’est tenu de soulager le prochain en prenant sur son nécessaire ou sur celui de sa famille ou en retranchant quoique ce soit de ce qu’exigent les convenances mondaines. Personne, en effet, ne doit vivre contrairement aux convenances. » (Cela est emprunté à saint Thomas : Nullus enim inconvenienter debet vivere. ) « Mais, après avoir satisfait aux besoins et aux convenances extérieures, dit plus loin l’encyclique, le devoir de chacun est de donner le superflu aux pauvres. »
Ainsi prêche le chef de l’Église la plus répandue aujourd’hui ; ainsi prêchaient tous les Pères de l’Église qui reconnaissaient le salut par l’action insuffisant.
Et à coté de la prédication de cette doctrine égoïste, qui prescrit de donner au prochain ce dont on n’a pas besoin, on prêche l’amour dudit prochain et c’est toujours avec emphase qu’on cite les célèbres paroles prononcées par saint Paul, dans le XIIIe chapitre de sa première épître aux Corinthiens.
Quoique la doctrine évangélique tout entière soit remplie d’appels à l’abnégation et enseigne que cette vertu est la première des conditions pour atteindre à la perfection chrétienne ; quoiqu’il y soit dit que « qui ne portera pas sa croix, qui ne reniera pas son père, sa mère, qui ne risquera pas sa vie... » ces hommes persuadent aux autres qu’il n’est pas nécessaire pour aimer son prochain de sacrifier ce à quoi on est habitué, mais qu’il suffit de donner ce qu’on juge convenable.
Ainsi parlent les Pères de l’Église et, conséquemment, ceux qui repoussent la doctrine de l’Église (en tant que manifestations extérieures du culte) pensent, parlent et écrivent de même manière que les libres-penseurs. Ces hommes se persuadent et persuadent aux autres que, sans qu’il soit besoin de réduire ses passions, on peut servir l’humanité et avoir une conduite morale.
Les hommes, après avoir rejeté les pratiques païennes, n’ont pas su s’assimiler la véritable doctrine chrétienne ; ils n’ont pas admis la marche progressive dans le chemin de la vertu, ils sont restés stationnaires.
IV
Dans le temps jadis, avant l’apparition du christianisme, tous les grands philosophes, en commençant par Socrate, furent d’avis que la première des vertus à acquérir était l’abstinence ἐνγκρατείς ou σωφροσύνη, et que vouloir en acquérir d’autres, sans posséder celle-là, était impossible.