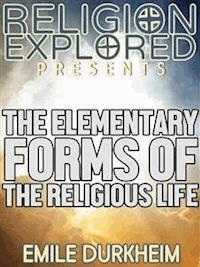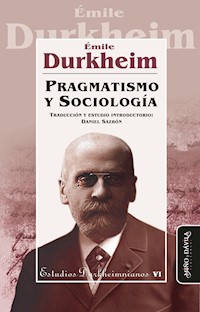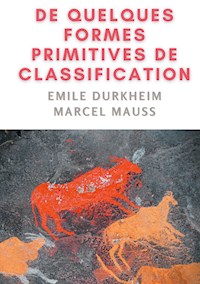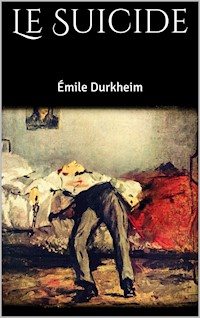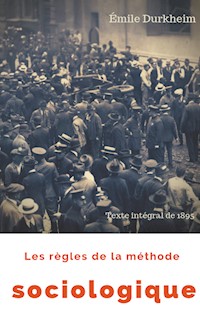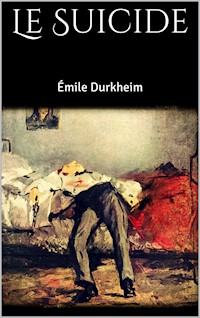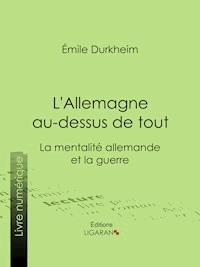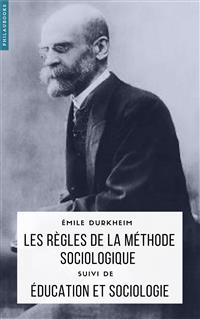
0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Philaubooks
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
- Veröffentlichungsjahr: 2019
Les Règles de la méthode sociologique, constitue l’ouvrage où le projet sociologique de l’auteur, considéré comme le père de la sociologie française, apparaît clairement. Il cherche en effet à fonder la sociologie comme une science nouvelle et à l’établir institutionnellement. Il définit, dans ce live, les règles méthodologiques à suivre pour une étude sociologique.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Les règles de la méthode sociologique
suivi de Education et sociologie
Emile Durkheim
philaubooks
Table des matières
Les règles de la méthode sociologique
Préface (première édition)
Préface (seconde édition)
Introduction
1. Qu’est-ce qu’un fait social ?
2. Règles relatives à l’observation des faits sociaux.
3. Règles relatives à la distinction du normal et du pathologique
4. Règles relatives à la constitution des types sociaux
5. Règles relatives à l’explication des faits sociaux
6. Règles relatives à l’administration de la preuve
Conclusion
Éducation et sociologie
1. L’éducation SA NATURE ET SON RÔLE
2. Nature et méthode de la pédagogie
3. Pédagogie et sociologie
4. L'évolution et le rôle de l'enseignement secondaire en France
À propos de l’auteur
Les règles de la méthode sociologique
Préface (première édition)
On est si peu habitué à traiter les faits sociaux scientifiquement que certaines des propositions contenues dans cet ouvrage risquent de surprendre le lecteur. Cependant, s’il existe une science des sociétés, il faut bien s’attendre à ce qu’elle ne consiste pas dans une simple paraphrase des préjugés traditionnels, mais nous fasse voir les choses autrement qu’elles n’apparaissent au vulgaire ; car l’objet de toute science est de faire des découvertes et toute découverte déconcerte plus ou moins les opinions reçues. À moins donc qu’on ne prête au sens commun, en sociologie, une autorité qu’il n’a plus depuis longtemps dans les autres sciences ― et on ne voit pas d’où elle pourrait lui venir ― il faut que le savant prenne résolument son parti de ne pas se laisser intimider par les résultats auxquels aboutissent ses recherches, si elles ont été méthodiquement conduites. Si chercher le paradoxe est d’un sophiste, le fuir, quand il est imposé par les faits, est d’un esprit sans courage ou sans foi dans la science.
Malheureusement, il est plus aisé d’admettre cette règle en principe et théoriquement que de l’appliquer avec persévérance. Nous sommes encore trop accoutumés à trancher toutes ces questions d’après les suggestions du sens commun pour que nous puissions facilement le tenir à distance des discussions sociologiques. Alors que nous nous en croyons affranchis, il nous impose ses jugements sans que nous y prenions garde. Il n’y a qu’une longue et spéciale pratique qui puisse prévenir de pareilles défaillances. Voilà ce que nous demandons au lecteur de bien vouloir ne pas perdre de vue. Qu’il ait toujours présent à l’esprit que les manières de penser auxquelles il est le plus fait sont plutôt contraires que favorables à l’étude scientifique des phénomènes sociaux et, par conséquent, qu’il se mette en garde contre ses premières impressions. S’il s’y abandonne sans résistance, il risque de nous juger sans nous avoir compris. Ainsi, il pourrait arriver qu’on nous accusât d’avoir voulu absoudre le crime, sous prétexte que nous en faisons un phénomène de sociologie normale. L’objection pourtant serait puérile. Car s’il est normal que, dans toute société, il y ait des crimes, il n’est pas moins normal qu’ils soient punis. L’institution d’un système répressif n’est pas un fait moins universel que l’existence d’une criminalité, ni moins indispensable à la santé collective. Pour qu’il n’y eût pas de crimes, il faudrait un nivellement des consciences individuelles qui, pour des raisons qu’on trouvera plus loin, n’est ni possible ni désirable ; mais pour qu’il n’y eût pas de répression, il faudrait une absence d’homogénéité morale qui est inconciliable avec l’existence d’une société. Seulement, partant de ce fait que le crime est détesté et détestable, le sens commun en conclut à tort qu’il ne saurait disparaître trop complètement. Avec son simplisme ordinaire, il ne conçoit pas qu’une chose qui répugne puisse avoir quelque raison d’être utile, et cependant il n’y a à cela aucune contradiction. N’y a-t-il pas dans l’organisme des fonctions répugnantes dont le jeu régulier est nécessaire à la santé individuelle ? Est-ce que nous ne détestons pas la souffrance ? et cependant un être qui ne la connaîtrait pas serait un monstre. Le caractère normal d’une chose et les sentiments d’éloignement qu’elle inspire peuvent même être solidaires. Si la douleur est un fait normal, c’est à condition de n’être pas aimée ; si le crime est normal, c’est à condition d’être haï 1. Notre méthode n’a donc rien de révolutionnaire. Elle est même, en un sens, essentiellement conservatrice, puisqu’elle considère les faits sociaux comme des choses dont la nature, si souple et si malléable qu’elle soit, n’est pourtant pas modifiable à volonté. Combien est plus dangereuse la doctrine qui n’y voit que le produit de combinaisons mentales, qu’un simple artifice dialectique peut, en un instant, bouleverser de fond en comble !
De même, parce qu’on est habitué à se représenter la vie sociale comme le développement logique de concepts idéaux, on jugera peut-être grossière une méthode qui fait dépendre l’évolution collective de conditions objectives, définies dans l’espace, et il n’est pas impossible qu’on nous traite de matérialiste. Cependant, nous pourrions plus justement revendiquer la qualification contraire. En effet l’essence du spiritualisme ne tient-elle pas dans cette idée que les phénomènes psychiques ne peuvent pas être immédiatement dérivés des phénomènes organiques ? Or notre méthode n’est en partie qu’une application de ce principe aux faits sociaux. Comme les spiritualistes séparent le règne psychologique du règne biologique, nous séparons le premier du règne social ; comme eux, nous nous refusons à expliquer le plus complexe par le plus simple. À la vérité, pourtant, ni l’une ni l’autre appellation ne nous conviennent exactement ; la seule que nous acceptions est celle de rationaliste. Notre principal objectif, en effet, est d’étendre à la condition humaine le rationalisme scientifique, en faisant voir que, considérée dans le passé, elle est réductible à des rapports de cause à effet qu’une opération non moins rationnelle peut transformer ensuite en règles d’action pour l’avenir. Ce qu’on a appelé notre positivisme n’est qu’une conséquence de ce rationalisme 2. On ne peut être tenté de dépasser les faits, soit pour en rendre compte soit pour en diriger le cours, que dans la mesure où on les croit irrationnels. S’ils sont intelligibles tout entiers, ils suffisent à la science comme à la pratique : à la science, car il n’y a pas alors de motif pour chercher en dehors d’eux les raisons qu’ils ont d’être ; à la pratique, car leur valeur utile est une de ces raisons. Il nous semble donc que, surtout par ce temps de mysticisme renaissant, une pareille entreprise peut et doit être accueillie sans inquiétude et même avec sympathie par tous ceux qui, tout en se séparant de nous sur certains points, partagent notre foi dans l’avenir de la raison.
1Mais, nous objecte-t-on, si la santé contient des éléments haïssables, comment la présenter, ainsi que nous faisons plus loin, comme l’objectif immédiat de la conduite ? ― Il n’y a à cela aucune contradiction. Il arrive sans cesse qu’une chose, tout en étant nuisible par certaines de ses conséquences, soit, par d’autres, utile ou même nécessaire à la vie ; or, si les mauvais effets qu’elle a sont régulièrement neutralisés par une influence contraire, il se trouve en fait qu’elle sert sans nuire, et cependant elle est toujours haïssable, car elle ne laisse pas de constituer par elle-même un danger éventuel qui n’est conjuré que par l’action d’une force antagoniste. C’est le cas du crime ; le tort qu’il fait à la société est annulé par la peine, si elle fonctionne régulièrement. Il reste donc que, sans produire le mal qu’il implique, il soutient avec les conditions fondamentales de la vie sociale les rapports positifs que nous verrons dans la suite. Seulement, comme c’est malgré lui, pour ainsi dire, qu’il est rendu inoffensif, les sentiments d’aversion dont il est l’objet ne laissent pas d’être fondés.
2C’est dire qu’il ne doit pas être confondu avec la métaphysique positiviste de Comte et de M. Spencer.
Préface (seconde édition)
Quand ce livre parut pour la première fois, il souleva d’assez vives controverses. Les idées courantes, comme déconcertées, résistèrent d’abord avec une telle énergie que, pendant un temps, il nous fut presque impossible de nous faire entendre. Sur les points mêmes où nous nous étions exprimé le plus explicitement, on nous prêta gratuitement des vues qui n’avaient rien de commun avec les nôtres, et l’on crut nous réfuter en les réfutant. Alors que nous avions déclaré à maintes reprises que la conscience, tant individuelle que sociale, n’était pour nous rien de substantiel, mais seulement un ensemble, plus ou moins systématisé, de phénomènes sui generis, on nous taxa de réalisme et d’ontologisme. Alors que nous avions dit expressément et répété de toutes les manières que la vie sociale était tout entière faite de représentations, on nous accusa d’éliminer l’élément mental de la sociologie. On alla même jusqu’à restaurer contre nous des procédés de discussion que l’on pouvait croire définitivement disparus. On nous imputa, en effet, certaines opinions que nous n’avions pas soutenues, sous prétexte qu’elles étaient « conformes à nos principes ». L’expérience avait pourtant prouvé tous les dangers de cette méthode qui, en permettant de construire arbitrairement les systèmes que l’on discute, permet aussi d’en triompher sans peine.
Nous ne croyons pas nous abuser en disant que, depuis, les résistances ont progressivement faibli. Sans doute, plus d’une proposition nous est encore contestée. Mais nous ne saurions ni nous étonner ni nous plaindre de ces contestations salutaires ; il est bien clair, en effet, que nos formules sont destinées à être réformées dans l’avenir. Résumé d’une pratique personnelle et forcément restreinte, elles devront nécessairement évoluer à mesure que l’on acquerra une expérience plus étendue et plus approfondie de la réalité sociale. En fait de méthode, d’ailleurs, on ne peut jamais faire que du provisoire ; car les méthodes changent à mesure que la science avance. Il n’en reste pas moins que, pendant ces dernières années, en dépit des oppositions, la cause de la sociologie objective, spécifique et méthodique a gagné du terrain sans interruption. La fondation de l’Année sociologique a certainement été pour beaucoup dans ce résultat. Parce qu’elle embrasse à la fois tout le domaine de la science, l’Année a pu, mieux qu’aucun ouvrage spécial, donner le sentiment de ce que la sociologie doit et peut devenir. On a pu voir ainsi qu’elle n’était pas condamnée à rester une branche de la philosophie générale, et que, d’autre part, elle pouvait entrer en contact avec le détail des faits sans dégénérer en pure érudition. Aussi ne saurions-nous trop rendre hommage à l’ardeur et au dévouement de nos collaborateurs ; c’est grâce à eux que cette démonstration par le fait a pu être tentée et qu’elle peut se poursuivre.
Cependant, quelque réels que soient ces progrès, il est incontestable que les méprises et les confusions passées ne sont pas encore tout entières dissipées. C’est pourquoi nous voudrions profiter de cette seconde édition pour ajouter quelques explications à toutes celles que nous avons déjà données, répondre à certaines critiques et apporter sur certains points des précisions nouvelles.
I
La proposition d’après laquelle les faits sociaux doivent être traités comme des choses — proposition qui est à la base même de notre méthode — est de celles qui ont provoqué le plus de contradictions. On a trouvé paradoxal et scandaleux que nous assimilions aux réalités du monde extérieur celles du monde social. C’était se méprendre singulièrement sur le sens et la portée de cette assimilation, dont l’objet n’est pas de ravaler les formes supérieures de l’être aux formes inférieures, mais, au contraire, de revendiquer pour les premières un degré de réalité au moins égal à celui que tout le monde reconnaît aux secondes. Nous ne disons pas, en effet, que les faits sociaux sont des choses matérielles, mais sont des choses au même titre que les choses matérielles, quoique d’une autre manière.
Qu’est-ce en effet qu’une chose ? La chose s’oppose à l’idée comme ce que l’on connaît du dehors à ce que l’on connaît du dedans. Est chose tout objet de connaissance qui n’est pas naturellement compénétrable à l’intelligence, tout ce dont nous ne pouvons nous faire une notion adéquate par un simple procédé d’analyse mentale, tout ce que l’esprit ne peut arriver à comprendre qu’à condition de sortir de lui-même, par voie d’observations et d’expérimentations, en passant progressivement des caractères les plus extérieurs et les plus immédiatement accessibles aux moins visibles et aux plus profonds. Traiter des faits d’un certain ordre comme des choses, ce n’est donc pas les classer dans telle ou telle catégorie du réel ; c’est observer vis-à-vis d’eux une certaine attitude mentale. C’est en aborder l’étude en prenant pour principe qu’on ignore absolument ce qu’ils sont, et que leurs propriétés caractéristiques, comme les causes inconnues dont elles dépendent, ne peuvent être découvertes par l’introspection même la plus attentive.
Les termes ainsi définis, notre proposition, loin d’être un paradoxe, pourrait presque passer pour un truisme si elle n’était encore trop souvent méconnue dans les sciences qui traitent de l’homme, et surtout en sociologie. En effet, on peut dire en ce sens que tout objet de science est une chose, sauf, peut-être, les objets mathématiques ; car, pour ce qui est de ces derniers, comme nous les construisons nous-mêmes depuis les plus simples jusqu’aux plus complexes, il suffit, pour savoir ce qu’ils sont, de regarder au dedans de nous et d’analyser intérieurement le processus mental d’où ils résultent. Mais dès qu’il s’agit de faits proprement dits, ils sont nécessairement pour nous, au moment où nous entreprenons d’en faire la science, des inconnus, des choses ignorées, car les représentations qu’on a pu s’en faire au cours de la vie, ayant été faites sans méthode et sans critique, sont dénuées de valeur scientifique et doivent être tenues à l’écart. Les faits de la psychologie individuelle eux-mêmes présentent ce caractère et doivent être considérés sous cet aspect. En effet, quoiqu’ils nous soient intérieurs par définition, la conscience que nous en avons ne nous en révèle ni la nature interne ni la genèse. Elle nous les fait bien connaître jusqu’à un certain point, mais seulement comme les sensations nous font connaître la chaleur ou la lumière, le son ou l’électricité ; elle nous en donne des impressions confuses, passagères, subjectives, mais non des notions claires et distinctes, des concepts explicatifs. Et c’est précisément pour cette raison qu’il s’est fondé au cours de ce siècle une psychologie objective dont la règle fondamentale est d’étudier les faits mentaux du dehors, c’est-à-dire comme des choses. À plus forte raison en doit-il être ainsi des faits sociaux ; car la conscience ne saurait être plus compétente pour en connaître que pour connaître de sa vie propre 1. — On objectera que, comme ils sont notre œuvre, nous n’avons qu’à prendre conscience de nous-mêmes pour savoir ce que nous y avons mis et comment nous les avons formés. Mais, d’abord, la majeure partie des institutions sociales nous sont léguées toutes faites par les générations antérieures ; nous n’avons pris aucune part à leur formation et, par conséquent, ce n’est pas en nous interrogeant que nous pourrons découvrir les causes qui leur ont donné naissance. De plus, alors même que nous avons collaboré à leur genèse, c’est à peine si nous entrevoyons de la manière la plus confuse, et souvent même la plus inexacte, les véritables raisons qui nous ont déterminé à agir et la nature de notre action. Déjà, alors qu’il s’agit simplement de nos démarches privées, nous savons bien mal les mobiles relativement simples qui nous guident ; nous nous croyons désintéressés alors que nous agissons en égoïstes, nous croyons obéir à la haine alors que nous cédons à l’amour, à la raison alors que nous sommes les esclaves de préjugés irraisonnés, etc. Comment donc aurions-nous la faculté de discerner avec plus de clarté les causes, autrement complexes, dont procèdent les démarches de la collectivité ? Car, à tout le moins, chacun de nous n’y prend part que pour une infime partie ; nous avons une multitude de collaborateurs et ce qui se passe dans les autres consciences nous échappe.
Notre règle n’implique donc aucune conception métaphysique, aucune spéculation sur le fond des êtres. Ce qu’elle réclame, c’est que le sociologue se mette dans l’état d’esprit où sont physiciens, chimistes, physiologistes, quand ils s’engagent dans une région, encore inexplorée, de leur domaine scientifique. Il faut qu’en pénétrant dans le monde social, il ait conscience qu’il pénètre dans l’inconnu ; il faut qu’il se sente en présence de faits dont les lois sont aussi insoupçonnées que pouvaient l’être celles de la vie, quand la biologie n’était pas constituée ; il faut qu’il se tienne prêt à faire des découvertes qui le surprendront et le déconcerteront. Or il s’en faut que la sociologie en soit arrivée à ce degré de maturité intellectuelle. Tandis que le savant qui étudie la nature physique a le sentiment très vif des résistances qu’elle lui oppose et dont il a tant de peine à triompher, il semble en vérité que le sociologue se meuve au milieu de choses immédiatement transparentes pour l’esprit, tant est grande l’aisance avec laquelle on le voit résoudre les questions les plus obscures. Dans l’état actuel de la science, nous ne savons véritablement pas ce que sont même les principales institutions sociales, comme l’État ou la famille, le droit de propriété ou le contrat, la peine et la responsabilité ; nous ignorons presque complètement les causes dont elles dépendent, les fonctions qu’elles remplissent, les lois de leur évolution ; c’est à peine si, sur certains points, nous commençons à entrevoir quelques lueurs. Et pourtant, il suffit de parcourir les ouvrages de sociologie pour voir combien est rare le sentiment de cette ignorance et de ces difficultés. Non seulement on se considère comme obligé de dogmatiser sur tous les problèmes à la fois, mais on croit pouvoir, en quelques pages ou en quelques phrases, atteindre l’essence même des phénomènes les plus complexes. C’est dire que de semblables théories expriment, non les faits qui ne sauraient être épuisés avec cette rapidité, mais la prénotion qu’en avait l’auteur, antérieurement à la recherche. Et sans doute, l’idée que nous nous faisons des pratiques collectives, de ce qu’elles sont ou de ce qu’elles doivent être, est un facteur de leur développement. Mais cette idée elle-même est un fait qui, pour être convenablement déterminé, doit, lui aussi, être étudié du dehors. Car ce qu’il importe de savoir, ce n’est pas la manière dont tel penseur individuellement se représente telle institution, mais la conception qu’en a le groupe ; seule, en effet, cette conception est socialement efficace. Or elle ne peut être connue par simple observation intérieure puisqu’elle n’est tout entière en aucun de nous ; il faut donc bien trouver quelques signes extérieurs qui la rendent sensible. De plus, elle n’est pas née de rien ; elle est elle-même un effet de causes externes qu’il faut connaître pour pouvoir apprécier son rôle dans l’avenir. Quoiqu’on fasse, c’est donc toujours à la même méthode qu’il en faut revenir.
II
Une autre proposition n’a pas été moins vivement discutée que la précédente : c’est celle qui présente les phénomènes sociaux comme extérieurs aux individus. On nous accorde aujourd’hui assez volontiers que les faits de la vie individuelle et ceux de la vie collective sont hétérogènes à quelque degré ; on peut même dire qu’une entente, sinon unanime, du moins très générale, est en train de se faire sur ce point. Il n’y a plus guère de sociologues qui dénient à la sociologie toute espèce de spécificité. Mais parce que la Société n’est composée que d’individus 2, il semble au sens commun que la vie sociale ne puisse avoir d’autre substrat que la conscience individuelle ; autrement, elle paraît rester en l’air et planer dans le vide.
Pourtant, ce qu’on juge si facilement inadmissible quand il s’agit des faits sociaux, est couramment admis des autres règnes de la nature. Toutes les fois que des éléments quelconques, en se combinant, dégagent, par le fait de leur combinaison, des phénomènes nouveaux, il faut bien concevoir que ces phénomènes sont situés, non dans les éléments, mais dans le tout formé par leur union. La cellule vivante ne contient rien que des particules minérales, comme la société ne contient rien en dehors des individus ; et pourtant il est, de toute évidence, impossible que les phénomènes caractéristiques de la vie résident dans des atomes d’hydrogène, d’oxygène, de carbone et d’azote. Car comment les mouvements vitaux pourraient-ils se produire au sein d’éléments non vivants ? Comment, d’ailleurs, les propriétés biologiques se répartiraient-elles entre ces éléments ? Elles ne sauraient se retrouver également chez tous puisqu’ils ne sont pas de même nature ; le carbone n’est pas l’azote et, par suite, ne peut revêtir les mêmes propriétés ni jouer le même rôle. Il n’est pas moins inadmissible que chaque aspect de la vie, chacun de ses caractères principaux s’incarne dans un groupe différent d’atomes. La vie ne saurait se décomposer ainsi ; elle est une et, par conséquent, elle ne peut avoir pour siège que la substance vivante dans sa totalité. Elle est dans le tout, non dans les parties. Ce ne sont pas les particules non-vivantes de la cellule qui se nourrissent, se reproduisent, en un mot, qui vivent ; c’est la cellule elle-même et elle seule. Et ce que nous disons de la vie pourrait se répéter de toutes les synthèses possibles. La dureté du bronze n’est ni dans le cuivre ni dans l’étain ni dans le plomb qui ont servi à le former et qui sont des corps mous ou flexibles ; elle est dans leur mélange. La fluidité de l’eau, ses propriétés alimentaires et autres ne sont pas dans les deux gaz dont elle est composée, mais dans la substance complexe qu’ils forment par leur association.
Appliquons ce principe à la sociologie. Si, comme on nous l’accorde, cette synthèse sui generis qui constitue toute société dégage des phénomènes nouveaux, différents de ceux qui se passent dans les consciences solitaires, il faut bien admettre que ces faits spécifiques résident dans la société même qui les produit, et non dans ses parties, c’est-à-dire dans ses membres. Ils sont donc, en ce sens, extérieurs aux consciences individuelles, considérées comme telles, de même que les caractères distinctifs de la vie sont extérieurs aux substances minérales qui composent l’être vivant. On ne peut les résorber dans les éléments sans se contredire, puisque, par définition, ils supposent autre chose que ce que contiennent ces éléments. Ainsi se trouve justifiée, par une raison nouvelle, la séparation que nous avons établie plus loin entre la psychologie proprement dite, ou science de l’individu mental, et la sociologie. Les faits sociaux ne diffèrent pas seulement en qualité des faits psychiques ; ils ont un autre substrat, ils n’évoluent pas dans le même milieu, ils ne dépendent pas des mêmes conditions. Ce n’est pas à dire qu’ils ne soient, eux aussi, psychiques en quelque manière puisqu’ils consistent tous en des façons de penser ou d’agir. Mais les états de la conscience collective sont d’une autre nature que les états de la conscience individuelle ; ce sont des représentations d’une autre sorte. La mentalité des groupes n’est pas celle des particuliers ; elle a ses lois propres. Les deux sciences sont donc aussi nettement distinctes que deux sciences peuvent l’être, quelques rapports qu’il puisse, par ailleurs, y avoir entre elles.
Toutefois, sur ce point, il y a lieu de faire une distinction qui jettera peut-être quelque lumière sur le débat.
Que la matière de la vie sociale ne puisse pas s’expliquer par des facteurs purement psychologiques, c’est-à-dire par des états de la conscience individuelle, c’est ce qui nous parait être l’évidence même. En effet, ce que les représentations collectives traduisent, c’est la façon dont le groupe se pense dans ses rapports avec les objets qui l’affectent. Or le groupe est constitué autrement que l’individu et les choses qui l’affectent sont d’une autre nature. Des représentations qui n’expriment ni les mêmes sujets ni les mêmes objets ne sauraient dépendre des mêmes causes. Pour comprendre la manière dont la société se représente elle-même et le monde qui l’entoure, c’est la nature de la société, et non celle des particuliers, qu’il faut considérer. Les symboles sous lesquels elle se pense changent suivant ce qu’elle est. Si, par exemple, elle se conçoit comme issue d’un animal éponyme, c’est qu’elle forme un de ces groupes spéciaux qu’on appelle des clans. Là où l’animal est remplacé par un ancêtre humain, mais également mythique, c’est que le clan a changé de nature. Si, au-dessus des divinités locales ou familiales, elle en imagine d’autres dont elle croit dépendre, c’est que les groupes locaux et familiaux dont elle est composée tendent à se concentrer et à s’unifier, et le degré d’unité que présente un panthéon religieux correspond au degré d’unité atteint au même moment par la société. Si elle condamne certains modes de conduite, c’est qu’ils froissent certains de ses sentiments fondamentaux ; et ces sentiments tiennent à sa constitution, comme ceux de l’individu à son tempérament physique et à son organisation mentale. Ainsi, alors même que la psychologie individuelle n’aurait plus de secrets pour nous, elle ne saurait nous donner la solution d’aucun de ces problèmes, puisqu’ils se rapportent à des ordres de faits qu’elle ignore.
Mais, cette hétérogénéité une fois reconnue, on peut se demander si les représentations individuelles et les représentations collectives ne laissent pas, cependant, de se ressembler en ce que les unes et les autres sont également des représentations ; et si, par suite de ces ressemblances, certaines lois abstraites ne seraient pas communes aux deux règnes. Les mythes, les légendes populaires, les conceptions religieuses de toute sorte, les croyances morales, etc., expriment une autre réalité que la réalité individuelle ; mais il se pourrait que la manière dont elles s’attirent ou se repoussent, s’agrègent ou se désagrègent, soit indépendante de leur contenu et tienne uniquement à leur qualité générale de représentations. Tout en étant faites d’une matière différente, elles se comporteraient dans leurs relations mutuelles comme font les sensations, les images, ou les idées chez l’individu. Ne peut-on croire, par exemple, que la contiguïté et la ressemblance, les contrastes et les antagonismes logiques agissent de la même façon, quelles que soient les choses représentées ? On en vient ainsi à concevoir la possibilité d’une psychologie toute formelle qui serait une sorte de terrain commun à la psychologie individuelle et à la sociologie ; et c’est peut-être ce qui fait le scrupule qu’éprouvent certains esprits à distinguer trop nettement ces deux sciences.
À parler rigoureusement, dans l’état actuel de nos connaissances, la question ainsi posée ne saurait recevoir de solution catégorique. En effet, d’une part, tout ce que nous savons sur la manière dont se combinent les idées individuelles se réduit à ces quelques propositions, très générales et très vagues, que l’on appelle communément lois de l’association des idées. Et quant aux lois de l’idéation collective, elles sont encore plus complètement ignorées. La psychologie sociale, qui devrait avoir pour tache de les déterminer, n’est guère qu’un mot qui désigne toutes sortes de généralités, variées et imprécises, sans objet défini. Ce qu’il faudrait, c’est chercher, par la comparaison des thèmes mythiques, des légendes et des traditions populaires, des langues, de quelle façon les représentations sociales s’appellent et s’excluent, fusionnent les unes dans les autres ou se distinguent, etc. Or si le problème mérite de tenter la curiosité des chercheurs, à peine peut-on dire qu’il soit abordé, et tant que l’on n’aura pas trouvé quelques-unes de ces lois, il sera évidemment impossible de savoir avec certitude si elles répètent ou non celles de la psychologie individuelle.
Cependant, à défaut de certitude, il est tout au moins probable que, s’il existe des ressemblances entre ces deux sortes de lois, les différences ne doivent pas être moins marquées. Il paraît, en effet, inadmissible que la matière dont sont faites les représentations n’agisse pas sur leurs modes de combinaisons. Il est vrai que les psychologues parlent parfois des lois de l’association des idées, comme si elles étaient les mêmes pour toutes les espèces de représentations individuelles. Mais rien n’est moins vraisemblable : les images ne se composent pas entre elles comme les sensations, ni les concepts comme les images. Si la psychologie était plus avancée, elle constaterait, sans doute, que chaque catégorie d’états mentaux a ses lois formelles qui lui sont propres. S’il en est ainsi, on doit a fortiori s’attendre à ce que les lois correspondantes de la pensée sociale soient spécifiques comme cette pensée elle-même. En fait, pour peu qu’on ait pratiqué cet ordre de faits, il est difficile de ne pas avoir le sentiment de cette spécificité. N’est-ce pas elle, en effet, qui nous fait paraître si étrange la manière si spéciale dont les conceptions religieuses (qui sont collectives au premier chef) se mêlent ou se séparent, se transforment les unes dans les autres, donnant naissance à des composés contradictoires qui contrastent avec les produits ordinaires de notre pensée privée. Si donc, comme il est présumable, certaines lois de la mentalité sociale rappellent effectivement certaines de celles qu’établissent les psychologues, ce n’est pas que les premières soient un simple cas particulier des secondes ; mais c’est qu’entre les unes et les autres, à côté de différences certainement importantes, il y a des similitudes que l’abstraction pourra dégager, et qui d’ailleurs, sont encore ignorées. C’est dire qu’en aucun cas la sociologie ne saurait emprunter purement et simplement à la psychologie telle ou telle de ses propositions, pour l’appliquer telle quelle aux faits sociaux. Mais la pensée collective tout entière, dans sa forme comme dans sa matière, doit être étudiée en elle-même, pour elle-même, avec le sentiment de ce qu’elle a de spécial, et il faut laisser à l’avenir le soin de rechercher dans quelle mesure elle ressemble à la pensée des particuliers. C’est même là un problème qui ressortit plutôt à la philosophie générale et à la logique abstraite qu’à l’étude scientifique des faits sociaux 3.
III
Il nous reste à dire quelques mots de la définition que nous avons donnée des faits sociaux dans notre premier chapitre. Nous les faisons consister en des manières de faire ou de penser, reconnaissables à cette particularité qu’elles sont susceptibles d’exercer sur les consciences particulières une influence coercitive. — Une confusion s’est produite à ce sujet qui mérite d’être notée.
On a tellement l’habitude d’appliquer aux choses sociologiques les formes de la pensée philosophique qu’on a souvent vu dans cette définition préliminaire une sorte de philosophie du fait social. On a dit que nous expliquions les phénomènes sociaux par la contrainte, de même que M. Tarde les explique par l’imitation. Nous n’avions point une telle ambition et il ne nous était même pas venu à l’esprit qu’on pût nous la prêter, tant elle est contraire à toute méthode. Ce que nous nous proposions était, non d’anticiper par une vue philosophique les conclusions de la science, mais simplement d’indiquer à quels signes extérieurs il est possible de reconnaître les faits dont elle doit traiter, afin que le savant sache les apercevoir là où ils sont et ne les confonde pas avec d’autres. Il s’agissait de délimiter le champ de la recherche aussi bien que possible, non de l’embrasser dans une sorte d’intuition exhaustive. Aussi acceptons-nous très volontiers le reproche qu’on a fait à cette définition de ne pas exprimer tous les caractères du fait social et, par suite, de n’être pas la seule possible. Il n’y a, en effet, rien d’inconcevable à ce qu’il puisse être caractérisé de plusieurs manières différentes ; car il n’y a pas de raison pour qu’il n’ait qu’une seule propriété distinctive 4. Tout ce qu’il importe, c’est de choisir celle qui paraît la meilleure pour le but qu’on se propose. Même il est très possible d’employer concurremment plusieurs critères, suivant les circonstances. Et c’est ce que nous avons reconnu nous-même être parfois nécessaire en sociologie ; car il y a des cas où le caractère de contrainte n’est pas facilement reconnaissable (voir p. 19). Tout ce qu’il faut, puisqu’il s’agit d’une définition initiale, c’est que les caractéristiques dont on se sert soient immédiatement discernables et puissent être aperçues avant la recherche. Or, c’est cette condition que ne remplissent pas les définitions que l’on a parfois opposées à la nôtre. On a dit, par exemple, que le fait social, c’est « tout ce qui se produit dans et par la société », ou encore « ce qui intéresse et affecte le groupe en quelque façon ». Mais on ne peut savoir si la société est ou non la cause d’un fait ou si ce fait a des effets sociaux que quand la science est déjà avancée. De telles définitions ne sauraient donc servir à déterminer l’objet de l’investigation qui commence. Pour qu’on puisse les utiliser, il faut que l’étude des faits sociaux ait été déjà poussée assez loin et, par suite, qu’on ait découvert quelque autre moyen préalable de les reconnaitre là où ils sont.
En même temps qu’on a trouvé notre définition trop étroite, on l’a accusée d’être trop large et de comprendre presque tout le réel. En effet, a-t-on dit, tout milieu physique exerce une contrainte sur les êtres qui subissent son action ; car ils sont tenus, dans une certaine mesure, de s’y adapter. — Mais il y a entre ces deux modes de coercition toute la différence qui sépare un milieu physique et un milieu moral. La pression exercée par un ou plusieurs corps sur d’autres corps ou même sur des volontés ne saurait être confondue avec celle qu’exerce la conscience d’un groupe sur la conscience de ses membres. Ce qu’a de tout à fait spécial la contrainte sociale, c’est qu’elle est due, non à la rigidité de certains arrangements moléculaires, mais au prestige dont sont investies certaines représentations. Il est vrai que les habitudes, individuelles ou héréditaires, ont, à certains égards, cette même propriété. Elles nous dominent, nous imposent des croyances ou des pratiques. Seulement, elles nous dominent du dedans ; car elles sont tout entières en chacun de nous. Au contraire, les croyances et les pratiques sociales agissent sur nous du dehors : aussi l’ascendant exercé par les unes et par les autres est-il, au fond, très différent.
Il ne faut pas s’étonner, d’ailleurs, que les autres phénomènes de la nature présentent, sous d’autres formes, le caractère même par lequel nous avons défini les phénomènes sociaux. Cette similitude vient simplement de ce que les uns et les autres sont des choses réelles. Car tout ce qui est réel a une nature définie qui s’impose, avec laquelle il faut compter et qui, alors même qu’on parvient à la neutraliser, n’est jamais complètement vaincue. Et, au fond, c’est là ce qu’il y a de plus essentiel dans la notion de la contrainte sociale. Car tout ce qu’elle implique, c’est que les manières collectives d’agir ou de penser ont une réalité en dehors des individus qui, à chaque moment du temps, s’y conforment. Ce sont des choses qui ont leur existence propre. L’individu les trouve toutes formées et il ne peut pas faire qu’elles ne soient pas ou qu’elles soient autrement qu’elles ne sont ; il est donc bien obligé d’en tenir compte et il lui est d’autant plus difficile (nous ne disons pas impossible) de les modifier que, à des degrés divers, elles participent de la suprématie matérielle et morale que la société a sur ses membres. Sans doute, l’individu joue un rôle dans leur genèse. Mais pour qu’il y ait fait social, il faut que plusieurs individus tout au moins aient mêlé leur action et que cette combinaison ait dégagé quelque produit nouveau. Et comme cette synthèse a lieu en dehors de chacun de nous (puisqu’il y entre une pluralité de consciences), elle a nécessairement pour effet de fixer, d’instituer hors de nous de certaines façons d’agir et de certains jugements qui ne dépendent pas de chaque volonté particulière prise à part. Ainsi qu’on l’a fait remarquer 5, il y a un mot qui, pourvu toutefois qu’on en étende un peu l’acception ordinaire, exprime assez bien cette manière d’être très spéciale : c’est celui d’institution. On peut en effet, sans dénaturer le sens de cette expression, appeler institution, toutes les croyances et tous les modes de conduite institués par la collectivité ; la sociologie peut alors être définie : la science des institutions, de leur genèse et de leur fonctionnement 6.
Sur les autres controverses qu’a suscitées cet ouvrage, il nous paraît inutile de revenir ; car elles ne touchent à rien d’essentiel. L’orientation générale de la méthode ne dépend pas des procédés que l’on préfère employer soit pour classer les types sociaux, soit pour distinguer le normal du pathologique. D’ailleurs, ces contestations sont très souvent venues de ce que l’on se refusait à admettre, ou de ce que l’on n’admettait pas sans réserves, notre principe fondamental : la réalité objective des faits sociaux. C’est donc finalement sur ce principe que tout repose, et tout y ramène. C’est pourquoi il nous a paru utile de le mettre une fois de plus en relief, en le dégageant de toute question secondaire. Et nous sommes assuré qu’en lui attribuant une telle prépondérance nous restons fidèle à la tradition sociologique ; car, au fond, c’est de cette conception que la sociologie tout entière est sortie. Cette science, en effet, ne pouvait naître que le jour où l’on eut pressenti que les phénomènes sociaux, pour n’être pas matériels, ne laissent pas d’être des choses réelles qui comportent l’étude. Pour être arrivé à penser qu’il y avait lieu de rechercher ce qu’ils sont, il fallait avoir compris qu’ils sont d’une façon définie, qu’ils ont une manière d’être constante, une nature qui ne dépend pas de l’arbitraire individuel et d’où dérivent des rapports nécessaires. Aussi l’histoire de la sociologie n’est-elle qu’un long effort en vue de préciser ce sentiment, de l’approfondir, de développer toutes les conséquences qu’il implique. Mais, malgré les grands progrès qui ont été faits en ce sens, on verra par la suite de ce travail qu’il reste encore de nombreuses survivances du postulat anthropocentrique qui, ici comme ailleurs, barre la route à la science. Il déplaît à l’homme de renoncer au pouvoir illimité qu’il s’est si longtemps attribué sur l’ordre social, et, d’autre part, il lui semble que, s’il existe vraiment des forces collectives, il est nécessairement condamné à les subir sans pouvoir les modifier. C’est ce qui l’incline à les nier. En vain des expériences répétées lui ont appris que cette toute-puissance, dans l’illusion de laquelle il s’entretient avec complaisance, a toujours été pour lui une cause de faiblesse ; que son empire sur les choses n’a réellement commencé qu’à partir du moment où il reconnut qu’elles ont une nature propre, et où il se résigna à apprendre d’elles ce qu’elles sont. Chassé de toutes les autres sciences, ce déplorable préjugé se maintient opiniâtrement en sociologie. Il n’y a donc rien de plus urgent que de chercher à en affranchir définitivement notre science ; et c’est le but principal de nos efforts.
1On voit que, pour admettre cette proposition, il n’est pas nécessaire de soutenir que la vie sociale est faite d’autre chose que de représentations ; il suffit de poser que les représentations, individuelles ou collectives, ne peuvent être étudiées scientifiquement qu’à condition d’être étudiées objectivement.
2La proposition n’est, d’ailleurs, que partiellement exacte. ― Outre les individus, il y a les choses qui sont des éléments intégrants de la société. Il est vrai seulement que les individus en sont les seuls éléments actifs.
3Il est inutile de montrer comment, de ce point de vue, la nécessité d’étudier les faits du dehors apparaît plus évidente encore, puisqu’ils résultent de synthèses qui ont lieu hors de nous et dont nous n’avons même pas la perception confuse que la conscience peut nous donner des phénomènes intérieurs.
4Le pouvoir coercitif que nous lui attribuons est même si peu le tout du fait social, qu’il peut présenter également le caractère opposé. Car, en même temps que les institutions s’imposent à nous, nous y tenons ; elles nous obligent et nous les aimons ; elles nous contraignent et nous trouvons notre compte à leur fonctionnement et à cette contrainte même. Cette antithèse est celle que les moralistes ont souvent signalée entre les deux notions du bien et du devoir qui expriment deux aspects différents, mais également réels, de la vie morale. Or il n’est peut-être pas de pratiques collectives qui n’exercent sur nous cette double action, qui n’est, d’ailleurs, contradictoire qu’en apparence. Si nous ne les avons pas définies par cet attachement spécial, à la fois intéressé et désintéressé, c’est tout simplement qu’il ne se manifeste pas par des signes extérieurs, facilement perceptibles. Le bien a quelque chose de plus interne, de plus intime que le devoir, partant, de moins saisissable.
5Voir Art. Sociologie de la Grande Encyclopédie, par MM. Fauconnet et Mauss.
6De ce que les croyances et les pratiques sociales nous pénètrent ainsi du dehors, il ne suit pas que nous les recevions passivement et sans leur faire subir de modification. En pensant les institutions collectives, en nous les assimilant, nous les individualisons, nous leur donnons plus ou moins notre marque personnelle ; c’est ainsi qu’en pensant le monde sensible chacun de nous le colore à sa façon et que des sujets différents s’adaptent différemment à un même milieu physique. C’est pourquoi chacun de nous se fait, dans une certaine mesure, sa morale, sa religion, sa technique. Il n’est pas de conformisme social qui ne comporte toute une gamme de nuances individuelles. Il n’en reste pas moins que le champ des variations permises est limité. Il est nul ou très faible dans le cercle des phénomènes religieux et moraux ou la variation devient aisément un crime ; il est plus étendu pour tout ce qui concerne la vie économique. Mais tôt ou tard, même dans ce dernier cas, on rencontre une limite qui ne peut être franchie.
Introduction
Jusqu’à présent, les sociologues se sont peu préoccupés de caractériser et de définir la méthode qu’ils appliquent à l’étude des faits sociaux. C’est ainsi que, dans toute l’œuvre de M. Spencer, le problème méthodologique n’occupe aucune place ; car l’Introduction à la science sociale, dont le titre pourrait faire illusion, est consacrée à démontrer les difficultés et la possibilité de la sociologie, non à exposer les procédés dont elle doit se servir. Mill, il est vrai, s’est assez longuement occupé de la question 1 ; mais il n’a fait que passer au crible de sa dialectique ce que Comte en avait dit, sans y rien ajouter de vraiment personnel. Un chapitre du Cours de philosophie positive, voilà donc, à peu près, la seule étude originale et importante que nous possédions sur la matière2.
Cette insouciance apparente n’a, d’ailleurs, rien qui doive surprendre. En effet, les grands sociologues dont nous venons de rappeler les noms ne sont guère sortis des généralités sur la nature des sociétés, sur les rapports du règne social et du règne biologique, sur la marche générale du progrès ; même la volumineuse sociologie de M. Spencer n’a guère d’autre objet que de montrer comment la loi de l’évolution universelle s’applique aux sociétés. Or, pour traiter ces questions philosophiques, des procédés spéciaux et complexes ne sont pas nécessaires. On se contentait donc de peser les mérites comparés de la déduction et de l’induction et de faire une enquête sommaire sur les ressources les plus générales dont dispose l’investigation sociologique. Mais les précautions à prendre dans l’observation des faits, la manière dont les principaux problèmes doivent être posés, le sens dans lequel les recherches doivent être dirigées, les pratiques spéciales qui peuvent leur permettre d’aboutir, les règles qui doivent présider à l’administration des preuves restaient indéterminées.
Un heureux concours de circonstances, au premier rang desquelles il est juste de mettre l’acte d’initiative qui a créé en notre faveur un cours régulier de sociologie à la Faculté des lettres de Bordeaux, nous ayant permis de nous consacrer de bonne heure à l’étude de la science sociale et d’en faire même la matière de nos occupations professionnelles, nous avons pu sortir de ces questions trop générales et aborder un certain nombre de problèmes particuliers. Nous avons donc été amené, par la force même des choses, à nous faire une méthode plus définie, croyons-nous, plus exactement adaptée à la nature particulière des phénomènes sociaux. Ce sont ces résultats de notre pratique que nous voudrions exposer ici dans leur ensemble et soumettre à la discussion. Sans doute, ils sont implicitement contenus dans le livre que nous avons récemment publié sur La Division du travail social. Mais il nous paraît qu’il y a quelque intérêt à les en dégager, à les formuler à part, en les accompagnant de leurs preuves et en les illustrant d’exemples empruntés soit à cet ouvrage, soit à des travaux encore inédits. On pourra mieux juger ainsi de l’orientation que nous voudrions essayer de donner aux études de sociologie.
1Système de Logique, l. VI, ch. VII-XII.
2Voir 2e éd., p. 294-336.