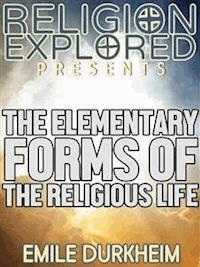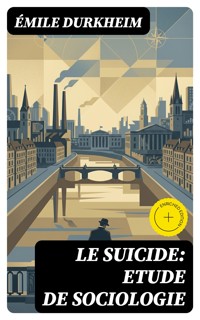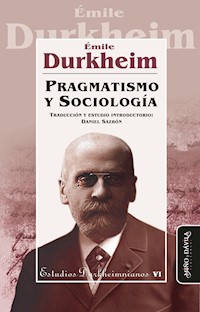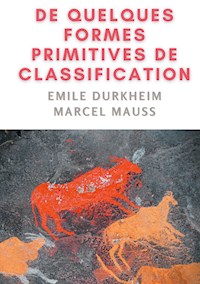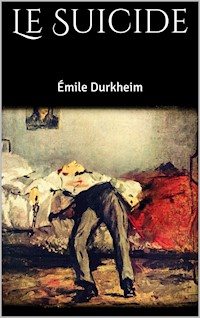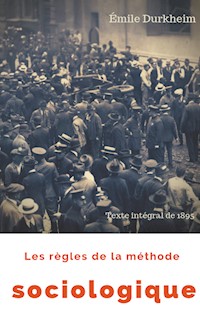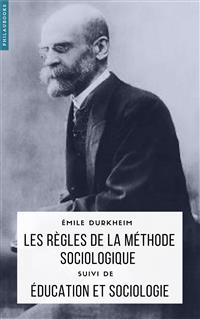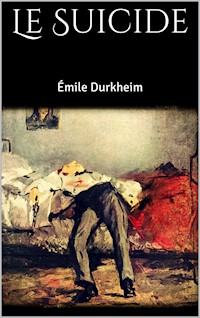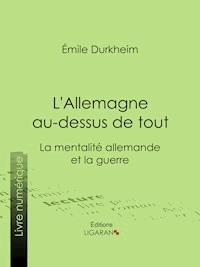2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Librorium Editions
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Nous nous proposons d’étudier dans ce livre la religion la plus primitive et la plus simple qui soit actuellement connue, d’en faire l’analyse et d’en tenter l’explication. Nous disons d’un système religieux qu’il est le plus primitif qu’il nous soit donné d’observer quand il remplit les deux conditions suivantes : en premier lieu, il faut qu’il se rencontre dans des sociétés dont l’organisation n’est dépassée par aucune autre en simplicité ; il faut de plus qu’il soit possible de l’expliquer sans faire intervenir aucun élément emprunté à une religion antérieure. Ce système, nous nous efforcerons d’en décrire l’économie avec l’exactitude et la fidélité que pourraient y mettre un ethnographe ou un historien. Mais là ne se bornera pas notre tâche. La sociologie se pose d’autres problèmes que l’histoire ou que l’ethnographie.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Les Formes élémentaires de la vie religieuse Le système totémique en Australie
Émile Durkheim
1912
© 2023 Librorium Editions
ISBN : 9782383837589
OBJET DE LA RECHERCHE
Sociologie religieuse
et théorie de la connaissance
I. — Objet principal du livre : analyse de la religion la plus simple qui soit connue, en vue de déterminer les formes élémentaires de la vie religieuse. — Pourquoi elles sont plus faciles à atteindre et à expliquer à travers les religions primitives
II. — Objet secondaire de la recherche : genèse des notions fondamentales de la pensée ou catégories. — Raisons de croire qu’elles ont une origine religieuse et, par suite, sociale. — Comment, de ce point de vue, on entrevoit un moyen de renouveler la théorie de la connaissance
LIVRE PREMIER
QUESTIONS PRÉLIMINAIRES
Chapitre Premier
DÉFINITION DU PHÉNOMÈNE RELIGIEUX
ET DE LA RELIGION
Utilité d’une définition préalable de la religion ; méthode à suivre pour procéder à cette définition. — Pourquoi il convient d’examiner d’abord les définitions usuelles
I. — La religion définie par le surnaturel et le mystérieux. — Critique : la notion du mystère n’est pas primitive
II. La religion définie en fonction de l’idée de Dieu ou d’être spirituel. — Religions sans dieux. — Dans les religions déistes, rites qui n’impliquent aucune idée de divinité
III. — Recherche d’une définition positive. Distinction des croyances et des rites. — Définition des croyances. — Première caractéristique : division bipartite des choses en sacrées et en profanes. — Caractères distinctifs de cette division. — Définition des rites en fonction des croyances. — Définition de la religion.
IV. — Nécessité d’une autre caractéristique pour distinguer la magie de la religion. — L’idée d’Église. Les religions individuelles excluent-elles l’idée d’Église
Chapitre II
LES PRINCIPALES CONCEPTIONS DE LA RELIGION ÉLÉMENTAIRE
I. L’animisme
Distinction de l’animisme et du naturisme
I. — Les trois thèses de l’animisme : 1o Genèse de l’idée d’âme ; 2o Formation de l’idée d’esprit ; 3o Transformation du culte des esprits en culte de la nature
II. — Critique de la première thèse. — Distinction de l’idée d’âme et de l’idée double. — Le rêve ne rend pas compte de l’idée
III. — Critique de la seconde thèse. — La mort n’explique pas la transformation de l’âme en esprit. — Le culte des âmes des morts n’est pas primitif
IV. — Critique de la troisième thèse. — L’instinct anthropomorphique. Critique qu’en a faite Spencer ; réserves à ce sujet. Examen des faits par lesquels on croit prouver l’existence de cet instinct. — Différence entre l’âme et les esprits de la nature. L’anthropomorphisme religieux n’est pas primitif
V. — Conclusion : l’animisme réduit la religion à n’être qu’un système d’hallucinations
Chapitre III
LES PRINCIPALES CONCEPTIONS DE LA RELIGION ÉLÉMENTAIRE (suite)
II. — Le naturisme
Historique de la théorie
I. — Exposé du naturisme d’après Max Müller
II. — Si la religion a pour objet d’exprimer les forces naturelles, comme elle les exprime d’une manière erronée, on ne comprend pas qu’elle ait pu se maintenir. — Prétendue distinction entre la religion et la mythologie
III. — Le naturisme n’explique pas la distinction des choses en sacrées et en profanes
Chapitre IV
LE TOTÉMISME COMME RELIGION ÉLÉMENTAIRE
Historique de la question, méthode pour la traiter
I. — Histoire sommaire de la question du totémisme
II. — Raisons de méthode pour lesquelles l’étude portera spécialement sur le totémisme australien. — De la place qui sera faite aux faits américains
LIVRE II
LES CROYANCES ÉLÉMENTAIRES
Chapitre Premier
LES CROYANCES PROPREMENT TOTÉMIQUES
I. — Le totem comme nom et comme emblème
I. — Définition du clan. — Le totem comme nom du clan. — Nature des choses qui servent de totems. — Manières dont est acquis le totem. — Les totems de phratries, de classes matrimoniales
II. — Le totem comme emblème. — Dessins totémiques gravés ou sculptés sur les objets ; tatoués ou dessinés sur les corps
III. — Caractère sacré de l’emblème totémique. — Les churinga. — Le nurtunja. — Le waninga. — Caractère conventionnel des emblèmes totémiques
Chapitre II
LES CROYANCES PROPREMENT TOTÉMIQUES(suite)
II. — L’animal totémique et l’homme
I. — Caractère sacré des animaux totémiques. — Interdiction de les manger, de les tuer, de cueillir les plantes totémiques. — Tempéraments divers apportés à ces interdictions. — Prohibitions de contact. — Le caractère sacré de l’animal est moins prononcé que celui de l’emblème
II. — L’homme. — Sa parenté avec l’animal ou la plante totémiques. — Mythes divers qui expliquent cette parente. — Le caractère sacré de l’homme est plus apparent sur certains points de l’organisme : le sang, les cheveux, etc. — Comment ce caractère varie avec le sexe et l’âge. — Le totémisme n’est pas une zoolâtrie ni une phytolâtrie
Chapitre III
LES CROYANCES PROPREMENT TOTÉMIQUES(suite)
III. Le système cosmogonique du totémisme et la notion de genre
I. — Les classifications des choses par clans, phratries, classes
II. — Genèse de la notion de genre : les premières classifications de choses empruntent leurs cadres à la société. — Différences entre le sentiment des ressemblances et l’idée de genre. — Pourquoi celle-ci est d’origine sociale
III. — Signification religieuse de ces classifications : toutes les choses classées dans un clan participent de la nature du totem et de son caractère sacré. Le système cosmogonique du totémisme. — Le totémisme comme religion tribale
Chapitre IV
LES CROYANCES PROPREMENT TOTÉMIQUES(fin)
IV. Le totem individuel et le totem sexuel
I. — Le totem individuel comme prénom ; son caractère sacré. — Le totem individuel comme emblème personnel. — Liens entre l’homme et son totem individuel. — Rapports avec le totem collectif
II. — Les totems des groupes sexuels. — Ressemblances et différences avec les totems collectifs et individuels. — Leur caractère tribal
Chapitre V
ORIGINES DE CES CROYANCES
I. — Examen critique des théories
I. — Théories qui dérivent le totémisme d’une religion antérieure : du culte des ancêtres (Wilken et Tylor) ; du culte de la nature (Jevons). — Critique de ces théories
II. — Théories qui dérivent le totémisme collectif du totémisme individuel. — Origines attribuées par ces théories au totem individuel (Frazer, Boas, Hill Tout). — Invraisemblance de ces hypothèses. — Raisons qui démontrent l’antériorité du totem collectif
III. — Théorie récente de Frazer : le totémisme conceptionnel et local. — Pétition de principe sur laquelle elle repose. — Le caractère religieux du totem est nié. — Le totémisme local n’est pas primitif
IV. — Théorie de Lang : le totem ne serait qu’un nom. — Difficultés pour expliquer de ce point de vue le caractère religieux des pratiques totémiques
V. — Toutes ces théories n’expliquent le totémisme qu’en postulent des notions religieuses qui lui seraient antérieures
Chapitre VI
ORIGINES DE CES CROYANCES(suite)
II. — La notion de principe ou mana totémique et l’idée de force
I. — La notion de force ou principe totémique. — Son ubiquité. — Son caractère à la fois physique et moral
II. — Conceptions analogues dans d’autres sociétés inférieures. — Les dieux à Samoa. — Le wakan des Sioux, l’orenda des Iroquois, le mana en Mélanésie. — Rapports de ces notions avec le totémisme. — L’Arùnkulta des Arunta
III. — Antériorité logique de la notion de force impersonnelle sur les différentes personnalités mythiques. — Théories récentes qui tendent à admettre cette antériorité
IV. — La notion de force religieuse est le prototype de la notion de force en général
Chapitre VII
ORIGINES DE CES CROYANCES(fin)
III. — Genèse de la notion de principe ou manu totémique
I. — Le principe totémique est le clan, mais pensé sous des espèces sensibles
II. — Raisons générales pour lesquelles la société est apte à éveiller la sensation du sacré et du divin. — La société comme puissance morale impérative ; la notion d’autorité morale. — La société comme force qui élève l’individu au-dessus de lui-même. — Faits qui prouvent que la société crée du sacré
III. — Raisons spéciales aux sociétés australiennes. — Les deux phases par lesquelles passe alternativement la vie de ces seciétés : dispersion, concentration. — Grande effervescence collective pendant les périodes de concentration. Exemples. Comment l’idée religieuse est née de cette effervescence.Pourquoi la force collective a été pensée sous les espèces du totem : c’est que le totem est l’emblème du clan. — Explication des principales croyances totémiques
IV. — La religion n’est pas un produit de la crainte. — Elle exprime quelque chose de réel. — Son idéalisme essentiel. Cet idéalisme est un caractère général de la mentalité collective. — Explication de l’extériorité des forces religieuses par rapport à leurs substrats. — Du principe la partie vaut le tout
V. — Origine de la notion d’emblème : l’emblématisme, condition nécessaire des représentations collectives. — Pourquoi le clan a emprunté ses emblèmes au règne animal et au règne végétal.
VI. — De l’aptitude du primitif à confondre les règnes et les classes que nous distinguons. — Origines de ces confusions. — Comment elles ont frayé la voie aux explications scientifiques. — Elles n’excluent pas la tendance à la distinction et à l’opposition
Chapitre VIII
LA NOTION D’ÂME
I. — Analyse de l’idée d’âme dans les sociétés australiennes
II. — Genèse de cette notion. — La doctrine de la réincarnation d’après Spencer et Gillen : elle implique que l’âme est une parcelle du principe totémique. — Examen des faits rapportés par Strehlow ; ils confirment la nature totémique de l’âme
III. — Généralité de la doctrine de la réincarnation. — Faits divers à l’appui de la genèse proposée
IV. — L’antithèse de l’âme et du corps : ce qu’elle a d’objectif. — Rapports de l’âme individuelle et de l’âme collective. — L’idée d’âme n’est pas chronologiquement postérieure à l’idée de mana.
V. — Hypothèse pour expliquer la croyance à la survie
VI. — L’idée d’âme et l’idée de personne ; éléments impersonnels de la personnalité
Chapitre IX
LA NOTION D’ESPRITS ET DE DIEUX
I. — Différence entre l’âme et l’esprit. — Les âmes des ancêtres mythiques sont des esprits, ayant des fonctions déterminées. — Rapports entre l’esprit ancestral, l’âme individuelle et le totem individuel. — Explication de ce dernier. — Sa signification sociologique
II. — Les esprits de la magie
III. — Les héros civilisateurs
IV. — Les grands dieux. — Leur origine. — Leur rapport avec l’ensemble du système totémique. — Leur caractère tribal et international
V. — Unité du système totémique
LIVRE III
LES PRINCIPALES ATTITUDES RITUELLES
Chapitre Premier
LE CULTE NÉGATIF ET SES FONCTIONS
LES RITES ASCÉTIQUES
I. — Le système des interdits — Interdits magiques et religieux. Interdits entre choses sacrées d’espèces différentes. Interdits entre sacré et profane. — Ces derniers sont à la base du culte négatif. — Principaux types de ces interdits ; leur réduction à deux types essentiels
II. — L’observance des interdits modifie l’état religieux des individus. — Cas où cette efficacité fut particulièrement apparente : les pratiques ascétiques. — Efficacité religieuse de la douleur. — Fonction sociale de l’ascétisme
III. — Explication du système des interdits : antagonisme du sacré et du profane, contagiosité du sacré
IV. — Causes de cette contagiosité. — Elle ne peut s’expliquer par les lois de l’association des idées. — Elle résulte de l’extériorité des forces religieuses par rapport à leurs substrats. — Intérêt logique de cette propriété des forces religieuses
Chapitre II
LE CULTE POSITIF
I. — Les éléments du sacrifice
La cérémonie de l’Intichiuma dans les tribus de l’Australie centrale. — Formes diverses qu’elle présente
I. — Forme Arunta. — Deux phases. — Analyse de la première : visite aux lieux saints, dispersion de poussière sacrée, effusions de sang, etc., pour assurer la reproduction de l’espèce totémique.
II. — Deuxième phase : consommation rituelle de la plante ou de l’animal totémique
III. — Interprétation de la cérémonie complète. — Le second rite consiste en une communion alimentaire. — Raison de cette communion
IV. — Les rites de la première phase consistent en oblations. — Analogies avec les oblations sacrificielles. — L’Intichiuma contient donc les deux éléments du sacrifice. — Intérêt de ces faits pour la théorie du sacrifice
V. — De la prétendue absurdité des oblations sacrificielles. — Comment elles s’expliquent : dépendance des êtres sacrés par rapport à leurs fidèles. — Explication du cercle dans lequel paraît se mouvoir le sacrifice. — Origine de la périodicité des rites positifs
Chapitre III
LE CULTE POSITIF(suite)
II. — Les rites mimétiques et le principe de causalité
I. — Nature des rites mimétiques. — Exemples de cérémonies où ils sont employés pour assurer la fécondité de l’espèce
II. — Ils reposent sur le principe : le semblable produit le semblable. Examen de l’explication qu’en donne l’école anthropologique. — Raisons qui font qu’on imite l’animal ou la plante. — Raisons qui font attribuer à ces gestes une efficacité physique. — La foi. — En quel sens elle est fondée sur l’expérience. — Les principes de la magie sont nés dans la religion
III. — Le principe précédent considéré comme un des premiers énoncés du principe de causalité. — Conditions sociales dont ce dernier dépend. — L’idée de force impersonnelle, de pouvoir, est d’origine sociale. — La nécessité du jugement causal expliquée par l’autorité inhérente aux impératifs sociaux
Chapitre IV
LE CULTE POSITIF(suite)
II. — Les rites représentatifs ou commémoratifs
I. — Rites représentatifs avec efficacité physique. — Leurs rapports avec les cérémonies antérieurement décrites. — L’action qu’ils produisent est toute morale
II. — Rites représentatifs sans efficacité physique. — Ils confirment les résultats précédents. — L’élément récréatif de la religion ; son importance ; ses raisons d’être. — La notion de fête
III. — Ambiguïté fonctionnelle des différentes cérémonies étudiées ; elles se substituent les unes aux autres. — Comment cette ambiguïté confirme la théorie proposée
Chapitre V
LES RITES PIACULAIRES ET L’AMBIGUÏTÉDE LA NOTION DU SACRÉ
Définition du rite piaculaire
I. — Les rites positifs du deuil. — Description de ces rites.
II. — Comment ils s’expliquent. — Ils ne sont pas une manifestation de sentiments privés. — La méchanceté prêtée à l’âme du mort ne peut pas davantage en rendre compte. — Ils tiennent à l’état d’esprit dans lequel se trouve le groupe. — Analyse de cet état. — Comment il prend fin par le deuil. — Changements parallèles dans la manière dont l’âme du mort est conçue.
III. — Autres rites piaculaires : à la suite d’un deuil public, d’une récolte insuffisante, d’une sécheresse, d’une aurore astrale. — Rareté de ces rites en Australie. — Comment ils s’expliquent.
IV. — Les deux formes du sacré : le pur et l’impur. — Leur antagonisme. — Leur parenté. — Ambiguïté de la notion du sacré. — Explication de cette ambiguïté. — Tous les rites présentent le même caractère
CONCLUSION
Dans quelle mesure les résultats obtenus peuvent être généralisés.
I. — La religion s’appuie sur une expérience bien fondée, mais non privilégiée. Nécessité d’une science pour atteindre la réalité qui fonde cette expérience. Quelle est cette réalité : les groupements humains. — Sens humain de la religion. — De l’objection qui oppose la société idéale et la société réelle. — Comment s’expliquent, dans cette théorie, l’individualisme et le cosmopolitisme religieux.
II. — Ce qu’il y a d’éternel dans la religion. — Du conflit entre la religion et la science ; il porte uniquement sur la fonction spéculative de la religion. — Ce que cette fonction paraît appelée à devenir.
III. — Comment la société peut-elle être une source de pensée logique, c’est-à-dire conceptuelle ? Définition du concept : ne se confond pas avec l’idée générale ; se caractérise par son impersonnalité, sa communicabilité. — Il a une origine collective. L’analyse de son contenu témoigne dans le même sens. — Les représentations collectives comme notions-types auxquelles les individus participent. — De l’objection d’après laquelle elles ne seraient impersonnelles qu’à condition d’être vraies. — La pensée conceptuelle est contemporaine de l’humanité.
IV. — Comment les catégories expriment des choses sociales. — La catégorie par excellence est le concept de totalité qui ne peut être suggéré que par la société. — Pourquoi les relations qu’expriment les catégories ne pouvaient devenir conscientes que dans la société. — La société n’est pas un être alogique. — Comment les catégories tendent à se détacher des groupements géographiques déterminés.Unité de la science, d’une part, de la morale et de la religion de l’autre. — Comment la société rend compte de cette unité. — Explication du rôle attribué à la société : sa puissance créatrice. — Répercussions de la sociologie sur la science de l’homme.
OBJET DE LA RECHERCHESociologie religieuse et théorie de la connaissance
I
Nous nous proposons d’étudier dans ce livre la religion la plus primitive et la plus simple qui soit actuellement connue, d’en faire l’analyse et d’en tenter l’explication. Nous disons d’un système religieux qu’il est le plus primitif qu’il nous soit donné d’observer quand il remplit les deux conditions suivantes : en premier lieu, il faut qu’il se rencontre dans des sociétés dont l’organisation n’est dépassée par aucune autre en simplicité[1] ; il faut de plus qu’il soit possible de l’expliquer sans faire intervenir aucun élément emprunté à une religion antérieure.
Ce système, nous nous efforcerons d’en décrire l’économie avec l’exactitude et la fidélité que pourraient y mettre un ethnographe ou un historien. Mais là ne se bornera pas notre tâche. La sociologie se pose d’autres problèmes que l’histoire ou que l’ethnographie. Elle ne cherche pas à connaître les formes périmées de la civilisation dans le seul but de les connaître et de les reconstituer. Mais, comme toute science positive, elle a, avant tout, pour objet d’expliquer une réalité actuelle, proche de nous, capable, par suite, d’affecter nos idées et nos actes : cette réalité, c’est l’homme et, plus spécialement l’homme d’aujourd’hui, car il n’en est pas que nous soyons plus intéressés à bien connaître. Nous n’étudierons donc pas la religion très archaïque dont il va être question pour le seul plaisir d’en raconter les bizarreries et les singularités. Si nous l’avons prise comme objet de notre recherche, c’est qu’elle nous a paru plus apte que toute autre à faire comprendre la nature religieuse de l’homme, c’est-à-dire à nous révéler un aspect essentiel et permanent de l’humanité.
Mais cette proposition ne va pas sans soulever de vives objections. On trouve étrange que, pour arriver à connaître l’humanité présente, il faille commencer par s’en détourner pour se transporter aux débuts de l’histoire. Cette manière de procéder apparaît comme particulièrement paradoxale dans la question qui nous occupe. Les religions passent, en effet, pour avoir une valeur et une dignité inégales ; on dit généralement qu’elles ne contiennent pas toutes la même part de vérité. Il semble donc qu’on ne puisse comparer les formes les plus hautes de la pensée religieuse aux plus basses sans rabaisser les premières au niveau des secondes. Admettre que les cultes grossiers des tribus australiennes peuvent nous aider à comprendre le christianisme, par exemple, n’est-ce pas supposer que celui-ci procède de la même mentalité, c’est-à-dire qu’il est fait des mêmes superstitions et repose sur les mêmes erreurs ? Voilà comment l’importance théorique, qui a été parfois attribuée aux religions primitives, a pu passer pour l’indice d’une irréligiosité systématique qui, en préjugeant les résultats de la recherche, les viciait par avance.
Nous n’avons pas à rechercher ici s’il s’est réellement rencontré des savants qui ont mérité ce reproche et qui ont fait de l’histoire et de l’ethnographie religieuse une machine de guerre contre la religion. En tout cas, tel ne saurait être le point de vue d’un sociologue. C’est, en effet, un postulat essentiel de la sociologie qu’une institution humaine ne saurait reposer sur l’erreur et sur le mensonge : sans quoi elle n’aurait pu durer. Si elle n’était pas fondée dans la nature des choses, elle aurait rencontré dans les choses des résistances dont elle n’aurait pu triompher. Quand donc nous abordons l’étude des religions primitives, c’est avec l’assurance qu’elles tiennent au réel et qu’elles l’expriment ; on verra ce principe revenir sans cesse au cours des analyses et des discussions qui vont suivre, et ce que nous reprocherons aux écoles dont nous nous séparerons, c’est précisément de l’avoir méconnu. Sans doute, quand on ne considère que la lettre des formules, ces croyances et ces pratiques religieuses paraissent parfois déconcertantes et l’on peut être tenté de les attribuer à une sorte d’aberration foncière. Mais, sous le symbole, il faut savoir atteindre la réalité qu’il figure et qui lui donne sa signification véritable. Les rites les plus barbares ou les plus bizarres, les mythes les plus étranges traduisent quelque besoin humain, quelque aspect de la vie soit individuelle soit sociale. Les raisons que le fidèle se donne à lui-même pour les justifier peuvent être, et sont même le plus souvent, erronées ; les raisons vraies ne laissent pas d’exister ; c’est affaire à la science de les découvrir.
Il n’y a donc pas, au fond, de religions qui soient fausses. Toutes sont vraies à leur façon : toutes répondent, quoique de manières différentes, à des conditions données de l’existence humaine. Sans doute, il n’est pas impossible de les disposer suivant un ordre hiérarchique. Les unes peuvent être dites supérieures aux autres en ce sens qu’elles mettent en jeu des fonctions mentales plus élevées, qu’elles sont plus riches d’idées et de sentiments, qu’il y entre plus de concepts, moins de sensations et d’images, et que la systématisation en est plus savante. Mais, si réelles que soient cette complexité plus grande et cette plus haute idéalité elles ne suffisent pas à ranger les religions correspondantes en des genres séparés. Toutes sont également des religions, comme tous les êtres vivants sont également des vivants, depuis les plus humbles plastides jusqu’à l’homme. Si donc nous nous adressons aux religions primitives, ce n’est pas avec l’arrière-pensée de déprécier la religion d’une manière générale ; car ces religions-là ne sont pas moins respectables que les autres. Elles répondent aux mêmes nécessités, elles jouent le même rôle, elles dépendent des mêmes causes ; elles peuvent donc tout aussi bien servir à manifester la nature de la vie religieuse et, par conséquent, à résoudre le problème que nous désirons traiter.
Mais pourquoi leur accorder une sorte de prérogative ? Pourquoi les choisir de préférence à toutes autres comme objet de notre étude ? — C’est uniquement pour des raisons de méthode.
Tout d’abord, nous ne pouvons arriver à comprendre les religions les plus récentes qu’en suivant dans l’histoire la manière dont elles se sont progressivement composées. L’histoire est, en effet, la seule méthode d’analyse explicative qu’il soit possible de leur appliquer. Seule, elle nous permet de résoudre une institution en ses éléments constitutifs, puisqu’elle nous les montre naissant dans le temps les uns après les autres. D’autre part, en situant chacun d’eux dans l’ensemble de circonstances où il a pris naissance, elle nous met en mains le seul moyen que nous ayons de déterminer les causes qui l’ont suscité. Toutes les fois donc qu’on entreprend d’expliquer une chose humaine, prise à un moment déterminé du temps — qu’il s’agisse d’une croyance religieuse, d’une règle morale, d’un précepte juridique, d’une technique esthétique, d’un régime économique — il faut commencer par remonter jusqu’à sa forme la plus primitive et la plus simple, chercher à rendre compte des caractères par lesquels elle se définit à cette période de son existence, puis faire voir comment elle s’est peu à peu développée et compliquée, comment elle est devenue ce qu’elle est au moment considéré. Or, on conçoit sans peine de quelle importance est, pour cette série d’explications progressives, la détermination du point de départ auquel elles sont suspendues. C’était un principe cartésien que, dans la chaîne des vérités scientifiques, le premier anneau joue un rôle prépondérant. Certes, il ne saurait être question de placer à la base de la science des religions une notion élaborée à la manière cartésienne, c’est-à-dire un concept logique, un pur possible, construit par les seules forces de l’esprit. Ce qu’il nous faut trouver, c’est une réalité concrète que, seule, l’observation historique et ethnographique peut nous révéler. Mais si cette conception cardinale doit être obtenue par des procédés différents, il reste vrai qu’elle est appelée à avoir, sur toute la suite des propositions qu’établit la science, une influence considérable. L’évolution biologique a été conçue tout autrement à partir du moment où l’on a su qu’il existait des êtres monocellulaires. De même, le détail des faits religieux est expliqué différemment, suivant qu’on met à l’origine de l’évolution le naturisme, l’animisme ou telle autre forme religieuse. Même les savants les plus spécialisés, s’ils n’entendent pas se borner à une tâche de pure érudition, s’ils veulent essayer de se rendre compte des faits qu’ils analysent, sont obligés de choisir telle ou telle de ces hypothèses et de s’en inspirer. Qu’ils le veuillent ou non, les questions qu’ils se posent prennent nécessairement la forme suivante : comment le naturisme ou l’animisme ont-ils été déterminés à prendre, ici ou là, tel aspect particulier, à s’enrichir ou à s’appauvrir de telle ou telle façon ? Puisque donc on ne peut éviter de prendre un parti sur ce problème initial et puisque la solution qu’on en donne est destinée à affecter l’ensemble de la science, il convient de l’aborder de front ; c’est ce que nous nous proposons de faire.
D’ailleurs, en dehors même de ces répercussions indirectes, l’étude des religions primitives a, par elle-même, un intérêt immédiat qui est de première importance.
Si, en effet, il est utile de savoir en quoi consiste telle ou telle religion particulière, il importe davantage encore de rechercher ce que c’est que la religion d’une manière générale. C’est ce problème qui, de tout temps, a tenté la curiosité des philosophes, et non sans raison ; car il intéresse l’humanité tout entière. Malheureusement, la méthode qu’ils emploient d’ordinaire pour le résoudre est purement dialectique : ils se bornent à analyser l’idée qu’ils se font de la religion, sauf à illustrer les résultats de cette analyse mentale par des exemples empruntés aux religions qui réalisent le mieux leur idéal. Mais si cette méthode doit être abandonnée, le problème reste tout entier et le grand service qu’a rendu la philosophie est d’empêcher qu’il n’ait été prescrit par le dédain des érudits. Or il peut être repris par d’autres voies. Puisque toutes les religions sont comparables, puisqu’elles sont toutes des espèces d’un même genre, il y a nécessairement des éléments essentiels qui leur sont communs. Par là, nous n’entendons pas simplement parler des caractères extérieurs et visibles qu’elles présentent toutes également et qui permettent d’en donner, dès le début de la recherche, une définition provisoire ; la découverte de ces signes apparents est relativement facile, car l’observation qu’elle exige n’a pas à dépasser la surface des choses. Mais ces ressemblances extérieures en supposent d’autres qui sont profondes. À la base de tous les systèmes de croyances et de tous les cultes, il doit nécessairement y avoir un certain nombre de représentations fondamentales et d’attitudes rituelles qui, malgré la diversité des formes que les unes et les autres ont pu revêtir, ont partout la même signification objective et remplissent partout les mêmes fonctions. Ce sont ces éléments permanents qui constituent ce qu’il y a d’éternel et d’humain dans la religion ; ils sont tout le contenu objectif de l’idée que l’on exprime quand on parle de la religion en général. Comment donc est-il possible d’arriver à les atteindre ?
Ce n’est certainement pas en observant les religions complexes qui apparaissent dans la suite de l’histoire. Chacune d’elles est formée d’une telle variété d’éléments qu’il est bien difficile d’y distinguer le secondaire du principal et l’essentiel de l’accessoire. Que l’on considère des religions comme celles de l’Égypte, de l’Inde ou de l’antiquité classique ! C’est un enchevêtrement touffu de cultes multiples, variables avec les localités, avec les temples, avec les générations, les dynasties, les invasions, etc. Les superstitions populaires y sont mêlées aux dogmes les plus raffinés. Ni la pensée ni l’activité religieuse ne sont également réparties dans la masse des fidèles ; suivant les hommes, les milieux, les circonstances, les croyances comme les rites sont ressentis de façons différentes. Ici, ce sont des prêtres, là, des moines, ailleurs, des laïcs ; il y a des mystiques et des rationalistes, des théologiens et des prophètes, etc. Dans ces conditions, il est difficile d’apercevoir ce qui est commun à tous. On peut bien trouver le moyen d’étudier utilement, à travers l’un ou l’autre de ces systèmes, tel ou tel fait particulier qui s’y trouve spécialement développé, comme le sacrifice ou le prophétisme, le monachisme ou les mystères ; mais comment découvrir le fond commun de la vie religieuse sous la luxuriante végétation qui le recouvre ? Comment, sous le heurt des théologies, les variations des rituels, la multiplicité des groupements, la diversité des individus, retrouver les états fondamentaux, caractéristiques de la mentalité religieuse en général ?
Il en va tout autrement dans les sociétés inférieures. Le moindre développement des individualités, l’étendue plus faible du groupe, l’homogénéité des circonstances extérieures, tout contribue à réduire les différences et les variations au minimum. Le groupe réalise, d’une manière régulière, une uniformité intellectuelle et morale dont nous ne trouvons que de rares exemples dans les sociétés plus avancées. Tout est commun à tous. Les mouvements sont stéréotypés ; tout le monde exécute les mêmes dans les mêmes circonstances et ce conformisme de la conduite ne fait que traduire celui de la pensée. Toutes les consciences étant entraînées dans les mêmes remous, le type individuel se confond presque avec le type générique. En même temps que tout est uniforme, tout est simple. Rien n’est fruste comme ces mythes composés d’un seul et même thème qui se répète sans fin, comme ces rites qui sont faits d’un petit nombre de gestes recommencés à satiété. L’imagination populaire ou sacerdotale n’a encore eu ni le temps ni les moyens de raffiner et de transformer la matière première des idées et des pratiques religieuses ; celle-ci se montre donc à nu et s’offre d’elle-même à l’observation qui n’a qu’un moindre effort à faire pour la découvrir. L’accessoire, le secondaire, les développements de luxe ne sont pas encore venus cacher le principal[2]. Tout est réduit à l’indispensable, à ce sans quoi il ne saurait y avoir de religion. Mais l’indispensable, c’est aussi l’essentiel, c’est-à-dire ce qu’il nous importe avant tout de connaître.
Les civilisations primitives constituent donc des cas privilégiés, parce que ce sont des cas simples. Voilà pourquoi, dans tous les ordres de faits, les observations des ethnographes ont été souvent de véritables révélations qui ont rénové l’étude des institutions humaines. Par exemple, avant le milieu du xixe siècle, on était convaincu que le père était l’élément essentiel de la famille ; on ne concevait même pas qu’il pût y avoir une organisation familiale dont le pouvoir paternel ne fût pas la clef de voûte. La découverte de Bachofen est venue renverser cette vielle conception. Jusqu’à des temps tout récents, on considérait comme évident que les relations morales et juridiques qui constituent la parenté n’étaient qu’un autre aspect des relations physiologiques qui résultent de la communauté de descendance ; Bachofen et ses successeurs, Mac Lennan, Morgan et bien d’autres, étaient encore placés sous l’influence de ce préjugé. Depuis que nous connaissons la nature du clan primitif, nous savons, au contraire, que la parenté ne saurait se définir par la consanguinité. Pour en revenir aux religions, la seule considération des formes religieuses qui nous sont le plus familières a fait croire pendant longtemps que la notion de dieu était caractéristique de tout ce qui est religieux. Or, la religion que nous étudions plus loin est, en grande partie, étrangère à toute idée de divinité ; les forces auxquelles s’adressent les rites y sont très différentes de celles qui tiennent la première place dans nos religions modernes, et pourtant elles nous aideront à mieux comprendre ces dernières. Rien donc n’est plus injuste que le dédain où trop d’historiens tiennent encore les travaux des ethnographes. Il est certain, au contraire, que l’ethnographie a très souvent déterminé, dans les différentes branches de la sociologie, les plus fécondes révolutions. C’est, d’ailleurs, pour la même raison que la découverte des êtres monocellulaires, dont nous parlions tout à l’heure, a transformé l’idée qu’on se faisait couramment de la vie. Comme, chez ces êtres très simples, la vie est réduite à ses traits essentiels, ceux-ci peuvent être plus difficilement méconnus.
Mais les religions primitives ne permettent pas seulement de dégager les éléments constitutifs de la religion ; elles ont aussi ce très grand avantage qu’elles en facilitent l’explication. Parce que les faits y sont plus simples, les rapports entre les faits y sont aussi plus apparents. Les raisons par lesquelles les hommes s’expliquent leurs actes n’ont pas encore été élaborées et dénaturées par une réflexion savante ; elles sont plus proches, plus parentes des mobiles qui ont réellement déterminé ces actes. Pour bien comprendre un délire et pour pouvoir lui appliquer le traitement le plus approprié, le médecin a besoin de savoir quel en a été le point de départ. Or cet événement est d’autant plus facile à discerner qu’on peut observer ce délire à une période plus proche de ses débuts. Au contraire, plus on laisse à la maladie le temps de se développer, plus il se dérobe à l’observation ; c’est que, chemin faisant, toute sorte d’interprétations sont intervenues qui tendent à refouler dans l’inconscient l’état originel et à le remplacer par d’autres à travers lesquels il est parfois malaisé de retrouver le premier. Entre un délire systématisé et les impressions premières qui lui ont donné naissance, la distance est souvent considérable. Il en est de même pour la pensée religieuse. À mesure qu’elle progresse dans l’histoire, les causes qui l’ont appelée à l’existence, tout en restant toujours agissantes, ne sont plus aperçues qu’à travers un vaste système d’interprétations qui les déforment. Les mythologies populaires et les subtiles théologies ont fait leur œuvre : elles ont superposé aux sentiments primitifs des sentiments très différents qui, tout en tenant aux premiers dont ils sont la forme élaborée, n’en laissent pourtant transpirer que très imparfaitement la nature véritable. La distance psychologique entre la cause et l’effet, entre la cause apparente et la cause effective, est devenue plus considérable et plus difficile à parcourir pour l’esprit. La suite de cet ouvrage sera une illustration et une vérification de cette remarque méthodologique. On y verra comment, dans les religions primitives, le fait religieux porte encore visible l’empreinte de ses origines : il nous eût été bien plus malaisé de les inférer d’après la seule considération des religions plus développées.
L’étude que nous entreprenons est donc une manière de reprendre, mais dans des conditions nouvelles, le vieux problème de l’origine des religions. Certes, si, par origine, on entend un premier commencement absolu, la question n’a rien de scientifique et doit être résolument écartée. Il n’y a pas un instant radical où la religion ait commencé à exister et il ne s’agit pas de trouver un biais qui nous permette de nous y transporter par la pensée. Comme toute institution humaine, la religion ne commence nulle part. Aussi toutes les spéculations de ce genre sont-elles justement discréditées ; elles ne peuvent consister qu’en constructions subjectives et arbitraires qui ne comportent de contrôle d’aucune sorte. Tout autre est le problème que nous nous posons. Ce que nous voudrions, c’est trouver un moyen de discerner les causes, toujours présentes, dont dépendent les formes les plus essentielles de la pensée et de la pratique religieuse. Or, pour les raisons qui viennent d’être exposées, ces causes sont d’autant plus facilement observables que les sociétés où on les observe sont moins compliquées. Voilà pourquoi nous cherchons à nous rapprocher des origines[3]. Ce n’est pas que nous entendions prêter aux religions inférieures des vertus particulières. Elles sont, au contraire, rudimentaires et grossières ; il ne saurait donc être question d’en faire des sortes de modèles que les religions ultérieures n’auraient eu qu’à reproduire. Mais leur grossièreté même les rend instructives ; car elles se trouvent constituer ainsi des expériences commodes où les faits et leurs relations sont plus faciles à apercevoir. Le physicien, pour découvrir les lois des phénomènes qu’il étudie, cherche à simplifier ces derniers, à les débarrasser de leurs caractères secondaires. Pour ce qui concerne les institutions, la nature fait spontanément des simplifications du même genre au début de l’histoire. Nous voulons seulement les mettre à profit. Et sans doute, nous ne pourrons atteindre par cette méthode que des faits très élémentaires. Quand nous en aurons rendu compte, dans la mesure où ce nous sera possible, les nouveautés de toute sorte qui se sont produites dans la suite de l’évolution ne seront pas expliquées pour cela. Mais si nous ne songeons pas à nier l’importance des problèmes qu’elles posent, nous estimons qu’ils gagnent à être traités à leur heure et qu’il y a intérêt à ne les aborder qu’après ceux dont nous allons entreprendre l’étude.
II
Mais notre recherche n’intéresse pas seulement la science des religions. Toute religion, en effet, a un côté par où elle dépasse le cercle des idées proprement religieuses et, par là, l’étude des phénomènes religieux fournit un moyen de renouveler des problèmes qui, jusqu’à présent, n’ont été débattus qu’entre philosophes.
On sait depuis longtemps que les premiers systèmes de représentations que l’homme s’est fait du monde et de lui-même sont d’origine religieuse. Il n’est pas de religion qui ne soit une cosmologie en même temps qu’une spéculation sur le divin. Si la philosophie et les sciences sont nées de la religion, c’est que la religion elle-même a commencé par tenir lieu de sciences et de philosophie. Mais ce qui a été moins remarqué, c’est qu’elle ne s’est pas bornée à enrichir d’un certain nombre d’idées un esprit humain préalablement formé ; elle a contribué à le former lui-même. Les hommes ne lui ont pas dû seulement, pour une part notable, la matière de leurs connaissances, mais aussi la forme suivant laquelle ces connaissances sont élaborées.
Il existe, à la racine de nos jugements, un certain nombre de notions essentielles qui dominent toute notre vie intellectuelle ; ce sont celles que les philosophes, depuis Aristote, appellent les catégories de l’entendement : notions de temps, d’espace[4], de genre, de nombre, de cause, de substance, de personnalité, etc. Elles correspondent aux propriétés les plus universelles des choses. Elles sont comme les cadres solides qui enserrent la pensée ; celle-ci ne paraît pas pouvoir s’en affranchir sans se détruire, car il ne semble pas que nous puissions penser des objets qui ne soient pas dans le temps ou dans l’espace, qui ne soient pas nombrables, etc. Les autres notions sont contingentes et mobiles ; nous concevons qu’elles puissent manquer à un homme, à une société, à une époque ; celles-là nous paraissent presque inséparables du fonctionnement normal de l’esprit. Elles sont comme l’ossature de l’intelligence. Or, quand on analyse méthodiquement les croyances religieuses primitives, on rencontre naturellement sur son chemin les principales d’entre ces catégories. Elles sont nées dans la religion et de la religion ; elles sont un produit de la pensée religieuse. C’est une constatation que nous aurons plusieurs fois à faire dans le cours de cet ouvrage.
Cette remarque a déjà quelque intérêt par elle-même ; mais voici ce qui lui donne sa véritable portée.
La conclusion générale du livre qu’on va lire, c’est que la religion est une chose éminemment sociale. Les représentations religieuses sont des représentations collectives qui expriment des réalités collectives ; les rites sont des manières d’agir qui ne prennent naissance qu’au sein des groupes assemblés et qui sont destinés à susciter, à entretenir ou à refaire certains états mentaux de ces groupes. Mais alors, si les catégories sont d’origine religieuse, elles doivent participer de la nature commune à tous les faits religieux : elles doivent être, elles aussi, des choses sociales, des produits de la pensée collective. Tout au moins — car, dans l’état actuel de nos connaissances en ces matières, on doit se garder de toute thèse radicale et exclusive — il est légitime de supposer qu’elles sont riches en éléments sociaux.
C’est, d’ailleurs, ce qu’on peut, dès à présent, entrevoir pour certaines d’entre elles. Qu’on essaie, par exemple, de se représenter ce que serait la notion du temps, abstraction faite des procédés par lesquels nous le divisons, le mesurons, l’exprimons au moyen de signes objectifs, un temps qui ne serait pas une succession d’années, de mois, de semaines, de jours, d’heures ! Ce serait quelque chose d’à peu près impensable. Nous ne pouvons concevoir le temps qu’à condition d’y distinguer des moments différents. Or quelle est l’origine de cette différenciation ? Sans doute, les états de conscience que nous avons déjà éprouvés peuvent se reproduire en nous, dans l’ordre même où ils se sont primitivement déroulés ; et ainsi des portions de notre passé nous redeviennent présentes, tout en se distinguant spontanément du présent. Mais, si importante que soit cette distinction pour notre expérience privée, il s’en faut qu’elle suffise à constituer la notion ou catégorie de temps. Celle-ci ne consiste pas simplement dans une commémoration, partielle ou intégrale, de notre vie écoulée. C’est un cadre abstrait et impersonnel qui enveloppe non seulement notre existence individuelle, mais celle de l’humanité. C’est comme un tableau illimité où toute la durée est étalée sous le regard de l’esprit et où tous les événements possibles peuvent être situés par rapport à des points de repères fixes et déterminés. Ce n’est pas mon temps qui est ainsi organisé ; c’est le temps tel qu’il est objectivement pensé par tous les hommes d’une même civilisation. Cela seul suffit déjà à faire entrevoir qu’une telle organisation doit être collective. Et, en effet, l’observation établit que ces points de repère indispensables par rapport auxquels toutes choses sont classées temporellement, sont empruntés à la vie sociale. Les divisions en jours, semaines, mois, années, etc., correspondent à la périodicité des rites, des fêtes, des cérémonies publiques[5]. Un calendrier exprime le rythme de l’activité collective en même temps qu’il a pour fonction d’en assurer la régularité[6].
Il en est de même de l’espace. Comme l’a démontré Hamelin[7], l’espace n’est pas ce milieu vague et indéterminé qu’avait imaginé Kant : purement et absolument homogène, il ne servirait à rien et n’offrirait même pas de prise à la pensée. La représentation spatiale consiste essentiellement dans une première coordination introduite entre les données de l’expérience sensible. Mais cette coordination serait impossible si les parties de l’espace s’équivalaient qualitativement, si elles étaient réellement substituables les unes aux autres. Pour pouvoir disposer spatialement les choses, il faut pouvoir les situer différemment : mettre les unes à droite, les autres à gauche, celles-ci en haut, celles-là en bas, au nord ou au sud, à l’est ou à l’ouest, etc. etc., de même que, pour pouvoir disposer temporellement les états de la conscience, il faut pouvoir les localiser à des dates déterminées. C’est dire que l’espace ne saurait être lui-même si, tout comme le temps, il n’était divisé et différencié. Mais ces divisions, qui lui sont essentielles, d’où lui viennent-elles ? Par lui-même, il n’a ni droite ni gauche, ni haut ni bas, ni nord ni sud, etc. Toutes ces distinctions viennent évidemment de ce que des valeurs affectives différentes ont été attribuées aux régions. Et comme tous les hommes d’une même civilisation se représentent l’espace de la même manière, il faut évidemment que ces valeurs affectives et les distinctions qui en dépendent leur soient également communes ; ce qui implique presque nécessairement qu’elles sont d’origine sociale[8].
Il y a, d’ailleurs, des cas où ce caractère social est rendu manifeste. Il existe des sociétés en Australie et dans l’Amérique du Nord où l’espace est conçu sous la forme d’un cercle immense, parce que le camp a lui-même une forme circulaire[9], et le cercle spatial est exactement divisé comme le cercle tribal et à l’image de ce dernier. Il y a autant de régions distinguées qu’il y a de clans dans la tribu et c’est la place occupée par les clans à l’intérieur du campement qui détermine l’orientation des régions. Chaque région se définit par le totem du clan auquel elle est assignée. Chez les Zuñi, par exemple, le pueblo comprend sept quartiers ; chacun de ces quartiers est un groupe de clans qui a eu son unité : selon toute probabilité, c’était primitivement un clan unique qui s’est ensuite subdivisé. Or l’espace comprend également sept régions et chacun de ces sept quartiers du monde est en relations intimes avec un quartier du pueblo, c’est-à-dire avec un groupe de clans[10]. « Ainsi, dit Cushing, une division est censée être en rapport avec le nord ; une autre représente l’ouest, une autre le sud[11], etc. « Chaque quartier du pueblo a sa couleur caractéristique qui le symbolise ; chaque région a la sienne qui est exactement celle du quartier correspondant. Au cours de l’histoire, le nombre des clans fondamentaux a varié ; le nombre des régions de l’espace a varié de la même manière. Ainsi, l’organisation sociale a été le modèle de l’organisation spatiale qui est comme un décalque de la première. Il n’y a pas jusqu’à la distinction de la droite et de la gauche qui, loin d’être impliquée dans la nature de l’homme en général, ne soit très vraisemblablement le produit de représentations religieuses, partant collectives[12].
On trouvera plus loin des preuves analogues relatives aux notions de genre, de force, de personnalité, d’efficacité. On peut même se demander si la notion de contradiction ne dépend pas, elle aussi, de conditions sociales. Ce qui tend à le faire croire, c’est que l’empire qu’elle a exercé sur la pensée a varié suivant les temps et les sociétés. Le principe d’identité domine aujourd’hui la pensée scientifique ; mais il y a de vastes systèmes de représentations qui ont joué dans l’histoire des idées un rôle considérable et où il est fréquemment méconnu : ce sont les mythologies, depuis les plus grossières jusqu’aux plus savantes[13]. Il y est, sans cesse, question d’êtres qui ont simultanément les attributs les plus contradictoires, qui sont à la fois uns et plusieurs, matériels et spirituels, qui peuvent se subdiviser indéfiniment sans rien perdre de ce qui les constitue ; c’est, en mythologie, un axiome que la partie vaut le tout. Ces variations par lesquelles a passé dans l’histoire la règle qui semble gouverner notre logique actuelle prouvent que, loin d’être inscrite de toute éternité dans la constitution mentale de l’homme, elle dépend, au moins en partie, de facteurs historiques, par conséquent sociaux. Nous ne savons pas exactement quels ils sont ; mais nous pouvons présumer qu’ils existent[14]
Cette hypothèse une fois admise, le problème de la connaissance se pose dans des termes nouveaux.
Jusqu’à présent, deux doctrines seulement étaient en présence. Pour les uns, les catégories ne peuvent être dérivées de l’expérience : elles lui sont logiquement antérieures et la conditionnent. On se les représente comme autant de données simples, irréductibles, immanentes à l’esprit humain en vertu de sa constitution native. C’est pourquoi on dit d’elles qu’elles sont a priori. Pour les autres, au contraire, elles seraient construites, faites de pièces et de morceaux, et c’est l’individu qui serait l’ouvrier de cette construction[15].
Mais l’une et l’autre solution soulèvent de graves difficultés.
Adopte-t-on la thèse empiriste ? Alors, il faut retirer aux catégories toutes leurs propriétés caractéristiques. Elles se distinguent, en effet, de toutes les autres connaissances par leur universalité et leur nécessité. Elles sont les concepts les plus généraux qui soient puisqu’elles s’appliquent à tout le réel, et, de même qu’elles ne sont attachées à aucun objet particulier, elles sont indépendantes de tout sujet individuel : elles sont le lieu commun où se rencontrent tous les esprits. De plus, ils s’y rencontrent nécessairement ; car la raison, qui n’est autre chose que l’ensemble des catégories fondamentales, est investie d’une autorité à laquelle nous ne pouvons nous dérober à volonté. Quand nous essayons de nous insurger contre elle, de nous affranchir de quelques-unes de ces notions essentielles, nous nous heurtons à de vives résistances. Non seulement donc elles ne dépendent pas de nous, mais elles s’imposent à nous. — Or les données empiriques présentent des caractères diamétralement opposés. Une sensation, une image se rapportent toujours à un objet déterminé ou à une collection d’objets de ce genre et elle exprime l’état momentané d’une conscience particulière : elle est essentiellement individuelle et subjective. Aussi pouvons-nous disposer, avec une liberté relative, des représentations qui ont cette origine. Sans doute, quand nos sensations sont actuelles, elles s’imposent à nous en fait. Mais, en droit, nous restons maîtres de les concevoir autrement qu’elles ne sont, de nous les représenter comme se déroulant dans un ordre différent de celui où elles se sont produites. Vis-à-vis d’elles, rien ne nous lie, tant que des considérations d’un autre genre n’interviennent pas. Voilà donc deux sortes de connaissances qui sont comme aux deux pôles contraires de l’intelligence. Dans ces conditions, ramener la raison à l’expérience, c’est la faire évanouir car c’est réduire l’universalité et la nécessité qui la caractérisent à n’être que de pures apparences, des illusions qui peuvent être pratiquement commodes, mais qui ne correspondent à rien dans les choses : c’est, par conséquent, refuser toute réalité objective à la vie logique que les catégories ont pour fonction de régler et d’organiser. L’empirisme classique aboutit à l’irrationalisme ; peut-être même est-ce par ce dernier nom qu’il conviendrait de le désigner.
Les aprioristes, malgré le sens ordinairement attaché aux étiquettes, sont plus respectueux des faits. Parce qu’ils n’admettent pas comme une vérité d’évidence que les catégories sont faites des mêmes éléments que nos représentations sensibles, ils ne sont pas obligés de les appauvrir systématiquement, de les vider de tout contenu réel, de les réduire à n’être que des artifices verbaux. Ils leur laissent, au contraire, tous leurs caractères spécifiques. Les aprioristes sont des rationalistes ; ils croient que le monde a un aspect logique que la raison exprime éminemment. Mais pour cela, il leur faut attribuer à l’esprit un certain pouvoir de dépasser l’expérience, d’ajouter à ce qui lui est immédiatement donné ; or, de ce pouvoir singulier, ils ne donnent ni explication ni justification. Car ce n’est pas l’expliquer que se borner à dire qu’il est inhérent à la nature de l’intelligence humaine. Encore faudrait-il faire entrevoir d’où nous tenons cette surprenante prérogative et comment nous pouvons voir, dans les choses, des rapports que le spectacle des choses ne saurait nous révéler. Dire que l’expérience elle-même n’est possible qu’à cette condition, c’est peut-être déplacer le problème ; ce n’est pas le résoudre. Car il s’agit précisément de savoir d’où vient que l’expérience ne se suffit pas, mais suppose des conditions qui lui sont extérieures et antérieures, et comment il se fait que ces conditions sont réalisées quand et comme il convient. Pour répondre à ces questions, on a parfois imaginé, par-dessus les raisons individuelles, une raison supérieure et parfaite dont les premières émaneraient et de qui elles tiendraient par une sorte de participation mystique, leur merveilleuse faculté : c’est la raison divine. Mais cette hypothèse a, tout au moins, le grave inconvénient d’être soustraite à tout contrôle expérimental ; elle ne satisfait donc pas aux conditions exigibles d’une hypothèse scientifique. De plus, les catégories de la pensée humaine ne sont jamais fixées sous une forme définie ; elles se font, se défont, se refont sans cesse ; elles changent suivant les lieux et les temps. La raison divine est, au contraire, immuable. Comment cette immutabilité pourrait-elle rendre compte de cette incessante variabilité ?
Telles sont les deux conceptions qui se heurtent l’une contre l’autre depuis des siècles ; et, si le débat s’éternise, c’est qu’en vérité les arguments échangés s’équivalent sensiblement. Si la raison n’est qu’une forme de l’expérience individuelle, il n’y a plus de raison. D’autre part, si on lui reconnaît les pouvoirs qu’elle s’attribue, mais sans en rendre compte, il semble qu’on la mette en dehors de la nature et de la science. En présence de ces objections opposées, l’esprit reste incertain. — Mais si l’on admet l’origine sociale des catégories, une nouvelle attitude devient possible qui permettrait, croyons-nous, d’échapper à ces difficultés contraires.
La proposition fondamentale de l’apriorisme, c’est que la connaissance est formée de deux sortes d’éléments irréductibles l’un à l’autre et comme de deux couches distinctes et superposées[16]. Notre hypothèse maintient intégralement ce principe. En effet, les connaissances que l’on appelle empiriques, les seules dont les théoriciens de l’empirisme se soient jamais servis pour construire la raison, sont celles que l’action directe des objets suscite dans nos esprits. Ce sont donc des états individuels, qui s’expliquent tout entiers[17] par la nature psychique de l’individu. Au contraire, si, comme nous le pensons, les catégories sont des représentations essentiellement collectives, elles traduisent avant tout des états de la collectivité : elles dépendent de la manière dont celle-ci est constituée et organisée, de sa morphologie, de ses institutions religieuses, morales, économiques, etc. Il y a donc entre ces deux espèces de représentations toute la distance qui sépare l’individuel du social, et on ne peut pas plus dériver les secondes des premières qu’on ne peut déduire la société de l’individu, le tout de la partie, le complexe du simple[18]. La société est une réalité sui generis ; elle a ses caractères propres qu’on ne retrouve pas, ou qu’on ne retrouve pas sous la même forme, dans le reste de l’univers. Les représentations qui l’expriment ont donc un tout autre contenu que les représentations purement individuelles et l’on peut être assuré par avance que les premières ajoutent quelque chose aux secondes.
La manière même dont se forment les unes et les autres achève de les différencier. Les représentations collectives sont le produit d’une immense coopération qui s’étend non seulement dans l’espace, mais dans le temps ; pour les faire, une multitude d’esprits divers ont associé, mêlé, combiné leurs idées et leurs sentiments ; de longues séries de générations y ont accumulé leur expérience et leur savoir. Une intellectualité très particulière, infiniment plus riche et plus complexe que celle de l’individu, y est donc comme concentrée. On comprend dès lors comment la raison a le pouvoir de dépasser la portée des connaissances empiriques. Elle ne le doit pas à je ne sais quelle vertu mystérieuse, mais simplement à ce fait que, suivant une formule connue, l’homme est double. En lui, il y a deux êtres : un être individuel qui a sa base dans l’organisme et dont le cercle d’action se trouve, par cela même, étroitement limité, et un être social qui représente en nous la plus haute réalité, dans l’ordre intellectuel et moral, que nous puissions connaître par l’observation, j’entends la société. Cette dualité de notre nature a pour conséquence, dans l’ordre pratique, l’irréductibilité de l’idéal moral au mobile utilitaire, et, dans l’ordre de la pensée, l’irréductibilité de la raison à l’expérience individuelle. Dans la mesure où il participe de la société, l’individu se dépasse naturellement lui-même, aussi bien quand il pense que quand il agit.
Ce même caractère social permet de comprendre d’où vient la nécessité des catégories. On dit d’une idée qu’elle est nécessaire quand, par une sorte de vertu interne, elle s’impose à l’esprit sans être accompagnée d’aucune preuve. Il y a donc en elle quelque chose qui contraint l’intelligence, qui emporte l’adhésion, sans examen préalable. Cette efficacité singulière, l’apriorisme la postule, mais n’en rend pas compte ; car dire que les catégories sont nécessaires parce qu’elles sont indispensables au fonctionnement de la pensée, c’est simplement répéter qu’elles sont nécessaires. Mais si elles ont l’origine que nous leur avons attribuée, leur ascendant n’a plus rien qui surprenne. En effet, elles expriment les rapports les plus généraux qui existent entre les choses ; dépassant en extension toutes nos autres notions, elles dominent tout le détail de notre vie intellectuelle. Si donc, à chaque moment du temps, les hommes ne s’entendaient pas sur ces idées essentielles, s’ils n’avaient pas une conception homogène du temps, de l’espace, de la cause, du nombre, etc., tout accord deviendrait impossible entre les intelligences et, par suite, toute vie commune. Aussi la société ne peut-elle abandonner les catégories au libre arbitre des particuliers sans s’abandonner elle-même. Pour pouvoir vivre, elle n’a pas seulement besoin d’un suffisant conformisme moral ; il y a un minimum de conformisme logique dont elle ne peut davantage se passer. Pour cette raison, elle pèse de toute son autorité sur ses membres afin de prévenir les dissidences. Un esprit déroge-t-il ostensiblement à ces normes de toute pensée ? Elle ne le considère plus comme un esprit humain dans le plein sens du mot, et elle le traite en conséquence. C’est pourquoi, quand, même dans notre for intérieur, nous essayons de nous affranchir de ces notions fondamentales, nous sentons que nous ne sommes pas complètement libres, que quelque chose nous résiste, en nous et hors de nous. Hors de nous, il y a l’opinion qui nous juge ; mais de plus, comme la société est aussi représentée en nous, elle s’oppose, du dedans de nous-mêmes, à ces velléités révolutionnaires ; nous avons l’impression que nous ne pouvons nous y abandonner sans que notre pensée cesse d’être une pensée vraiment humaine. Telle paraît être l’origine de l’autorité très spéciale qui est inhérente à la raison et qui fait que nous acceptons de confiance ses suggestions. C’est l’autorité même de la société[19], se communiquant à certaines manières de penser qui sont comme les conditions indispensables de toute action commune. La nécessité avec laquelle les catégories s’imposent à nous n’est donc pas l’effet de simples habitudes dont nous pourrions secouer le joug avec un peu d’effort ; ce n’est pas davantage une nécessité physique ou métaphysique, puisque les catégories changent suivant les lieux et les temps ; c’est une sorte particulière de nécessité morale qui est à la vie intellectuelle ce que l’obligation morale est à la volonté[20].
Mais si les catégories ne traduisent originellement que des états sociaux, ne s’ensuit-il pas qu’elles ne peuvent s’appliquer au reste de la nature qu’à titre de métaphores ? Si elles sont faites uniquement pour exprimer des choses sociales, elles ne sauraient, semble-t-il, être étendues aux autres règnes que par voie de convention. Ainsi, en tant qu’elles nous servent à penser le monde physique ou biologique, elles ne pourraient avoir que la valeur de symboles artificiels, pratiquement utiles peut-être, mais sans rapport avec la réalité. On reviendrait donc, par une autre voie, au nominalisme et à l’empirisme.
Mais interpréter de cette manière une théorie sociologique de la connaissance, c’est oublier que, si la société est une réalité spécifique, elle n’est cependant pas un empire dans un empire ; elle fait partie de la nature, elle en est la manifestation la plus haute. Le règne social est un règne naturel, qui ne diffère des autres que par sa complexité plus grande. Or il est impossible que la nature, dans ce qu’elle a de plus essentiel, soit radicalement différente d’elle-même, ici et là. Les relations fondamentales qui existent entre les choses — celles-là justement que les catégories ont pour fonction d’exprimer — ne sauraient donc être essentiellement dissemblables suivant les règnes. Si, pour des raisons que nous aurons à rechercher[21], elles se dégagent d’une façon plus apparente dans le monde social, il est impossible qu’elles ne se retrouvent pas ailleurs, quoique sous des formes plus enveloppées. La société les rend plus manifestes, mais elle n’en a pas le privilège. Voilà comment des notions qui ont été élaborées sur le modèle des choses sociales peuvent nous aider à penser des choses d’une autre nature. Du moins, si, quand elles sont ainsi détournées de leur signification première, ces notions jouent, en un sens, le rôle de symboles, c’est de symboles bien fondés. Si, par cela seul que ce sont des concepts construits, il y entre de l’artifice, c’est un artifice qui suit de près la nature et qui s’efforce de s’en rapprocher toujours davantage[22]. De ce que les idées de temps, d’espace, de genre, de cause, de personnalité sont construites avec des éléments sociaux, il ne faut donc pas conclure qu’elles sont dénuées de toute valeur objective. Au contraire, leur origine sociale fait plutôt présumer qu’elles ne sont pas sans fondement dans la nature des choses[23].
Ainsi renouvelée, la théorie de la connaissance semble