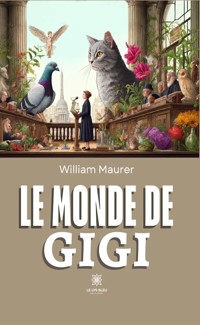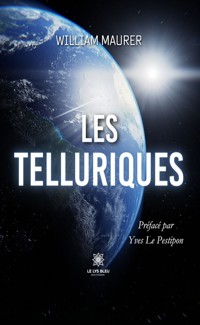
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Le Lys Bleu Éditions
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Französisch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Un empereur-philosophe, une SDF enragée, un athée esthète, un mystique et plein d’autres figures, inconnues ou mythiques, se rencontrent dans ce recueil. Leur point commun ? Ils aiment le monde d’en bas, mais face aux épreuves de la vie, le silence du ciel les blesse. Dans les rires ou les larmes, la beauté ou la laideur, la grandeur ou la banalité, chacun d’eux, témoin de notre condition, lève les yeux, raconte ses histoires, exprime ses craintes, ses espoirs, ses joies ou ses révoltes dans des styles au contraste explosif. Ce recueil se veut être une exploration de voix humaines contraires, comiques ou tragiques, parlant de notre condition, ainsi qu’une ode vibrante à la richesse de la langue française dans ses contrastes les plus saisissants.
À PROPOS DE L'AUTEUR
À l’âge de vingt-huit ans, W
illiam Maurer s’est distingué en tant que professeur double agrégé de lettres modernes et de musique. Formé au conservatoire de Toulouse en tant que claveciniste et compositeur, il a développé une passion précoce pour les différents styles littéraires et leur capacité à rendre compte de la richesse et de la complexité du monde réel.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 432
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
William Maurer
Les telluriques
Recueil
© Lys Bleu Éditions – William Maurer
ISBN : 979-10-422-3554-3
Le code de la propriété intellectuelle n’autorisant aux termes des paragraphes 2 et 3 de l’article L.122-5, d’une part, que les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective et, d’autre part, sous réserve du nom de l’auteur et de la source, que les analyses et les courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite (article L.122-4). Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
À Patrice Besnard,
mon meilleur ami qui, pendant trois ans,
m’a aidé à la rédaction de ce livre
et qui est parti avant de pouvoir le lire.
Préface
Les poètes ne sont pas assignés à résidence dans l’idéal. Lorsque Francis Ponge publia Le Parti des pris des choses, il ne proposa pas une suite d’ascensions vers les anges. Quand Charles Pennequin écrit et agit, il est vulgaire. Hugo osa « nommer le cochon par son nom ». La Fontaine lui-même proposa des fables matérialistes au sillage de Lucrèce, d’Épicure, et de Démocrite. Cela n’empêche pas les uns et les autres de considérer le ciel, depuis la terre, et d’être subtils. S’ils sont volontiers à la recherche du sommet, ils travaillent à la base. « La grâce », qui est cette année le thème obligatoire du « Printemps des poètes », n’est pas l’unique objet de leurs sentiments. Ils goûtent les grouillements gros, les graisses, les groins, les grogs, les grognements d’ici-bas, et en font œuvres.
Les Telluriques de William Maurer sont d’abord des poèmes terrestres. Il ne s’agit certes pas de « la terre qui, elle, ne ment pas »… Les Telluriques prennent toute la terre, où ça ment fort, dans ses épaisseurs, ses violences, ses troubles, sa puissance organique, ses éruptions de lave sans grâce, ses matières. Ce n’est certes pas un ouvrage de géologie, voire de tectonique. Ce poète prend en considération les activités humaines, les choses, le ciel parfois, les laideurs, les médiocrités, tout ce qui bouge, tremble, éructe, autour de nous, en nous, le vaste immédiat sans arrière-monde. Il n’indique pas seulement « le ciel par-dessus le toit », il montre les tourbillons d’astres, le toit, tout ce qui est tu sous les toits, les grouillements, la vulgarité passionnante des choses et des êtres. Maurer est donc loin des poètes élégants, comme Bobin, Goffette, Maulpoix, Velter… Il est de la Réunion, île volcanique, obscène et merveilleux surgissement.
« Les inventions d’inconnu réclament des formes nouvelles. » On pourrait objecter à Rimbaud que la recension du connu en réclame aussi, tant le connu est souvent voilé par la poésie poétique. William Maurer éclate la trame des régularités. Parfois ce sont des vers, parfois de la prose. Parfois c’est bref, parfois long. Ça bouge. Ça se heurte. C’est tellurique. Chacun des poèmes est une plaque qui cogne ses voisines. Par ces chocs et ces réunions, l’œuvre se crée, produit des formes. Ça éructe et chante.
Ici, la poésie n’est pas « comme l’amour ». William Maurer renoue avec la tradition satirique. Ses textes sont souvent des actes d’attaque. Il se moque. Il est sans doute injuste, incorrect, mais Villon aussi. La Bible même n’est pas un chef-d’œuvre de délicatesses tendres. Tout n’y est pas « Cantique des cantiques ».
Chez William Maurer on rencontre des gros, des grincements, des insultes, des protestations contre les sirops de l’amour, ainsi que des astres, des cailloux… Il y a de tout. Telle est l’ambition : contre une poésie du silence et des anorexies, dire hors Platon les éruptions multiples de présences, et saluer parfois la beauté.
Les Telluriques sont une comédie, certes pas divine, mais diverse. C’est une forte œuvre de poésie qui dérange les anges.
Yves Le Pestipon
Biographie de Yves Le Pestipon
Yves Le Pestipon est un écrivain et poète français, ancien élève de l’École normale supérieure de Saint-Cloud, agrégé de lettres, docteur ès lettres, spécialiste de La Fontaine et professeur de chaire supérieure à Toulouse. Initiateur, avec d’autres, du festival des Bruissonnantes et des Classiques au détail, il a également rédigé la préface des Fables de La Fontaine dans un tirage spécial de Bibliothèque de la Pléiade aux éditions Gallimard en 2021.
Avant-propos
Ce recueil de poésies philosophiques s’inspire de plusieurs traditions : la poésie de type ésotérique qui va de Stéphane Mallarmé à Yves Bonnefoy d’une part (en passant par Saint-John Perse et Eugène Guillevic), les poésies religieuses de Charles Péguy et de Paul Claudel, les jeux de langage oulipiens (que l’on retrouve notamment chez Raymond Queneau et Boris Vian) et enfin les poésies orientales (en l’occurrence celle de Mahmoud Darwich). Ces affiliations diverses expliquent en grande partie la diversité stylistique et formelle au sein de ce travail (vers libres, poèmes en prose, prose poétique, aphorismes, etc.), mais aussi la diversité des mythologies convoquées : bibliques, gréco-latines, arabes et africaines.
En deçà de ces différences, le socle fondamental commun qui sous-tend toutes ces formes poétiques réside dans ce que j’appellerais un parti-pris ontologique anti-platonicien qui ne cesse de dire et de redire la grandeur de la matière éphémère, périssable, tout en interrogeant ce divorce de l’ordre et du monde que déplore Albert Camus dans Le mythe de Sisyphe. Qu’il s’agisse d’un portrait, d’une imprécation, d’une déclaration d’amour, d’une plainte funèbre ou d’autres « structures dramatiques », le questionnement métaphysique demeure toujours présent, et redonne une part de noblesse à la terre, à l’instant fugitif, sans jamais pour autant s’excuser d’un regard nostalgique et même envieux sur le temps où le ciel parlait encore.
Ce qui s’oppose s’assemble, et de ce qui diffère naît la plus belle harmonie, et la discorde qui engendre toutes choses.
Héraclite, Fragments, VIII
Le monde n’est que variété et dissemblance.
C’est un sujet merveilleusement vain, divers et ondoyant que l’homme.
Celui qui jugerait d’eux en détail, pièce par pièce, séparément, se trouverait plus souvent dire vrai.
Montaigne, Essais
Révolte
Embrasée la lumière,
Infinie la tendresse
De cet amas d’os,
De chair
Et de nerf
Qui deviendra
Poussière.
Le cœur et l’estomac
ou
Des cochons
Dans l’avion, temps écoulé : 15 minutes
Assis près d’un hublot, je regardais les côtes de l’île que nous quittions, un brin nostalgique, lorsque les hôtesses, telles des fées arthuriennes ou des servantes de l’Égypte antique (silhouettes fines, tailleurs moulants bleus et dorés, sourire immobile de poupée Chucky), firent un défilé, les bras raides comme la justice avec, dans chacun d’eux, une bombe criminelle.
Elles pulvérisèrent leur poison, probablement un spray anti-moustique ou nettoyant, et nous asphyxièrent de cette odeur de désodorisant lavande bon marché qui s’infiltra jusqu’au cockpit, allant faire mu-muse avec les narines des pilotes à l’agonie. Elles partirent et revinrent, armées de leur vaporisateur de la mort.
En une seconde, ce majestueux avion d’Air France était devenu un gros cabinet ; certains crurent même à un exercice prévu pour les obliger à essayer les masques à oxygène. Cette brise légère (synthétique et cancérigène) avait, comme la madeleine de Proust, rappelé à tout le monde une autre odeur, celle qui précède toujours cette alizé et la rend nécessaire, une fragrance plus naturelle, plus percutante, plus caverneuse et plus fouettante, traversant les temps et les lieux, bravant l’Histoire et reconnaissable entre mille : je veux bien sûr parler de la merde la plus insoutenable. Quoi de plus universel comme réminiscence fraternelle du genre humain ? Tous les passagers s’échangèrent un regard complice. Peut-être était-ce également un signe utile pour raviver les consciences endormies pendant l’été, et nous faire comprendre que les vacances étaient bel et bien finies.
Cette souffrance olfactive était similaire à une autre épreuve que mon nez avait dû endurer quelques années plus tôt.
L’une de mes tantes avait reçu, en cadeau, un énorme cochon, dont la fortune était déjà tracée sur le fil du billot vers l’issue funeste et privilégiée que notre espèce réservait à la sienne. Par un miracle ineffable, qui avait au moins nécessité l’alignement des planètes, la tyrannie de l’estomac avait cédé aux élans du cœur. La famille entière s’amouracha de l’animal qui évita de justesse la guillotine, et devint très vite un bon porc de compagnie, aussitôt baptisé du doux nom de Franklin. En hommage à la tortue du dessin animé éponyme ou à l’inventeur du paratonnerre ? Je ne sais. Toujours est-il que ce monstre ne m’aimait pas et que je le lui rendais bien.
Devant leur portail, avant même de l’avoir rencontré, j’avais senti d’emblée qu’une inimitié naturelle et réciproque serait inévitable. Mon nez ne me faisait que trop pressentir et appréhender ce que mes yeux ne voyaient pas encore. Son parfum musqué était tellement fort qu’il le précédait d’un kilomètre ; vous étiez à peine avancé dans la rue que vos narines vous suppliaient de faire demi-tour sous peine de vous faire crever sur place.
Or, un de mes grands défauts fut toujours de subordonner les intuitions de mes sens et même mon instinct de conservation aux injonctions morale, sociale et surtout familiale auxquelles, comme un bon garçon, je me faisais un devoir de m’assujettir, et parmi ces devoirs, figurait celui de rendre visite à mes tantes aujourd’hui même. Prenant donc mon courage à deux mains, je pris celle de mon père et m’engouffrai donc dans la rue, pensant que le pire était déjà passé.
Quelle ne fut pas ma surprise en entrant dans le jardin ! C’était de ces puanteurs indicibles, incroyables. Qui ne se contentent pas d’annihiler votre odorat, mais vous aveuglent, vous rendent sourds, vous brûlent et vous paralysent : pendant quelques secondes ? Vous demeurez là. Pétrifié. Hébété. En deuil devant votre pensée. Votre nez vient de perdre la foi. La beauté du monde ? Une illusion qui s’écroule. L’amour ? Une chimère. Le pardon ici ? Impossible. Les concepts et catégories devenues floues se confondent en un vertige nauséabond. Vous sentez en vous quelque chose qui n’était pas vivant et qui pourtant a réussi à mourir. Votre père en sueur vous presse d’avancer, armé de son seul mouchoir ; regard suppliant, jambes tremblantes, vous faîtes quelques pas, vous sentez sous votre pied droit une chaleur salvatrice jusqu’à ce que, bravant leur peur, vos yeux veuillent bien regarder le sol et, choqués, courent se cacher sous les paupières : c’était une déjection trop récente. C’en est fini. Votre corps tout entier est athée. L’esprit moins directement touché résiste, mais pour combien de temps ? Tiendra-t-il jusqu’au perron ? Ô, fragrances venues des ténèbres ! Que mes sens ne savaient pas possibles ! N’êtes-vous pas le meilleur argument des Esprits Forts ? Un dieu bienveillant ne vous aurait pas faites. Odeurs devenues gifles, claquements de fouet, molécules d’excréments, envahissant tous les orifices de votre crâne, dissolvant tout votre être dans une épaisse exhalaison putride inconnue au tableau de Mendeleïev.
J’ai toujours pensé que les plus forts arguments de l’athéisme n’avaient besoin ni des grandes idées ni des grands sentiments que font surgir en nous, par exemple, la souffrance universelle, l’injustice la plus révoltante ou l’imperfection consubstantielle des choses ; mais qu’au contraire, ces arguments pouvaient acquérir toute leur solidité en s’appuyant sur les constatations les plus rudimentaires que nous pouvons faire sur certains menus objets, animés ou non, dont la laideur et l’inutilité sont telles que l’on ne peut s’empêcher de se dire : « il est impossible qu’un Dieu ait pu créer cela ». Il n’est pas nécessaire d’aller bien loin : que l’on m’explique l’intérêt de la mouche ou du moustique qu’on dirait créés exprès pour nous importuner ; du reste, je vais peut-être un peu vite dans mon amalgame des deux insectes, car malgré sa faculté de transmettre les maladies les plus graves (ce que la mouche n’a pas), le moustique a cette politesse sur la mouche que sa taille est si petite que sa laideur est épargnée à l’œil humain empêché de voir de si près, alors que l’apparence si disgracieuse, si émétisante de la grosse mouche à merde se présente à nous avec tant de volume, de netteté et d’évidence qu’elle nous fait l’effet d’une véritable agression, d’un odieux attentat contre la vue, et que nous n’avons d’autre choix que de la souffrir jusqu’au moment où, alléluia, grâce à une tapette ou à un vieux magazine roulé, nous arrivons à tuer cette infâme erreur de la nature, à ôter de nos yeux cette insulte à la beauté pour ensuite, plein d’obédience, prier qu’un autre ne traverse pas la fenêtre ou ne naisse de la poubelle.
Hélas, des exemples de cet acabit sont en trop grand nombre au sein de la nature : que dire de cette incohérence physique qu’est le mille-pattes ? Le serpent n’en a besoin d’aucune ; nous-mêmes sommes bien la preuve qu’il n’en faut que deux pour se déplacer ; que l’on veuille pousser la fantaisie jusqu’à quatre, six ou huit (dans le cas de l’araignée), je le veux bien, mais mille ? Et dire que l’on répète à tout-va que la nature est économe de ses moyens… En tout cas, cet animal bizarrement charpenté est bien la preuve éclatante que l’infini et le vivant sont incompatibles.
Revenons à nos cochons.
Ma curiosité visuelle et malsaine me poussa jusqu’à la porcherie, où je ne le vis pas d’abord précisément parce qu’il était trop près, et que je faillis échanger avec son groin baveux et concupiscent de mère maquerelle un baiser libidineux, sensuel à la Betty Boop. Je fis un bond en arrière avec une vélocité que je ne me connaissais pas, visiblement horrifié par la monstruosité quasi mythique de cette bête dont l’apparence, loin de démentir l’odeur, n’en était, hélas, que la pleine confirmation. Son museau de rongeur, son regard de Tartuffe, sa danse tribale, enfin tous les ébrouements de son corps n’indiquaient qu’une seule et même chose : un reniement entier et sans appel de toute ma personne. J’avais refusé ses avances. Je lui avais déplu. Il me déprécia. Et me le démontra en faisant le tour de son enclos d’un trot élégant et empressé, presque louis-quatorzien, ce que je retins comme l’une des chorégraphies les plus superbes du snobisme.
Ma tante ouvrit la porte et vit sur la complexion de son neveu le sourire le plus radieux et le plus faux qu’elle eût jamais vu. Et de voir mes cousins, cousines, nouvins et nouvines s’ébouer en prenant leur café dans la cuisine en échangeant les plaisanteries d’usage sur la joyeuse grasseté familiale. Je riais d’autant plus que j’avais été assuré par la balance (instrument du démon et quelquefois des anges) que j’avais, ô comble de félicité, perdu cinq cents grammes de matière adipeuse. Un petit chiffre pour le cadran, un grand pas pour mon bonheur. Ces cinq cents grammes difficilement perdus étaient peut-être la principale raison du prolongement de mon séjour en métropole qui durait maintenant dix ans. Si l’on fait le calcul, cela fait dix années de gastronomie française pour cinq cents grammes de graisse en moins, le dieu de la surcharge pondérale est un sacré farceur, qui se refuse bien souvent à abandonner ne serait-ce qu’un petit lopin de son empire, lequel s’était follement accru depuis l’invention de ces Américains ignobles : le fast-food.
Après m’avoir questionné brièvement sur ma vie européenne, mes classes au conservatoire, mes études de littérature, ma vie privée (inexistante), auxquelles elles me firent comprendre qu’elles n’y entendaient rien, elles revinrent à leur principal sujet de conversation. Celui qui les enflammait. Celui qui les ravissait. Les faisait se transir d’extase. Qui les faisait exulter. Roucouler. Jouir. Le sujet de ce jour. Mais aussi de tous les autres jours : leur cochon.
Il est vrai que cet animal était auréolé d’un certain mystère, d’un charme presque envoûtant auquel je songeais toujours depuis notre amourette ratée. En temps normal, c’est-à-dire non troublé par la venue d’un étranger (moi en l’occurrence), Franklin précédait le perron, l’entrée, le garage, tout son foyer en somme, en se tenant noblement sur ses quatre pieds, le museau de rat relevé tel un seigneur féodal du XIIe siècle gardant hardiment son fief, et à qui il ne manquerait que l’épée, le heaume et la cotte de maille. Entre mes deux cousines et ma tante, il était difficile de distinguer laquelle des trois était la plus éprise de ce porc. Molière en les regardant y eût peut-être reconnu ses « femmes savantes », mutatis mutandis, où le rôle d’écrivailleur pédant ne serait plus tenu par Monsieur Trissotin, mais par Franklin qui, au lieu de réciter des sonnets latins et des idylles en grec ancien, se contenterait de faire « gr. gr. gr. gr. ».
Il fallait que j’arrête de penser. Nous riions tous, mais pas de la même chose. Lorsque les rires gras cessèrent, je continuais tout seul par à-coups. J’imaginais Bélise et Philinte se tenant au bord de la porcherie de Franklin : « Que ce quatrième “gr” est exquis ! N’a-t-on jamais rien crié de plus beau ? On se sent naître jusqu’au fond du… de l’âme un je ne sais quoi qui fait que l’on se p... âme. »
Certes, je pensais tout bas, mais je riais tout haut. Toujours est-il que ce porc, elles, il les aimait, et lui, elles l’adoraient, d’une affection étrange certes, mais contagieuse que je commençais d’éprouver moi-même pour cette bête à face de rongeur, sabot de cheval et queue en tire-bouchon. J’eusse pu être la quatrième des dames franklines, si mon nez, converti désormais à l’athéisme le plus féroce, n’avait arrêté mes élans de jeune fille en émoi. Elles entreprirent de me narrer la vie pré-adoptive de Franklin, mais à peine l’avaient-elles commencée qu’elles se mirent à employer un ton si éloquent que je crus plusieurs fois à la lecture des mémoires du Général de Gaulle. Elles avaient, elles aussi, un certain génie littéraire, puisque, sans le savoir, elles avaient inventé ce que j’appellerais la zoographie (nouveau genre défini comme étant la biographie d’un animal). Je ne perdis pas une miette de leur histoire tant j’ignorais que la vie d’un cochon pût être aussi riche. Pendant ce récit, je voyais défiler devant mes yeux la vie porcine de Franklin qui n’avait jamais été facile, mais il avait réussi non seulement à se faire adopter par un foyer bienheureux, mais surtout à s’en faire idolâtrer, comme ces dieux païens, à qui l’on faisait avec déférence maintes offrandes qui, pour lui, ne consistaient qu’en plateaux de cochonneries qu’il s’empressait de dévorer sous les cils ébaubis et vaporeux de ses maîtresses. Elles ne m’avaient parlé que de son enfance. Je me demande si je serais rentré à temps si elles avaient embrayé sur sa puberté.
Comme elles n’avaient plus rien à dire, j’écourtai ma visite et, me voyant prendre congé, mes cousines m’exhortèrent à faire un dernier salut à leur mascotte dont je n’eus pas même un « gr » de cordialité ou un coup de groin chaleureux… Je partis résolument, me demandant néanmoins lesquels de ces dames ou de ce porc servaient de compagnie à l’autre. Plus tard, quand je fis le récit de cette mésaventure à mon meilleur ami Patrice (que d’ordinaire je faisais parler pour avoir plaisir à ne pas l’écouter), celui-ci me soutint virulemment que le « suscrofa domesticus » alias le porc (ce vieux bigot pédant avait un faible par les noms latins) non content d’être extrêmement propre avait une intelligence équivalente à celle du chimpanzé. Il n’en démordait pas ! Inutile de vous dire que j’accueillis ses propos avec une certaine méfiance et même un certain scepticisme dus aux épreuves que mon odorat avait eu à souffrir. Face à mon incrédulité perceptible, il m’assura que le porc avait une peau extrêmement délicate, sujette aux coups de soleil, qu’il la lui fallait protéger en se roulant dans la « gadoue » protectrice et qu’à cause de l’exiguïté des enclos dans lesquels il se trouvait bien trop souvent confiné, il était inévitable que la pauvre bête en fût réduite à se badigeonner de sa propre merde. Mon regard dut lui laisser voir que j’étais moyennement convaincu par cet argument qui provoquait une petite jacquerie de mes sens. Il voulut braver mes réticences en se précipitant sur la page Wikipédia. Dans sa frénésie de culture porcologique, il me fit même part d’une anecdote extraordinaire digne du grand Michelet : au XIIe siècle, un horrible cochon avait commis un régicide en dévorant l’héritier du royaume de France, Philippe fils de Louis VI le Gros, cause d’une interdiction de la divagation des porcs dans la commune de Paris, exception faite des cochons de la confrérie des moines Antonins.
On en apprend tous les jours.
Je ne me sentais pas concerné, mais je ne comprenais pas que lui, si féru d’Histoire et si patriote, pût estimer autant une espèce qui aurait pu provoquer une guerre de succession au sein du pays. Toutefois, la hardiesse qu’il mit à défendre ce quadrupède qui faisait de la thalassothérapie dans sa propre fiente et le peu de compassion qu’il témoigna pour mon olfaction diminuée me résolurent de clore la discussion en lui décochant une petite ignominie de ma composition :
— Cela ne m’étonne pas que tu t’y connaisses en matière de porc et encore moins que tu les aimes.
Je savourai longtemps la cruauté de ce trait qu’il ne comprit jamais.
Cher lecteur, aucune des ressemblances que vous devinerez avec des faits ou des personnes réels n’est fortuite. Aussi improbable que cela puisse vous le paraître, ce récit, même s’il est enrichi de quelques jeux de langage imagés de ma plume, n’en est pas moins fidèle à la pure vérité de ce qui s’est déroulé il y a de cela quatre ans.
Je vous avoue, en toute confidence, que je ne me console pas du succès unanime et immédiat dont ce texte fut auréolé auprès de ceux de mon cercle à qui j’en fis naïvement la lecture. J’estime que la faveur particulière dont il jouit encore maintenant demeure disproportionnée et injuste au regard de textes plus anciens ou plus récents, que j’avais écrits avec bien plus de soin, que je jugeais plus aboutis, plus « sérieux », et ainsi plus à même de mériter leur enthousiasme.
Néanmoins, comme ils s’empressèrent de me réclamer un deuxième chapitre pour cette « saga » et que je voulais complaire à la gentillesse qu’ils avaient eue de m’écouter, et d’exprimer sans fard tout le bien qu’ils en pensaient, je décidai de m’informer auprès de mon père quant au devenir de Franklin, et à l’éventualité que nous puissions lui rendre une petite visite, à lui ainsi qu’à ma tante et mes cousines, bien sûr.
J’appris alors une terrible nouvelle : les faits du premier chapitre s’étant déroulés et ayant été écrits avant la pandémie de covid-19, la famille de Franklin n’avait pas encore eu à en subir les conséquences. Or, depuis, les confinements dus à cette crise, dans lesquels cette famille, comme toutes les autres, s’était retrouvée plongée (et qui étaient ici d’autant plus cruels qu’elle habitait isolée dans une campagne profonde) avaient rendu leurs déplacements vers les supermarchés si difficiles et incommodants de là où elles étaient, qu’un jour, épuisées, mues par une envie insatiable de bonne viande, elles cédèrent à la facilité et décidèrent que Franklin serait à nouveau soumis à l’usage pour lequel il était entré dans la maison : les nourrir.
Ainsi prit fin la vie furtive de Franklin, dans une famille de la campagne réunionnaise, dont la mort avait été provoquée indirectement par l’importation d’un virus de Chine. Pour l’instant, je ne connais pas de meilleur exemple quant aux conséquences désastreuses d’une mondialisation outrancière.
Toujours d’après mon père, un peu honteux de me l’avouer d’ailleurs, sa famille n’en éprouva aucun remords et se vanta même auprès de lui d’avoir fait un fabuleux festin où elles parlèrent longuement du délice de cette viande rôtie.
En somme, hormis les anciennes maîtresses devenues les allègres dévoreuses de ce pauvre animal, tout le monde en fut attristé : mon père d’abord, qui, malgré ses brèves rencontres avec lui, avait fini par prendre ce porc en affection ; mes amis ensuite, extrêmement déçus de n’avoir pas leur deuxième chapitre ; et enfin moi qui, affligé également pour les deux raisons précédentes, y en avais ajouté deux autres, à savoir d’abord la vitesse scandaleuse avec laquelle elles avaient changé le rapport qui les liait à cet animal, passé du privilège d’être un compagnon unique au statut anonyme de simple viande bonne à garnir les assiettes, et deuxièmement, je fus particulièrement touché par la terrible et amère leçon que je retirai de cette tragédie : on a beau aimer les animaux, quand la faim s’installe, ils ont intérêt à fuir la ferme.
Oraison funèbre
Je crie sur l’asphalte la phosphorescence de tes entrailles dans la boue spacieuse.
La souffrance de Nathanaël
Dans la nuit, sous la pluie, dans mes bras, je le portais comme une mariée déchue.
Ce n’était pas un visage, c’était une souffrance faite homme, ou plutôt une souffrance qui s’était laissée tomber dans un corps d’homme pour se sentir encore plus souffrir : latente, drapée sous la peau, tranquille, bien consciente d’elle-même, au chaud dans sa légitimité, qui ne se trompait ni de geste ni d’objet, ni ne se criait dans une exclamation, une exubérance de cabaret, de foire ou de cinéma ; une souffrance qui ne faisait pas tout pour se laisser deviner, qui ne minaudait pas, ne marchandait pas, ne prostituait pas sa vérité pour attirer des yeux, des compréhensions ou des pitiés anonymes, et qui ne tentait pas de se grandir, de se fuir ou de se nier dans le simulacre d’une exultation trop forte pour être vraie ; ce n’était pas non plus de ces souffrances informes ou difformes qui se déforment encore pour arrêter, extorquer, ou arracher la commisération ; c’était plutôt une souffrance qui, née de son hôte sous la forme d’un point infime comme un atome dense, avait fini, comme au cours d’une évolution régulière, rigoureuse, mais rapide, par acquérir l’énergie du vivant et, par duplication et réduplication, s’était développée, engrossée, étoffée jusqu’à s’étendre et devenir autonome, jusqu’à se détacher de lui, Nathanaël, et s’infiltrer dans toutes les cellules, toutes les synapses et tous les chromosomes, jusqu’aux mitochondries et l’ADN, telle une figure géométrique où le centre était partout, dont la surface épousait les os, les muscles, le cœur et le cerveau, toutes les particules diffuses de ce corps chétif en somme comme une seconde âme, mais qui pour ne pas épuiser la première âme sous son intensité, avait dû trouver une parade pour, non pas s’amoindrir ni s’alléger, mais plutôt s’éluder, se contourner, se recroqueviller comme une graine murmurante à peine luminescente. Une souffrance sans majuscule, grouillante comme le soleil, mais pudique comme la lune, chaste et discrète, mince comme une feuille de papier, fière de se fuir dans la malice de son abstraction, à peine décelable par un pli autour des yeux ; une souffrance qui s’était rogné toute singularité, toute identité, presque toute pesanteur, tout attirail ou tout ornement pour ne garder que la forteresse de son dénuement : le seul haillon qu’elle avait mis contre le bonheur du monde décidé à la tuer et qu’elle savait imprenable. Elle avait depuis longtemps déposé ses velléités de théâtre et ne luttait plus pour exister dans le regard du monde. Peu importe l’objet originel à qui elle devait sa naissance : c’était une souffrance émancipée de sa raison d’être, désincarnée, qui avait fermé les yeux sur l’image de sa cause ; une souffrance profonde, patiente et sereine, de celles dont la froideur finit par tenir chaud la nuit et vous enrober dans son sourire telle une vérité divine. Une souffrance dont Nathanaël était désormais l’hôte, qu’il ne voyait plus tant ils se confondaient et qui, elle, ne craignait nul attentat de l’amour.
C’était elle que je portais, que je voyais, c’était elle qui venait d’ouvrir les yeux pour me défier, et elle enfin que je devais terrasser pour le rencontrer lui : celui que je commençais d’aimer.
Le monde idéal
Lettre de Nathanaël à Rose
« Pour le déni de ma nature, Rose,
De ta chaude naïveté de cristal je m’imprègne
Comme d’un épais manteau dont je ne veux m’extraire
Vois, n’aie pas peur, sur ma face, ces yeux bleus assoiffés
Ce regard suspicieux et ces lèvres angoissées
Qui te déclarent la guerre et t’appellent à les vaincre
Par la lame aiguisée de toute ta bonté simple
Ils te toisent et t’éveillent
Nus dans leur abandon
Et te prient maintenant de leur ôter ta grâce
Afin que retournant sombrer dans leurs limites,
Ils savourent le repos dans leur désert fragile.
Le mouvement généreux de tes petits pieds nus
Détruit en un instant les dogmes les plus vils,
Et tes fins cheveux blonds effilés comme la paille
Épousent la sécheresse du blé
Et le bronze amolli par tes pleurs angéliques
Ôtera tous les fers qu’il osa mettre aux hommes.
De la frêle pesanteur de ta persévérance
Tu enlaces à jamais l’herbe qui te méprise
Tu continues ta course au sommet des misères
Et ton haleine enfin comme un voile de clarté
Dissipe en un instant les afflictions diverses
Ton sourire fatigué s’imprime sur mon visage
À l’effigie de ceux dont je partage le sort.
En ton sein, les damnés accourent se réfugier
Sans se soucier jamais de prostituer leurs mondes.
Dans la complexion lasse de ta face inclinée
Tu franchiras sans fin le bourbier de ce monde.
Les empires finiront leur course à l’Impossible,
La Folie apeurée fuira le cœur des hommes
Et le ciel daignera se pencher sur nos têtes
Si honteux de te voir
Amaigrie, desséchée dans le don
De ta bénédiction
Profane.
***
Je te vois encore
Courir au-dessus de ma tête
Dans un pré que le sol ne touche pas
Verdoyant d’azur et de joie consentie
Et de l’air vivifiant qui s’offre à tes poumons
Que les Saints dans leur ciel n’ont même jamais humé.
***
Le ciel et le néant te disputent à la terre
Mais les os recourbés
Tu demeures avilie dans l’incompréhension de la pierre inutile
Avec liesse
Tu accueilles la souillure épaisse du soufre et de la sève
Comme un onguent
Et la rugosité de l’écorce et des pins
Te caresse
Et tu exultes
D’un rire démolisseur, gras, pur et insolent
Éclaboussant ainsi les araignées abstraites
De ta fureur de vivre écœurante et visqueuse
Abîmée dans la flamme de jouissance périssable
Acharnée à gratter sous les sillons arides
L’or des plaisirs solides et des cœurs altérables.
***
Rose,
L’inaltération de ton regard m’effraie
Pour mon malheur, je sais
Que jamais ton visage brisé de compassion
Ne se détournera de l’érosion de l’Être
Ni de la pourriture des veines et des artères
Ni de l’affadissement des désirs les plus fous
Ni de la maladie qui se joue de nos corps
Ni de tout ce qui fait que tout passe et s’effondre
Et recommence ainsi pour s’effondrer encore
Dans la fange dédaignée que nous sauvons en vain
Par nos amours blessés et nos cœurs trop humains.
***
Rose,
Donne-moi le secret
De ta chair translucide
Ta corporéité discrète et vaporeuse
Vestige de ton union avec l’informe aimé
Suscite l’affolement obscur de ma convoitise.
Elle me console, m’afflige et me dévore
Comme la seule qualité que je voudrais avoir
Qui se refuse toujours à mon inachèvement
La blanche fadeur de ta nature nacrée
Figure le plus essentiel de mes délices
La vérité ne sera-t-elle donc pas
Dans la suavité fauve de ces fruits exotiques
Ni dans la séduction du pourpre bacchanale
Ni dans la chair moelleuse des courtisanes en flamme
Ni dans l’ivresse des jeux étincelants de la ville ?
Voilà.
J’ai laissé ma langue emprunter et nommer ta nature diaphane
De toute la force de sa conception
J’ai esquissé ton Être au travers de mes doutes
Pardonne-moi, Rose, pour cet amas de mots fébriles
Qui masque ta réelle présence
Il faut tuer Narcisse
Je te rends ta substance
De jeune fille que je n’aurai jamais
Car tu es le rêve du ciel.
Un jour,
La fine dissolution de tes légers attraits
Attisera mon espérance
De toucher la lumière d’ici-bas »
On s’fait tous baiser
Y a pas à dire. Concrètement !??? Ce mec, c’était une pute puissance mille. Eh oui… Une tafiole, comme on dit… Une caricature sur pattes ! engoncée dans des jeans slim taille basse – trouées, avec polo rose bonbon et sac à main Louis Vuitton… The panoplie complète quoi ! Et vas-y que j’te casse des poignets et que j’me tiens les mains sur les hanches en tortillant du cul au cas où on saurait pas que je suis Pédé ! Un vrai chevalier d’la manchette, on dirait qu’il fait exprès s’il était pas né si con… Quand on l’écoutait ?! Une voix frêle-midinette, mi-parisienne hautaine, mi-prout-prouteuse à balancer des « euh » partout ! à vous donner envie d’vous enfiler une om’lette… La conversation ? Soirées, potins, teufs, baise et bonbons, et bla bla bla que j’t’étale mes « euh » à tout va pour faire croire que j’ai une vie bien remplie, et que j’passe pas mon temps à déprimer sur Netflix ou à nettoyer les chiottes d’une EPHAD ou d’la gare du Nord, histoire de combler mes fins de mois… Pfff… C’est sûr : c’était pas une lumière, ce type… Nicolas qu’il s’appelait !... Noir. Chétif. Cheveux gélifiés, remontés genre crête-de-coq, couleur arc-en-ciel du drapeau LGBTEFGH+XYZ ! Mais dans cet assemblage bizarrement sexué où suintaient le bling-bling, la peinture abstraite et l’artifice des coquettes fin-de-siècle, deux yeux bleus vous transfiguraient sur place, affamés d’amour et d’espoir. Son bon cœur lui collait à la peau comme une sale crasse venimeuse et j’étais piquée… Je l’avais vu qu’une fois, puis après ? PARTI ! Jamais d’temps pour moi, pfff ! Toujours un truc à faire… Par-ci… par-là… p’tite magouille à tenter histoire de frauder la vie et les caisses d’allocs… revente de beuh, dans des transactions où les plus baraqués se la fermaient devant son sens des affaires…
J’le vois encore là ! avec sa bande de copains encore moins virils que lui, à s’pavaner, plus fantaisistes que le frère de Louis XIV en Princesse Palatine à Versailles… Là, c’était plutôt galerie de crachats entre scooters et débris de verre sous un ciel trop bleu délavé qui s’foutait royalement d’leur pomme comme de la mienne.
Il faisait tellement d’effort Nicolas pour me cacher qu’il voulait pas voir ma sale tête que c’en était flatteur. Il devait me trouver, mais alors teeeellement chiante !!! Il avait pas tort. Toujours première de la classe, vierge, sortais jamais, y avait pas de quoi sauter au plafond, vraiment pas… mais alors vraiment pas… franchement… la fadeur personnifiée, sans épice, sans saveur, sans sentiment. Même le cœur palpitait pas ! Ou plus…
J’lui aurais dit qu’j’voulais le voir tout le temps. Tout le temps ! N’importe quand. N’importe où. N’importe comment. Pour n’importe quoi ! avec n’importe qui ! du moment qu’il s’rait là, avec moi, j’ voulais le voir jusqu’à en crever, il aurait pas compris… l’idiot… Ah, si ?!!! Non !? Ou pas… Pfff… Sûr… il m’aurait ri au nez, gêné… et moi !? Je s’rais restée, là, coite et conne comme une courge, recadrée, là, dans ma solitude, dans ma poisse, à traîner dans les rues, la nuit, ou à m’étouffer dans la poussière avec un cacheton périmé pour ne pas crever seule… jusqu’à m’étouffer ! Affamée ? D’une touze sans intérêt.
J’en avais lu des conneries remâchées sur l’amour dans ces bouquins obligatoires qu’on nous file à l’école, ça d’vrait pas être permis d’empoisonner les gens avec ça !!! De la guimauve camomillée ! pour ménagère ménopausée… tout juste bonne à causer avec le télé-achat du dimanche matin qu’on trouve sur M6, qui vous pousse à acheter la dernière merde high-tech censée vous rendre heureux pour toujours et qu’on fout au placard après un seul essai…
La passion, concrètement, ça fait pas pleurer. C’est pas rose. C’est même pas rouge sang comme ces satanées roses qu’on nous fout sous l’nez à la Saint-Valentin !!! C’est juste emmerdant. Ça te prend aux tripes. D’un coup. Comme ça. Sans prévenir !... Ça suinte, ça dégouline, ça chie la soif de l’autre comme une bonne diarrhée sous les tropiques !!! Ça te brûle. Ça te colle à la peau, à la cervelle, pire que le zzzz d’une bestiole qui vole. Un truc presque mystique pour un type ou une femme qu’au fond t’aimes même pas, qu’tu connais pas, du pur délire. Le romantisme ? Pipi de chat ou publicité mensongère. Ça se passe pas comme ça en vrai ! … jamais. Ça a duré des mois, des mois et des mois ! … je flairais chaque occasion pour le voir. Sortir. Même quelques secondes ! je connaissais son emploi du temps par cœur… Malsain, tout ça… ridicule ! et pourtant ! On continue… On comprend pas. Le plus jouissif ? C’est qu’ça s’voyait pas d’un millimètre… Bonjour, comment allez-vous ? Très bien et vous ?
— Pareil ! Belle journée n’est-ce pas ? On aurait presque envie de profiter du soleil en prenant un verre à un bistrot, NON ?
— Oui, absolument, au plaisir ! Putain, le con, il a pas compris… Nouvel essai la prochaine fois !? My God... T’es pathétique, ma pauvre… J’espère que tu le sais au moins… Il est tellement beau que j’ai envie de le gifler. J’ai bien joué mon rôle : le même regard éclatant, le même sourire faux cul aux lèvres, pas un cheveu qui dépasse, la gentille fifille en somme… lisse comme la soie, douce comme le duvet et… dure comme un diamant. Il n’a vu qu’du feu et pourtant… à l’intérieur c’est tout un monde qui crie ses entrailles. C’est là qu’on voit qu’les gens sont tellement faciles à berner… Il faut jouer la comédie ! sinon tu t’fais bouffer ! La figure, ça dit rien du tout, juste une vitrine, c’est tout propre au début, quand le magasin vient d’ouvrir, ça brille tellement qu’on voit pas l’foutoir d’antiquailles derrière… et… ? Puis ça s’ternit, ça s’fissure, y a p’us qu’des produits périmés, sans éclat… Un jour ça casse, p’us de lumière, rideau ! Ciao ! Juste un grenier… une trappe ! de la poussière… Des souvenirs… et c’est c’qui fait que votre meilleur ami faisait la fête avec vous y a une heure et qu’on le retrouve dans une baignoire à mariner dans son sang… Depuis la star du show-biz qui fait une overdose sur scène au roi qui commande aux armées et se laisse crever d’faim parce que son chat est mort. C’est terrible de mettre autant de rage inutile et absurde à cacher qu’on est pas si con qu’ça ! Qu’au final, on est pas plus original qu’un autre ! Qu’on aimerait bien passer toute not’vie avec des gens qui nous aimeraient pour toujours même avec nos conneries ! Qui nous donneraient juste un bon coup d’patte pour rire ou pleurer quand la vie est trop dure ! Pourquoi c’est si difficile d’admettre qu’on est pas si spécial que ça ? Pourquoi s’acharner à faire du cinéma !? À faire croire qu’on veut pas c’que tout l’monde veut ? C’est idiot un chien qui tourne sur lui-même pour s’arracher la queue, non ??? Y serait tellement plus laid s’il l’avait pas ! Ça devrait pas être permis par la loi, ça ! … Vous rigolez, hein ? Je le vois !!! Ben d’après vous pourquoi les Grands font tout c’qu’y font ? C’est pour ça qu’les rois clamsent au combat ! dans le désert ! loin d’leurs bonnes femmes et d’leurs gosses qui les attendent bêtement en chialant à les maudire, leur mari et leur papounet ! Eux et le jour où ils ont eu la rage d’être quelqu’un ! Oui ! quelqu’un qui se donne tout l’mal du monde pour être hypocrite. Pour pas vouloir c’que l’p’tit paysan du coin a toujours voulu. Il revient enfin ! (le roi)… Triomphe total !!! Le plus grand, le plus beau, le plus riche, le plus aimé, le plus généreux ! Bref. Le plus tout ce qu’il veut… Je disais ? Ah ! Oui : Il rentre. Dans son palais… Lente procession ! Bien ronflante, hein ! Faut faire durer… Musique ! On applaudit ! On crie ! Louanges ! baise de pieds !... On pleure !? Mais oui ! On lève les bras au ciel, on prie Dieu sait qui ! on s’agite ! Y ont envie d’être bas ces gens, ça se voit ! À raser la poussière sous les tapis ! Ils savent qu’il faut en faire trop. Pas un problème. Notre star ! Il sait y faire avec ces chiens à genoux ! leur nonosse ! Pardi !!! Il les méprise, marche droit devant lui ! Presque arrivé ! Renforts de timbales et trompettes pour se faire mousser ! Il se retourne vers ses fans… Se baisse très très, mais alors trèèèèèèèèèès lentement. Voilà ! Fesses bien posées sur son trône, dos bien droit. Bien enflé dans son costume ? Puissant ! Tout est parfait. Il jouit. C’est bon ? C’est fini. Ses sujets retournent se déhancher, ils ont fait le boulot, maintenant c’est oublié… Place à la fête ! On va foutre le zbeul ! Du coup, lui ? Sourire effacé, protocole, ennui… Ses yeux virent à gauche : par la fenêtre, hiver, neige. Le même mendiant. Là. Tous les jours… Il passe sa vie avec son seul ami. Et not’roi il a envie de quoi, hein ? D’après vous ? Allez. Quand même… faites un effort ! c’est simple ! Repartir deux, trois ans en guerre : faut bien s’bouger le cul quand on a envie d’être heureux, même deux minutes.
Bref. Un être humain, c’est pas si compliqué qu’ça, juste un mammifère qui a réussi dans la chaîne alimentaire, un peu plus futé que les autres si on veut, manger, boire, dormir, se reproduire, c’est pas suffisant ? Soit. Je veux bien. Il faut autre chose. Oui, probablement, c’est même certain, mais quoi ? Faut pas pousser. Juste un phénomène de mode. Et aller déverser ses problèmes existentiels chez le psy… C’est fou l’énergie que les gens mettent à s’persuader qu’ils sont plus compliqués qu’les autres,) différents… la maladie du « mais-tu-sais-moi-je »… Faites un referendum : voulez-vous être heureux ou compliqué ? À vous de choisir ! On serait surpris du résultat… Plus effrayant que Jean-Marie en 2002…
Fin bref, voilà comme ça a commencé… Mon bel homo, il était pas roi, si ce n’est de mon cœur ! (Oui, elle était facile celle-là…) Eh ! Un peu de kitsch ça fait pas de mal ! Mais il était bien occupé lui aussi ! Il avait pas besoin de cacher son goût pour le mâle ! Pour ça on lui en voulait pas ! Mais s’il avait montré son cœur d’artichaut, ALORS LÀ ! Une autre histoire ce serait… Drôle d’époque quand même… Je me dis ? Bon. Son cœur comme son corps a ses raisons… comme le mien d’ailleurs ! mais y a des fois, franchement ? Ça aide pas.
On a fantasmé des années sur quelqu’un qu’on calculerait même plus au bout d’une semaine s’il était à nous, l’amour est plus fort que la mort apparemment, c’est pas bête… Si on était pas aussi accro à quelqu’un, si on espérait pas le voir tous les jours jusqu’à en chialer toutes ses tripes, on se laisserait mourir d’amour tellement on supporterait pas qu’il nous file entre les doigts d’un « je te vois comme une amie » ! Mais qui a inventé cette phrase-là !? Au fond, je savais même pas c’que je lui trouvais… un jour je l’avais supplié de m’accompagner à la bibliothèque… La blague ! j’avais zappé qu’il faisait une allergie à la « cultivation » comme il disait lui-même…
Heureusement, dans la vie, la loi est simple : rien ne reste. Soit les gens restent, mais le cœur change, soit le cœur reste, mais les gens crèvent. Dans les deux cas, on s’fait tous baiser. Et Dieu laisse le diable faire ses bêtises par peur de s’ennuyer là-haut. En vérité, je vous l’dis. On est les grands perdants de ce jeu malsain. Quelle attitude adopter ? Franchement ? Je sais pas… En fait, si… non… je mens, je dirais à cette conne de nature : tiens, ça c’est tout l’amour qu’ils ont eu pour moi, y a pas grand-chose, mais c’est déjà ça, en plus ? Dans leurs souvenirs ? Tu peux me rayer ; j’ai jamais existé, mais en échange tu dis à ta secrétaire la belle faucheuse de barrer leurs noms de sa liste ! De leur foutre la paix ad vitam aeternam ! Avec en prime à l’apocalypse accès direct au paradis avec forfait illimité en première classe sans passer par la case purgatoire. Et une fois là-haut par pitié, tu leur zappes les chaînes d’infos ! Ah ! Je délire ! … Si seulement ! … mais bon… elle est maligne, y a pas de marchandage possible : elle passerait son temps à négocier derrière son bureau.
Ah ouiiiiii ! Je sais ! Si l’on continue dans la séquence « je refais le monde », on pourrait faire ça : notre argent devrait être remplacé par l’amour (le vrai) que les gens ont pour nous. Y en aurait des milliardaires qui finiraient sous les ponts, moi j’vous dis !
L’amour et la mort hein ? Couple mythique, on n’refera pas tout l’tintouin, un monde de totale indifférence, c’est peut-être ça l’Enfer… Pourquoi j’ai l’impression qu’on est en plein dedans !? Parfois, quand je prends le métro le matin, j’me dis qu’on est pas loin… Peut-être parce que personne a envie d’me r’garder… Je les comprends… Peut-être que je me regarderais pas non plus si je pouvais… mais bon ! Faut bien se laver de temps en temps !
J’m’appelle Emmanuelle, 32 ans, SDF (Sans Douceur Féminine) et j’vous emmerde. Bien profond.
Le chant de l’abnégateur
Pour rafraîchir les plaintes de la Terre
Je lève les yeux
Je deviens cette bouche ouverte comme un trou noir
À la circonférence parfaite
Mon cri n’est pas cette rage aiguë déformant les visages
Ni la haine des harpies qui déchirent les montagnes
J’expire un chant cosmique à l’écho infini
Qui statufie l’oreille et encercle l’Être
Rase la surface des maux
Et telle une droite lumineuse pourfend les rideaux du vide
Les cailloux sont mes timbales
Comme un couteau lumineux et tranchant
La félicité de la matière
ou
Des gros
Dans l’avion, temps écoulé : 2 heures
Jusqu’à maintenant je les avais peu vus, mais je les aimais bien. Ils étaient drôles et gras tout comme moi, à la réserve près que, des kilos en trop, ils n’en étaient pas, eux, préoccupés ou tourmentés, le moins du monde.
L’un d’eux n’en finissait pas d’enfler.
Toutes et tous se lovaient voluptueusement dans leur glouglou ventral et roulaient, s’y déplaçaient comme dans une petite voiture, peut-être une Fiat Punto, ou comme dans un second corps au cas où le premier n’eût pas suffi pour les protéger des intempéries du climat, des agressions extérieures ou des aléas de l’existence humaine.
Ils allaient la cueillir. Cette graisse. Avec une jovialité fauve, suave, gélatineuse et même communautariste ; une nonchalance éthérée, un je m’enfoutisme d’aristocrate bon-enfant presque abstrait ou impressionniste ; géométrique, translucide, exacerbé, ondulatoire ; une mollesse médusine et mollusqueuse ; enfin, je ne sais pas ; un je-ne-sais-quoi de pâte-à-modelin, une flamboyance d’arc-en-ciel ; peut-être un sublime quadridimensionnel et tésséractal de l’indifférence aux rondeurs superflues, qui ne retenait jamais leurs bouches prêtes à poser leurs crocs, ni leurs mains rapaces avides de jeter leurs serres, sans une once de remords, sur une patte de poulet trop longtemps dédaignée ou une énième côte de bœuf implorante.
Sans exagérer, à ne vous point mentir, ils accueillaient, aspiraient, accumulaient, entassaient, buvaient, ramassaient, compilaient, empilaient, empalaient, assemblaient, mélangeaient, juxtaposaient, superposaient, écrasaient, malaxaient, engraissaient, bref. Ils, elles, la prenaient. Cette graisse. Comme une manne céleste, une sève régénératrice, un flux vital plus fluidifiant que le sang, plus oxygéné que les globules rouges. Le cholestérol s’unissait aux artères dans un mariage d’amour. Le sucre glissait joyeux sur l’insuline. L’estomac criait sa fureur à la salade. Les yeux pleuraient devant la pomme. Les muscles effrayés tremblaient devant le sport télévisuel. Affolés, les dents quand ils ne mâchaient pas. La langue malade de ne rien goûter. Les mains tristes de ne rien porter à la bouche qui ne souriait qu’une fois ouverte. Toutes les parties du corps et de l’âme ne criaient leur amour et ne jouissaient en chœur que dans une messe vouée à l’absorption éternelle du pain et du vin. C’étaient des bipèdes devenus quadruventres, des bâtons devenus cercles, ou si l’on veut, en trois dimensions, des cylindres devenus sphères. Prodige de géométrie et d’architecture. Ils s’y logeaient comme dans un T3. Un abandon total au Dieu de la sauce et de la friture qu’ils faisaient ployer sous les honneurs et les offrandes gastriques. Dans le rire gras, l’embonpoint bienheureux, la félicité suprême, bref, l’essence même de la vie.
Matinée
L’irisation courbée des myosotis est sucrée
dans les bleus et les blonds des jours
Une journée avec tonton
— Tonton !
— Gigi !
Je vole.
J’ai couru et je me suis jetée dans les bras de tonton Icare. Il m’a soulevée et il m’a fait tourner dans les airs comme un avion très rapide. Je me sens comme un oiseau et je ris. Je suis heureuse. Je commence à avoir le tournis, mais je m’en fiche. Tonton Icare est là !
J’adore quand il me porte comme ça ! Ça fait longtemps que mes parents ne me portent plus. Ils disent que j’ai passé l’âge, mais moi ça me manque ! C’est pour ça que je suis toujours pressée que tonton vienne nous voir. C’est le seul qui veut bien encore me porter. Pourtant, il dit tous les ans que j’ai grandi. Je sais qu’un jour, il ne pourra plus, alors j’en profite. Et pour que ça dure le plus longtemps possible, il faut que je reste légère le plus longtemps possible. C’est pour ça que six mois avant de le voir, je fais un régime : je divise ma ration de glace par deux. C’est dur ! Mais je veux que tonton puisse me porter encore longtemps ! Alors pas le choix…