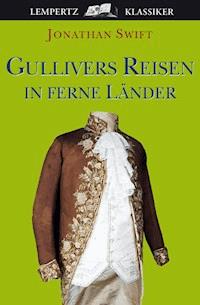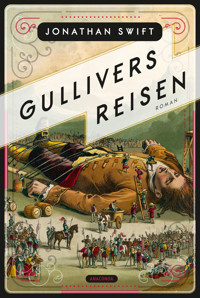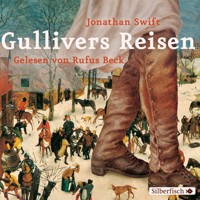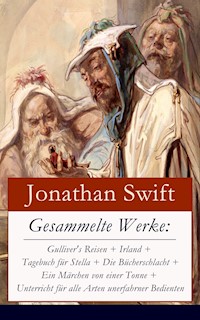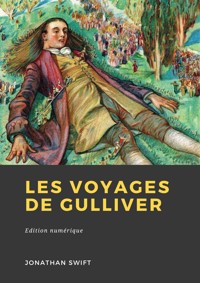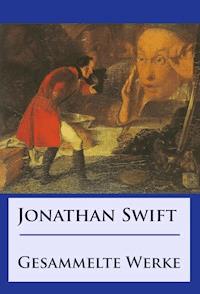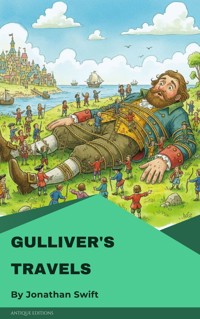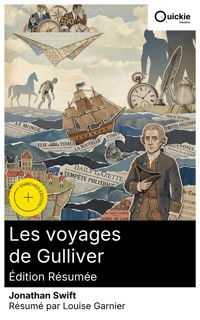Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Französisch
RÉSUMÉ : "Les Voyages extraordinaires de Gulliver" est un roman classique de la littérature anglaise écrit par Jonathan Swift. Publié pour la première fois en 1726, ce récit d'aventures se divise en quatre parties, chacune décrivant un voyage fantastique entrepris par le protagoniste, Lemuel Gulliver. Le roman commence avec Gulliver naufragé sur l'île de Lilliput, où il découvre un peuple de minuscules habitants. Ces rencontres révèlent une satire sociale qui critique les moeurs politiques et culturelles de l'époque. Dans le second voyage, Gulliver se retrouve à Brobdingnag, un pays de géants, où sa perspective change radicalement, mettant en lumière les faiblesses et les absurdités de la société humaine. Son troisième voyage le conduit à Laputa, une île volante peuplée de philosophes et de scientifiques, où Swift dénonce l'inefficacité de la science déconnectée de la réalité. Enfin, Gulliver atteint le pays des Houyhnhnms, des chevaux dotés de raison, où il est confronté à des Yahoos, créatures sauvages et dépravées qui ressemblent étrangement aux humains. À travers ces aventures, Swift utilise une narration vivante et imaginative pour offrir une critique acerbe des comportements humains, des institutions politiques et des prétentions scientifiques. "Les Voyages extraordinaires de Gulliver" est à la fois une oeuvre de divertissement et une réflexion profonde sur la nature humaine et la société. __________________________________________ BIOGRAPHIE DE L'AUTEUR : Jonathan Swift est né le 30 novembre 1667 à Dublin, en Irlande. Considéré comme l'un des plus grands satiristes de la langue anglaise, Swift a étudié au Trinity College de Dublin avant de s'installer en Angleterre, où il a commencé sa carrière littéraire. Il a d'abord travaillé comme secrétaire pour Sir William Temple, un diplomate influent, ce qui lui a permis de fréquenter les cercles littéraires et politiques de l'époque. Swift est devenu doyen de la cathédrale Saint-Patrick à Dublin en 1713, une position qu'il a occupée jusqu'à sa mort en 1745. Outre "Les Voyages extraordinaires de Gulliver", Swift est également connu pour ses oeuvres satiriques comme "A Modest Proposal" et "The Tale of a Tub". Son style est caractérisé par une ironie mordante et une critique sociale incisive, souvent dirigée contre les institutions politiques et religieuses de son temps.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 406
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Sommaire
Voyage à Lilliput
Chapitre I
Chapitre II
Chapitre III
Chapitre IV
Chapitre V
Chapitre VI
Chapitre VII
Chapitre VIII
Voyage à Brobdingnag
Chapitre I
Chapitre II
Chapitre III
Chapitre IV
Chapitre V
Chapitre VI
Voyage à Laputa, aux Balnibarbes, à Luggnagg, à Gloubbdoubdrie et au Japon
Chapitre I
Chapitre II
Chapitre III
Chapitre IV
Chapitre V
Chapitre VI
Chapitre VII
Chapitre VIII
Chapitre IX
Chapitre X
Voyage au pays des Houyhnhnms
Chapitre I
Chapitre II
Chapitre III
Chapitre IV
Chapitre V
Chapitre VI
Chapitre VII
Chapitre VIII
Chapitre IX
Chapitre X
Chapitre XI
Chapitre XII
Extrait d’un pamphlet sur l’Irlande
Voyage à Lilliput
Chapitre I
L’auteur rend un compte succinct des premiers motifs qui le portèrent à voyager. Il fait naufrage et se sauve à la nage dans le pays de Lilliput. On l’enchaîne et on le conduit en cet état plus avant dans les terres.
Mon père, dont le bien, situé dans la province de Nottingham, était médiocre, avait cinq fils : j’étais le troisième, et il m’envoya au collège d’Emmanuel, à Cambridge, à l’âge de quatorze ans. J’y demeurai trois années, que j’employai utilement. Mais la dépense de mon entretien au collège était trop grande, on me mit en apprentissage sous M. Jacques Bates, fameux chirurgien à Londres, chez qui je demeurai quatre ans. Mon père m’envoyant de temps en temps quelques petites sommes d’argent, je les employai à apprendre le pilotage et les autres parties des mathématiques les plus nécessaires à ceux qui forment le dessein de voyager sur mer, ce que je prévoyais être ma destinée. Ayant quitté M. Bates, je retournai chez mon père ; et, tant de lui que de mon oncle Jean et de quelques autres parents, je tirai la somme de quarante livres sterling par an pour me soutenir à Leyde. Je m’y rendis et m’y appliquai à l’étude de la médecine pendant deux ans et sept mois, persuadé qu’elle me serait un jour très utile dans mes voyages.
Bientôt après mon retour de Leyde, j’eus, à la recommandation de mon bon maître M. Bates, l’emploi de chirurgien sur l’Hirondelle, où je restai trois ans et demi, sous le capitaine Abraham Panell, commandant. Je fis pendant ce temps-là des voyages au Levant et ailleurs. À mon retour, je résolus de m’établir à Londres. M. Bates m’encouragea à prendre ce parti, et me recommanda à ses malades. Je louai un appartement dans un petit hôtel situé dans le quartier appelé Old-Jewry, et bientôt après j’épousai Mlle Marie Burton, seconde fille de M. Édouard Burton, marchand dans la rue de Newgate, laquelle m’apporta quatre cents livres sterling en mariage.
Mais mon cher maître M. Bates étant mort deux ans après, et n’ayant plus de protecteur, ma pratique commença à diminuer. Ma conscience ne me permettait pas d’imiter la conduite de la plupart des chirurgiens, dont la science est trop semblable à celle des procureurs : c’est pourquoi, après avoir consulté ma femme et quelques autres de mes intimes amis, je pris la résolution de faire encore un voyage de mer. Je fus chirurgien successivement dans deux vaisseaux ; et plusieurs autres voyages que je fis, pendant six ans, aux Indes orientales et occidentales, augmentèrent un peu ma petite fortune. J’employais mon loisir à lire les meilleurs auteurs anciens et modernes, étant toujours fourni d’un certain nombre de livres, et, quand je me trouvais à terre, je ne négligeais pas de remarquer les mœurs et les coutumes des peuples, et d’apprendre en même temps la langue du pays, ce qui me coûtait peu, ayant la mémoire très bonne.
Le dernier de ces voyages n’ayant pas été heureux, je me trouvai dégoûté de la mer, et je pris le parti de rester chez moi avec ma femme et mes enfants. Je changeai de demeure, et me transportai de l’Old-Jewry à la rue de Fetter-Lane, et de là à Wapping, dans l’espérance d’avoir de la pratique parmi les matelots ; mais je n’y trouvai pas mon compte.
Après avoir attendu trois ans, et espéré en vain que mes affaires iraient mieux, j’acceptai un parti avantageux qui me fut proposé par le capitaine Guillaume Prichard, prêt à monter l’Antilope et à partir pour la mer du Sud. Nous nous embarquâmes à Bristol, le 4 de mai 1699, et notre voyage fut d’abord très heureux.
Il est inutile d’ennuyer le lecteur par le détail de nos aventures dans ces mers ; c’est assez de lui faire savoir que, dans notre passage aux Indes orientales, nous essuyâmes une tempête dont la violence nous poussa vers le nord-ouest de la terre de Van-Diémen. Par une observation que je fis, je trouvai que nous étions à 30° 2’ de latitude méridionale. Douze hommes de notre équipage étaient morts par le travail excessif et par la mauvaise nourriture. Le 5 novembre, qui était le commencement de l’été dans ces pays-là, le temps étant un peu noir, les mariniers aperçurent un roc qui n’était éloigné du vaisseau que de la longueur d’un câble ; mais le vent était si fort que nous fûmes directement poussés contre l’écueil, et que nous échouâmes dans un moment. Six hommes de l’équipage, dont j’étais un, s’étant jetés à propos dans la chaloupe, trouvèrent le moyen de se débarrasser du vaisseau et du roc. Nous allâmes à la rame environ trois lieues ; mais à la fin la lassitude ne nous permit plus de ramer ; entièrement épuisés, nous nous abandonnâmes au gré des flots, et bientôt nous fûmes renversés par un coup de vent du nord.
Je n’ai jamais su quel fut le sort de mes camarades de la chaloupe, ni de ceux qui se sauvèrent sur le roc, ou qui restèrent dans le vaisseau ; mais je crois qu’ils périrent tous ; pour moi, je nageai à l’aventure, et fus poussé, vers la terre par le vent et la marée. Je laissai souvent tomber mes jambes, mais sans toucher le fond. Enfin, étant près de m’abandonner, je trouvai pied dans l’eau, et alors la tempête était bien diminuée. Comme la pente était presque insensible, je marchai une demi-lieue dans la mer avant que j’eusse pris terre. Je fis environ un quart de lieue sans découvrir aucune maison ni aucun vestige d’habitants, quoique ce pays fût très peuplé. La fatigue, la chaleur et une demi-pinte d’eau-de-vie que j’avais bue en abandonnant le vaisseau, tout cela m’excita à dormir. Je me couchai sur l’herbe, qui était très fine, où je fus bientôt enseveli dans un profond sommeil, qui dura neuf heures. Au bout de ce temps-là, m’étant éveillé, j’essayai de me lever ; mais ce fut en vain. Je m’étais couché sur le dos ; je trouvai mes bras et mes jambes attachés à la terre de l’un et de l’autre côté, et mes cheveux attachés de la même manière. Je trouvai même plusieurs ligatures très minces qui entouraient mon corps, depuis mes aisselles jusqu’à mes cuisses. Je ne pouvais que regarder en haut ; le soleil commençait à être fort chaud, et sa grande clarté blessait mes yeux. J’entendis un bruit confus autour de moi, mais, dans la posture où j’étais, je ne pouvais rien voir que le soleil. Bientôt je sentis remuer quelque chose sur ma jambe gauche, et cette chose, avançant doucement sur ma poitrine, monter presque jusqu’à mon menton. Quel fut mon étonnement lorsque j’aperçus une petite figure de créature humaine haute tout au plus de trois pouces, un arc et une flèche à la main, avec un carquois sur le dos ! J’en vis en même temps au moins quarante autres de la même espèce. Je me mis soudain à jeter des cris si horribles, que tous ces petits animaux se retirèrent transis de peur ; et il y en eut même quelques-uns, comme je l’ai appris ensuite, qui furent dangereusement blessés par les chutes précipitées qu’ils firent en sautant de dessus mon corps à terre. Néanmoins ils revinrent bientôt, et l’un d’eux, qui eut la hardiesse de s’avancer si près qu’il fut en état de voir entièrement mon visage, levant les mains et les yeux par une espèce d’admiration, s’écria d’une voix aigre, mais distincte : Hekinah Degul. Les autres répétèrent plusieurs fois les mêmes mots ; mais alors je n’en compris pas le sens. J’étais, pendant ce temps-là, étonné, inquiet, troublé, et tel que serait le lecteur en pareille situation. Enfin, faisant des efforts pour me mettre en liberté, j’eus le bonheur de rompre les cordons ou fils, et d’arracher les chevilles qui attachaient mon bras droit à la terre ; car, en le haussant un peu, j’avais découvert ce qui me tenait attaché et captif. En même temps, par une secousse violente qui me causa une douleur extrême, je lâchai un peu les cordons qui attachaient mes cheveux du côté droit (cordons plus fins que mes cheveux mêmes), en sorte que je me trouvai en état de procurer à ma tête un petit mouvement libre. Alors ces insectes humains se mirent en fuite et poussèrent des cris très aigus. Ce bruit cessant, j’entendis un d’eux s’écrier : Tolgo Phonac, et aussitôt je me sentis percé à la main de plus de cent flèches qui me piquaient comme autant d’aiguilles. Ils firent ensuite une autre décharge en l’air, comme nous tirons des bombes en Europe, dont plusieurs, je crois, tombaient paraboliquement sur mon corps, quoique je ne les aperçusse pas, et d’autres sur mon visage, que je tâchai de me couvrir avec ma main droite. Quand cette grêle de flèches fut passée, je m’efforçai encore de me détacher ; mais on fit alors une autre décharge plus grande que la première, et quelques-uns tâchaient de me percer de leurs lances ; mais, par bonheur, je portais une veste impénétrable de peau de buffle. Je crus donc que le meilleur parti était de me tenir en repos et de rester comme j’étais jusqu’à la nuit ; qu’alors, dégageant mon bras gauche, je pourrais me mettre tout à fait en liberté, et, à l’égard des habitants, c’était avec raison que je me croyais d’une force égale aux plus puissantes armées qu’ils pourraient mettre sur pied pour m’attaquer, s’ils étaient tous de la même taille que ceux que j’avais vus jusque-là. Mais la fortune me réservait un autre sort.
Quand ces gens eurent remarqué que j’étais tranquille, ils cessèrent de me décocher des flèches ; mais, par le bruit que j’entendis, je connus que leur nombre s’augmentait considérablement, et, environ à deux toises loin de moi, vis-à-vis de mon oreille gauche, j’entendis un bruit pendant plus d’une heure comme des gens qui travaillaient. Enfin, tournant un peu ma tête de ce côté-là, autant que les chevilles et les cordons me le permettaient, je vis un échafaud élevé de terre d’un pied et demi, où quatre de ces petits hommes pouvaient se placer, et une échelle pour y monter ; d’où un d’entre eux, qui me semblait être une personne de condition, me fit une harangue assez longue, dont je ne compris pas un mot. Avant que de commencer, il s’écria trois fois : Langro Dehul san. Ces mots furent répétés ensuite, et expliqués par des signes pour me les faire entendre. Aussitôt cinquante hommes s’avancèrent, et coupèrent les cordons qui attachaient le côté gauche de ma tête ; ce qui me donna la liberté de la tourner à droite et d’observer la mine et l’action de celui qui devait parler. Il me parut être de Moyen Âge, et d’une taille plus grande que les trois autres qui l’accompagnaient, dont l’un, qui avait l’air d’un page, tenait la queue de sa robe, et les deux autres étaient debout de chaque côté pour le soutenir. Il me sembla bon orateur, et je conjecturai que, selon les règles de l’art, il mêlait dans son discours des périodes pleines de menaces et de promesses. Je fis la réponse en peu de mots, c’est-à-dire par un petit nombre de signes, mais d’une manière pleine de soumission, levant ma main gauche et les deux yeux au soleil, comme pour le prendre à témoin que je mourais de faim, n’ayant rien mangé depuis longtemps. Mon appétit était, en effet, si pressant que je ne pus m’empêcher de faire voir mon impatience (peut-être contre les règles de l’honnêteté) en portant mon doigt très souvent à ma bouche, pour faire connaître que j’avais besoin de nourriture.
L’Hurgo (c’est ainsi que, parmi eux, on appelle un grand seigneur, comme je l’ai ensuite appris) m’entendit fort bien. Il descendit de l’échafaud, et ordonna que plusieurs échelles fussent appliquées à mes côtés, sur lesquelles montèrent bientôt plus de cent hommes qui se mirent en marche vers ma bouche, chargés de paniers pleins de viandes. J’observai qu’il y avait de la chair de différents animaux, mais je ne les pus distinguer par le goûter. Il y avait des épaules et des éclanches en forme de selles de mouton, et fort bien accommodées, mais plus petites que les ailes d’une alouette ; j’en avalai deux ou trois d’une bouchée avec six pains. Ils me fournirent tout cela, témoignant de grandes marques d’étonnement et d’admiration à cause de ma taille et de mon prodigieux appétit. Ayant fait un autre signe pour leur faire savoir qu’il me manquait à boire, ils conjecturèrent, par la façon dont je mangeais, qu’une petite quantité de boisson ne me suffirait pas ; et, étant un peuple d’esprit, ils levèrent avec beaucoup d’adresse un des plus grands tonneaux de vin qu’ils eussent, le roulèrent vers ma main et le défoncèrent. Je le bus d’un seul coup avec un grand plaisir. On m’en apporta un autre muid, que je bus de même, et je fis plusieurs signes pour avertir de me voiturer encore quelques autres muids.
Après m’avoir vu faire toutes ces merveilles, ils poussèrent des cris de joie et se mirent à danser, répétant plusieurs fois, comme ils avaient fait d’abord : Hehinah Degul. Bientôt après, j’entendis une acclamation universelle, avec de fréquentes répétitions de ces mots : Peplom Selan, et j’aperçus un grand nombre de peuple sur mon côté gauche, relâchant les cordons à un tel point que je me trouvai en état de me tourner, et d’avoir le soulagement d’uriner, fonction dont je m’acquittai au grand étonnement du peuple, lequel, devinant ce que j’allais faire, s’ouvrit impétueusement à droite et à gauche pour éviter le déluge. Quelque temps auparavant, on m’avait frotté charitablement le visage et les mains d’une espèce d’onguent d’une odeur agréable, qui, dans très peu de temps, me guérit de la piqûre des flèches. Ces circonstances, jointes aux rafraîchissements que j’avais reçus, me disposèrent à dormir ; et mon sommeil fut environ de huit heures, sans me réveiller, les médecins, par ordre de l’empereur, ayant frelaté le vin et y ayant mêlé des drogues soporifiques.
Tandis que je dormais, l’empereur de Lilliput (c’était le nom de ce pays) ordonna de me faire conduire vers lui. Cette résolution semblera peut-être hardie et dangereuse, et je suis sûr qu’en pareil cas elle ne serait du goût d’aucun souverain de l’Europe ; cependant, à mon avis, c’était un dessein également prudent et dangereux ; car, en cas que ces peuples eussent tenté de me tuer avec leurs lances et leurs flèches pendant que je dormais, je me serais certainement éveillé au premier sentiment de douleur, ce qui aurait excité ma fureur et augmenté mes forces à un tel degré, que je me serais trouvé en état de rompre le reste des cordons ; et, après cela, comme ils n’étaient pas capables de me résister, je les aurais tous écrasés et foudroyés.
On fit donc travailler à la hâte cinq mille charpentiers et ingénieurs pour construire une voiture : c’était un chariot élevé de trois pouces, ayant sept pieds de longueur et quatre de largeur, avec vingt-deux roues. Quand il fut achevé, on le conduisit au lieu où j’étais. Mais la principale difficulté fut de m’élever et de me mettre sur cette voiture. Dans cette vue, quatre-vingts perches, chacune de deux pieds de hauteur, furent employées ; et des cordes très fortes, de la grosseur d’une ficelle, furent attachées, par le moyen de plusieurs crochets, aux bandages que les ouvriers avaient ceints autour de mon cou, de mes mains, de mes jambes et de tout mon corps. Neuf cents hommes des plus robustes furent employés à élever ces cordes par le moyen d’un grand nombre de poulies attachées aux perches ; et, de cette façon, dans moins de trois heures de temps, je fus élevé, placé et attaché dans la machine. Je sais tout cela par le rapport qu’on m’en a fait depuis, car, pendant cette manœuvre, je dormais très profondément. Quinze cents chevaux, les plus grands de l’écurie de l’empereur, chacun d’environ quatre pouces et demi de haut, furent attelés au chariot, et me traînèrent vers la capitale, éloignée d’un quart de lieue.
Il y avait quatre heures que nous étions en chemin, lorsque je fus subitement éveillé par un accident assez ridicule. Les voituriers s’étant arrêtés un peu de temps pour raccommoder quelque chose, deux ou trois habitants du pays avaient eu la curiosité de regarder ma mine pendant que je dormais ; et, s’avançant très doucement jusqu’à mon visage, l’un d’entre eux, capitaine aux gardes, avait mis la pointe aiguë de son esponton bien avant dans ma narine gauche, ce qui me chatouilla le nez, m’éveilla, et me fit éternuer trois fois. Nous fîmes une grande marche le reste de ce jour-là, et nous campâmes la nuit avec cinq cents gardes, une moitié avec des flambeaux, et l’autre avec des arcs et des flèches, prête à tirer si j’eusse essayé de me remuer. Le lendemain au lever du soleil, nous continuâmes notre voyage, et nous arrivâmes sur le midi à cent toises des portes de la ville. L’empereur et toute la cour sortirent pour nous voir ; mais les grands officiers ne voulurent jamais consentir que Sa Majesté hasardât sa personne en montant sur mon corps, comme plusieurs autres avaient osé faire.
À l’endroit où la voiture s’arrêta, il y avait un temple ancien, estimé le plus grand de tout le royaume, lequel, ayant été souillé quelques années auparavant par un meurtre, était, selon la prévention de ces peuples, regardé comme profane, et, pour cette raison, employé à divers usages. Il fut résolu que je serais logé dans ce vaste édifice. La grande porte, regardant le nord, était environ de quatre pieds de haut, et presque de deux pieds de large ; de chaque côté de la porte, il y avait une petite fenêtre élevée de six pouces. À celle qui était du côté gauche, les serruriers du roi attachèrent quatre-vingt-onze chaînes, semblables à celles qui sont attachées à la montre d’une dame d’Europe, et presque aussi larges ; elles furent par l’autre bout attachées à ma jambe gauche avec trente-six cadenas. Vis-à-vis de ce temple, de l’autre côté du grand chemin, à la distance de vingt pieds, il y avait une tour d’au moins cinq pieds de haut ; c’était là que le roi devait monter avec plusieurs des principaux seigneurs de sa cour pour avoir la commodité de me regarder à son aise. On compte qu’il y eut plus de cent mille habitants qui sortirent de la ville, attirés par la curiosité, et, malgré mes gardes, je crois qu’il n’y aurait pas eu moins de dix mille hommes qui, à différentes fois, auraient monté sur mon corps par des échelles, si on n’eût publié un arrêt du conseil d’État pour le défendre. On ne peut s’imaginer le bruit et l’étonnement du peuple quand il me vit debout et me promener : les chaînes qui tenaient mon pied gauche étaient environ de six pieds de long, et me donnaient la liberté d’aller et de venir dans un demi-cercle.
Chapitre II
L’empereur de Lilliput, accompagné de plusieurs de ses courtisans, vient pour voir l’auteur dans sa prison. Description de la personne et de l’habit de Sa Majesté. Gens savants nommés pour apprendre la langue à l’auteur. Il obtient des grâces par sa douceur. Ses poches sont visitées.
L’empereur, à cheval, s’avança un jour vers moi, ce qui pensa lui coûter cher : à ma vue, son cheval, étonné, se cabra ; mais ce prince, qui est un cavalier excellent, se tint ferme sur ses étriers jusqu’à ce que sa suite accourût et prît la bride. Sa Majesté, après avoir mis pied à terre, me considéra de tous côtés avec une grande admiration, mais pourtant se tenant toujours, par précaution, hors de la portée de ma chaîne.
L’impératrice, les princes et princesses du sang, accompagnés de plusieurs dames, s’assirent à quelque distance dans des fauteuils. L’empereur est plus grand qu’aucun de sa cour, ce qui le fait redouter par ceux qui le regardent ; les traits de son visage sont grands et mâles, avec une lèvre épaisse et un nez aquilin ; il a un teint d’olive, un air élevé, et des membres bien proportionnés, de la grâce et de la majesté dans toutes ses actions. Il avait alors passé la fleur de sa jeunesse, étant âgé de vingt-huit ans et trois quarts, dont il en avait régné environ sept. Pour le regarder avec plus de commodité je me tenais couché sur le côté, en sorte que mon visage pût être parallèle au sien ; et il se tenait à une toise et demie loin de moi. Cependant, depuis ce temps-là, je l’ai eu plusieurs fois dans ma main ; c’est pourquoi je ne puis me tromper dans le portrait que j’en fais. Son habit était uni et simple, et fait moitié à l’asiatique et moitié à l’européenne ; mais il avait sur la tête un léger casque d’or, orné de joyaux et d’un plumet magnifique. Il avait son épée nue à la main, pour se défendre en cas que j’eusse brisé mes chaînes ; cette épée était presque longue de trois pouces ; la poignée et le fourreau étaient d’or et enrichis de diamants. Sa voix était aigre, mais claire et distincte, et je le pouvais entendre aisément, même quand je me tenais debout. Les dames et les courtisans étaient tous habillés superbement ; en sorte que la place qu’occupait toute la cour paraissait à mes yeux comme une belle jupe étendue sur la terre, et brodée de figures d’or et d’argent. Sa Majesté impériale me fit l’honneur de me parler souvent ; et je lui répondis toujours ; mais nous ne nous entendions ni l’un ni l’autre.
Au bout de deux heures, la cour se retira, et on me laissa une forte garde pour empêcher l’impertinence, et peut-être la malice de la populace, qui avait beaucoup d’impatience de se rendre en foule autour de moi pour me voir de près. Quelques-uns d’entre eux eurent l’effronterie et la témérité de me tirer des flèches, dont une pensa me crever l’œil gauche. Mais le colonel fit arrêter six des principaux de cette canaille, et ne jugea point de peine mieux proportionnée à leur faute que de les livrer liés et garrottés dans mes mains. Je les pris donc dans ma main droite et en mis cinq dans la poche de mon justaucorps, et à l’égard du sixième, je feignis de le vouloir manger tout vivant. Le pauvre petit homme poussait des hurlements horribles, et le colonel avec ses officiers étaient fort en peine, surtout quand ils me virent tirer mon canif. Mais, je fis bientôt cesser leur frayeur, car, avec un air doux et humain, coupant promptement les cordes dont il était garrotté, je le mis doucement à terre, et il prit la fuite. Je traitai les autres de la même façon, les tirant successivement l’un après l’autre de ma poche. Je remarquai avec plaisir que les soldats et le peuple avaient été très touchés de cette action d’humanité, qui fut rapportée à la cour d’une manière très avantageuse, et qui me fit honneur.
La nouvelle de l’arrivée d’un homme prodigieusement grand, s’étant répandue dans tout le royaume, attira un nombre infini de gens oisifs et curieux ; en sorte que les villages furent presque abandonnés, et que la culture de la terre en aurait souffert, si Sa Majesté impériale n’y avait pourvu par différents édits et ordonnances. Elle ordonna donc que tous ceux qui m’avaient déjà vu retourneraient incessamment chez eux, et n’approcheraient point, sans une permission particulière, du lieu de mon séjour. Par cet ordre, les commis des secrétaires d’État gagnèrent des sommes très considérables.
Cependant l’empereur tint plusieurs conseils pour délibérer sur le parti qu’il fallait prendre à mon égard. J’ai su depuis que la cour avait été fort embarrassée. On craignait que je ne vinsse à briser mes chaînes et à me mettre en liberté ; on disait que ma nourriture, causant une dépense excessive, était capable de produire une disette de vivres ; on opinait quelquefois à me faire mourir de faim, ou à me percer de flèches empoisonnées ; mais on fit réflexion que l’infection d’un corps tel que le mien pourrait produire la peste dans la capitale et dans tout le royaume. Pendant qu’on délibérait, plusieurs officiers de l’armée se rendirent à la porte de la grand-chambre où le conseil impérial était assemblé, et deux d’entre eux, ayant été introduits, rendirent compte de ma conduite à l’égard des six criminels dont j’ai parlé, ce qui fit une impression si favorable sur l’esprit de Sa Majesté et de tout le conseil, qu’une commission impériale fut aussitôt expédiée pour obliger tous les villages, à quatre cent cinquante toises aux environs de la ville, de livrer tous les matins six bœufs, quarante moutons et d’autres vivres pour ma nourriture, avec une quantité proportionnée de pain et de vin et d’autres boissons. Pour le payement de ces vivres, Sa Majesté donna des assignations sur son trésor. Ce prince n’a d’autres revenus que ceux de son domaine, et ce n’est que dans des occasions importantes qu’il lève des impôts sur ses sujets, qui sont obligés de le suivre à la guerre à leurs dépens. On nomma six cents personnes pour me servir, qui furent pourvues d’appointements pour leur dépense de bouche et de tentes construites très commodément de chaque côté de ma porte.
Il fut aussi ordonné que trois cents tailleurs me feraient un habit à la mode du pays ; que six hommes de lettres, des plus savants de l’empire, seraient chargés de m’apprendre la langue, et enfin, que les chevaux de l’empereur et ceux de la noblesse et les compagnies des gardes feraient souvent l’exercice devant moi pour les accoutumer à ma figure. Tous ces ordres furent ponctuellement exécutés. Je fis de grands progrès dans la connaissance de la langue de Lilliput. Pendant ce temps-là l’empereur m’honora de visites fréquentes, et même voulut bien aider mes maîtres de langue à m’instruire.
Les premiers mots que j’appris furent pour lui faire savoir l’envie que j’avais qu’il voulût bien me rendre ma liberté ; ce que je lui répétais tous les jours à genoux. Sa réponse fut qu’il fallait attendre encore un peu de temps, que c’était une affaire sur laquelle il ne pouvait se déterminer sans l’avis de son conseil, et que, premièrement, il fallait que je promisse par serment l’observation d’une paix inviolable avec lui et avec ses sujets ; qu’en attendant, je serais traité avec toute l’honnêteté possible. Il me conseilla de gagner ; par ma patience et par ma bonne conduite, son estime et celle de ses peuples. Il m’avertit de ne lui savoir point mauvais gré s’il donnait ordre à certains officiers de me visiter, parce que, vraisemblablement, je pourrais porter sur moi plusieurs armes dangereuses et préjudiciables à la sûreté de ses États. Je répondis que j’étais prêt à me dépouiller de mon habit et à vider toutes mes poches en sa présence. Il me repartit que, par les lois de l’empire, il fallait que je fusse visité par deux commissaires ; qu’il savait bien que cela ne pouvait se faire sans mon consentement ; mais qu’il avait si bonne opinion de ma générosité et de ma droiture, qu’il confierait sans crainte leurs personnes entre mes mains ; que tout ce qu’on m’ôterait me serait rendu fidèlement quand je quitterais le pays, ou que j’en serais remboursé selon l’évaluation, que j’en ferais moi-même.
Lorsque les deux commissaires vinrent pour me fouiller, je pris ces messieurs dans mes mains, je les mis d’abord dans les poches de mon justaucorps et ensuite dans toutes mes autres poches.
Ces officiers du prince, ayant des plumes, de l’encre et du papier sur eux, firent un inventaire très exact de tout ce qu’ils virent ; et, quand ils eurent achevé ; ils me prièrent de les mettre à terre, afin qu’ils pussent rendre compte de leur visite à l’empereur.
Cet inventaire était conçu dans les termes suivants :
« Premièrement, dans la poche droite du justaucorps du grand homme Montagne (c’est ainsi que je rends ces mots : Quinbus Flestrin), après une visite exacte, nous n’avons trouvé qu’un morceau de toile grossière, assez grand pour servir de tapis de pied, dans la principale chambre de parade de Votre Majesté. Dans la poche gauche ; nous avons trouvé un grand coffre d’argent avec un couvercle de même métal, que nous, commissaires, n’avons pu lever (ma tabatière). Nous avons prié ledit homme Montagne de l’ouvrir, et, l’un de nous étant entré dedans, a eu de la poussière jusqu’aux genoux, dont il a éternué pendant deux heures, et l’autre pendant sept minutes. Dans la poche droite de sa veste, nous avons trouvé un paquet prodigieux de substances blanches et minces, pliées l’une sur l’autre, environ de la grosseur de trois hommes, attachées d’un câble bien fort et marquées de grandes figures noires, lesquelles il nous a semblé être des écritures. Dans la poche gauche, il y avait une grande machine plate armée de grandes dents très longues qui ressemblent aux palissades qui sont dans la cour de Votre Majesté (un peigne). Dans la grande poche du côté droit de son couvre-milieu (c’est ainsi que je traduis le mot de ranfulo, par lequel on voulait entendre ma culotte), nous avons vu un grand pilier de fer creux, attaché à une grosse pièce de bois plus large que le pilier, et d’un côté du pilier il y avait d’autres pièces de fer en relief, serrant un caillou coupé en talus ; nous n’avons su ce que c’était (un pistolet à pierre) ; et dans la poche gauche il y avait encore une machine de la même espèce. Dans la plus petite poche du côté droit, il y avait plusieurs pièces rondes et plates, de métal rouge et blanc et d’une grosseur différente ; quelques-unes des pièces blanches, qui nous ont paru être d’argent, étaient si larges et si pesantes, que mon confrère et moi nous avons eu de la peine à les lever. Item, deux sabres de poche (deux canifs), dont la lame s’emboîtait dans une rainure du manche, et qui avait le fil fort tranchant ; ils étaient placés dans une grande boîte ou étui. Il restait deux poches à visiter : celles-ci, il les appelait goussets. C’étaient deux ouvertures coupées dans le haut de son couvre-milieu, mais fort serrées par son ventre, qui les pressait. Hors du gousset droit pendait une grande chaîne d’argent, avec une machine très merveilleuse au bout. Nous lui avons commandé de tirer hors du gousset tout ce qui tenait à cette chaîne ; cela paraissait être un globe dont la moitié était d’argent et l’autre était un métal transparent. Sur le côté transparent, nous avons vu certaines figures étranges tracées dans un cercle ; nous avons cru que nous pourrions les toucher, mais nos doigts ont été arrêtés par une substance lumineuse. Nous avons appliqué cette machine à nos oreilles ; elle faisait un bruit continuel, à peu près comme celui d’un moulin à eau, et nous avons conjecturé que c’est ou quelque animal inconnu, ou la divinité qu’il adore ; mais nous penchons plus du côté de la dernière opinion, parce qu’il nous a assuré (si nous l’avons bien entendu, car il s’exprimait fort imparfaitement) qu’il faisait rarement une chose sans l’avoir consultée ; il l’appelait son oracle, et disait qu’elle désignait le temps pour chaque action de sa vie. Du gousset gauche il tira un filet presque assez large pour servir à un pêcheur (une bourse), mais qui s’ouvrait et se refermait ; nous avons trouvé au-dedans plusieurs pièces massives d’un métal jaune ; si c’est du véritable or, il faut qu’elles soient d’une valeur inestimable.
Ainsi, ayant, par obéissance aux ordres de Votre Majesté, fouillé exactement toutes ses poches, nous avons observé une ceinture autour de son corps, faite de la peau de quelque animal prodigieux, à laquelle, du côté gauche, pendait une épée de la longueur de six hommes, et du côté droit une bourse ou poche partagée en deux cellules, chacune étant capable de tenir trois sujets de Votre Majesté. Dans une de ces cellules il y avait plusieurs globes ou balles d’un autre métal très pesant, environ de la grosseur de notre tête, et qui exigeaient une main très forte pour les lever ; l’autre cellule contenait un amas de certaines graines noires, mais peu grosses et assez légères, car nous en pouvions tenir plus de cinquante dans la paume de nos mains (des balles et de la poudre).
Tel est l’inventaire exact de tout ce que nous avons trouvé sur le corps de l’homme Montagne, qui nous a reçus avec beaucoup d’honnêteté et avec des égards conformes à la commission de Votre Majesté.
Signé et scellé le quatrième jour de la lune quatre-vingt-neuvième du règne très heureux de Votre Majesté.
« Flessen Frelock, Marsi Frelock. »
Quand cet inventaire eut été lu en présence de l’empereur, il m’ordonna, en des termes honnêtes, de lui livrer toutes ces choses en particulier. D’abord il demanda mon sabre : il avait donné ordre à trois mille hommes de ses meilleures troupes qui l’accompagnaient de l’environner à quelque distance avec leurs arcs et leurs flèches ; mais je ne m’en aperçus pas dans le moment, parce que mes yeux étaient fixés sur Sa Majesté. Il me pria donc de tirer mon sabre, qui, quoique un peu rouillé par l’eau de la mer, était néanmoins assez brillant. Je le fis, et tout aussitôt les troupes jetèrent de grands cris. Il m’ordonna de le remettre dans le fourreau et de le jeter à terre, aussi doucement que je pourrais, environ à six pieds de distance de ma chaîne. La seconde chose qu’il me demanda fut un de ces piliers creux de fer, par lesquels il entendait mes pistolets de poche ; je les lui présentai et, par son ordre, je lui en expliquai l’usage comme je pus, et, ne les chargeant que de poudre, j’avertis l’empereur de n’être point effrayé, et puis je les lirai en l’air. L’étonnement, à cette occasion, fut plus, grand qu’à la vue de mon sabre ; ils tombèrent tous à la renverse comme s’ils eussent été frappés du tonnerre ; et même l’empereur, qui était très brave, ne put revenir à lui-même qu’après quelque temps. Je lui remis mes deux pistolets de la même manière que mon sabre, avec mes sacs de plomb et de poudre, l’avertissant de ne pas approcher le sac de poudre du feu, s’il ne voulait voir son palais impérial sauter en l’air, ce qui le surprit beaucoup. Je lui remis aussi ma montre, qu’il fut fort curieux de voir, et il commanda à deux de ses gardes les plus grands de la porter sur leurs épaules, suspendue à un grand bâton, comme les charretiers des brasseurs portent un baril de bière en Angleterre. Il était étonné du bruit continuel qu’elle faisait et du mouvement de l’aiguille qui marquait les minutes ; il pouvait aisément le suivre des yeux, la vue de ces peuples étant bien plus perçante que la nôtre. Il demanda sur ce sujet le sentiment de ses docteurs, qui furent très partagés, comme le lecteur peut bien se l’imaginer.
Ensuite je livrai mes pièces d’argent et de cuivre, ma bourse, avec neuf grosses pièces d’or et quelques-unes plus petites, mon peigne, ma tabatière d’argent, mon mouchoir et mon journal. Mon sabre, mes pistolets de poche et mes sacs de poudre et de plomb furent transportés à l’arsenal de Sa Majesté ; mais tout le reste fut laissé chez moi.
J’avais une poche en particulier, qui ne fut point visitée, dans laquelle il y avait une paire de lunettes, dont je me sers quelquefois à cause de la faiblesse de mes yeux, un télescope, avec plusieurs autres bagatelles que je crus de nulle conséquence pour l’empereur, et que, pour cette raison, je ne découvris point aux commissaires, appréhendant qu’elles ne fussent gâtées ou perdues si je venais à m’en dessaisir.
Chapitre III
L’auteur divertit l’empereur et les grands de l’un et de l’autre sexe d’une manière fort extraordinaire. Description des divertissements de la cour de Lilliput. L’auteur est mis en liberté à certaines conditions.
L’empereur voulut un jour me donner le divertissement de quelque spectacle, en quoi ces peuples surpassent toutes les nations que j’ai vues, soit pour l’adresse, soit pour la magnificence ; mais rien ne me divertit davantage que lorsque je vis des danseurs de corde voltiger sur un fil blanc bien mince, long de deux pieds onze pouces.
Ceux qui pratiquent cet exercice sont les personnes qui aspirent aux grands emplois, et souhaitent de devenir les favoris de la cour ; ils sont pour cela formés dès leur jeunesse à ce noble exercice, qui convient surtout aux personnes de haute naissance. Quand une grande charge est vacante, soit par la mort de celui qui en était revêtu, soit par sa disgrâce (ce qui arrive très souvent), cinq ou six prétendants à la charge présentent une requête à l’empereur pour avoir la permission de divertir Sa Majesté et sa cour d’une danse sur la corde, et celui qui saute le plus haut sans tomber obtient la charge. Il arrive très souvent qu’on ordonne aux grands magistrats de danser aussi sur la corde, pour montrer leur habileté et pour faire connaître à l’empereur qu’ils n’ont pas perdu leur talent. Flimnap, grand trésorier de l’empire, passe pour avoir l’adresse de faire une cabriole sur la corde au moins un pouce plus haut qu’aucun autre seigneur de l’empire ; je l’ai vu plusieurs fois faire le saut périlleux (que nous appelons le somerset) sur une petite planche de bois attachée à une corde qui n’est pas plus grosse qu’une ficelle ordinaire.
Ces divertissements causent souvent des accidents funestes, dont la plupart sont enregistrés dans les archives impériales. J’ai vu moi-même deux ou trois prétendants s’estropier ; mais le péril est beaucoup plus grand quand les ministres reçoivent ordre de signaler leur adresse ; car, en faisant des efforts extraordinaires pour se surpasser eux-mêmes et pour l’emporter sur les autres, ils font presque toujours des chutes dangereuses.
On m’assura qu’un an avant mon arrivée, Flimnap se serait infailliblement cassé la tête en tombant, si un des coussins du roi ne l’eût préservé.
Il y a un autre divertissement qui n’est que pour l’empereur, l’impératrice et pour le premier ministre. L’empereur met sur une table trois fils de soie très déliés, longs de six pouces ; l’un est cramoisi, le second jaune, et le troisième blanc. Ces fils sont proposés comme prix à ceux que l’empereur veut distinguer par une marque singulière de sa faveur. La cérémonie est faite dans la grand-chambre d’audience de Sa Majesté, où les concurrents sont obligés de donner une preuve de leur habileté, telle que je n’ai rien vu de semblable dans aucun autre pays de l’ancien ou du nouveau monde.
L’empereur tient un bâton, les deux bouts parallèles à l’horizon, tandis que les concurrents, s’avançant successivement, sautent par-dessus le bâton. Quelquefois l’empereur tient un bout et son premier ministre tient l’autre ; quelquefois le ministre le tient tout seul. Celui qui réussit le mieux et montre plus d’agilité et de souplesse en sautant est récompensé de la soie cramoisie ; la jaune est donnée au second, et la blanche au troisième. Ces fils, dont ils font des baudriers, leur servent dans la suite d’ornement et, les distinguant du vulgaire, leur inspirent une noble fierté.
L’empereur ayant un jour donné ordre à une partie de son armée, logée dans sa capitale et aux environs, de se tenir prête, voulut se réjouir d’une façon très singulière. Il m’ordonna de me tenir debout comme un autre colosse de Rhodes, mes pieds aussi éloignés l’un de l’autre que je les pourrais étendre commodément ; ensuite il commanda à son général, vieux capitaine fort expérimenté, de ranger les troupes en ordre de bataille et de les faire passer en revue entre mes jambes, l’infanterie par vingt-quatre de front, et la cavalerie par seize, tambours battants, enseignes déployées et piques hautes. Ce corps était composé de trois mille hommes d’infanterie et de mille de cavalerie.
Sa Majesté prescrivit, sous peine de mort, à tous les soldats d’observer dans la marche la bienséance la plus exacte envers ma personne, ce qui n’empêcha pas quelques-uns des jeunes officiers de lever les yeux en haut pendant qu’ils passaient au-dessous de moi. Et, pour confesser la vérité, ma culotte était alors en si mauvais état qu’elle leur donna l’occasion d’éclater de rire.
J’avais présenté ou envoyé tant de mémoires ou de requêtes pour ma liberté, que Sa Majesté, à la fin, proposa l’affaire, premièrement au conseil des dépêches, et puis au Conseil d’État, où il n’y eut d’opposition que de la part du ministre Skyresh Bolgolam, qui jugea à propos, sans aucun sujet, de se déclarer, contre moi ; mais tout le reste du conseil me fut favorable, et l’empereur appuya leur avis. Ce ministre, qui était galbet, c’est-à-dire grand amiral, avait mérité la confiance de son maître par son habileté dans les affaires ; mais il était d’un esprit aigre et fantasque. Il obtint que les articles touchant les conditions auxquelles je devais être mis en liberté seraient dressés par lui-même. Ces articles me furent apportés par Skyresh Bolgolam en personne, accompagné de deux sous-secrétaires et de plusieurs gens de distinction. On me dit d’en promettre l’observation par serment, prêté d’abord à la façon de mon pays, et ensuite à la manière ordonnée par leurs lois, qui fut de tenir l’orteil de mon pied droit dans ma main gauche, de mettre le doigt du milieu de ma main droite sur le haut de ma tête, et le pouce sur la pointe de mon oreille droite. Mais, comme le lecteur peut être curieux de connaître le style de cette cour et de savoir les articles préliminaires de ma délivrance, j’ai fait une traduction de l’acte entier mot pour mot :
« Golbasto momaren eulamé gurdilo shefin mully ully gué, très puissant empereur de Lilliput, les délices et la terreur de l’univers, dont les États s’étendent à cinq mille blustrugs (c’est-à-dire environ six lieues en circuit) aux extrémités du globe, souverain de tous les souverains, plus haut que les fils des hommes, dont les pieds pressent la terre jusqu’au centre, dont la tête touche le soleil, dont un clin d’œil fait trembler les genoux des potentats, aimable comme le printemps, agréable comme l’été, abondant comme l’automne, terrible comme l’hiver ; à tous nos sujets aimés et féaux, salut. Sa très haute Majesté propose à l’homme Montagne les articles suivants, lesquels, pour préliminaire, il sera obligé de ratifier par un serment solennel :
I. L’homme Montagne ne sortira point de nos vastes États sans notre permission scellée du grand sceau.
II. Il ne prendra point la liberté d’entrer dans notre capitale sans notre ordre exprès, afin que les habitants soient avertis deux heures auparavant de se tenir enfermés chez eux.
III. Ledit homme Montagne bornera ses promenades à nos principaux grands chemins, et se gardera de se promener ou de se coucher dans un pré ou pièce de blé.
IV. En se promenant par lesdits chemins, il prendra tout le soin possible de ne fouler aux pieds les corps d’aucun de nos fidèles sujets ni de leurs chevaux ou voitures ; il ne prendra aucun de nos dits sujets dans ses mains, si ce n’est de leur consentement.
V. S’il est nécessaire qu’un courrier du cabinet fasse quelque course extraordinaire, l’homme Montagne sera obligé de porter dans sa poche ledit courrier durant six journées, une fois toutes les lunes, et de remettre ledit courrier (s’il en est requis) sain et sauf en notre présence impériale.
VI. Il sera notre allié contre nos ennemis de l’île de Blefuscu, et fera tout son possible pour faire périr la flotte qu’ils arment actuellement pour faire une descente sur nos terres.
VII. Ledit homme Montagne, à ses heures de loisir, prêtera son secours à nos ouvriers, en les aidant à élever certaines grosses pierres, pour achever les murailles de notre grand parc et de nos bâtiments impériaux.
VIII. Après avoir fait le serment solennel d’observer les articles ci-dessus énoncés, ledit homme Montagne aura une provision journalière de viande et de boisson suffisante à la nourriture de dix-huit cent soixante-quatorze de nos sujets, avec un accès libre auprès de notre personne impériale, et autres marques de notre faveur.
Donné en notre palais, à Belsaborac, le douzième jour de la quatre-vingt-onzième lune de notre règne. »
Je prêtai le serment et signai tous ces articles avec une grande joie, quoique quelques-uns ne fussent pas aussi honorables que je l’eusse souhaité, ce qui fut l’effet de la malice du grand amiral Skyresh Bolgolam. On m’ôta mes chaînes, et je fus mis en liberté. L’empereur me fit l’honneur de se rendre en personne et d’être présent à la cérémonie de ma délivrance. Je rendis de très humbles actions de grâces à Sa Majesté, en me prosternant à ses pieds ; mais il me commanda de me lever, et cela dans les termes les plus obligeants.
Le lecteur a pu observer que, dans le dernier article de l’acte de ma délivrance, l’empereur était convenu de me donner une quantité de viande et de boisson qui pût suffire à la subsistance de dix-huit cent soixante-quatorze Lilliputiens. Quelque temps après, demandant à un courtisan, mon ami particulier, pourquoi on s’était déterminé à cette quantité, il me répondit que les mathématiciens de Sa Majesté, ayant pris la hauteur de mon corps par le moyen d’un quart de cercle, et supputé sa grosseur, et le trouvant, par rapport au leur, comme dix-huit cent soixante-quatorze sont à un, ils avaient inféré de la similarité de leur corps que je devais avoir un appétit dix-huit cent soixante-quatorze fois plus grand que le leur ; d’où le lecteur peut juger de l’esprit admirable de ce peuple, et de l’économie sage, exacte et clairvoyante de leur empereur.
Chapitre IV
Description de Mildendo, capitale de Lilliput, et du palais de l’empereur. Conversation entre l’auteur et un secrétaire d’État, touchant les affaires de l’empire. Offres que l’auteur fait de servir l’empereur dans ses guerres.
La première requête que je présentai, après avoir obtenu ma liberté, fut pour avoir la permission de voir Mildendo, capitale de l’empire ; ce que l’empereur m’accorda, mais en me recommandant de ne faire aucun mal aux habitants ni aucun tort à leurs maisons. Le peuple en fut averti par une proclamation qui annonçait le dessein que j’avais de visiter la ville. La muraille qui l’environnait était haute de deux pieds et demi, et épaisse au moins de onze pouces, en sorte qu’un carrosse pouvait aller dessus et faire le tour de la ville en sûreté ; elle était flanquée de fortes tours à dix pieds de distance l’une de l’autre. Je passai par-dessus la porte occidentale, et je marchai très lentement et de côté par les deux principales rues, n’ayant qu’un pourpoint, de peur d’endommager les toits et les gouttières des maisons par les pans de mon justaucorps. J’allais avec une extrême circonspection, pour me garder de fouler aux pieds quelques gens qui étaient restés dans les rues, nonobstant les ordres précis signifiés à tout le monde de se tenir chez soi, sans sortir aucunement durant ma marche. Les balcons, les fenêtres des premier, deuxième, troisième et quatrième étages, celles des greniers ou galetas et les gouttières même étaient remplis d’une si grande foule de spectateurs, que je jugeai que la ville devait être considérablement peuplée. Cette ville forme un carré exact, chaque côté de la muraille ayant cinq cents pieds de long. Les deux grandes rues qui se croisent et la partagent en quatre quartiers égaux ont cinq pieds de large ; les petites rues, dans lesquelles je ne pus entrer, ont de largeur depuis douze jusqu’à dix-huit pouces. La ville est capable de contenir cinq cent mille âmes. Les maisons sont de trois ou quatre étages. Les boutiques et les marchés sont bien fournis. Il y avait autrefois bon opéra et bonne comédie ; mais, faute d’auteurs excités par les libéralités du prince, il n’y a plus rien qui vaille.