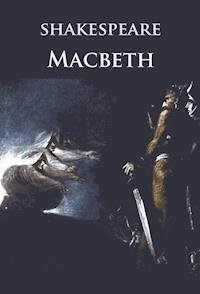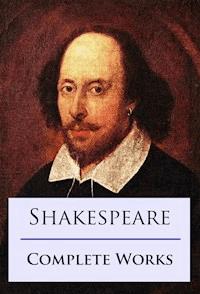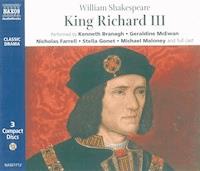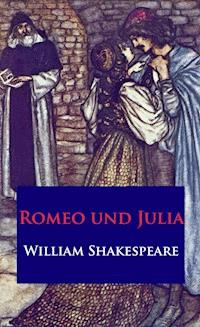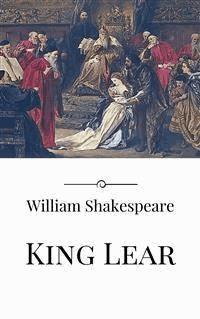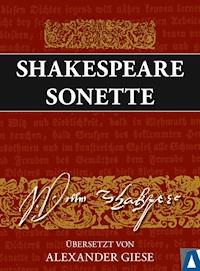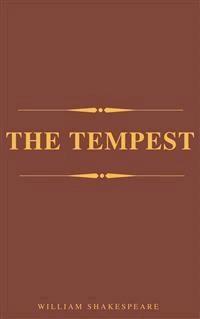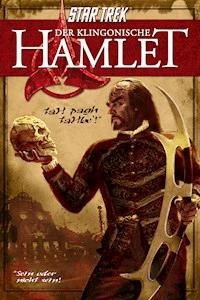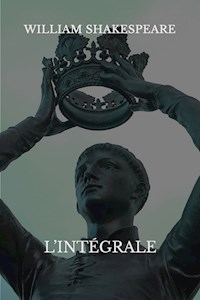
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Découvrez ou redécouvrez toutes les oeuvres de William Shakespeare dans cette édition complète: "Macbeth", "Othello", "Roméo et Juliette", "Hamlet", "Le Songe d'une nuit d'été", "Le Roi Lear", "Beaucoup de bruit pour rien", "Le Marchand de Venise", "La Tempête", "Comme il vous plaira", "Richard III", "Jules César". Et biens d'autres oeuvres moins connues du grand public.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 5844
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
oeuvres complète de William Shakespeare
Pages de titreAvertissementPRÉFACE DE LA NOUVELLE TRADUCTION DE SHAKESPEARELISTE DES TRAGÉDIESANTOINE ET CLÉOPÂTRECORIOLANLE PREMIER HAMLETLE SECOND HAMLETJULES CÉSARMACBETHOTHELLOLE ROI LEARROMÉO ET JULIETTETIMON D'ATHÈNESTITUS ANDRONICUSTROÏLUS ET CRESSIDALISTE DES COMÉDIESBEAUCOUP DE BRUIT POUR RIENLA COMÉDIE DES MÉPRISESCOMME IL VOUS PLAIRALES DEUX GENTILSHOMMES DE VÉRONELES JOYEUSES COMMÈRES DE WINDSORLE MARCHAND DE VENISEMESURE POUR MESURELE SOIR DES ROIS ou CE QUE VOUS VOUDREZPEINES D’AMOUR PERDUESLA MÉGÈRE DOMPTÉELE SONGE D’UNE NUIT D’ÉTÉTOUT EST BIEN QUI FINIT BIENLISTE DES ROMANCESLE CONTE D’HIVERCYMBELINEPÉRICLÈS PRINCE DE TYRLA TEMPÊTELES DEUX NOBLES PARENTSLISTE DES PIÈCES HISTORIQUESLE ROI JEANLE ROI RICHARD IILE ROI RICHARD IIILE ROI HENRI IV (1)LE ROI HENRI IV (2)LE ROI HENRI VLE ROI HENRI VI (1)LE ROI HENRI VI (2)LE ROI HENRI VI (3)LE ROI HENRI VIIILISTE DES POÉSIESSONNETSLE PÉLERIN PASSIONNÉLE PHÉNIX ET LA COLOMBEVÉNUS ET ADONISLUCRÈCELA PLAINTE D’UNE AMANTELE PÉLERIN AMOUREUXPage de copyrightShakespeare : Œuvres completes
Avertissement
de la première édition
Par Victor Hugo
1865
En publiant une traduction nouvelle de Shakespeare, nous croyons devoir expliquer en quoi cette traduction diffère des précédentes.
D’abord cette traduction est nouvelle par la forme. Comme l’a dit un critique compétent dans Profils et Grimaces, elle est faite, non sur la traduction de Letourneur, mais sur le texte de Shakespeare. Il ne faut pas l’oublier, la version de Letourneur, qui a servi de type à toutes les traductions publiées jusqu’ici, date du XVIIIe siècle : c’est dire que le premier interprète de Shakespeare a dû faire et a fait bien des concessions. Il était déjà bien assez téméraire de présenter à l’étroite critique littéraire du temps un théâtre où la distinction du comique et du tragique était méconnue et où la loi des unités était violée, sans ajouter encore à ces hardiesses les hardiesses du style. Aussi ne faut-il nullement s’étonner si la traduction de Letourneur est pleine de périphrases, si elle enveloppe la pensée du poète de tant de circonlocutions, et si elle est restée si loin de l’original. Disons-le hautement, pour qu’une traduction littérale de Shakespeare fût possible, il fallait que le mouvement littéraire de 1830 eût vaincu, il fallait que la liberté qui avait triomphé en politique eût triomphé en littérature, il fallait que la langue nouvelle, la langue révolutionnaire, la langue du mot propre et de l’image, eût été définitivement créée. La traduction littérale de Shakespeare étant devenue possible, nous l’avons tentée. Avons-nous réussi ? Le lecteur en jugera.
Autre nouveauté. En consultant les éditions primitives de Shakespeare, nous avons reconnu que toutes les pièces publiées de son vivant ont d’abord paru sans cette division en cinq actes à laquelle elles sont aujourd’hui universellement soumises, et que cette division uniforme, si contraire au libre génie du grand Will, a été improvisée après sa mort par deux comédiens obscurs de l’époque. En comparant ainsi la bible shakespearienne aux reproductions qui en ont été faites plus tard, nous avons éprouvé en quelque sorte l’étonnement qu’avait ressenti Érasme en comparant l’Évangile grec à la Vulgate de saint Jérôme. Nous avons fait comme les protestants : plein d’une fervente admiration pour le texte sacré, nous en avons supprimé toutes les interpolations posthumes, et, au risque d’être taxé d’hérésie, nous avons fait disparaître dans notre édition ces indications d’actes qui rompaient arbitrairement l’unité profonde de l’œuvre.
Tout le monde sait que Shakespeare, dans ses drames, emploie alternativement les deux formes, le vers et la prose. Dans telle pièce, la prose et le vers se partagent également le dialogue ; dans telle autre, c’est la poésie qui domine ; dans telle autre, c’est la prose. Ici les lignes plébéiennes et comiques coudoient familièrement les vers tragiques et patriciens ; là elles font antichambre dans des scènes séparées. Mais, quelque brusques que soient ces, changements, ils ne sont jamais arbitraires. Suivant une loi d’harmonie dont le poète a le secret, les variations de la forme sont constamment d’accord chez lui, soit avec l’action, soit avec les caractères. Elles accompagnent toujours avec une admirable justesse la pensée du grand compositeur. Nous avons donc voulu, dans notre traduction même, noter ces importantes variations par un signe qui, tout en laissant au dialogue sa vivacité, indiquât au lecteur d’une façon très apparente les soudaines transitions du ton, familier au ton lyrique. Ne pouvant donner le rythme du vers shakespearien, nous avons du moins tenu à en indiquer la coupe, nous avons, essayé de traduire le texte vers par vers, et nous avons mis un tiret — à chaque vers.
On sait encore qu’un certain nombre de pièces, comédies ou drames, publiées du temps de Shakespeare, avec son nom ou ses initiales, ont été déclarées apocryphes, simplement sur ce fait qu’elles n’ont pas été réimprimées dans l’in-folio de 1623. Nonobstant cette déclaration, nous les avons lues avec un soin scrupuleux, et, sans adopter entièrement l’avis de Schlegel, qui les range parmi les meilleures de Shakespeare, nous pouvons affirmer avoir reconnu dans plusieurs d’entre elles la retouche, sinon la touche, du maître. Pour que le lecteur puisse décider lui-même la question, nous les avons traduites, et elles forment le complément de notre ouvrage.
Une autre curiosité de cette édition, c’est de citer intégralement, dans des préfaces explicatives ou dans des appendices, les œuvres aujourd’hui oubliées qui ont été comme les esquisses des chefs-d’œuvre de Shakespeare. En effet, l’auteur d’Hamlet pensait sur l’originalité de l’art comme l’auteur d’Amphitryon et comme l’auteur du Cid. Il faisait consister la création dramatique, non dans l’invention de l’action, mais dans l’invention des caractères. Aussi, quand l’idée l’y sollicitait, il n’hésitait pas à réclamer la solidarité du génie avec tous les travailleurs passés, et il les appelait à lui, si humbles et si oubliés qu’ils fussent. Il disait à certain Bandello : Travaillons, ami ! et Roméo et Juliette ressuscitaient. Il criait à je ne sais quel Cinthio : À la besogne, frère ! et Othello naissait. Ce sont les opuscules de ces obscurs collaborateurs que nous avons tirés de leur poussière pour les restituer ici à l’imprimerie impérissable.
Nouvelle par la forme, nouvelle par les compléments, nouvelle par les révélations critiques et historiques, notre traduction est nouvelle encore par l’association de deux noms. Elle offre au lecteur cette nouveauté suprême : une préface de l’auteur de Ruy Blas. Victor Hugo contresigne l’œuvre de son fils et la présente à la France.
Un monument a été élevé dans l’exil à Shakespeare. L’étude en a posé la première pierre, le génie en a posé la dernière.
LES DEUX HAMLET À MA MÈRE RESPECTUEUSE OFFRANDE
F. V. H.
Hauteville-House, février 1858.
PRÉFACE DE LA NOUVELLE TRADUCTION DE SHAKESPEARE
Par Victor Hugo
1865
I
Une traduction est presque toujours regardée tout d’abord par le peuple à qui on la donne comme une violence qu’on lui fait. Le goût bourgeois résiste à l’esprit universel.
Traduire un poète étranger, c’est accroître la poésie nationale ; cet accroissement déplaît à ceux auxquels il profite. C’est du moins le commencement ; le premier mouvement est la révolte. Une langue dans laquelle on transvase de la sorte un autre idiome fait ce qu’elle peut pour refuser. Elle en sera fortifiée plus tard, en attendant elle s’indigne. Cette saveur nouvelle lui répugne. Ces locutions insolites, ces tours inattendus, cette irruption sauvage de figures inconnues, tout cela, c’est de l’invasion. Que va devenir sa littérature à elle ? Quelle idée a-t-on de venir lui mêler dans le sang cette substance des autres peuples ? C’est de la poésie en excès. Il y a là abus d’images, profusion de métaphores, violation des frontières, introduction forcée du goût cosmopolite dans le goût local. Est-ce grec ? c’est grossier. Est-ce anglais ? c’est barbare. Apreté ici, âcreté là. Et, si intelligente que soit la nation qu’on veut enrichir, elle s’indigne. Elle hait cette nourriture. Elle boit de force, avec colère, Jupiter enfant recrachait le lait de la chèvre divine.
Ceci a été vrai en France pour Homère, et encore plus vrai pour Shakespeare.
Au dix-septième siècle, à propos de madame Dacier, on posa la question : Faut-il traduire Homère ? L’abbé Terrasson, tout net, répondit non. La Mothe fit mieux ; il refit l’Iliade. Ce La Mothe était un homme d’esprit qui était idiot. De nos jours, nous avons eu en ce genre M. Beyle, dit Stendhal, qui écrivait : Je préfère à Homère les mémoires du maréchal Gouvion Saint-Cyr.
Faut-il traduire Homère ? fut la question littéraire du dix-septième siècle. La question littéraire du dix-huitième fut celle-ci : — Faut-il traduire Shakespeare ?
II
« Il faut que je vous dise combien je suis fâché contre un nommé Letourneur, qu’on dit secrétaire de la librairie, et qui ne me paraît pas le secrétaire du bon goût. Auriez-vous lu les deux volumes de ce misérable ? il sacrifie tous les Français sans exception à son idole (Shakespeare), comme on sacrifiait autrefois des cochons à Cérès ; il ne daigne pas même nommer Corneille et Racine. Ces deux grands hommes sont seulement enveloppés dans la proscription générale, sans que leurs noms soient prononcés. Il y a déjà deux tomes imprimés de ce Shakespeare, qu’on prendrait pour des pièces de la foire, faites il y a deux cents ans. Il y aura encore cinq volumes. Avez-vous une haine assez vigoureuse contre cet impudent imbécile ? Souffrirez-vous l’affront qu’il fait à la France ? Il n’y a point en France assez de camouflets, assez de bonnets d’âne, assez de piloris pour un pareil faquin. Le sang pétille dans mes vieilles veines en vous parlant de lui. Ce qu’il y a d’affreux, c’est que le monstre a un parti en France, et pour comble de calamité et d’horreur, c’est moi qui autrefois parlai le premier de ce Shakespeare ; c’est moi qui le premier montrai aux Français quelques perles que j’avais trouvées dans son énorme fumier. Je ne m’attendais pas que je servirais un jour à fouler aux pieds les couronnes de Racine et de Corneille pour en orner le front d’un histrion barbare. »
À qui est adressée cette lettre ? à La Harpe. Par qui ? par Voltaire. On le voit, il faut de la bravoure pour être Letourneur.
Ah ! vous traduisez Shakespeare ? Eh bien, vous êtes un faquin ; mieux que cela, vous êtes un impudent imbécile ; mieux encore, vous êtes un misérable. Vous faites un affront à la France. Vous méritez toutes les formes de l’opprobre public, depuis le bonnet d’âne, comme les cancres, jusqu’au pilori, comme les voleurs. Vous êtes peut-être un « monstre. » Je dis peut-être, car dans la lettre de Voltaire monstre est amphibologique ; la syntaxe l’adjuge à Letourneur, mais la haine le donne à Shakespeare.
Ce digne Letourneur, couronné à Montauban et à Besançon, lauréat académique de province, uniquement occupé d’émousser Shakespeare, de lui ôter les reliefs et les angles et de le faire passer, c’est-à-dire de le rendre passable, ce bonhomme, travailleur consciencieux, ayant pour tout horizon les quatre murs de son cabinet, doux comme une fille, incapable de fiel et de représailles, poli, timide, honnête, parlant bas, vécut toute sa vie sous cette épithète, misérable, que lui avait jetée l’éclatante voix de Voltaire, et mourut à cinquante-deux ans, étonné.
III
Letourneur, chose curieuse à dire, n’était pas moins bafoué par les Anglais que par les Français. Nous ne savons plus quel lord, faisant autorité, disait de Letourneur : pour traduire un fou, il faut être un sot. Dans le livre intitulé William Shakespeare, publié récemment, on peut lire, réunis et groupés, tous ces étranges textes anglais qui ont insulté Shakespeare pendant deux siècles. Au verdict des gens de lettres, ajoutez le verdict des princes. Georges Ier, sous le règne duquel, vers 1726, Shakespeare parut poindre un peu, n’en voulut jamais écouter un vers. Ce Georges était « un homme grave et sage » (Millot), qui aima une jolie femme jusqu’à la faire grand-écuyer. Georges II pensa comme Georges Ier. Il s’écriait : — Je ne pourrais pas lire Shakespeare. Et il ajoutait, c’est Hume qui le raconte : — C’est un garçon si ampoulé ! — (He was such a bombast fellow !) L’abbé Millot, historien qui prêchait l’Avent à Versailles et le Carême à Lunéville, et que Querlon préfère à Hénault, raconte l’influence de Pope sur Georges II au sujet de Shakespeare. Pope s’indignait de l’orgueil de Shakespeare, et comparait Shakespeare à un mulet qui ne porte rien et qui écoute le bruit de ses grelots. Le dédain littéraire justifiait le dédain royal. Georges III continua la tradition. Georges III, qui commença de bonne heure, à ce qu’il paraît, l’état d’esprit, par lequel il devait finir, jugeait Shakespeare et disait à miss Burney : — Quoi ! n’est-ce pas là un triste galimatias ? quoi ! quoi ! — (What ! is there not sad stuff ? what ! what !)
On dira : ce ne sont là que des opinions de roi. Qu’on ne s’y trompe point, la mode en Angleterre suit le roi. L’opinion de la majesté royale en matière de goût est grave de l’autre côté du détroit. Le roi d’Angleterre est le leader suprême des salons de Londres. Témoin le poète lauréat, presque toujours accepté par le public. Le roi ne gouverne pas, mais il règne. Le livre qu’il lit et la cravate qu’il met, font loi. Il plaît à un roi de rejeter le génie, l’Angleterre méconnaît Shakespeare ; il plaît à un roi d’admirer la niaiserie, l’Angleterre adore Brummel.
Disons-le, la France de 1814 tombait plus bas encore quand elle permettait aux Bourbons de jeter Voltaire à la voirie.
IV
Le danger de traduire Shakespeare a disparu aujourd’hui.
On n’est plus un ennemi public pour cela.
Mais si le danger n’existe plus, la difficulté reste.
Letourneur n’a pas traduit Shakespeare ; il l’a, candidement, sans le vouloir, obéissant à son insu au goût hostile de son époque, parodié.
Traduire Shakespeare, le traduire réellement, le traduire avec confiance, le traduire en s’abandonnant à lui, le traduire avec la simplicité honnête et fière de l’enthousiasme, ne rien éluder, ne rien omettre, ne rien amortir, ne rien cacher, ne pas lui mettre de voile là où il est nu, ne pas lui mettre de masque là où il est sincère, ne pas lui prendre sa peau pour mentir dessous, le traduire sans recourir à la périphrase, cette restriction mentale, le traduire sans complaisance puriste pour la France ou puritaine pour l’Angleterre, dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, le traduire comme on témoigne, ne point le trahir, l’introduire à Paris de plain-pied, ne pas prendre de précautions insolentes pour ce génie, proposer à la moyenne des intelligences, qui a la prétention de s’appeler le goût, l’acceptation de ce géant, le voilà ! en voulez-vous ? ne pas crier gare, ne pas être honteux du grand homme, l’avouer, l’afficher, le proclamer, le promulguer, être sa chair et ses os, prendre son empreinte, mouler sa forme, penser sa pensée, parler sa parole, répercuter Shakespeare de l’anglais en français, quelle entreprise !
V
Shakespeare est un des poètes qui se défendent le plus contre le traducteur.
La vieille violence faite à Protée symbolise l’effort des traducteurs. Saisir le génie, rude besogne. Shakespeare résiste, il faut l’étreindre ; Shakespeare échappe, il faut le poursuivre.
Il échappe par l’idée, il échappe par l’expression. Rappelez-vous le unsex, cette lugubre déclaration de neutralité d’un monstre entre le bien et le mal, cet écriteau posé sur une conscience eunuque. Quelle intrépidité il faut pour reproduire nettement en français certaines beautés insolentes de ce poète, par exemple le Buttock of the night, où l’on entrevoit les parties honteuses de l’ombre. D’autre expressions semblent sans équivalents possibles ; ainsi green girl, fille verte, n’a aucun sens en français. On pourrait dire de certains mots qu’ils sont imprenables. Shakespeare a un sunt lacrymae rerum. Dans le we have kissed away kingdoms and provinces, aussi bien que dans le profond soupir de Virgile, l’indicible est dit. Cette gigantesque dépense d’avenir faite dans un lit, ces provinces s’en allant en baisers, ces royaumes possibles s’évanouissant sur les bouches jointes d’Antoine et de Cléopâtre, ces empires dissous en caresses et ajoutant inexprimablement leur grandeur à la volupté, néant comme eux, toutes ces sublimités sont dans ce mot kissed away kingdoms.
Shakespeare échappe au traducteur par le style, il échappe aussi par la langue. L’anglais se dérobe le plus qu’il peut au français. Les deux idiomes sont composés en sens inverse. Leur pôle n’est pas le même ; l’anglais est saxon, le français est latin. L’anglais actuel est presque de l’allemand du quinzième siècle, à l’orthographe près. L’antipathie immémoriale des deux idiomes a été telle, qu’en 1095 les normands déposèrent Wolstan, évêque de Worcester, pour le seul crime d’être une vieille brute d’anglais ne sachant pas parler français. En revanche on a parlé danois à Bayeux. Duponceau estime qu’il y a dans l’anglais trois racines saxonnes sur quatre. Presque tous les verbes, toutes les particules, les mots qui font la charpente de la langue, sont du Nord. La langue anglaise a en elle une si dangereuse force isolante que l’Angleterre, instinctivement, et pour faciliter ses communications avec l’Europe, a pris ses termes de guerre aux Français, ses termes de navigation aux Hollandais, et ses termes de musique aux Italiens. Charles Duret écrivait en 1613, à propos de la langue anglaise : « Peu d’étrangers veulent se pener de l’apprendre. » À l’heure qu’il est, elle est encore saxonne à ce point que l’usage n’a frappé de désuétude qu’à peine un septième des mots de l’Orosius du roi Alfred. De là une perpétuelle lutte sourde entre l’anglais et le français quand on les met en contact. Rien n’est plus laborieux que de faire coïncider ces deux idiomes. Ils semblent destinés à exprimer des choses opposées. L’un est septentrional, l’autre est méridional. L’un confine aux lieux cimmériens, aux bruyères, aux steppes, aux neiges, aux solitudes froides, aux espaces nocturnes, pleins de silhouettes indéterminées, aux régions blêmes ; l’autre confine aux régions claires. Il y a plus de lune dans celui-ci, et plus de soleil dans celui-là. Sud contre Nord, jour contre nuit, rayon contre spleen. Un nuage flotte toujours dans la phrase anglaise. Ce nuage est une beauté. Il est partout dans Shakespeare. Il faut que la clarté française pénètre ce nuage sans le dissoudre. Quelquefois la traduction doit se dilater. Un certain vague ajoute du trouble à la mélancolie et caractérise le Nord. Hamlet, en particulier, a pour air respirable ce vague. Le lui ôter, le tuerait. Une profonde brume diffuse l’enveloppe. Fixer Hamlet, c’est le supprimer. Il importe que la traduction n’ait pas plus de densité que l’original. Shakespeare ne veut pas être traduit comme Tacite.
Shakespeare résiste par le style ; Shakespeare résiste par la langue. Est-ce là tout ? non. Il résiste par le sens métaphysique ; il résiste par le sens historique ; il résiste par le sens légendaire. Il a beaucoup d’ignorance, ceci est convenu ; mais, ce qui est moins connu, il a beaucoup de science. Parfois tel détail qui surprend, où l’on croit voir sa grossièreté, atteste précisément sa particularité et sa finesse ; très souvent ce que les critiques négateurs dénoncent dans Shakespeare comme l’invention ridicule d’un esprit sans culture et sans lettres, prouve, tout au contraire, sa bonne information. Il est sagace et singulier dans l’histoire. Il est on ne peut mieux renseigné dans la tradition et dans le conte. Quant à sa philosophie, elle est étrange ; elle tient de Montaigne par le doute, et d’Ézéchiel par la vision.
VI
Il y a des problèmes dans la Bible ; il y en a dans Homère ; on connaît ceux de Dante ; il existe en Italie des chaires publiques d’interprétation de la Divine comédie. Les obscurités propres à Shakespeare, aux divers points de vue que nous venons d’indiquer, ne sont pas moins abstruses. Comme la question biblique, comme la question homérique, comme la question dantesque, la question shakespearienne existe.
L’étude de cette question est préalable à la traduction. Il faut d’abord se mettre au fait de Shakespeare.
Pour pénétrer la question shakespearienne et, dans la mesure du possible, la résoudre, toute une bibliothèque est nécessaire. Historiens à consulter, depuis Hérodote jusqu’à Hume, poètes, depuis Chaucer jusqu’à Coleridge, critiques, éditeurs, commentateurs, nouvelles, romans, chroniques, drames, comédies, ouvrages en toutes langues, documents de toutes sortes, pièces justificatives de ce génie. On l’a fort accusé ; il importe d’examiner son dossier. Au British-Museum, un compartiment est exclusivement réservé aux ouvrages qui ont un rapport quelconque avec Shakespeare. Ces ouvrages veulent être les uns vérifiés, les autres approfondis. Labeur âpre et sérieux, et plein de complications. Sans compter les registres du Stationers’Hall, sans compter les registres du chef de troupe Henslowe, sans compter les registres de Stratford, sans compter les archives de Bridgewater House, sans compter le journal de Symon Forman. Il n’est pas inutile de confronter les dires de tous ceux qui ont essayé d’analyser Shakespeare, à commencer par Addison dans le Spectateur, et à finir par Jaucourt dans l’Encyclopédie. Shakespeare a été, en France, en Allemagne, en Angleterre, très souvent jugé, très souvent condamné, très souvent exécuté ; il faut savoir par qui et comment. Où il s’inspire, ne le cherchez pas, c’est en lui-même ; mais où il puise, tâchez de le découvrir. Le vrai traducteur doit faire effort pour lire tout ce que Shakespeare a lu. Il y a là pour le songeur des sources, et pour le piocheur des trouvailles. Les lectures de Shakespeare étaient variées et profondes. Cet inspiré était un étudiant. Faites donc ses études si vous voulez le connaître. Avoir lu Belleforest ne suffit pas, il faut lire Plutarque ; avoir lu Montaigne ne suffit pas, il faut lire Saxo Grammaticus ; avoir lu Érasme ne suffit pas, il faut lire Agrippa ; avoir lu Froissard ne suffit pas, il faut lire Plaute ; avoir lu Boccace ne suffit pas, il faut lire saint Augustin. Il faut lire tous les cancioneros et tous les fabliaux, Huon de Bordeaux, la belle Jehanne, le comte de Poitiers, le miracle de Notre-Dame, la légende du Renard, le roman de la Violette, la romance du Vieux-Manteau. Il faut lire Robert Wace, il faut lire Thomas le Rimeur. Il faut lire Boëce, Laneham, Spenser, Marlowe, Geoffroy de Monmouth, Gilbert de Montreuil, Holinshed, Amyot, Giraldi Cinthio, Pierre Boisteau, Arthur Brooke, Bandello, Luigi da Porto. Il faut lire Benoist de Saint-Maur, sir Nicholas Lestrange, Paynter, Comines, Monstrelet, Grove, Stubbes, Strype, Thomas Morus et Ovide. Il faut lire Graham d’Aberfoyle et Straparole. J’en passe. On aurait tort de laisser de côté Webster, Cavendish, Gower, Tarleton, Georges Whetstone, Reginald Scot, Nichols et sir Thomas North. Alexandre Silvayn veut être feuilleté. Les Papiers de Sidney sont utiles. Un livre contrôle l’autre. Les textes s’entr’éclairent. Rien à négliger dans ce travail. Figurez-vous une lecture dont le diamètre va du Gesta romanorum à la Démonologie de Jacques VI.
Arriver à comprendre Shakespeare, telle est la tâche. Toute cette érudition a ce but : parvenir à un poète. C’est le chemin de pierres de ce paradis.
Forgez-vous une clef de science pour ouvrir cette poésie.
VII
Et de la sorte, vous saurez de qui est contemporain le Thésée du Songe d’une nuit d’été ; vous saurez comment les prodiges de la mort de César se répercutent dans Macbeth ; vous saurez quelle quantité d’Oreste il y a dans Hamlet. Vous connaîtrez le vrai Timon d’Athènes, le vrai Shylock, le vrai Falstaff.
Shakespeare était un puissant assimilateur. Il s’amalgamait le passé. Il cherchait, puis trouvait ; il trouvait, puis inventait ; il inventait, puis créait. Une insufflation sortait pour lui du lourd tas des chroniques. De ces in-folios il dégageait des fantômes.
Fantômes éternels. Les uns terribles, les autres adorables. Richard III, Glocester, Jean sans Terre, Marguerite, lady Macbeth, Regane et Goneril, Claudius, Lear, Roméo et Juliette, Jessica, Perdita, Miranda, Pauline, Constance, Ophélia, Cordélia, tous ces monstres, toutes ces fées. Les deux pôles du cœur humain et les deux extrémités de l’art représentés par des figures à jamais vivantes d’une vie mystérieuse, impalpables comme le nuage, immortelles comme le souffle. La difformité intérieure, Iago ; la difformité extérieure, Caliban ; et près d’Iago le charme, Desdemona, et en regard de Caliban la grâce, Titania.
Quand on a lu les innombrables livres lus par Shakespeare, quand on a bu aux mêmes sources, quand on s’est imprégné de tout ce dont il était pénétré, quand on s’est fait en soi un fac-simile du passé tel qu’il le voyait, quand on a appris tout ce qu’il savait, moyen d’en venir à rêver tout ce qu’il rêvait, quand on a digéré tous ces faits, toute cette histoire, toutes ces fables, toute cette philosophie, quand on a gravi cet escalier de volumes, on a pour récompense cette nuée d’ombres divines au-dessus de sa tête.
VIII
Un jeune homme s’est dévoué à ce vaste travail. À côté de cette première tâche, reproduire Shakespeare, il y en avait une deuxième, le commenter. L’une, on vient de le voir, exige un poète, l’autre un bénédictin. Ce traducteur a accepté l’une et l’autre. Parallèlement à la traduction de chaque drame, il a placé, sous le titre d’introduction, une étude spéciale, où toutes les questions relatives au drame traduit sont discutées et débattues, et où, pièces en mains, le pour et contre est plaidé. Ces trente-six introductions aux trente-six drames de Shakespeare, divisés en quinze livres portant chacun un titre spécial, sont dans leur ensemble une œuvre considérable. Œuvre de critique, œuvre de philologie, œuvre de philosophie, œuvre d’histoire, qui côtoie et corrobore la traduction ; quant à la traduction en elle-même, elle est fidèle, sincère, opiniâtre dans la résolution d’obéir au texte ; elle est modeste et fière ; elle ne tâche pas d’être supérieure à Shakespeare.
Le commentaire couche Shakespeare sur la table d’autopsie, la traduction le remet debout ; et après l’avoir vu disséqué, nous le retrouvons en vie.
Pour ceux qui, dans Shakespeare, veulent tout Shakespeare, cette traduction manquait. On l’a maintenant. Désormais il n’y a plus de bibliothèque bien faite sans Shakespeare. Une bibliothèque est aussi incomplète sans Shakespeare que sans Molière.
L’ouvrage a paru volume par volume et a eu d’un bout à l’autre ce grand collaborateur, le succès.
Le peu que vaut notre approbation, nous le donnons sans réserve à cet ouvrage, traduction au point de vue philologique, création au point de vue critique et historique. C’est une œuvre de solitude. Ces œuvres-là sont consciencieuses et saines. La vie sévère conseille le travail austère. Le traducteur actuel sera, nous le croyons et toute la haute critique de France, d’Angleterre et d’Allemagne l’a proclamé déjà, le traducteur définitif. Première raison, il est exact ; deuxième raison, il est complet. Les difficultés que nous venons d’indiquer, et une foule d’autres, il les a franchement abordées, et, selon nous, résolues. Faisant cette tentative, il s’y est dépensé tout entier. Il a senti, en accomplissant cette tâche, la religion de construire un monument. Il y a consacré douze des plus belles années de la vie. Nous trouvons bon qu’un jeune homme ait eu cette gravité. La besogne était malaisée, presque effrayante ; recherches, confrontations de textes, peines, labeurs sans relâche. Il a eu pendant douze années la fièvre de cette grande audace et de cette grande responsabilité. Cela est bien à lui d’avoir voulu cette œuvre et de l’avoir terminée. Il a de cette façon marqué sa reconnaissance envers deux nations, envers celle dont il est l’hôte et envers celle dont il est le fils. Cette traduction de Shakespeare, c’est, en quelque sorte, le portrait de l’Angleterre envoyé à la France. À une époque où l’on sent approcher l’heure auguste de l’embrassement des peuples, c’est presque un acte, et c’est plus qu’un fait littéraire. Il y a quelque chose de pieux et de touchant dans ce don qu’un Français offre à la patrie, d’où nous sommes absents, lui et moi, par notre volonté et avec douleur.
LISTE DES TRAGÉDIES
ANTOINE ET CLÉOPÂTRE
1606
Traduction par François Guizot, 1864
Notice
On critiquera sans doute, dans cette pièce, le peu de liaison des scènes entre elles, défaut qui tient à la difficulté de rassembler une succession rapide et variée d’évènements dans un même tableau ; mais cette variété et ce désordre apparent tiennent la curiosité toujours éveillée, et un intérêt toujours plus vif émeut les passions du lecteur jusqu’au dernier acte. Il ne faut cependant commencer la lecture d’Antoine et Cléopâtre qu’après s’être pénétré de la Vie d’Antoine par Plutarque : c’est encore à cette source que le poète a puisé son plan, ses caractères et ses détails.
Peut-être les caractères secondaires de cette pièce sont-ils plus légèrement esquissés que dans les autres grands drames de Shakespeare ; mais tous sont vrais, et tous sont à leur place. L’attention en est moins distraite des personnages principaux qui ressortent fortement, et frappent l’imagination.
On voit dans Antoine un mélange de grandeur et de faiblesse ; l’inconstance et la légèreté sont ses attributs ; généreux, sensible, passionné, mais volage, il prouve qu’à l’amour extrême du plaisir, un homme de son tempérament peut joindre, quand les circonstances l’exigent, une âme élevée, capable d’embrasser les plus nobles résolutions, mais qui cède toujours aux séductions d’une femme.
Par opposition au caractère aimable d’Antoine, Shakespeare nous peint Octave César faux, sans courage, d’une âme étroite, hautaine et vindicative. Malgré les flatteries des poètes et des historiens, Shakespeare nous semble avoir deviné le vrai caractère de ce prince, qui avoua lui-même, en mourant, qu’il avait porté un masque depuis son avènement à l’empire.
Lépide, le troisième triumvir, est l’ombre au tableau à côté d’Antoine et de César ; son caractère faible, indécis et sans couleur, est tracé d’une manière très comique dans la scène où Énobarbus et Agrippa s’amusent à singer son ton et ses discours. Son plus bel exploit est dans la dernière scène de l’acte précédent, où il tient bravement tête à ses collègues, le verre à la main, encore est-on oblige d’emporter ivre-mort ce TROISIÈME PILIER DE L’UNIVERS.
On regrette que le jeune Pompée ne paraisse qu’un instant sur la scène ; peut-être oublie-t-il trop facilement sa mission sacrée, de venger un père, après la noble réponse qu’il adresse aux triumvirs ; et l’on est presque tenté d’approuver le hardi projet de ce Ménécrate qui dit avec amertume : Ton père, ô Pompée, n’eût jamais fait un traité semblable. Mais Shakespeare a suivi ici l’histoire scrupuleusement. D’ailleurs l’art exige que l’intérêt ne soit pas trop dispersé dans une composition dramatique ; voilà pourquoi l’aimable Octavie ne nous est aussi montrée qu’en passant ; cette femme si douce, si pure, si vertueuse, dont les grâces modestes sont éclipsées par l’éclat trompeur et l’ostentation de son indigne rivale.
Cléopâtre est dans Shakespeare cette courtisane voluptueuse et rusée que nous peint l’histoire ; comme Antoine, elle est remplie de contrastes : tour à tour vaniteuse comme une coquette et grande comme une reine, volage dans sa soif des voluptés, et sincère dans son attachement pour Antoine ; elle semble créée pour lui et lui pour elle. Si sa passion manque de dignité tragique, comme le malheur l’ennoblit, comme elle s’élève à la hauteur de son rang par l’héroïsme qu’elle déploie à ses derniers instants ! Elle se montre digne, en un mot, de partager la tombe d’Antoine.
Une scène qui nous a semblé d’un pathétique profond, c’est celle où Énobarbus, bourrelé de remords de sa trahison, adresse à la Nuit une protestation si touchante, et meurt de douleur en invoquant le nom d’Antoine, dont la générosité l’a rappelé au sentiment de ses devoirs.
Johnson prétend que cette pièce n’avait point été divisée en actes par l’auteur, ou par ses premiers éditeurs. On pourrait donc altérer arbitrairement la division que nous avons adoptée d’après le texte anglais ; peut-être, d’après cette observation de Johnson, Letourneur s’était-il cru autorisé à renvoyer deux ou trois scènes à la fin, comme oiseuses ou trop longues ; nous les avons scrupuleusement rétablies.
Selon le docteur Malone, la pièce d’Antoine et Cléopâtre a été composée en 1608, et après celle de Jules César dont elle est en quelque sorte une suite, puisqu’il existe entre ces deux tragédies la même connexion qu’entre les tragédies historiques de l’histoire anglaise.
Personnages
MARC-ANTOINE, triumvir. OCTAVE CÉSAR, triumvir. M. EMILIUS LEPIDUS, triumvir. SEXTUS POMPEIUS. DOMITIUS ENOBARBUS, ami d'Antoine. VENTIDIUS, ami d'Antoine. ÉROS, ami d’Antoine. SCARUS, ami d’Antoine. DERCETAS, ami d’Antoine. DÉMÉTRIUS, ami d’Antoine. PHILON, ami d'Antoine. MÉCÈNE, ami de César. AGRIPPA, ami de César. DOLABELLA, ami de César. PROCULEIUS, ami de César. THYREUS, ami de César. GALLUS, ami de Pompée. MÉNAS, ami de Pompée. MÉNÉCRATE, ami de Pompée VARIUS, ami de Pompée. TAURUS, lieutenant de César. CASSIDIUS, lieutenant d’Antoine. SILIUS, officier de l’armée de Ventidius. EUPHRODIUS, député d’Antoine à César. ALEXAS, MARDIAN, SELEUCUS et DIOMÈDE, serviteurs de Cléopâtre. UN DEVIN. UN PAYSAN. CLÉOPÂTRE, reine d’Égypte. OCTAVIE, soeur de César, femme d’Antoine. CHARMIAN, femme de Cléopâtre. IRAS, femme de Cléopâtre. OFFICIERS. SOLDATS. MESSAGERS ET SERVITEURS.
Acte Premier
Scène I
ALEXANDRIE.
Un appartement du palais de Cléopâtre. Entrent DÉMÉTRIUS ET PHILON.
PHILON. En vérité, ce fol amour de notre général passe la mesure. Ses beaux yeux, qu’on voyait, au milieu de ses légions rangées en bataille, étinceler, comme ceux de Mars armé, maintenant tournent leurs regards, fixent leur attention sur un front basané. Son cœur de guerrier, qui, plus d’une fois, dans la mêlée des grandes batailles, brisa sur son sein les boucles de sa cuirasse, dément sa trempe. Il est devenu le soufflet et l’éventail qui apaisent les impudiques désirs d’une Égyptienne. Regarde, les voilà qui viennent. (Fanfares. Entrent Antoine et Cléopâtre avec leur suite. Des eunuques agitent des éventails devant Cléopâtre) — Observe-le bien, et tu verras en lui la troisième colonne de l’univers devenue le jouet d’une prostituée. Regarde et vois. CLÉOPÂTRE. Si c’est de l’amour, dites-moi, quel degré d’amour ? ANTOINE. C’est un amour bien pauvre, celui que l’on peut calculer. CLÉOPÂTRE. Je veux établir, par une limite, jusqu’à quel point je puis être aimée. ANTOINE. Alors il te faudra découvrir un nouveau ciel et une nouvelle terre. (Entre un serviteur.) LE SERVITEUR. Des nouvelles, mon bon seigneur, des nouvelles de Rome ! ANTOINE. Ta présence m’importune : sois bref. CLÉOPÂTRE. Non ; écoute ces nouvelles, Antoine, Fulvie peut-être est courroucée. Ou qui sait, si l’imberbe César ne vous envoie pas ses ordres suprêmes : Fais ceci ou fais cela ; empare-toi de ce royaume et affranchis cet autre : obéis, ou nous te réprimanderons. ANTOINE. Comment, mon amour ? CLÉOPÂTRE. Peut-être, et même cela est très probable, peut-être que vous ne devez pas vous arrêter plus longtemps ici ; César vous donne votre congé. Il faut donc l’entendre, Antoine. — Où sont les ordres de Fulvie ? de César, veux-je dire ? ou de tous deux ? — Faites entrer les messagers. — Aussi vrai que je suis reine d’Égypte, tu rougis, Antoine : ce sang qui te monte au visage rend hommage à César ; ou c’est la honte qui colore ton front, quand l’aigre voix de Fulvie te gronde. — Les messagers ! ANTOINE. Que Rome se fonde dans le Tibre, que le vaste portique de l’empire s’écroule ! C’est ici qu’est mon univers. Les royaumes ne sont qu’argile. Notre globe fangeux nourrit également la brute et l’homme. Le noble emploi de la vie, c’est ceci (il l’embrasse), quand un tendre couple, quand des amants comme nous peuvent le faire. Et j’invite le monde sous peine de châtiment à reconnaître que nous sommes incomparables ! CLÉOPÂTRE. O rare imposture ! Pourquoi a-t-il épousé Fulvie s’il ne l’aimait pas ? Je semblerai dupe, mais je ne le suis pas. — Antoine sera toujours lui-même. ANTOINE. S’il est inspiré par Cléopâtre. Mais au nom de l’amour et de ses douces heures, ne perdons pas le temps en fâcheux entretiens. Nous ne devrions pas laisser écouler maintenant sans quelque plaisir une seule minute de notre vie… Quel sera l’amusement de ce soir ? CLÉOPÂTRE. Entendez les ambassadeurs. ANTOINE. Fi donc ! reine querelleuse, à qui tout sied : gronder, rire, pleurer : chaque passion brigue à l’envie l’honneur de paraître belle et de se faire admirer sur votre visage. Point de députés ! Je suis à toi, et à toi seule, et ce soir, nous nous promènerons dans les rues d’Alexandrie, et nous observerons les mœurs du peuple… Venez, ma reine : hier au soir vous en aviez envie. (Au messager.) Ne nous parle pas.
(Ils sortent avec leur suite.) DÉMÉTRIUS. Antoine fait-il donc si peu de cas de César ? PHILON. Oui, quelquefois, quand il n’est plus Antoine, il s’écarte trop de ce caractère qui devrait toujours accompagner Antoine. DÉMÉTRIUS. Je suis vraiment affligé de voir confirmer tout ce que répète de lui à Rome la renommée, si souvent menteuse : mais j’espère de plus nobles actions pour demain… Reposez doucement !
Scène II
Un autre appartement du palais.
CHARMIANE. Seigneur Alexas, cher Alexas, incomparable, presque tout-puissant Alexas, où est le devin que vous avez tant vanté à la reine ? Oh ! que je voudrais connaître cet époux, qui, dites-vous, doit couronner ses cornes de guirlandes ! ALEXAS. Devin ! LE DEVIN. Que désirez-vous ? CHARMIANE. Est-ce cet homme ?… Est-ce vous, monsieur, qui connaissez les choses ? LE DEVIN. Je sais lire un peu dans le livre immense des secrets de la nature. ALEXAS. Montrez-lui votre main.
(Entre Énobarbus.) ÉNOBARBUS. Qu’on serve promptement le repas : et du vin en abondance, pour boire à la santé de Cléopâtre. CHARMIANE. Mon bon monsieur, donnez-moi une bonne fortune. LE DEVIN. Je ne la fais pas, mais je la devine. CHARMIANE. Eh bien ! je vous prie, devinez-m’en une bonne. LE DEVIN. Vous serez encore plus belle que vous n’êtes. CHARMIANE. Il veut dire en embonpoint. IRAS. Non ; il veut dire que vous vous farderez quand vous serez vieille. CHARMIANE. Que les rides m’en préservent ! ALEXAS. Ne troublez point sa prescience, et soyez attentive. CHARMIANE. Chut ! LE DEVIN. Vous aimerez plus que vous ne serez aimée. CHARMIANE. J’aimerais mieux m’échauffer le foie avec le vin. ALEXAS. Allons, écoutez. CHARMIANE. Voyons, maintenant, quelque bonne aventure ; que j’épouse trois rois dans une matinée, que je devienne veuve de tous trois, que j’aie à cinquante ans un fils auquel Hérode de Judée rende hommage. Trouve-moi un moyen de me marier avec Octave César, et de marcher l’égale de ma maîtresse. LE DEVIN. Vous survivrez à la reine que vous servez. CHARMIANE. Oh ! merveilleux ! J’aime bien mieux une longue vie que des figues. LE DEVIN. Vous avez éprouvé dans le passé une meilleure fortune que celle qui vous attend. CHARMIANE. A ce compte, il y a toute apparence que mes enfants n’auront pas de nom. Je vous prie, combien dois-je avoir de garçons et de filles ? LE DEVIN. Si chacun de vos désirs avait un sein fécond, vous auriez un million d’enfants. CHARMIANE. Tais-toi, insensé ! Je te pardonne, parce que tu es un sorcier. ALEXAS. Vous croyez que votre couche est la seule confidente de vos désirs. CHARMIANE. Allons, viens. Dis aussi à Iras sa bonne aventure. ALEXAS. Nous voulons tous savoir notre destinée. ÉNOBARBUS. Ma destinée, comme celle de la plupart de vous, sera d’aller nous coucher ivres ce soir. LE DEVIN. Voilà une main qui présage la chasteté, si rien ne s’y oppose d’ailleurs. CHARMIANE. Oui, comme le Nil débordé présage la famine… IRAS. Allez, folâtre compagne de lit, vous ne savez pas prédire. CHARMIANE. Oui, si une main humide n’est pas un pronostic de fécondité, il n’est pas vrai que je puisse me gratter l’oreille. — Je t’en prie, dis-lui seulement une destinée tout ordinaire. LE DEVIN. Vos destinées se ressemblent. IRAS. Mais comment, comment ? Citez quelques particularités. LE DEVIN. J’ai dit. IRAS. Quoi ! n’aurai-je pas seulement un pouce de bonne fortune de plus qu’elle ? CHARMIANE. Et si vous aviez un pouce de bonne fortune de plus que moi, où le choisiriez-vous ? IRAS. Ce ne serait pas au nez de mon mari. CHARMIANE. Que le ciel corrige nos mauvaises pensées ! — Alexas ! allons, sa bonne aventure, à lui, sa bonne aventure. Oh ! qu’il épouse une femme qui ne puisse pas marcher. Douce Isis, je t’en supplie, que cette femme meure ! et alors donne-lui-en une pire encore, et après celle-là d’autres toujours plus méchantes, jusqu’à ce que la pire de toutes le conduise en riant à sa tombe, cinquante fois déshonoré. Bonne Isis, exauce ma prière, et, quand tu devrais me refuser dans des occasions plus importantes, accorde-moi cette grâce ; bonne Isis, je t’en conjure ! IRAS. Ainsi soit-il ; chère déesse, entends la prière que nous t’adressons toutes ! car si c’est un crève-cœur de voir un bel homme avec une mauvaise femme, c’est un chagrin mortel de voir un laid malotru sans cornes : ainsi donc, chère Isis, par bienséance, donne-lui la destinée qui lui convient. CHARMIANE. Ainsi soit-il. ALEXAS. Voyez-vous ; s’il dépendait d’elles de me déshonorer, elles se prostitueraient pour en venir à bout. ÉNOBARBUS. Silence : voici Antoine. CHARMIANE. Ce n’est pas lui ; c’est la reine.
(Entre Cléopâtre.) CLÉOPÂTRE. Avez-vous vu mon seigneur ? ÉNOBARBUS. Non, madame. CLÉOPÂTRE. Est-ce qu’il n’est pas venu ici ? CHARMIANE. Non, madame. CLÉOPÂTRE. Il était d’une humeur gaie… Mais tout à coup un souvenir de Rome a saisi son âme. — Énobarbus ! ÉNOBARBUS. Madame ? CLÉOPÂTRE. Cherchez-le, et l’amenez ici… — Où est Alexas ? ALEXAS. Me voici, madame, à votre service. — Mon seigneur s’avance.
(Antoine entre avec un messager et sa suite.) CLÉOPÂTRE. Nous ne le regarderons pas. — Suivez-moi.
(Sortent Cléopâtre, Énobarbus, Alexas, Iras, Charmiane, le devin et la suite.) LE MESSAGER. Fulvie, votre épouse, s’est avancée sur le champ de bataille… ANTOINE. Contre mon frère Lucius ? LE MESSAGER. Oui : mais cette guerre a bientôt été terminée. Les circonstances les ont aussitôt réconciliés, et ils ont réuni leurs forces contre César. Mais, dès le premier choc, la fortune de César dans la guerre les a chassés tous deux de l’Italie. ANTOINE. Bien : qu’as-tu de plus funeste encore à m’apprendre ? LE MESSAGER. Les mauvaises nouvelles sont fatales à celui qui les apporte. ANTOINE. Oui, quand elles s’adressent à un insensé, ou à un lâche ; poursuis. — Avec moi, ce qui est passé est passé, voilà mon principe. Quiconque m’apprend une vérité, dût la mort être au bout de son récit, je l’écoute comme s’il me flattait. LE MESSAGER. Labiénus, et c’est une sinistre nouvelle, a envahi l’Asie Mineure depuis l’Euphrate avec son armée de Parthes ; sa bannière triomphante a flotté depuis la Syrie, jusqu’à la Lydie et l’Ionie ; tandis que… ANTOINE. Tandis qu’Antoine, voulais-tu dire… LE MESSAGER. Oh ! mon maître ! ANTOINE. Parle-moi sans détour : ne déguise point les bruits populaires : appelle Cléopâtre comme on l’appelle à Rome ; prends le ton d’ironie avec lequel Fulvie parle de moi ; reproche-moi mes fautes avec toute la licence de la malignité et de la vérité réunies. — Oh ! nous ne portons que des ronces quand les vents violents demeurent immobiles ; et le récit de nos torts est pour nous une culture. — Laisse-moi un moment. LE MESSAGER. Selon votre plaisir, seigneur.
(Il sort.) ANTOINE. Quelles nouvelles de Sicyone ? Appelle le messager de Sicyone. PREMIER SERVITEUR. Le messager de Sicyone ? y en a-t-il un ? SECOND SERVITEUR. Seigneur, il attend vos ordres. ANTOINE. Qu’il vienne. — Il faut que je brise ces fortes chaînes égyptiennes, ou je me perds dans ma folle passion. (Entre un autre messager.) Qui êtes-vous ? LE SECOND MESSAGER. Votre épouse Fulvie est morte. ANTOINE. Où est-elle morte ? LE MESSAGER. A Sicyone : la longueur de sa maladie, et d’autres circonstances plus graves encore, qu’il vous importe de connaître, sont détaillées dans cette lettre.
(Il lui donne la lettre.) ANTOINE. Laissez-moi seul. (Le messager sort.) Voilà une grande âme partie ! Je l’ai pourtant désiré. — L’objet que nous avons repoussé avec dédain, nous voudrions le posséder encore ! Le plaisir du jour diminue par la révolution des temps et devient une peine. — Elle est bonne parce qu’elle n’est plus. La main qui la repoussait voudrait la ramener ! — Il faut absolument que je m’affranchisse du joug de cette reine enchanteresse. Mille maux plus grands que ceux que je connais déjà sont près d’éclore de mon indolence. — Où es-tu, Énobarbus ?
(Énobarbus entre.) ÉNOBARBUS. Que voulez-vous, seigneur ? ANTOINE. Il faut que je parte sans délai de ces lieux. ÉNOBARBUS. En ce cas, nous tuons toutes nos femmes. Nous voyons combien une dureté leur est mortelle : s’il leur faut subir notre départ, la mort est là pour elles. ANTOINE. Il faut que je parte. ÉNOBARBUS. Dans une occasion pressante, que les femmes meurent ! — Mais ce serait pitié de les rejeter pour un rien, quoique comparées à un grand intérêt elles doivent être comptées pour rien. Au moindre bruit de ce dessein, Cléopâtre meurt, elle meurt aussitôt ; je l’ai vue mourir vingt fois pour des motifs bien plus légers. Je crois qu’il y a de l’amour pour elle dans la mort, qui lui procure quelque jouissance amoureuse, tant elle est prompte à mourir. ANTOINE. Elle est rusée à un point que l’homme ne peut imaginer. ÉNOBARBUS. Hélas, non, seigneur ! Ses passions ne sont formées que des plus purs éléments de l’amour. Nous ne pouvons comparer ses soupirs et ses larmes aux vents et aux flots. Ce sont de plus grandes tempêtes que celles qu’annoncent les almanachs, ce ne peut être une ruse chez elle. Si c’en est une, elle fait tomber la pluie aussi bien que Jupiter. ANTOINE. Que je voudrais ne l’avoir jamais vue ! ÉNOBARBUS. Ah ! seigneur, vous auriez manqué de voir une merveille ; et n’avoir pas été heureux par elle, c’eût été décréditer votre voyage. ANTOINE. Fulvie est morte. ÉNOBARBUS. Seigneur ? ANTOINE. Fulvie est morte. ÉNOBARBUS. Fulvie ? ANTOINE. Morte ! ÉNOBARBUS. Eh bien ! seigneur, offrez aux dieux un sacrifice d’actions de grâces ! Quand il plaît à leur divinité d’enlever à un homme sa femme, ils lui montrent les tailleurs de la terre, pour le consoler en lui faisant voir que lorsque les vieilles robes sont usées, il reste des gens pour en faire de neuves. S’il n’y avait pas d’autre femme que Fulvie, alors vous auriez une véritable blessure et des motifs pour vous lamenter ; mais votre chagrin porte avec lui sa consolation ; votre vieille chemise vous donne un jupon neuf. En vérité, pour verser des larmes sur un tel chagrin, il faudrait les faire couler avec un oignon. ANTOINE. Les affaires qu’elle a entamées dans l’État ne peuvent supporter mon absence. ÉNOBARBUS. Et les affaires que vous avez entamées ici ne peuvent se passer de vous, surtout celle de Cléopâtre, qui dépend absolument de votre présence. ANTOINE. Plus de frivoles réponses. — Que nos officiers soient instruits de ma résolution. Je déclarerai à la reine la cause de notre expédition, et j’obtiendrai de son amour la liberté de partir. Car ce n’est pas seulement la mort de Fulvie, et d’autres motifs plus pressants encore, qui parlent fortement à mon cœur : des lettres aussi de plusieurs de nos amis qui travaillent pour nous dans Rome, pressent mon retour dans ma patrie. Sextus Pompée a défié César, et il tient l’empire de la mer. Notre peuple inconstant, dont l’amour ne s’attache jamais à l’homme de mérite, que lorsque son mérite a disparu, commence à faire passer toutes les dignités et la gloire du grand Pompée sur son fils, qui, grand déjà en renommée et en puissance, plus grand encore par sa naissance et son courage, passe pour un grand guerrier ; si ses avantages vont en croissant, l’univers pourrait être en danger. Plus d’un germe se développe, qui, semblable au poil d’un coursier, n’a pas encore le venin du serpent, mais est déjà doué de la vie. Apprends à ceux dont l’emploi dépend de nous, que notre bon plaisir est de nous éloigner promptement de ces lieux. ÉNOBARBUS. Je vais exécuter vos ordres.
(Ils sortent.)
Scène III
CLÉOPÂTRE. Où est-il ? CHARMIANE. Je ne l’ai pas vu depuis. CLÉOPÂTRE. Voyez où il est, qui est avec lui, et ce qu’il fait. Je ne vous ai pas envoyée. — Si vous le trouvez triste, dites que je suis à danser ; s’il est gai, annoncez que je viens de me trouver mal. Volez, et revenez. CHARMIANE. Madame, il me semble que si vous l’aimez tendrement, vous ne prenez pas les moyens d’obtenir de lui le même amour. CLÉOPÂTRE. Que devrais-je faire,… que je ne fasse ? CHARMIANE. Cédez-lui en tout ; ne le contrariez en rien. CLÉOPÂTRE. Tu parles comme une folle ; c’est le moyen de le perdre. CHARMIANE. Ne le poussez pas ainsi à bout, je vous en prie, prenez garde : nous finissons par haïr ce que nous craignons trop souvent. (Antoine entre.) Mais voici Antoine. CLÉOPÂTRE. Je suis malade et triste. ANTOINE. Il m’est pénible de lui déclarer mon dessein. CLÉOPÂTRE. Aide-moi, chère Charmiane, à sortir de ce lieu. Je vais tomber. Cela ne peut durer longtemps : la nature ne peut le supporter. ANTOINE. Eh bien ! ma chère reine… CLÉOPÂTRE. Je vous prie, tenez-vous loin de moi. ANTOINE. Qu’y a-t-il donc ? CLÉOPÂTRE. Je lis dans vos yeux que vous avez reçu de bonnes nouvelles. Que vous dit votre épouse ? — Vous pouvez partir. Plût aux dieux qu’elle ne vous eût jamais permis de venir ! — Qu’elle ne dise pas surtout que c’est moi qui vous retiens : je n’ai aucun pouvoir sur vous. Vous êtes tout à elle. ANTOINE. Les dieux savent bien… CLÉOPÂTRE. Non, jamais reine ne fut si indignement trahie… Cependant, dès l’abord, j’avais vu poindre ses trahisons. ANTOINE. Cléopâtre ! CLÉOPÂTRE. Quand tu ébranlerais de tes serments le trône même des dieux, comment pourrais-je croire que tu es à moi, que tu es sincère, toi, qui as trahi Fulvie ? Quelle passion extravagante a pu me laisser séduire par ces serments des lèvres aussitôt violés que prononcés ? ANTOINE. Ma tendre reine… CLÉOPÂTRE. Ah ! de grâce, ne cherche point de prétexte pour me quitter : dis-moi adieu, et pars. Lorsque tu me conjurais pour rester, c’était alors le temps des paroles : tu ne parlais pas alors de départ. — L’éternité était dans nos yeux et sur nos lèvres. Le bonheur était peint sur notre front ; aucune partie de nous-mêmes qui ne nous fît goûter la félicité du ciel. Il en est encore ainsi, ou bien toi, le plus grand guerrier de l’univers, tu en es devenu le plus grand imposteur ! ANTOINE. Que dites-vous, madame ? CLÉOPÂTRE. Que je voudrais avoir ta taille. — Tu apprendrais qu’il y avait un cœur en Égypte. ANTOINE. Reine, écoutez-moi. L’impérieuse nécessité des circonstances exige pour un temps notre service ; mais mon cœur tout entier reste avec vous. Partout, notre Italie étincelle des épées de la guerre civile. Sextus Pompée s’avance jusqu’au port de Rome. L’égalité de deux pouvoirs domestiques engendre les factions. Le parti odieux, devenu puissant, redevient le parti chéri. Pompée proscrit, mais riche de la gloire de son père, s’insinue insensiblement dans les cœurs de ceux qui n’ont point gagné au gouvernement actuel : leur nombre s’accroît et devient redoutable, et les esprits fatigués du repos aspirent à en sortir par quelque résolution désespérée. — Un motif plus personnel pour moi, et qui doit surtout vous rassurer sur mon départ, c’est la mort de Fulvie. CLÉOPÂTRE. Si l’âge n’a pu affranchir mon cœur de la folie de l’amour, il l’a guéri du moins de la crédulité de l’enfance ! — Fulvie peut-elle mourir ? ANTOINE. Elle est morte, ma reine. Jetez ici les yeux et lisez à votre loisir tous les troubles qu’elle a suscités. La dernière nouvelle est la meilleure ; voyez en quel lieu, en quel temps elle est morte. CLÉOPÂTRE. O le plus faux des amants ! Où sont les fioles sacrées que tu as dû remplir des larmes de ta douleur ? Ah ! je vois maintenant, je vois par la mort de Fulvie comment la mienne sera reçue ! ANTOINE. Cessez vos reproches, et préparez-vous à entendre les projets que je porte en mon sein, qui s’accompliront ou seront abandonnés selon vos conseils. Je jure par le feu qui féconde le limon du Nil, que je pars de ces lieux votre guerrier, votre esclave, faisant la paix ou la guerre au gré de vos désirs. CLÉOPÂTRE. Coupe mon lacet, Charmiane, viens ; mais non…. laisse-moi : je me sens mal, et puis mieux dans un instant : c’est ainsi qu’aime Antoine ! ANTOINE. Reine bien-aimée, épargnez-moi : rendez justice à l’amour d’Antoine, qui supportera aisément une juste procédure. CLÉOPÂTRE. Fulvie doit me l’avoir appris. Ah ! de grâce, détourne-toi, et verse des pleurs pour elle ; puis, fais-moi tes adieux, et dis que ces pleurs coulent pour l’Égypte. Maintenant, joue devant moi une scène de dissimulation profonde et qui imite l’honneur parfait. ANTOINE. Vous m’échaufferez le sang. — Cessez. CLÉOPÂTRE. Tu pourrais faire mieux, mais ceci est bien déjà. ANTOINE. Je jure par mon épée !… CLÉOPÂTRE. Jure aussi par ton bouclier… Son jeu s’améliore ; mais il n’est pas encore parfait. — Vois, Charmiane, vois, je te prie, comme cet emportement sied bien à cet Hercule romain. ANTOINE. Je vous laisse, madame. CLÉOPÂTRE. Aimable seigneur, un seul mot… « Seigneur, il faut donc nous séparer… » Non, ce n’est pas cela : « Seigneur, nous nous sommes aimés. » Non, ce n’est pas cela ; vous le savez assez !… C’est quelque chose que je voudrais dire… Oh ! ma mémoire est un autre Antoine ; j’ai tout oublié ! ANTOINE. Si votre royauté ne comptait la nonchalance parmi ses sujets, je vous prendrais vous-même pour la nonchalance. CLÉOPÂTRE. C’est un pénible travail que de porter cette nonchalance aussi près du cœur que je la porte ! Mais, seigneur, pardonnez, puisque le soin de ma dignité me tue dès que ce soin vous déplaît. Votre honneur vous rappelle loin de moi ; soyez sourd à ma folie, qui ne mérite pas la pitié ; que tous les dieux soient avec vous ! Que la victoire, couronnée de lauriers, se repose sur votre épée, et que de faciles succès jonchent votre sentier ! ANTOINE. Sortons, madame, venez. Telle est notre séparation, qu’en demeurant ici vous me suivez pourtant, et que moi, en fuyant, je reste avec vous. — Sortons.
(Ils sortent.)
Scène IV
ROME. Un appartement dans la maison de César.
CÉSAR. Vous voyez, Lépide, et vous saurez à l’avenir que ce n’est point le vice naturel de César de haïr un grand rival. — Voici les nouvelles d’Alexandrie. Il pêche, il boit, et les lampes de la nuit éclairent ses débauches. Il n’est pas plus homme que Cléopâtre, et la veuve de Ptolémée n’est pas plus efféminée que lui. Il a donné à peine audience à mes députés, et daigne difficilement se rappeler qu’il a des collègues. Vous reconnaîtrez dans Antoine l’abrégé de toutes les faiblesses dont l’humanité est capable. LÉPIDE. Je ne puis croire qu’il ait des torts assez grands pour obscurcir toutes ses vertus. Ses défauts sont comme les taches du ciel, rendues plus éclatantes par les ténèbres de la nuit. Ils sont héréditaires plutôt qu’acquis ; il ne peut s’en corriger, mais il ne les a pas cherchés. CÉSAR. Vous êtes trop indulgent. Accordons que ce ne soit pas un crime de se laisser tomber sur la couche de Ptolémée, de donner un royaume pour un sourire, de s’asseoir pour s’enivrer avec un esclave ; de chanceler, en plein midi, dans les rues, et de faire le coup de poing avec une troupe de drôles trempés de sueur. Dites que cette conduite sied bien à Antoine, et il faut que ce soit un homme d’une trempe bien extraordinaire pour que ces choses ne soient pas des taches dans son caractère… Mais du moins Antoine ne peut excuser ses souillures, quand sa légèreté nous impose un si pesant fardeau : encore s’il ne consumait dans les voluptés que ses moments de loisir, le dégoût et son corps exténué lui en demanderaient compte ; mais sacrifier un temps si précieux qui l’appelle à quitter ses divertissements, et parle si haut pour sa fortune et pour la nôtre, c’est mériter d’être grondé comme ces jeunes gens, qui, déjà dans l’âge de connaître leurs devoirs, immolent leur expérience au plaisir présent, et se révoltent contre le bon jugement.
(Entre un messager.) LÉPIDE. Voici encore des nouvelles. LE MESSAGER, à César. Vos ordres sont exécutés, et d’heure en heure, très noble César, vous serez instruit de ce qui se passe. Pompée est puissant sur mer, et il paraît aimé de tous ceux que la crainte seule attachait à César. Les mécontents se rendent dans nos ports ; et le bruit court qu’on lui a fait grand tort. CÉSAR. Je ne devais pas m’attendre à moins. L’histoire, dès son origine, nous apprend que celui qui est au pouvoir a été bien-aimé jusqu’au moment où il l’a obtenu ; et que l’homme tombé dans la disgrâce, qui n’avait jamais été aimé, qui n’avait jamais mérité l’amour du peuple, lui devient cher dès qu’il tombe. Cette multitude ressemble au pavillon flottant sur les ondes, qui avance ou recule, suit servilement l’inconstance du flot, et s’use par son mouvement continuel. LE MESSAGER. César, je t’annonce que Ménécrate et Ménas, deux fameux pirates, exercent leur empire sur les mers, qu’ils fendent et sillonnent de vaisseaux de toute espèce. Ils font de fréquentes et vives incursions sur les côtes d’Italie. Les peuples qui habitent les rivages pâlissent à leur nom seul, et la jeunesse ardente se révolte. Nul vaisseau ne peut se montrer qu’il ne soit pris aussitôt qu’aperçu. Le nom seul de Pompée inspire plus de terreur que n’en inspirerait la présence même de toute son armée. CÉSAR. Antoine, quitte tes débauches et tes voluptés ! Lorsque repoussé de Mutine, après avoir tué les deux consuls, Hirtius et Pansa, tu fus poursuivi par la famine, tu la combattis, malgré ta molle éducation, avec une patience plus grande que celle des sauvages. Tu bus l’urine de tes chevaux, et des eaux fangeuses que les animaux mêmes auraient rejetées avec dégoût. Ton palais ne dédaignait pas alors les fruits les plus sauvages des buissons épineux. Tel que le cerf affamé, lorsque la neige couvre les pâturages, tu mâchais l’écorce des arbres. On dit que sur les Alpes tu te repus d’une chair étrange, dont la vue seule fit périr plusieurs des tiens ; et toi (ton honneur souffre maintenant de ces récits) tu supportas tout cela en guerrier si intrépide, que ton visage même n’en fut pas altéré. LÉPIDE. C’est bien dommage. CÉSAR. Que la honte le ramène promptement à Rome. Il est temps que nous nous montrions tous deux sur le champ de bataille. Assemblons, sans tarder, notre conseil, pour concerter nos projets. Pompée prospère par notre indolence. LÉPIDE. Demain, César, je serai en état de vous instruire, avec exactitude, de ce que je puis exécuter sur mer et sur terre, pour faire face aux circonstances présentes. CÉSAR. C’est aussi le soin qui m’occupera jusqu’à demain. Adieu. LÉPIDE. Adieu, seigneur. Tout ce que vous apprendrez d’ici là des mouvements qui se passent au dehors, je vous conjure de m’en faire part. CÉSAR. N’en doutez pas, seigneur ; je sais que c’est mon devoir.
(Ils sortent.)
Scène V
ALEXANDRIE. Appartement du palais.
CLÉOPÂTRE. Charmiane. CHARMIANE. Madame ? CLÉOPÂTRE. Ah ! ah ! donne-moi une potion de mandragore. CHARMIANE. Pourquoi donc, madame ? CLÉOPÂTRE. Afin que je puisse dormir pendant tout le temps que mon Antoine sera absent. CHARMIANE. Vous songez trop à lui. CLÉOPÂTRE. O trahison !… CHARMIANE. Madame, j’espère qu’il n’en est point ainsi. CLÉOPÂTRE. Eunuque ! Mardian ! MARDIAN. Quel est le bon plaisir de Votre Majesté ? CLÉOPÂTRE. Je ne veux pas maintenant t’entendre chanter. Je ne prends aucun plaisir à ce qui vient d’un eunuque. — Il est heureux pour toi que ton impuissance empêche tes pensées les plus libres d’aller errer hors de l’Égypte. As-tu des inclinations ? L’EUNUQUE. Oui, gracieuse reine. CLÉOPÂTRE. En vérité ? MARDIAN. Pas en vérité, madame, car je ne puis rien faire en vérité que ce qu’il est honnête de faire ; mais j’ai de violentes passions, et je pense à ce que Mars fit avec Vénus. CLÉOPÂTRE. Ô Charmiane, où crois-tu qu’il soit à présent ? Est-il debout ou assis ? Se promène-t-il à pied ou est-il à cheval ? Heureux coursier, qui porte Antoine, conduis-toi bien, cheval ; car sais-tu bien qui tu portes ? L’Atlas qui soutient la moitié de ce globe, le bras et le casque de l’humanité. — Il dit maintenant ou murmure tout bas : Où est mon serpent du vieux Nil ? car c’est le nom qu’il me donne. — Oh ! maintenant, je me nourris d’un poison délicieux. — Penses-tu à moi qui suis brunie par les brûlants baisers du soleil, et dont le temps a déjà sillonné le visage de rides profondes ? — O toi, César au large front, dans le temps que tu étais ici à terre, j’étais un morceau de roi ! et le grand Pompée s’arrêtait, et fixait ses regards sur mon front ; il eût voulu y attacher à jamais sa vue, et mourir en me contemplant ! ALEXAS ENTRE. Souveraine d’Égypte, salut ! CLÉOPÂTRE. Que tu es loin de ressembler à Marc-Antoine ! Et cependant, venant de sa part, il me semble que cette pierre philosophale t’a changé en or. Comment se porte mon brave Marc-Antoine ? ALEXAS. La dernière chose qu’il ait faite, chère reine, a été de baiser cent fois cette perle orientale. — Ses paroles sont encore gravées dans mon cœur. CLÉOPÂTRE. Mon oreille est impatiente de les faire passer dans le mien. ALEXAS. « Ami, m’a-t-il dit, va : dis que le fidèle Romain envoie à la reine d’Égypte ce trésor de l’huître, et que, pour rehausser la mince valeur du présent, il ira bientôt à ses pieds décorer de royaumes son trône superbe ; dis-lui que bientôt tout l’Orient la nommera sa souveraine. » Là-dessus, il me fit un signe de tête, et monta d’un air grave sur son coursier fougueux, qui alors a poussé de si grands hennissements, que, lorsque j’ai voulu parler, il m’a réduit au silence. CLÉOPÂTRE. Dis-moi, était-il triste ou gai ? ALEXAS. Comme la saison de l’année qui est placée entre les extrêmes de la chaleur et du froid ; il n’était ni triste ni gai. CLÉOPÂTRE. Ô caractère bien partagé ! Observe-le bien, observe-le bien, bonne Charmiane ; c’est bien lui, mais observe-le bien ; il n’était pas triste, parce qu’il voulait montrer un front serein à ceux qui composent leur visage sur le sien ; il n’était pas gai, ce qui semblait leur dire qu’il avait laissé en Égypte son souvenir et sa joie, mais il gardait un juste milieu. O céleste mélange ! Que tu sois triste ou gai, les transports de la tristesse et de la joie te conviennent également, plus qu’à aucun autre mortel ! — As-tu rencontré mes courriers ? ALEXAS. Oui, madame, au moins vingt. Pourquoi les dépêchez-vous si près l’un de l’autre ? CLÉOPÂTRE. Il périra misérable, l’enfant qui naîtra le jour où j’oublierai d’envoyer vers Antoine. — Charmiane, de l’encre et du papier. — Sois le bienvenu, cher Alexas. — Charmiane, ai-je jamais autant aimé César ? CHARMIANE. Ô ce brave César ! CLÉOPÂTRE. Que ton exclamation t’étouffe ! Dis, le brave Antoine. CHARMIANE. Ce vaillant César ! CLÉOPÂTRE. Par Isis, je vais ensanglanter ta joue, si tu oses encore comparer César avec le plus grand des hommes. CHARMIANE. Sauf votre bon plaisir, je ne fais que répéter ce que vous disiez vous-même. CLÉOPÂTRE. Temps de jeunesse quand mon jugement n’était pas encore mur. — Coeur glacé de répéter ce que je disais alors. — Mais viens, sortons : donne-moi de l’encre et du papier ; il aura chaque jour plus d’un message, dussé-je dépeupler l’Égypte.
Acte Deuxième
Scène I
MESSINE. Appartement de la maison de Pompée.
POMPÉE. Si les grands dieux sont justes, ils seconderont les armes du parti le plus juste. MÉNÉCRATE. Vaillant Pompée, songez que les dieux ne refusent pas ce qu’ils diffèrent d’accorder. POMPÉE. Tandis qu’au pied de leur trône nous les implorons, la cause que nous les supplions de protéger dépérit. MÉNÉCRATE. Nous nous ignorons nous-mêmes, et nous demandons souvent notre ruine, leur sagesse nous refuse pour notre bien, et nous gagnons à ne pas obtenir l’objet de nos prières. POMPÉE. Je réussirai : le peuple m’aime, et la mer est à moi ; ma puissance est comme le croissant de la lune, et mon espérance me prédit qu’elle parviendra à son plein. Marc-Antoine est à table en Égypte ; il n’en sortira jamais pour faire la guerre. César, en amassant de l’argent, perd les cœurs ; Lépide les flatte tous deux, et tous deux flattent Lépide : mais il n’aime ni l’un ni l’autre, et ni l’un ni l’autre ne se soucie de lui. MÉNÉCRATE. César et Lépide sont en campagne, amenant avec eux des forces imposantes. POMPÉE. D’où tenez-vous cette nouvelle ? Elle est fausse. MÉNÉCRATE. De Silvius, seigneur. POMPÉE. Il rêve ; je sais qu’ils sont encore tous deux à Rome, où ils attendent Antoine. — Voluptueuse Cléopâtre, que tous les charmes de l’amour prêtent leur douceur à tes lèvres flétries ! Joins à la beauté les arts magiques et la volupté ; enchaîne le débauché dans un cercle de fêtes ; échauffe sans cesse son cerveau. Que les cuisiniers épicuriens aiguisent son appétit par des assaisonnements toujours renouvelés, afin que le sommeil et les banquets lui fassent oublier son honneur dans la langueur du Léthé. — Qu’y a-t-il, Varius ?
(Varius paraît.) VARIUS. Comptez sur la vérité de la nouvelle que je vous annonce. Marc-Antoine est d’heure en heure attendu à Rome : depuis qu’il est parti d’Égypte il aurait eu le temps de faire un plus long voyage. POMPÉE. J’aurais écouté plus volontiers une nouvelle moins sérieuse… Ménas, je n’aurais jamais pensé que cet homme insatiable de voluptés eût mis son casque pour une guerre aussi peu importante. C’est un guerrier qui vaut à lui seul plus que les deux autres ensemble… Mais concevons de nous-mêmes une plus haute opinion, puisque le bruit de notre marche peut arracher des genoux de la veuve d’Égypte cet Antoine qui n’est jamais las de débauches. MÉNAS. Je ne puis croire que César et Antoine puissent s’accorder ensemble. Sa femme, qui vient de mourir, a offensé César ; son frère lui a fait la guerre, quoiqu’il n’y fût pas, je crois, poussé par Antoine. POMPÉE.