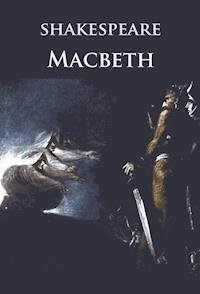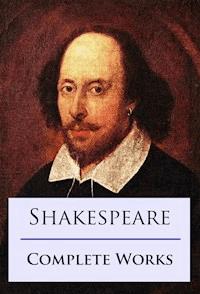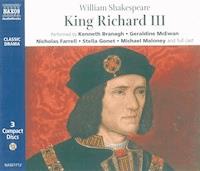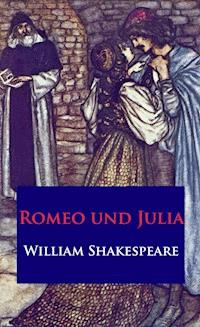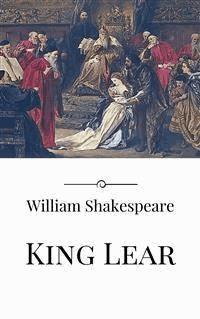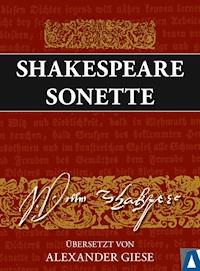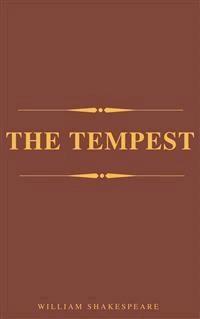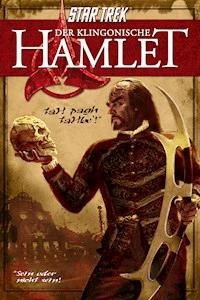Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
RÉSUMÉ : "Othello, le Maure de Venise" est une tragédie poignante de William Shakespeare qui explore les thèmes intemporels de la jalousie, de la trahison et de l'amour. L'histoire se déroule à Venise et à Chypre, où Othello, un général maure respecté au service de la République de Venise, se retrouve au coeur d'une intrigue perfide orchestrée par son lieutenant, Iago. Iago, motivé par la rancoeur et l'ambition, manipule habilement les personnages autour de lui pour semer le doute et la discorde. Il convainc Othello que sa femme, Desdémone, lui est infidèle avec Cassio, un autre officier. Aveuglé par la jalousie, Othello tombe dans un piège qui le conduira à prendre des décisions tragiques et irréversibles. La pièce met en lumière la fragilité de l'esprit humain face aux manipulations et aux préjugés, tout en offrant une réflexion profonde sur les conséquences dévastatrices de la méfiance et de l'orgueil. Grâce à une écriture magistrale et des personnages complexes, Shakespeare nous invite à réfléchir sur la nature humaine et les forces destructrices qui peuvent la gouverner. L'AUTEUR : William Shakespeare, né en 1564 à Stratford-upon-Avon, est l'un des dramaturges et poètes les plus influents de la littérature anglaise. Il est souvent surnommé le "Barde de l'Avon" et a produit une oeuvre prolifique qui comprend des tragédies, des comédies et des sonnets. Shakespeare a commencé sa carrière à Londres, où il a rapidement acquis une réputation grâce à ses pièces novatrices et à son talent pour capturer les nuances de l'âme humaine. Parmi ses oeuvres les plus célèbres figurent "Hamlet", "Macbeth", "Roméo et Juliette" et bien sûr "Othello". Ses écrits sont caractérisés par leur richesse linguistique, leur exploration des émotions humaines et leur capacité à transcender les époques. Bien que les détails de sa vie personnelle restent en grande partie obscurs, son influence sur la littérature et la culture mondiale est indéniable. Shakespeare est décédé en 1616, mais son héritage perdure, continuant d'inspirer et d'éduquer des générations de lecteurs et de spectateurs à travers le monde.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 143
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
PERSONNAGES
OTHELLO : le Maure de Venise
BRABANTIO : père de Desdémona.
CASSIO : lieutenant honorable.
IAGO : un scélérat
RODERIGO : gentilhomme dupe.
LE DOGE DE VENISE.
SÉNATEURS.
MONTANO : gouverneur de Chypre.
GENTILSHOMMES DE CHYPRE.
LODOVICO ET GRATIANO : nobles vénitiens.
MATELOTS.
LE CLOWN.
DESDÉMONA : femme d’Othello.
ÉMILIA : femme d’Iago.
BIANCA : courtisane
La scène est d’abord à Venise, puis dans l’île de Chypre
Sommaire
SCÈNE I
SCÈNE II
SCÈNE III
SCÈNE IV
SCÈNE V
SCÈNE VI
SCÈNE VII
SCÈNE VIII
SCÈNE IX
SCÈNE X
SCÈNE XI
SCÈNE XII
SCÈNE XIII
SCÈNE XIV
SCÈNE XV
SCÈNE XVI
SCÈNE I
[ Venise. Une place sur laquelle est située la maison de Brabantio. Il fait nuit. ]
Arrivent RODERIGO et IAGO.
RODERIGO.
– Fi ! ne m’en parle pas. Je suis fort contrarié – que toi, Iago, qui as usé de ma bourse, – comme si les cordons t’appartenaient, tu aies eu connaissance de cela.
IAGO.
– Tudieu ! mais vous ne voulez pas m’entendre. – Si jamais j’ai songé à pareille chose, – exécrez-moi.
RODERIGO.
Tu m’as dit que tu le haïssais.
IAGO.
– Méprisez-moi, si ce n’est pas vrai. Trois grands de la Cité – vont en personne, pour qu’il me fasse son lieutenant, le solliciter, – chapeau bas, et, foi d’homme, je sais mon prix, je ne mérite pas un grade moindre. – Mais lui, entiché de son orgueil et de ses idées, – répond évasivement, et, dans un jargon – ridicule, bourré de termes de guerre, – il éconduit mes protecteurs. En vérité, dit-il, – j’ai déjà choisi mon officier. – Et quel est cet officier ? – Morbleu, c’est un grand calculateur, – un Michel Cassio, un Florentin, – un garçon presque condamné à la vie d’une jolie femme, – qui n’a jamais rangé en bataille un escadron, – et qui ne connaît pas mieux la manœuvre – qu’une donzelle, ne possédant que la théorie des bouquins, – sur laquelle les robins bavards peuvent disserter – aussi magistralement que lui. N’importe ! à lui la préférence ! Un babil sans pratique – est tout ce qu’il a de militaire. – Et moi, qui, sous les yeux de l’autre, ai fait mes preuves – à Rhodes, à Chypre et dans maints pays – chrétiens et païens, il faut que je reste en panne et que je sois dépassé – par un teneur de livres, un faiseur d’additions ! – C’est lui, au moment venu, qu’on doit faire lieutenant, – et moi, je reste l’enseigne (titre que Dieu bénisse !) de sa seigneurie more.
RODERIGO.
– Par le ciel, j’eusse préféré être son bourreau.
IAGO.
– Pas de remède à cela, c’est la plaie du service. – L’avancement se fait par apostille et par faveur, – et non d’après la vieille gradation qui fait du second – l’héritier du premier. Maintenant, monsieur, jugez vous-même – si je suis engagé par de justes raisons – à aimer le Maure.
RODERIGO.
Moi, je ne resterais pas sous ses ordres.
IAGO.
– Oh ! rassurez-vous, monsieur. – Je n’y reste que pour servir mes projets sur lui. – Nous ne pouvons pas tous être les maîtres, et les maîtres – ne peuvent pas tous être fidèlement servis. Vous remarquerez – beaucoup de ces marauds, humbles et agenouillés – qui, raffolant de leur obséquieux servage – s’échinent, leur vie durant, comme l’âne de leur maître, – rien que pour avoir la pitance. Se font-ils vieux ? on les chasse : – fouettez-moi ces honnêtes drôles !… Il en est d’autres – qui, tout en affectant les formes et les visages du dévouement, – gardent dans leur cœur la préoccupation d’euxmêmes, – et qui, ne jetant à leur seigneur que des semblants de dévouement, – prospèrent à ses dépens, puis, une fois leurs habits bien garnis, – se font hommage à eux-mêmes. Ces gaillards-là ont quelque cœur, – et je suis de leur nombre, je le confesse. – En effet, seigneur, – aussi vrai que vous êtes Roderigo, – si j’étais le Maure, je ne voudrais pas être Iago. – En le servant, je ne sers que moi-même. – Ce n’est, le ciel m’est témoin, ni l’amour ni le devoir qui me font agir, – mais, sous leurs dehors, mon intérêt personnel. – Si jamais mon action visible révèle – l’acte et l’idée intimes de mon âme – par une démonstration extérieure, le jour ne sera pas loin – où je porterai mon cœur sur ma manche, – pour le faire becqueter aux corneilles… Je ne suis pas ce que je suis.
RODERIGO.
– Quel bonheur a l’homme aux grosses lèvres – pour réussir ainsi !
IAGO.
Appelez le père, – réveillez-le, et mettez-vous aux trousses de l’autre. Empoisonnez sa joie. – Criez son nom dans les rues. Mettez en feu les parents, – et, quoiqu’il habite sous un climat favorisé, – criblez-le de moustiques. Si son bonheur est encore du bonheur, – altérez-le du moins par tant de tourments – qu’il perde son éclat.
RODERIGO.
– Voici la maison du père ; je vais l’appeler tout haut.
IAGO.
– Oui, avec un accent d’effroi, avec un hurlement terrible, – comme quand, par une nuit de négligence, l’incendie – est signalé dans une cité populeuse.
RODERIGO, sous les fenêtres de la maison de Brabantio.
– Holà ! Brabantio ! Signor Brabantio ! Holà !
IAGO.
Éveillez-vous ! Holà ! Brabantio ! Au voleur ! au voleur ! au voleur ! – Ayez l’œil sur votre maison, sur votre fille et sur vos sacs ! – Au voleur ! au voleur !
BRABANTIO, paraissant à une fenêtre.
– Quelle est la raison de cette terrible alerte ? – De quoi s’agit-il ?
RODERIGO.
– Signor, toute votre famille est-elle chez vous ?
IAGO.
– Vos portes sont-elles fermées ?
BRABANTIO.
Pourquoi ? dans quel but me demandez-vous cela ?
IAGO.
– Sangdieu ! monsieur, vous êtes volé. Par pudeur, passez votre robe ! – Votre cœur est déchiré : vous avez perdu la moitié de votre âme ! – Juste en ce moment, en ce moment, en ce moment même, un vieux bélier noir – est monté sur votre blanche brebis. Levez-vous, levez-vous ! – Éveillez à son de cloche les citoyens en train de ronfler, – ou autrement le diable va faire de vous un grand-papa. – Levez-vous, vous dis-je.
BRABANTIO.
Quoi donc ? avez-vous perdu l’esprit ?
RODERIGO.
– Très révérend signor, est-ce que vous ne reconnaissez pas ma voix ?
BRABANTIO.
– Non. Qui êtes-vous ?
RODERIGO.
– Mon nom est Roderigo.
BRABANTIO.
Tu n’en es que plus mal venu. – Je t’ai défendu de rôder autour de ma porte ; – tu m’as entendu dire en toute franchise – que ma fille n’est pas pour toi ; et voici qu’en pleine folie, – rempli du souper et des boissons qui te dérangent, – tu viens, par une méchante bravade, – alarmer mon repos.
RODERIGO.
– Monsieur ! Monsieur ! Monsieur ! Monsieur !
BRABANTIO.
Mais tu peux être sûr – que ma colère et mon pouvoir sont assez forts – pour te faire repentir de ceci.
RODERIGO.
Patience, mon bon monsieur.
BRABANTIO.
– Que me parlais-tu de vol ? Nous sommes ici à Venise : – ma maison n’est point une grange abandonnée.
RODERIGO.
Très grave Brabantio, – je viens à vous, dans toute la simplicité d’une âme pure. –
IAGO.
Pardieu, monsieur, vous êtes de ces gens qui refuseraient de servir Dieu, si le diable le leur disait. Parce que nous venons vous rendre un service, vous nous prenez pour des chenapans, et vous laissez couvrir votre fille par un cheval de Barbarie ! Vous voulez avoir des étalons pour cousins et des genets pour alliés !
BRABANTIO.
Quel misérable païen es-tu donc, toi ?
IAGO.
Je suis, monsieur, quelqu’un qui vient vous dire que votre fille et le Maure sont en train de faire la bête à deux dos.
BRABANTIO.
– Tu es un manant.
IAGO.
Vous êtes… un sénateur.
BRABANTIO, à Roderigo.
– Tu me répondras de ceci ! Je te connais, toi, Roderigo !
RODERIGO.
– Monsieur, je vous répondrai de tout. Mais, de grâce, une question. – Est-ce d’après votre désir et votre consentement réfléchi, – comme je commence à le croire, que votre charmante fille, – à cette heure indue, par une nuit si épaisse, – est allée, sous la garde pure et simple – d’un maraud de louage, d’un gondolier, – se livrer aux étreintes grossières d’un Maure lascif ? – Si cela est connu et permis par vous, – alors nous avons eu envers vous le tort d’une impudente indiscrétion. – Mais, si cela se passe à votre insu, mon savoir-vivre me dit – que nous recevons à tort vos reproches. Ne croyez pas – que, m’écartant de toute civilité, – j’aie voulu jouer et plaisanter avec votre honneur ! – Votre fille, si vous ne l’avez pas autorisée, – je le répète, a fait une grosse révolte, – en attachant ses devoirs, sa beauté, son esprit, sa fortune, – à un vagabond, à un étranger qui a roulé – ici et partout. Édifiezvous par vous-même tout de suite – Si elle est dans sa chambre et dans votre maison, – faites tomber sur moi la justice de l’État – pour vous avoir ainsi abusé.
BRABANTIO, à l’intérieur.
Battez le briquet ! holà ! – Donnez-moi un flambeau ! Appelez tous mes gens !… – Cette aventure n’est pas en désaccord avec mon rêve ; – la croyance à sa réalité m’oppresse déjà. – De la lumière, dis-je ! de la lumière !
Il se retire de la fenêtre.
IAGO, à Roderigo.
– Adieu. Il faut que je vous quitte. – Il ne me paraît ni opportun, ni sain, dans mon emploi, – d’être assigné, comme je le serais – en restant, pour déposer contre le Maure ; car, je le sais bien, – quoique ceci puisse lui attirer quelque cuisante mercuriale, – l’État ne peut pas se défaire de lui sans danger. Il est engagé, – par des raisons si impérieuses, dans la guerre de Chypre – qui se poursuit maintenant, que, s’agît-il du salut de leurs âmes, – nos hommes d’État n’en trouveraient pas un autre à sa taille – pour mener leurs affaires. En conséquence, – bien que je le haïsse à l’égal des peines de l’enfer – je dois, pour les nécessités du moment, – arborer les couleurs, l’enseigne de l’affection, – pure enseigne, en effet !… Afin de le découvrir sûrement, – dirigez les recherches vers le Sagittaire. – Je serai là avec lui. Adieu donc !
Il s’en va.
BRABANTIO arrive suivi de gens portant des torches.
BRABANTIO.
– Le mal n’est que trop vrai : elle est partie ! – Et ce qui me reste d’une vie méprisable – n’est plus qu’amertume… Maintenant, Roderigo, – où l’as-tu vue ?… Oh ! malheureuse fille ! – Avec le Maure, dis-tu ?… Qui voudrait être père, à présent ? – Comment l’as-tu reconnue ?… Oh ! elle m’a trompée – incroyablement !… Que t’a-t-elle dit, à toi ?… D’autres flambeaux ! – Qu’on réveille tous mes parents !… Sont-ils mariés, crois-tu ?
RODERIGO.
– Oui, sans doute, je le crois.
BRABANTIO.
– Ciel ! comment a-t-elle échappé ? Ô trahison du sang ! – Pères, à l’avenir, ne vous rassurez pas sur l’esprit de vos filles, – d’après ce que vous leur verrez faire… N’y a-t-il pas de sortilèges – au moyen desquels les facultés de la jeunesse et de la virginité – peuvent être déçues ? N’as-tu pas lu, Roderigo, – quelque chose comme cela ?
RODERIGO.
Oui, monsieur, certainement.
BRABANTIO.
– Éveillez mon frère !… Que ne te l’ai-je donnée ! – Que ceux-ci prennent une route, ceux-là, une autre !
À Roderigo.
Savez-vous – où nous pourrions les surprendre, elle et le Maure ?
RODERIGO.
– Je crois que je puis le découvrir, si vous voulez – prendre une bonne escorte et venir avec moi.
BRABANTIO.
– De grâce, conduisez-nous. Je vais frapper à toutes les maisons ; – je puis faire sommation, au besoin.
À ses gens.
Armez-vous, holà ! – et appelez des officiers de nuit spéciaux ! – En avant, mon bon Roderigo, je vous dédommagerai de vos peines.
Tous s’en vont.
SCÈNE II
[ Venise. La place de l’Arsenal. Il fait toujours nuit. ]
Entrent IAGO, OTHELLO et plusieurs domestiques.
IAGO.
– Bien que j’aie tué des hommes au métier de la guerre, – je regarde comme l’étoffe même de la conscience – de ne pas commettre de meurtre prémédité ; je ne sais pas être inique – parfois pour me rendre service : neuf ou dix fois, – j’ai été tenté de le trouer ici, sous les côtes.
OTHELLO.
– Les choses sont mieux ainsi.
IAGO.
– Non, mais il bavardait tant ! – il parlait en termes si ignobles et si provocants – contre Votre Honneur, – qu’avec le peu de sainteté que vous me connaissez, – j’ai eu grand-peine à le ménager. Mais, de grâce, monsieur. – êtes-vous solidement marié ? Soyez sûr – que ce Magnifique est très aimé : – il a, par l’influence, une voix aussi puissante que – celle du doge. Il vous fera divorcer. – Il vous opposera toutes les entraves, toutes les rigueurs – pour lesquelles la loi, tendue de tout son pouvoir, – lui donnera de la corde.
OTHELLO.
Laissons-le faire selon son dépit. – Les services que j’ai rendus à Sa Seigneurie – parleront plus fort que ses plaintes. On ne sait pas tout encore : – quand je verrai qu’il y a honneur à s’en vanter, – je révélerai que je tiens la vie et l’être – d’hommes assis sur un trône ; et mes mérites – pourront répondre la tête haute à la fière fortune – que j’ai conquise. Sache-le bien, Iago, – si je n’aimais pas la gentille Desdémona, – je ne voudrais pas restreindre mon existence, libre sous le ciel, – au cercle d’un intérieur, – non, pour tous les trésors de la mer. Mais vois donc ! quelles sont ces lumières là-bas ?
CASSIO et plusieurs officiers portant des torches apparaissent à distance.
IAGO.
– C’est le père et ses amis qu’on a mis sur pied. – Vous feriez bien de rentrer.
OTHELLO.
Non pas : il faut que l’on me trouve. – Mon caractère, mon titre, ma conscience intègre – me montreront tel que je suis. Sont-ce bien eux ?
IAGO.
– Par Janus, je crois que non.
OTHELLO, s’approchant des nouveaux venus.
Les gens du doge et mon lieutenant ! – Que la nuit vous soit bonne, mes amis ! – Quoi de nouveau ?
CASSIO.
Le doge vous salue, général, – et réclame votre comparution immédiate.
OTHELLO.
De quoi s’agit-il, – à votre idée ?
CASSIO.
– Quelque nouvelle de Chypre, je suppose : – c’est une affaire qui presse. Les galères – ont expédié une douzaine de messagers qui ont couru – toute la nuit, les uns après les autres. – Déjà beaucoup de nos conseils se sont levés et réunis – chez le doge. On vous a réclamé ardemment ; – et, comme on ne vous a pas trouvé à votre logis, – le sénat a envoyé trois escouades différentes – à votre recherche.
OTHELLO.
Il est heureux que j’aie été trouvé par vous. – Je n’ai qu’un mot à dire ici, dans la maison.
Il montre le Sagittaire.
– Et je pars avec vous.
Il s’éloigne et disparaît.
CASSIO.
Enseigne, que fait-il donc là ?
IAGO.
– Sur ma foi, il a pris à l’abordage un galion de terre ferme. – Si la prise est déclarée légale, sa fortune est faite à jamais.
CASSIO.
– Je ne comprends pas.
IAGO.
Il est marié.
CASSIO.
À qui donc ?
IAGO.
Marié à…
OTHELLO revient.
IAGO.
Allons, général, voulez-vous venir ?
OTHELLO.
Je suis à vous.
CASSIO.
– Voici une autre troupe qui vient vous chercher.
Entrent BRABANTIO, RODERIGO et des officiers de nuit, armés et partant des torches.
IAGO.
– C’est Brabantio : général, prenez garde. – Il vient avec de mauvaises intentions.
OTHELLO.
Holà ! arrêtez.
RODERIGO, à Brabantio.
– Seigneur, voici le Maure.
BRABANTIO, désignant Othello.
Sus au voleur !
Ils dégainent des deux côtés.
IAGO.
– C’est vous. Roderigo ? Allons, monsieur, à nous deux !
OTHELLO.
– Rentrez ces épées qui brillent : la rosée pourrait les rouiller.
À Brabantio.
– Bon signor, vous aurez plus de pouvoir avec vos années – qu’avec vos armes.
BRABANTIO.
– Ô toi ! hideux voleur, où as-tu recélé ma fille ? – Damné que tu es, tu l’as enchantée !… – En effet, je m’en rapporte à tout être de sens : – si elle n’était pas tenue à la chaîne de la magie, – est-ce qu’une fille si tendre, si belle, si heureuse, – si opposée au mariage qu’elle repoussait – les galants les plus somptueux et les mieux frisés du pays, – aurait jamais, au risque de la risée générale, – couru de la tutelle de son père au sein noir de suie – d’un être comme toi, fait pour effrayer et non pour plaire ? – Je prends tout le monde pour juge. Ne tombe-t-il pas sous le sens – que tu as pratiqué sur elle tes charmes hideux – et abusé sa tendre jeunesse avec des drogues ou des minéraux – qui éveillent le désir ? Je ferai examiner ça. – La chose est probable et palpable à la réflexion. – En conséquence, je t’appréhende et je t’empoigne – comme un suborneur du monde, comme un adepte – des arts prohibés et hors la loi.
À ses gardes.
Emparez-vous de lui ; s’il résiste, – maîtrisez-le à ses risques et périls.
OTHELLO.
Retenez vos bras, – vous, mes partisans, et vous, les autres ! – Si ma réplique devait être à coups d’épée, je me la serais rappelée – sans souffleur.
À Brabantio.
Où voulez-vous que j’aille – pour répondre à votre accusation ?
BRABANTIO.
En prison ! jusqu’à l’heure rigoureuse – où la loi, dans le cours de sa session régulière, – t’appellera à répondre.
OTHELLO.
Et, si je vous obéis, – comment pourrai-je satisfaire le doge, – dont les messagers, ici rangés à mes côtés, – doivent, pour quelque affaire d’État pressante, – me conduire jusqu’à lui ?
UN OFFICIER, à Brabantio.
C’est vrai, très digne signer, – le doge est en conseil, et votre excellence elle-même – a été convoquée, j’en suis sûr.
BRABANTIO.
Comment ! le doge en conseil ! – à cette heure de nuit !… Emmenez-le. – Ma cause n’est point frivole : le doge lui-même – et tous mes frères du sénat – ne peuvent prendre ceci que comme un affront personnel. – Car, si de telles actions peuvent avoir un libre cours, – des serfs et des païens seront bientôt nos gouvernants !
Ils s’en vont.
SCÈNE III
[ Venise. La salle du conseil. ]
Le DOGE et les SÉNATEURS sont assis autour d’une table. Au fond se tiennent les officiers de service.
LE DOGE.
– Il n’y a pas dans ces nouvelles assez d’harmonie – pour y croire.
PREMIER SÉNATEUR.
En effet, elles sont en contradiction. – Mes lettres disent cent sept galères.
LE DOGE.
– Et les miennes, cent quarante.
DEUXIÈME SÉNATEUR.
Et les miennes, deux cents. – Bien qu’elles ne s’accordent pas sur le chiffre exact – (vous savez que les rapports fondés sur des conjectures – ont souvent des variantes), elles confirment toutes – le fait d’une flotte turque se portant sur Chypre.
LE DOGE.
– Oui, cela suffit pour former notre jugement. – Je ne me laisse pas rassurer par les contradictions, – et je vois le fait principal prouvé – d’une terrible manière.
UN MATELOT, au-dehors.
Holà ! holà ! holà !
Entre un OFFICIER suivi d’un matelot.
L’OFFICIER.
– Un messager des galères !
LE DOGE.
Eh bien ! qu’y a-t-il ?
LE MATELOT.
– L’expédition turque appareille pour Rhodes ; – c’est ce que je suis chargé d’annoncer au gouvernement – par le seigneur Angelo.
LE DOGE, aux sénateurs.
Que dites-vous de ce changement ?
PREMIER SÉNATEUR.
Il n’a pas de motif – raisonnable. C’est une feinte – pour détourner notre attention. Considérons – la valeur de Chypre pour le Turc ; – comprenons seulement – que cette île est pour le Turc plus importante que Rhodes, – et qu’elle lui est en même temps plus facile à emporter, – puisqu’elle n’a ni l’enceinte militaire – ni aucun moyen de défense – dont Rhodes est investie : songeons à cela – et nous ne pourrons pas croire que le Turc fasse la faute – de renoncer à la conquête qui l’intéresse le plus – et de négliger une attaque d’un succès facile – pour provoquer et risquer un danger sans profit
LE DOGE.
– Non, à coup sûr, ce n’est pas à Rhodes qu’il en veut.
UN OFFICIER.
– Voici d’autres nouvelles.
Entre un MESSAGER.
LE MESSAGER.