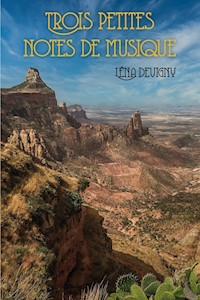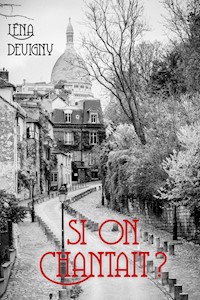
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Publishroom
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Alice a survécu à la tentative d'avortement de sa mère et en garde l'impression d'être indestructible. Elevée par cette mère ambivalente cabossée par la vie, abusée par un père malfaisant, elle avance néanmoins avec de solides atouts dans son jeu : une grand-mère aimante, une amie truculente au soutien sans faille, la musique, exutoire à sa difficulté d'être, et la rage de vivre chevillée au corps.
Héroïne résiliente, Alice trace sa route en chantant malgré les drames qui la frappent. Parviendra-t-elle à se libérer, à s'autoriser à goûter au bonheur?
EXTRAIT
Seize millimètres. À peine la taille d’une olive.
Fruit de toutes les existences immémoriales qui l’ont précédé et le constituent, ce petit haricot en apparence si vulnérable est un condensé de vie(s), l’expression éclatante de l’inné.
Je suis rythme, pulsation, mouvement. Pulsion de vie, entité en devenir, créature en perpétuel développement, en constante expansion.
Assoupi, ondoyant voluptueusement dans l’obscurité aqueuse de ma caverne, je suis soudain éveillé, alerté par une clarté inhabituelle derrière mes paupières closes. D’instinct j’ai flairé le danger. La mer, devenue houleuse, hostile, me ballotte, tandis que la peur s’insinue en moi. Prémonition d’une intrusion dans mon abri matriciel, d’une possibilité d’arrachement, de marée descendante, de finitude.
Mon cerveau reptilien m’enjoignant de fuir, je profite d’un courant ascendant pour m’élancer, à la force de mes bras et de mes jambes ébauchés. Je me hisse jusqu’à trouver refuge dans le coin le plus inaccessible, où je me tapis, inerte. Effluves ferrugineux. J’ai l’intuition que ce qui a pénétré mon paradis perdu n’aspire qu’à mon anéantissement. Un spot puissant balaye la nuit en quête du fugitif. Un violent courant d’air froid tente de m’entraîner en bas, vers l’issue béante qui me fascine autant qu’elle me terrifie. Vertige.
Le sicaire a décidé de faire place nette en mon royaume. Monarque déchu, trahi par celle qui, hier encore, me couvait en son sein, désormais seul face à l’adversité, je refuse de capituler. Malgré mes doigts et mes orteils à peine modelés, je m’agrippe aux parois tendres et charnues de mon cocon avec l’énergie du désespoir. Je lutte pour ne pas glisser et me laisser emporter dans leur tube de mort.
Sorti du néant il y a près de sept semaines, je livre mon premier combat. Sans voix, sans vue, sans ouïe. Je clame mon droit à poursuivre mon évolution. Ça peut sembler dérisoire, perdu d’avance, mais je suis coriace et animé d’une telle volonté, pétri d’une telle rage d’exister que rien ne saurait m’ébranler. J’ai la prescience que si je ne dois gagner qu’une bataille, ce sera celle-là.
Je veux VIVRE. Envers et contre tout.
À PROPOS DE L'AUTEURE
Léna Devigny, de son nom de plume, est musicienne de formation et diplômée en lettres. Professeure de musique depuis une vingtaine d’années, nourrie de littérature, de voyages et de psychanalyse, elle s’est inspirée de son enfance à Montmartre dans les années soixante-dix, de rencontres qui ont jalonné sa vie, enrichi son imaginaire, pour concevoir son premier roman, "Si on chantait ?" qu’elle auto-édite en Février 2020.
https://www.facebook.com/lenadevignyauteur
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 280
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Léna Devigny
SionChantait ?
Roman
Seize millimètres. À peine la taille d’une olive.
Fruit de toutes les existences immémoriales qui l’ont précédé et le constituent, ce petit haricot en apparence si vulnérable est un condensé de vie(s), l’expression éclatante de l’inné.
Je suis rythme, pulsation, mouvement. Pulsion de vie, entité en devenir, créature en perpétuel développement, en constante expansion.
Assoupi, ondoyant voluptueusement dans l’obscurité aqueuse de ma caverne, je suis soudain éveillé, alerté par une clarté inhabituelle derrière mes paupières closes. D’instinct j’ai flairé le danger. La mer, devenue houleuse, hostile, me ballotte, tandis que la peur s’insinue en moi. Prémonition d’une intrusion dans mon abri matriciel, d’une possibilité d’arrachement, de marée descendante, de finitude.
Mon cerveau reptilien m’enjoignant de fuir, je profite d’un courant ascendant pour m’élancer, à la force de mes bras et de mes jambes ébauchés. Je me hisse jusqu’à trouver refuge dans le coin le plus inaccessible, où je me tapis, inerte. Effluves ferrugineux. J’ai l’intuition que ce qui a pénétré mon paradis perdu n’aspire qu’à mon anéantissement. Un spot puissant balaye la nuit en quête du fugitif. Un violent courant d’air froid tente de m’entraîner en bas, vers l’issue béante qui me fascine autant qu’elle me terrifie. Vertige.
Le sicaire a décidé de faire place nette en mon royaume. Monarque déchu, trahi par celle qui, hier encore, me couvait en son sein, désormais seul face à l’adversité, je refuse de capituler. Malgré mes doigts et mes orteils à peine modelés, je m’agrippe aux parois tendres et charnues de mon cocon avec l’énergie du désespoir. Je lutte pour ne pas glisser et me laisser emporter dans leur tube de mort.
Sorti du néant il y a près de sept semaines, je livre mon premier combat. Sans voix, sans vue, sans ouïe. Je clame mon droit à poursuivre mon évolution. Ça peut sembler dérisoire, perdu d’avance, mais je suis coriace et animé d’une telle volonté, pétri d’une telle rage d’exister que rien ne saurait m’ébranler. J’ai la prescience que si je ne dois gagner qu’une bataille, ce sera celle-là.
Je veux VIVRE. Envers et contretout.
Je reviens de loin, des abîmes insondables dont on ne garde aucune réminiscence. La partie de cache-cache à laquelle je me livrai pour sauver ma peau, entraîna des douleurs si insupportables, arracha de tels cris à ma mère, que le gynécologue renonça à poursuivre l’intervention.
J’ai survécu à une tentative d’assassinat à l’âge de deux mois in utero. De là me vient sans doute ce sentiment prégnant que je suis « increvable », indestructible.
Je me suis souvent interrogée surles raisons qui ont pu amener ma mère à s’éprendre de mon géniteur, cet enjôleur délétère de six ans son aîné. Sa séduction, ses « façons pas très catholiques » n’y étaient sans doute pas étrangères, et comme le chantait Henri Garat dès 1931 : « Y a pas mieux qu’un mauvais garçon pour t’donner l’grand frisson ». Frisson ou pas, il n’en reste pas moins que la rencontre, ou plutôt la collision entre ces deux écorchés vifs, est à l’origine du séisme dont je suis issue.
En ce début de soirée d’août 1969, il fait une chaleur accablante à Paris. Six coups retentissent à l’église Saint-Jean de Montmartre, invitant les fidèles à la messe du soir. Hélène, ma mère, âgée de dix-huit ans, sort de son rendez-vous hebdomadaire entre jeunes de la paroisse, du genre rallye pour les classes populaires. Lors de ces réunions bon enfant du samedi après-midi, on discute, on écoute de la musique, on esquisse quelques pas de danse en tout bien tout honneur, sous l’œil vigilant d’une sœur-sourire qui fait office de chaperon.
Ce jour-là Hélène porte sa mini-jupe préférée, couleur mandarine. Sa mère a beau lui répéter à l’envi que les jupes-culottes – à taille haute avec ourlet flottant sous le genou – sont également à la mode, elle n’en a cure ! Elle a de jolies jambes et entend bien les montrer ! Un photographe l’a récemment accostée pour lui proposer de la portraiturer.
– Vous avez les mêmes yeux que Marie Laforêt ! Vous lui ressemblez tant que c’est à s’y méprendre ! lui a-t-il dit, admiratif.
Flattée elle a néanmoins décliné sa proposition : sa mère n’aurait jamais donné son consentement. Depuis la disparition de son mari, elle se montre intransigeante, dure avec ses filles. Hélène ne lui en tient pas rigueur : elle sait que le chagrin l’a dépouillée de sa joyeuse humeur d’antan.
Élevée dans « l’amour de Dieu et de son prochain », Hélène prend plaisir à faire le bien autour d’elle, à se montrer charitable, ainsi que sa mère le lui a inculqué. Aussi n’est-il pas rare de la croiser faisant des courses pour une voisine impotente. Gracieuse, polie, elle a toujours un mot aimable pour les autres :
– Bonjour madame Doin, votre hanche va mieux ? Vous ne souffrez pas trop ?
– Oh tu sais, couci-couça !
– En tout cas, vous êtes drôlement bien coiffée ! Vous sortez de chez le coiffeur ?
– Oh non, mon p’tit, j’essaie de faire au mieux, mais tu sais, à mon âge… ! Ah on ne peut pas être et avoir été ! La roue tourne !
Comme toute jeune femme de son âge, Hélène nourrit des rêves qui la transportent : elle s’imagine foulant le sol d’illustres plateaux de théâtres, incarnant tour à tour Adela, Junie, Antigone, Bérénice, exprimant passion, révolte, désespoir, dans une salutaire catharsis. À l’instar de Tony dans « West Side story », elle pressent que quelque chose de merveilleux est sur le point de survenir dans sa morne existence.
Pourtant derrière cette apparence de vitalité et de fougue, Hélène dissimule une plaie béante causée par la mort tragique de son père bien-aimé, cinq ans plus tôt.
Petit moineau dans un corps de cygne, elle marche dans la rue d’un pas alerte en fredonnant « Je t’aime… moi non plus », le sulfureux titre de Serge Gainsbourg que la jeunesse écoute en douce sur France Inter, les hormones en ébullition. Comment ne pas subir le charme érotique de cette chanson ?
C’est à cet instant précis que j’aimerais pouvoir influer sur le cours des événements en supprimant la séquence suivante de la trame du roman familial. Si seulement j’avais pu la mettre en garde !
– Méfie-toi, Hélène : il va jouer sur la corde sensible ! Vois ses narines qui palpitent, son instinct de prédateur à l’affût d’une proie ! Ne traîne pas et rentre sans tarder à la maison ! Ne t’a-t-on pas répété cent fois de ne pas parler à des inconnus ?!
Trop tard ! Il l’a abordée rue des Abbesses et l’a l’invitée à prendre un verre. Après quelques secondes d’hésitation, elle a accepté de le suivre dans un café à deux pas de là. Quand ses grands yeux vert d’eau ont croisé ceux si bleus, si clairs du mauvais garçon, son cœur a fait « boum ». Et « quand notre cœur fait boum, tout avec lui dit boum » !
Elle s’est jetée à corps perdu dans cette relation avec ce fringant voyou fraîchement sorti de sa cellule de Fleury, où il venait de purger sa peine pour un braquage à la voiture-bélier. Elle a fait fi des recommandations, des valeurs familiales, troquant les réunions paroissiales contre des rencontres illicites. Elle a ignoré la défiance, déterminée à l’accompagner sur le chemin de la rédemption, à le sauver.
C’était sans compter sur l’absence d’états d’âme du jeune homme, endurci depuis sa prime enfance par les mauvais traitements que lui infligeait son ivrogne de père sous le regard complaisant de sa mère dépressive.
En 1969 il était révolu le temps où on se fréquentait pendant des semaines, voire des mois, avant de s’adonner aux plaisirs charnels ! Le mouvement de la révolution sexuelle en marche, les jeunes revendiquaient l’amour libre. Hélène et sa nouvelle conquête se retrouvaient donc régulièrement chez des amis à lui pour consommer leur amour.
Lorsque cinq mois plus tard elle réalisa qu’elle était enceinte de son « Mesrine », de son « bandit rangé des voitures », elle pleura de vertige et de béatitude. Exaltée, forte de tous les possibles qu’elle portait en son ventre, elle courut au « Houdon », le bar où il passait ses journées accoudé au comptoir, le regard nébuleux, attendant que ne vienne le trouver un hypothétique emploi. Sans lui laisser le temps de réagir, dans une tirade de jeune première, elle épancha son amour pour lui, évoqua l’existence fabuleuse qui s’offrait à eux, posant les jalons d’une vie qui au début serait modeste.
– Dans un premier temps, comme nous n’aurons pas d’argent, nous vivrons chez ma mère. Elle a un canapé dans le salon qui fera l’affaire. Si tout va bien, j’aurai mon bac dans quelques mois ! Après ce sera l’École Normale, avant un poste d’enseignante ! Oh bien sûr au début nous ne roulerons pas sur l’or, mais ensuite j’aurai une paye très convenable ! Mon frère est débordé au magasin et cherche un manutentionnaire. Je suis sûre qu’il te donnera la place quand il saura pour nous !
Le regard de l’homme s’était posé sur elle, fixe, froid, dur, reptilien.
– Quand il saura quoi ?
Mi-intimidée mi-euphorique, elle avait achevé dans un souffle :
– Mon chéri, j’attends un enfant. Notre enfant ! Je suis si heureuse !
Elle s’était avancée pour l’enlacer. Il l’avait brutalement repoussée. Son regard bleu ciel s’était fait acier, crépusculaire. Comme des pierres roulant sur le lit d’un torrent presque à sec, il avait éructé :
– T’es contente, t’as ce que tu voulais, tu t’es fait engrosser ? Qu’est-ce que tu crois ? Que je vais tout plaquer pour élever un autre gniard ?
– … ?…
– Ben oui, figure-toi que j’ai déjà une femme et un môme de quatre ans, ma belle ! On a pris du bon temps tous les deux, mais je t’ai rien promis, moi ! Allez, casse-toi ! Casse-toi, j’te dis !
En dépit de la vie qui frémissait en elle, elle s’était tout à coup sentie vide, évidée. Face à son regard méprisant et sa posture menaçante, elle avait renoncé à hasarder un second rapprochement. « Boum ! » comme une déflagration intime, un attentat à sa candeur et ses rêves de jeune femme.
Rentrée chez elle, ou plutôt chez sa mère, elle avait confessé son inconduite, ses illusions, son désespoir. La vie naissante qui la comblait d’allégresse une heure avant était devenue faute, souillure, chose infâme, déshonorante, à taire, à dissimuler. Fille-mère, en 1970, ça sonnait comme la mort de Gilda dans « Rigoletto » : dramatique. La famille porterait collectivement le péché et la honte, subirait les commérages du voisinage, les regards accusateurs des commerçants, les moqueries, la mauvaise réputation dans le quartier.
À « fille-mère » on associait communément un mot comme une tache sur une blouse immaculée : bâtard. Quand j’étais petite fille, lorsque les gens le prononçaient, la moue froncée, ils y mettaient tant de dégoût, d’horreur, que je me figurais une sorte de satyre.
Sa mère, assommée par l’aveu, ne songeant qu’à la protéger, lui avait conseillé de le faire passer.
– Mais maman, je ne peux pas ! Je l’aime ! Il va revenir !
– Seigneur, mais de quoi vivrez-vous ? Et que va dire ton frère ? Et nos voisins ? Nos amis ?
Son frère, il l’avait giflée le lendemain en apprenant la nouvelle. Par amour. Pour son bien. Pour lui remettre les idées en place. Depuis la mort de son père, les décisions se prenaient en concertation avec lui. La seule solution, c’était l’extermination de l’intrus. Un rendez-vous fut donc pris en vue d’un avortement. Elle n’eut d’autre choix que de se ranger à cet arrêt.
Deux semaines plus tard, Hélène partait pour la clinique avec sa mère. Sous le poids du malheur, silhouettes graciles, voûtées, se tenant par le bras, on eût dit deux vieilles femmes arthritiques. Elles n’avaient pourtant que soixante-sept ans à ellesdeux.
Ma mère et Violette revinrent de la clinique au bout d’à peine trois heures. Celui qui préside aux destinées humaines avait voulu que l’indésiré ne passe pas, vienne au monde dans sept mois. La famille prendrait ses responsabilités et ferait corps autour de ma mère pour élever cet enfant.
Courageuse et tenace, celle-ci passa son bac avec succès à cinq mois de grossesse, avant d’être admise à l’École normale où elle suivit la formation dispensée pour devenir institutrice.
J’ai poussé mon premier cri un mercredi pluvieux d’octobre 1970, à l’heure du déjeuner. J’ai dû penser que ce serait plus convivial. Ce jour-là, ma marraine qui se piquait d’avoir des dons de voyance prit solennellement la parole, et telle une fée ou plutôt une sorcière de conte, proclama :
– Cette petite fille n’aura pas une vie facile ! Elle ne trouvera l’amour que tardivement. Mais bon, mieux vaut tard que jamais !
L’assistance avait ri comme d’une bonne blague. Avec le recul je ne peux m’empêcher de penser qu’elle m’a diablement porté la poisse avec ses prédictions à trois sous !
Dès que j’ai montré le bout de mon museau, ils ont oublié comme par enchantement qu’ils avaient envisagé de me faire disparaître sept mois auparavant ! L’arrivée de ma frimousse coïncida avec la renaissance de ma grand-mère Violette, qui, depuis son veuvage, regardait passer les jours en égrenant son chapelet, un voile d’égarement collé au visage. Les rires, les exclamations joyeuses et la radio résonnèrent à nouveau rue des Martyrs. Mère et fille se consacrèrent à moi avec un amour et une ferveur inépuisables. J’étais devenue le centre de leurs préoccupations, l’unique objet de toutes leurs attentions, leur raison de vivre.
Hélène entra à l’École normale à l’automne 1971. Pendant qu’elle suivait sa formation, Violette me gardait, s’occupait de moi avec un dévouement confinant à la dévotion. Chaque après-midi elle poussait mon landau dans les rues avoisinantes, fière comme Artaban. Violette n’était que bonté, mais pouvait se métamorphoser en harpie si d’aucuns touchaient au moindre de mes cheveux ou se risquaient à me manquer de respect. Le boucher de la rue Lepic chez lequel elle n’avait plus mis les pieds depuis la libération de Paris, en avait d’ailleurs fait les frais. Il avait osé me surnommer « la bâtarde de la rue des Martyrs » auprès d’une voisine cancanière, qui s’était fait fort de le rapporter à ma grand-mère. Celle-ci lui passa le soir-même une énorme commande pour mon baptême à venir, à la grande stupéfaction du commerçant qui ne l’avait pas vue franchir le seuil de sa boutique depuis plus de vingt ans. Au matin de la réception des viandes et autres charcuteries, la sentence fusa :
– Ma petite bâtarde trouve votre viande beaucoup trop dure pour ses petites dents ! Quant à moi, votre visage rubicond de boucher engraissé avec nos tickets de rationnement sous l’Occupation me coupe l’appétit !
Laissant tout en plan sur l’étal, sous le regard éberlué du boucher elle s’en était retournée droite comme un I, pleine de morgue, le menton haut, la démarche assurée de celle qui a bel et bien accompli sa mission.
La guerre avait laissé des traces, et pas seulement sur le dos de mon grand-père !
Je devais avoir à peu près trois ans lorsqu’au cours de notre balade nous croisâmes le pilier de comptoir à l’origine de ma conception. Il se tenait sur le seuil de son café favori, un verre à la main, le regard vitreux. Sous le coup d’une impulsion, se campant devant lui, le touchant presque du bord de ma poussette, Violette lui déclara fielleusement devant le patron et les quelques clients attablés en terrasse :
– Je vous présente votre fille, Alice, qui Dieu merci a tout pris de sa mère !
Pour toute réponse il se pencha vers moi et me cracha au visage. Ma grand-mère lui décocha une gifle cinglante, essuya délicatement ma joue avec son mouchoir en tissu, et avant de lui tourner le dos, lui jeta, acide :
– Vous êtes indigne de ma fille et de la vôtre ! Un bien triste personnage !
Je n’ai pas souvenance de cet épisode. Elle me le raconta beaucoup plus tard.
Si elle avait soupçonné que ma mère continuait à fréquenter son repris de justice, ça aurait sacrément bardé à la maison et on aurait entendu chanter Ramona jusqu’au rez-de-chaussée ! Depuis que j’étais née, ma mère n’avait cessé d’espérer un revirement, un miracle. On ne comptait plus les cierges qui s’étaient consumés à l’église ni les prières qu’elle avait murmurées. Elle lui avait pardonné son esclandre à l’annonce de sa grossesse, avait mis cela sur le compte du choc provoqué par la nouvelle. Ils avaient longuement parlé de sa compagne et de son enfant légitimé. Prévisible, pas original, il avait proféré le classique « il faut me laisser du temps ». Incapable de se passer de lui, elle avait consenti à tenir le second rôle, en attendant le premier, le moment venu. Elle avait la faiblesse de lui faire confiance.
En 1974, ma mère obtint un poste d’institutrice et deux ans plus tard, à la faveur d’une procédure accélérée par son statut de mère célibataire, nous emménageâmes dans une HLM à la porte de Clignancourt, au treizième étage de la tour dominant le périphérique. Pour épargner à Violette un nouveau déchirement, elle instaura deux jours qui lui seraient consacrés : le mercredi et le dimanche.
Le goûter, chez nous, était une véritable institution. Cette tradition familiale provenait du mari de Violette, boulanger-pâtissier de son état, qui lui apportait chaque après-midi des viennoiseries tout juste sorties du four. Un jour il en avait profité pour la prendre par la taille, l’attirer contre lui et l’embrasser :
– Ah ma guitoune ! Aucune femme ne peut se targuer d’avoir une taille aussi fine que la tienne ! Tu te souviens de la première fois que je l’ai tenue entre mes mains ?
Comment aurait-elle pu l’oublier ? Après l’avoir défendue contre un importun, il l’avait invitée à danser une java, la bleue, celle de Fréhel, qui ensorcelle…
Monsieur Grégoire, le patron de René, avait attendu le retour de son artisan un bon moment, car il l’avait entraînée vers le lit conjugal. En le voyant revenir quarante-cinq minutes plus tard avec un sourire béat et les cheveux embroussaillés, le gros boulanger, espiègle, tout en lissant sa moustache rousse piquetée de grains de farine, s’était exclamé, goguenard :
– Voilà une livraison pour le moins soignée !
René avait piqué un fard et s’était empressé de regagner le fournil. Lorsqu’elle m’avait relaté cette anecdote, ma grand-mère avait sorti son mouchoir pour essuyer la larme qui perlait au coin de son œil bleuté.
Elle me gardait chez elle le samedi soir, quand ma mère sortait avec ses copines de l’École normale ou retrouvait son Clyde Barrow clandestinement. Quelle fête ! Nous commencions par faire nos petites courses pour le dîner. N’aspirant qu’à me faire plaisir, elle achetait mes mets favoris : un petit cœur d’agneau au bon goût de noisette,comme elle disait, ou du jambonneau. Nous assistions à la messe de 18 h, où elle me faisait communier à sa suite – estimant selon toute vraisemblance que le corps du Christ me serait salutaire –, dédiions un cierge à Notre-Dame du Sacré-Cœur ou à la Sainte-Vierge, puis retournions à la maison pour une soirée des plus profanes.
Pendant qu’elle préparait le repas, elle me lançait invariablement : « Si on chantait ? ». Je choisissais alors un disque dans le buffet et le mettais à tourner sur la platine de l’électrophone, dans le salon-salle à manger. Là, sur le seuil de la cuisine, bien en vue, tandis qu’elle s’affairait près de la cuisinière à gaz, j’imitais tantôt Zizi Jeanmaire en la singeant avec « mon truc en plumes, plumes de zoiseaux, de z’animaux… », un vieux boa noir tout effiloché qu’elle m’avait donné pour jouer, tantôt Mistinguett, empruntant une voix aigrelette de vieille meneuse de revue et multipliant les poses, les mimiques :
– « Il m’a vue nue, toute nue »…
Nous rigolions comme deux bossues ! Câline, elle prenait mon visage entre ses mains toujours fraîches, déposait sur mes joues des grappes de baisers sonores et, émue, me regardait avec des yeux énamourés.
– Ah ma tototte ! Mon petit clown ! T’es à moi, toi !
Aimée, protégée, je baignais dans une atmosphère de quiétude enveloppante qui me ravissait.
Le dimanche, assises sur la moquette du salon, Violette, ma mère et moi jouions pendant des heures à divers jeux de société. Me plaçant entre elles deux, j’enserrais leurs cous de mes bras, rapprochant leurs visages du mien, et susurrais un qu’est-ce qu’on s’aime ! que nous savourions, comblées. C’était l’époque du « big bisou » de Carlos, qui trouva un large écho chez nous. Dieu que la vie était belle, lumineuse auprès d’elles, les piliers de ma cathédrale domestique !
Lorsque mon géniteur sonnait chez nous, en revanche, il faisait nuit. J’étais déjà couchée, voire endormie. S’il m’arrivait d’être encore debout malgré l’heure avancée, ma mère, rayonnante, nerveuse, m’enjoignait de me mettre au lit séance tenante. Elle m’embrassait à la va-vite, éteignait ma lampe de chevet, et refermait derrière elle la cloison coulissante en plastique qui tenait lieu de porte entre ma chambre et le salon, où elle dormait. Sans doute craignait-elle que je n’aperçoive le visiteur et n’en fasse une description précise à ma grand-mère, description qui à coup sûr l’aurait fait devenir chèvre ! Je n’avais en tout cas pas manqué de lui rapporter qu’un monsieur venait parfois le soir, et qu’à cause de lui maman escamotait le dernier bisou du soir !
Elle l’accueillait toujours comme le Messie, guettant dans la moindre étreinte, même alcoolisée, un semblant d’affection de sa part. Maugréant, ruminant mon ressentiment dans mon lit, je ne tardais jamais à percevoir des gémissements, les murmures de ma mère, ses supplications, les éclats de voix de l’intrus, des plaintes suivies de sanglots, qui, bien qu’ils fussent ténus, me vrillaient le cœur, puisque maternels. J’épiais de mes deux oreilles démesurément ouvertes, pour tenter de ne pas perdre le fil de la voix de ma mère, ne fût-il qu’un souffle. C’était la garantie qu’elle était toujours là, qu’elle allait bien. L’inquiétude et l’extrême vigilance de mon écoute me tenaient éveillée une grande partie de lanuit.
Ce soir de juin 1977, les soupirs, les gémissements de l’intrus font rapidement place à des ronflements tonitruants. Je m’endors, de guerre lasse. Au petit jour, réveillée par le claquement de la porte d’entrée, j’esquisse un sourire : enfin il est parti ! Fini le confinement dans ma chambre ! La maison redevient mon royaume. Je ne bouge pas, j’attends, aux aguets, les yeux clos. Maman va venir pour déposer sur mon front le baiser dont j’ai été privée avant de m’endormir… à cause de lui ! Le rideau de plastique glisse sur son rail, doucement. Surtout ne pas ouvrir les yeux. Faire semblant de dormir. Tendre rituel du matin entre maman etmoi.
Au lieu d’un délicat baiser sur mon front, c’est une lourde main qui s’abat sur ma bouche.
Relents de tabac froid.
Sous le coup de la surprise, de la peur, j’ouvre les yeux, immensément.
Appel d’air pour compenser l’occlusion de mes lèvres.
Un souffle inconnu empestant l’alcools’engouffre dans mes narines. Son regard se cogne au mien comme des poings prêts à en découdre. Je me débats, donne des coups de pied, agite les bras en tous sens, essaie en vain de le griffer, de le déséquilibrer, de me libérer de son emprise. Il jure de s’en prendre à maman si je crie, si j’appelle. Mon attitude pétrifiée, mon regard épouvantélui confirment que je ne parlerai pas. Lentement il retire sa main de mon visage. L’empreinte de ses doigts s’est imprimée sur ma peau, dans ma chair.
J’abandonne la lutte pour regarder par la fenêtre, loin devant moi, par-delà la lune blafarde et la grisaille du ciel. Soulevant ma couverture, mon drap, il m’arrache brutalement mon bas de pyjama à l’effigie de Titi le petit canari. Titi, « mon plus grand ami », dont je serine la chanson depuis des semaines, ne me sera d’aucuns secours : il gît sur la moquette à côté de mon nounours, atterré. Ce qui est en train de se déroulerme laisse interdite, échappe à mon entendement.
Les yeux de l’homme ne se détournent à aucun moment. Il les enfonce dans les miens en même temps que son sexe me pénètre. Malgré la douleur fulgurante, pas un son ne sort de ma bouche. En état de sidération, j’erre dans un ailleurs indéfinissable, sorte de brouillard sonore, olfactif et visuel, d’oùses motsme parviennent assourdis, feutrés.
– Si tu parles de ça à ta mère, je lui ferai la même chose ! Et si tu caftes à ta grand-mère, je la tuerai !
Mots horrifiques qui scellent mes lèvres. Mon silence contre leurs vies sauves. Il a compris qu’il pouvait agir à sa guise, alors il se décontracte, glisse une main entre mes cuisses, l’autre entre les siennes.
– Tu es belle !
J’ai fini par baisser les yeux pour ne plus lire ma terreur dans les siens, puis par les fermer, tandis que s’amplifiaient ses grognements lancinants. J’ai repensé aux phacochères du Jardin des Plantes qui en poussaient de semblables et intérieurement j’ai souri malgrémoi.
– Tu aimes que je te caresse comme ça… Tu aimes ça, hein ? Ouvre la bouche ! Bien grand !
Le goût âcre du sperme a remplacé celui du dentifrice à la fraise dans ma petite bouche d’enfant.
Pour conjurer le sort, du haut de mes six ans et demi, je chante dans ma tête :
« C’est moi le p’tit Titi, votre plus grand ami. Allons-y les amis la vie est belle. On va siffler aussi ».
J’ai expérimenté cette dissociation pour la première fois ce matin-là : en emplissant ma tête de musique, j’ai pu m’abstraire du réel, me couper de mes émotions et me distancier de ma souffrance pour survivre à l’horreur, là où nul ne pouvait plus m’atteindre.
Après avoir joui dans ma bouche, il se rhabille hâtivement, file dans la salle de bain, en revient aussitôt avec une serviette dont il a mouillé une extrémité. Je le regarde nettoyer énergiquement les gouttes de sang, de mon sang sur le drap. Il va et vient à plusieurs reprises pour fignoler son « petit ménage ». Quand il estime que les traces de son crime ont été suffisamment effacées, il ramasse mon pyjama, me le jette au visage et tente de m’intimider en réitérant ses menaces :
– Enfile-le ! Et je te préviens : si jamais tu répètes un seul mot de ce qui s’est passé, de ce que nous avons fait, à ta mère ou à ta salope de grand-mère, je les fume !
Tout en enfilant mon pyjama à grand-peine après l’empalement paternel, j’ai essayé d’imaginer la scène. Ça n’avait ni queue ni tête, son histoire ! Avant de s’esquiver dans la salle de bain, il s’empare de mes peluches tombées sur le sol et les dispose avec soin sur mon drap, de manière à camoufler la trace rose pâle, encore humide, qui subsiste. Maman et grand-mère ne doivent rien savoir. Jamais. Sinon elles connaîtront le même sort que moi. Ou il les brûlera avec son briquet et les aspirera avec sa bouche. Il est capable de tout ! J’entends l’eau de la douche couler. Je me recroqueville par terre. J’aimerais tant que maman revienne !
La porte coulissante glisse sur son rail. Je frémis, retiens mon souffle en serrant mon ours à l’en étouffer, paniquée.
– Ça va, ma puce ? Tu vas venir boire ton chocolat ?
Elle se fige à ma vue, s’agenouille à ma hauteur. Ses yeux fixent ma bouche où des marques de doigts n’ont pas eu le temps de s’estomper. Elle a compris qu’il s’était passé quelque chose de grave. Ses lèvres s’agitent, s’affolent, ses yeux questionnent, implorent des réponses rassurantes, ses bras m’enserrent un peu trop fort. Je n’ai pas réussi à stopper mes tremblements, à réprimer mes larmes silencieuses, mais je n’ai pas flanché : je n’ai rien dit. C’est un sacrifice nécessaire, pour qu’il ne les tue pas. J’ai fait un pacte avec le diable. Je ne saurais m’en dédire. De toute façon, même si je le voulais, je serais incapable d’articuler une parole. Je suis bloquée, muette, paralysée.
Telle une furie elle fait irruption dans la salle de bain. L’eau a cessé de couler.
Ils se disputent violemment. Vociférations. Claques. Plaintes.Cris.
– Dégage, sale ivrogne ! Comment as-tu pu frapper Alice ? Va rejoindre ta femme ! Et ton fils ! Et ne remets plus JAMAIS les pieds ici ! hurle-t-elle.
La porte en claquant a fait vibrer les murs. Elle s’assoit près de moi, appuie sa joue baignée de larmes contre la mienne.
– Il est parti, je l’ai fichu dehors… C’était ton père… Il ne reviendra plus. Dis-toi qu’il est mort ! De toute façon, pour nous c’est tout comme !
Déniant l’inconcevable, elle venait cependant de réaliser quel danger il représentait pour moi avec son alcoolisme et ses accès de violence. Me berçant dans ses bras, elle avait psalmodié :
– On aura une belle vie, ma puce, tu verras…
Comme une incantation.
Pour continuer à vivre malgré le poids de la honte et de la culpabilité, par un procédé que les psys qualifient d’« amnésie traumatique », j’ai déjà commencé à remiser, à refouler cet épisode dans cette zone obscure et quasi impénétrable qu’est l’inconscient. Je n’en conserverai en surface que les symptômes, déconnectés de l’acte lui-même.
À la suite de cet épisode, je me suis souvent demandé laquelle, de ma mère ou de ma grand-mère, je sacrifierais si j’y étais forcée. Jamais je n’ai pu trancher. Elles m’étaient toutes deux essentielles.
Mon amour pour l’une et l’autre m’a condamnée à enfouir l’effroyable secret au plus profond de mon cœur de petite fille, bâillonnée par la peur et l’indicible douleur.
J’ai pris l’habitude, depuis quelques temps, de plier mon maillot de corps – mon Damart – d’une manière singulière. Le cérémonial que je m’impose nécessite patience et dextérité. Il consiste en un petit rabat vertical à droite, un autre à gauche, un plus large en bas – horizontal cette fois – avant de rentrer le tout précautionneusement dans ma culotte. Tant que je ne suis pas satisfaite de mon origami vestimentaire, gênée par une couture qui me gratte ou une protubérance de tissu, je ne décolle pas de ma chambre. Cette manie, qui je le concède, frôle l’obsession, a le don d’agacer maman, de la faire sortir de ses gonds, et me vaut de me faire régulièrement gronder, voire bousculer au moment de partir pour l’école.
Ce matin-là, ma troisième tentative a échoué au moment de l’étape finale : le grand pli horizontal s’est mué en un boudin informe, engendrant une sensation d’inconfort insupportable. Je reprends donc mon rituel depuis le début en ronchonnant, avec maman qui bout à deux pas de moi. Après trois « Dépêche-toi donc ! » et deux « Mais quelle empotée ! », à bout de nerfs elle attrape mon col roulé et mon pantalon de velours côtelé sur le valet de nuit, s’empare de mes Clarks, de mon manteau, de mon cartable, et me pousse manu militari jusqu’au palier. Les portes de l’ascenseur s’ouvrent. Dans la cabine j’enfile tout à la hâte. La crainte de me retrouver dehors à moitié nue s’est substituée à l’incommodité.
Sur les conseils de ma maîtresse qui me trouvait « un air absent, l’esprit ailleurs », maman m’a emmenée voir une dame très gentille. On a beaucoup discuté toutes les deux. Elle m’a demandé pourquoi je m’isolais à la récré au lieu de jouer avec les autres enfants, pourquoi je ne participais plus aux exercices de calcul mental… C’est vrai qu’avant j’étais toujours la première à soulever mon ardoise pour montrer le résultat à la maîtresse ! Avant. Mais avant quoi ? Je ne saurais dire pourquoi je n’en ai plus envie. Elle m’a fait remarquer que je m’étais remise à sucer mon pouce et à cela non plus je n’avais pas d’explication. Quand elle a voulu savoir si quelqu’un m’avait fait du mal, de bonne foi j’ai répondu « non ».
– Et ton papa, est-ce qu’il te manque ?
– Il est mort.
– Tu penses à lui, quelquefois ?
– Non.
– Et de voir que les autres enfants ont une maman et un papa qui veillent sur eux, ça ne te rend pas triste ?
– Moi j’ai maman et grand-mère, c’est pareil !
Elle a eu beau m’expliquer que non, ce n’était pas la même chose, je l’ai laissée blablater en attendant que ça se passe ! Moi je sais bien que ma grand-mère vaut tous les papas du monde ! Après l’entretien, la dame m’a montré des feuilles noircies de taches d’encre :
– Alors ma chérie, qu’est-ce que tu vois ?
– Un papillon !
– Etlà ?
– Deux hippocampes !
– Et ça, à quoi cela te fait-il penser ?
– Une chauve-souris !
– Et ça ?
– Des taches !
– Mais encore ?
– Des taches noires et rouges !
La psychologue attendit vainement la réponse qui lui permettrait de me cataloguer, de me faire rentrer dans l’une de ses cases prédéterminées ! Pas le moindre « zizi » à se mettre sous la dent ! Pas même une goutte de « sang » ! Juste « des taches rouges » ! C’était à désespérer ! Désappointée elle ramassa prestement ses feuilles, les rangea dans le tiroir de son bureau, avant de me raccompagner dans la salle d’attente où m’attendait ma mère. Après l’avoir rassurée quant à mon état psychique, elle lui précisa qu’il était inutile de reprendre un rendez-vous.
Soulagée, celle-ci m’entraîna en sautillant dans le café voisin, où j’eus droit à une bouteille d’Orangina et même à une pièce d’un franc pour une partie de flipper ! Les boules claquaient contre la paroi de verre et la sempiternelle musique électronique « vintage » de la machine envahissait la salle par intermittence. Bien que concentrée sur ma partie, je jetais de fréquents coups d’œil à ma mère, qui, attablée, me contemplait avec tendresse à travers les volutes de fumée de ses Camel blondes.