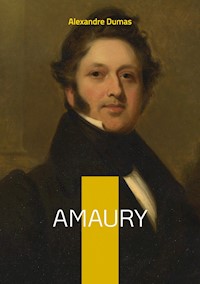
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Französisch
RÉSUMÉ : "Amaury" est un roman d'Alexandre Dumas qui plonge le lecteur dans une intrigue riche en émotions et en rebondissements. L'histoire se déroule dans le cadre romantique et tourmenté de la France du XIXe siècle. Amaury, le protagoniste, est un jeune homme noble et passionné, pris dans un tourbillon de sentiments contradictoires. Sa vie bascule lorsqu'il rencontre Madeleine, une femme énigmatique et fascinante qui éveillera en lui des passions insoupçonnées. À travers une série de péripéties, Amaury doit naviguer entre amour, jalousie et honneur, tout en affrontant les conventions sociales de son époque. Le récit explore les thèmes de l'amour impossible et de la quête identitaire, tout en offrant une critique subtile des moeurs de la société française. Dumas, fidèle à son style, mêle habilement drame et suspense, tenant le lecteur en haleine jusqu'à la dernière page. "Amaury" est une oeuvre qui, bien que moins connue que certains autres ouvrages de Dumas, mérite d'être redécouverte pour la profondeur de ses personnages et la finesse de son analyse psychologique. L'AUTEUR : Alexandre Dumas, né le 24 juillet 1802 à Villers-Cotterêts, est l'un des écrivains français les plus prolifiques et populaires du XIXe siècle. Fils d'un général de la Révolution française, il a su tirer parti de son héritage pour se faire un nom dans le monde littéraire. Dumas est surtout connu pour ses romans historiques, tels que "Les Trois Mousquetaires" et "Le Comte de Monte-Cristo", qui ont marqué des générations de lecteurs par leur style flamboyant et leurs intrigues captivantes. Outre ses romans, il a également écrit de nombreuses pièces de théâtre, contribuant à la renaissance du drame romantique en France. Sa vie personnelle est aussi romanesque que ses écrits, marquée par des succès éclatants et des revers financiers. Dumas a voyagé à travers l'Europe, s'inspirant de ses expériences pour enrichir ses récits. Malgré les critiques sur sa production prolifique et son recours à des collaborateurs, Dumas reste une figure emblématique de la littérature mondiale, célébré pour sa capacité à captiver et émouvoir ses lecteurs.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 457
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Sommaire
Chapitre
Chapitre I
Chapitre II
Chapitre III
Chapitre IV
Chapitre V
Chapitre VI
Chapitre VII
Chapitre VIII
Chapitre IX
Chapitre X
Chapitre XI
Chapitre XII
Chapitre XIII
Chapitre XIV
Chapitre XV
Chapitre XVI
Chapitre XVII
Chapitre XVIII
Chapitre XIX
Chapitre XX
Chapitre XXI
Chapitre XXII
Chapitre XXIII
Chapitre XXIV
Chapitre XXV
Chapitre XXVI
Chapitre XXVII
Chapitre XXVIII
Chapitre XXIX
Chapitre XXX
Chapitre XXXI
Chapitre XXXII
Chapitre XXXIII
Chapitre XXXIV
Chapitre XXXV
Chapitre XXXVI
Chapitre XXXVII
Chapitre XXXVIII
Chapitre XXXIX
Chapitre XL
Chapitre XLI
Chapitre XLII
Chapitre XLIII
Chapitre XLIV
Chapitre XLV
Chapitre XLVI
Chapitre XLVII
Chapitre XLVIII
Chapitre XLIX
Chapitre L
Chapitre LI
Chapitre LII
Chapitre LIII
Chapitre LIV
Chapitre LV
Conclusion
Préface
Il y a une chose qui est à peu près inconnue à tout le reste de l’Europe et qui est particulière à la France, – c’est la causerie.
Dans tous les autres pays de la terre, on discute, on parle, on pérore ; en France seulement on cause.
Quand j’étais en Italie, en Allemagne ou en Angleterre, et que j’annonçais tout à coup que je partais le lendemain pour Paris, quelques-uns s’étonnaient de ce brusque départ, et demandaient :
– Qu’allez-vous faire à Paris ?
– Je vais causer, répondais-je.
Et alors tout le monde s’ébahissait de ce que, fatigué de parler ou d’entendre parler, je faisais cinq cents lieues pour causer.
Les Français seuls comprenaient et disaient :
– Vous êtes bien heureux, vous !
Et quelquefois un ou deux des moins retenus là-bas se détachaient et revenaient avec moi.
En effet, savez-vous quelque chose de plus charmant qu’un de ces petits comités, dans le coin d’un salon élégant, entre cinq à six personnes qui laissent capricieusement aller la parole au gré de leur caprice, suivant et caressant une idée tant qu’elle leur sourit, l’abandonnant lorsqu’elles en ont épuisé toute la saveur, pour se reprendre à une autre idée qui grandit et se développe à son tour au milieu de la raillerie des uns, des paradoxes des autres, de l’esprit de tous, puis qui, tout à coup, arrivée à l’apogée de son éclat, au zénith de son développement, disparaît, s’évapore, se volatilise comme une bulle de savon au toucher de la maîtresse de la maison qui, une tasse de thé à la main, s’approche, navette vivante qui porte d’un groupe à l’autre le fil argenté de la causerie générale, recueillant les avis, demandant les opinions, posant des problèmes, et forçant de temps en temps chaque coterie de jeter son mot dans ce tonneau des Danaïdes qu’on appelle la conversation ?
Il y a à Paris cinq ou six salons pareils à celui que je viens de décrire, où l’on ne danse pas, où l’on ne chante pas, où l’on ne joue pas, et dont cependant on ne sort jamais qu’à trois ou quatre heures du matin.
Un de ces salons est celui d’un de mes bons amis, M. le comte de M... ; quand je dis un de mes bons amis, j’aurais dû dire un des bons amis de mon père, car M. le comte de M..., qui se garde bien de dire son âge, et à qui on ne pense pas, au reste, à le demander, doit avoir de soixante-cinq à soixante-huit ans, quoique, grâce au soin extrême qu’il prend de sa personne, il n’en paraisse pas plus de cinquante ; c’est un des derniers et des plus aimables représentants de ce pauvre dix-huitième siècle tant calomnié ; ce qui fait qu’il ne croit pas à grand-chose pour son compte, sans que pour cela, comme la plupart des incrédules, il ait la manie de vouloir empêcher les autres de croire.
Il y a en lui deux principes : un qui lui vient du cœur, l’autre qui lui vient de l’esprit, qui se combattent continuellement. Égoïste par système, il est généreux par tempérament. Né dans l’époque des gentilshommes et des philosophes, – l’aristocratie corrige en lui le philosophe – il a pu voir encore tout ce qu’il y avait de grand et de spirituel dans le dernier siècle. Rousseau l’a baptisé du titre de citoyen ; Voltaire lui a prédit qu’il serait poète ; Francolin lui a recommandé d’être honnête homme.
Il parle de cet implacable 93 comme le comte de Saint-Germain parlait des proscriptions de Sylla et des boucheries de Néron. Il a regardé passer tour à tour, et du même œil sceptique, les massacreurs, les septembriseurs, les guillotineurs, d’abord dans leur char, puis dans leur charrette. Il a connu Florian et André Chénier, Demoustier et madame de Staël, le chevalier de Bertin et Chateaubriand ; il a baisé la main de madame Tallien, de madame Récamier, de la princesse Borghèse de Joséphine et de la duchesse de Berri. Il a vu grandir Bonaparte et tomber Napoléon. L’abbé Maury l’appelait son écolier, et M. de Talleyrand son élève : c’est un dictionnaire de dates, un répertoire de faits, un manuel d’anecdotes, une mine de mots.
Afin d’être sûr de conserver sa supériorité, il n’a jamais voulu écrire ; il raconte, voilà tout.
Aussi, comme je le disais tout à l’heure, son salon est-il un des cinq ou six salons de Paris dans lesquels, quoiqu’il n’y ait ni jeu, ni musique, ni danse, on reste jusqu’à trois ou quatre heures du matin. Il est vrai que sur ses billets d’invitation il écrit de sa main : on causera, comme les autres font imprimer : on dansera.
La formule écarte en général les banquiers et les agents de change ; mais elle attire les gens d’esprit qui aiment à parler, les artistes qui aiment à écouter, et les misanthropes de toutes classes qui, malgré les prières des maîtresses de maison, n’ont jamais voulu hasarder un cavalier seul en avant, et qui prétendent que la contredanse est ainsi nommée parce que c’est le contraire de la danse.
Au reste, il a un talent admirable pour arrêter d’un mot les théories qui peuvent blesser les opinions, ou les discussions qui menacent de devenir ennuyeuses.
Un jour, un jeune homme à longs cheveux et à longue barbe parlait devant lui de Robespierre, dont il exaltait le système, dont il déplorait la mort prématurée, et dont il prédisait la réhabilitation. – C’est un homme qui n’a pas été jugé, disait-il.
– Heureusement qu’il a été exécuté, répondit M. le comte de M... ; et la conversation en resta là.
Or, il y a un mois à peu près que je me trouvai à l’une de ces soirées, dans laquelle, après avoir à peu près épuisé tous les textes, on arriva, ne sachant plus que dire sans doute, à parler de l’amour. C’était justement dans un de ces moments où la conversation s’est généralisée, et où l’on échange des mots d’un bout à l’autre du salon.
– Qui est-ce qui parle d’amour ? demanda le comte de M...
– C’est le docteur P..., dit une voix.
– Et qu’en dit-il ?
– Mais il dit que c’est une congestion cérébrale bénigne, dont on peut guérir avec la diète, des sangsues et la saignée.
– Vous dites cela, docteur ?
– Oui ; ensuite, la possession vaut mieux : c’est à la fois plus rapide et plus sûr.
– Mais enfin, docteur, supposez que l’on ne possède pas, et supposez qu’on ne s’adresse pas à vous, qui avez trouvé la panacée universelle, mais à quelqu’un de vos confrères, moins versé que vous dans la clinique : – Meurt-on d’amour ?
– Ma foi ! c’est une question qu’il ne faut pas faire aux médecins, mais aux malades, reprit le docteur. Répondez, messieurs ; dites, mesdames.
On pense bien que sur une aussi grave question les avis se partagèrent.
Les jeunes gens, qui avaient du temps devant eux pour périr de désespoir, répondirent que oui ; les vieillards, qui ne pouvaient plus guère succomber qu’aux catarrhes ou à la goutte, répondirent que non ; les femmes hochèrent la tête d’un air de doute, mais sans se prononcer : trop fières pour dire non, trop sincères pour dire oui.
Tout le monde tenait tellement à s’expliquer, qu’on finit par ne plus s’entendre.
– Eh bien ! dit le comte de M..., je vais vous tirer d’embarras.
– Vous ?
– Oui, moi.
– Et comment cela ?
– En vous disant l’amour dont on meurt et l’amour dont on ne meurt point.
– Il y a donc plusieurs sortes d’amours ? demanda une femme qui, peut-être moins qu’aucune de celles qui étaient là, avait le droit de faire cette question.
– Oui, madame, répondit le comte ; et même, pour le moment, serait-il un peu long de les énumérer. Revenons donc à la proposition que je vous ai faite : il est minuit bientôt ; nous avons encore deux ou trois heures devant nous. Vous êtes assis sur de bons fauteuils, le feu flambe joyeusement dans la cheminée. Au dehors, la nuit est froide et la neige tombe ; vous êtes donc dans les conditions où, depuis longtemps, je désirais trouver un auditoire. Je vous tiens, je ne vous lâche plus. – Auguste, faites fermer les portes, et revenez avec le manuscrit que vous savez.
Un jeune homme se leva, c’était le secrétaire du comte de M..., garçon charmant et plein de distinction, qu’on disait tout bas être dans la maison à un titre plus intime que celui que nous avons dit, ce que pouvait au reste faire croire l’affection toute paternelle que lui portait le comte de M...
À ce mot de manuscrit, ce furent des exclamations et des empressements à n’en plus finir.
– Pardon, fit le comte, mais il n’y a pas de roman sans préface, et je ne suis pas au bout de la mienne. Vous pourriez croire que je suis inventeur de cette histoire, et je tiens à établir, avant toute chose, que je n’ai jamais rien inventé. Voici donc comment la susdite histoire m’est tombée entre les mains. Exécuteur testamentaire d’un mien ami, mort il y a dix-huit mois, j’ai, parmi ses papiers, trouvé des mémoires ; seulement, il les écrivait, je dois le dire avant tout, non sur la vie des autres, mais sur la sienne propre. C’était un médecin : aussi, je vous en demande pardon, ces mémoires ne sont-ils rien autre chose qu’une longue autopsie. Oh ! ne vous effrayez pas, mesdames : autopsie morale, autopsie faite, non pas avec le scalpel, mais avec la plume, une de ces autopsies du cœur auxquelles vous aimez tant à assister. Un autre journal, qui n’était pas de son écriture, était mêlé à ses souvenirs comme la biographie de Kressler aux méditations du chat Murr. Je reconnus cette écriture : c’était celle d’un jeune homme que j’avais rencontré souvent chez lui, et dont il était le tuteur. Ces deux manuscrits, qui, séparément, ne faisaient qu’une histoire inintelligible, se complétaient l’un par l’autre ; je les ai lus, et je trouvai l’histoire assez, – comment dirai-je ? – assez humaine. J’y avais pris un grand intérêt ; et comme en ma qualité de sceptique, – vous savez tous que c’est la réputation qu’on m’a faite, – heureux ceux à qui on fait une réputation quelconque ; – et comme, dis-je, en ma qualité de sceptique, je ne prends pas grand intérêt à grand-chose, je pensai que si ce récit, qui m’avait bien pris le cœur, – pardon, docteur, si je me sers de ce mot ; je sais que, dans ce sens, le cœur n’existe pas, mais il faut bien se servir des locutions usitées, sans cela on deviendrait inintelligible ; – je pensai donc que si ce récit m’avait pris le cœur, à moi sceptique, il pourrait bien produire le même effet sur mes contemporains ; puis, il faut vous le dire, une petite vanité me chatouillait : c’était de perdre, en écrivant, ma réputation d’homme d’esprit, comme cela est arrivé à M..., je ne me rappelle plus son nom, vous savez, qui est devenu conseiller d’État... Je me mis donc à classer les deux journaux, à les numéroter selon la place qu’ils devaient occuper, pour que le récit eût un sens ; puis j’effaçai les noms propres pour leur en substituer de mon invention ; puis, enfin, je parlai à la troisième personne au lieu de les laisser parler à la première, et un beau matin, sans que je m’en fusse douté, je me trouvai à la tête de deux volumes.
– Que vous n’avez point fait imprimer, parce que plusieurs des personnages vivent encore, sans doute ?
– Non, ah ! mon Dieu, non. Ce n’est point là la raison : des deux personnages principaux, l’un est trépassé depuis dix-huit mois, et l’autre a quitté Paris depuis quinze jours. Or, vous êtes trop occupés et trop oublieux pour reconnaître un mort et un absent, si ressemblants que soient leurs portraits. C’est donc un tout autre motif qui m’a retenu.
– Et lequel ?
– Chut ! ne dites cela ni à Lamennais, ni à Béranger, ni à Alfred de Vigny, ni à Soulié, ni à Balzac, ni à Deschamps, ni à Sainte-Beuve, ni à Dumas, mais j’ai promesse pour un des premiers fauteuils vacants à l’Académie, si je continue à ne rien faire. Une fois reçu, on me laisse libre. Auguste, mon ami, continua le comte de M... en s’adressant au jeune homme qui venait de rentrer avec le manuscrit, asseyez-vous, et lisez : nous vous écoutons.
Auguste s’assit, puis on toussa, on remua les fauteuils, on s’accouda sur les divans ; et lorsque tout le monde eut pris ses aises, au milieu du plus profond silence, le jeune homme lut ce qui suit :
I
Vers le commencement de mai de l’année 1838, et comme dix heures du matin venaient de sonner, la porte cochère d’un petit hôtel de la rue des Mathurins s’ouvrit et donna passage à un jeune homme monté sur un beau cheval alezan, dont les jambes fines et dont le cou un peu allongé trahissaient l’origine anglaise ; derrière lui, et par la même porte du même hôtel, sortit, à une distance convenable, un domestique vêtu de noir, et monté comme lui sur un cheval de race, mais dans lequel cependant l’œil d’un amateur devait reconnaître moins de sang que dans le premier.
Ce cavalier, qui n’avait besoin que de se montrer pour être rangé tout d’abord dans cette classe d’individus auxquels, en imitation de nos voisins d’outre-mer, la langue du monde a donné le titre de lions, était un jeune homme de vingt-trois à vingt-quatre ans, d’une mise si simple et en même temps si recherchée, qu’elle dénonçait dans celui qui la portait ces habitudes aristocratiques qu’on tient de la naissance seule et qu’aucune éducation ne saurait créer là où elles n’existent pas naturellement.
Il est juste de dire aussi que sa physionomie répondait admirablement à cette mise et à cette tournure, et qu’il eût été difficile de rêver quelque chose de plus élégant et de plus fin que ce visage encadré dans des cheveux et dans des favoris noirs, et auquel une pâleur mate et juvénile donnait un caractère tout particulier de distinction. Aussi, ce jeune homme, dernier rejeton d’une des plus anciennes familles de la monarchie, portait-il un de ces vieux noms qui vont s’éteignant tous les jours et qu’on ne trouvera bientôt plus que dans l’histoire : il s’appelait Amaury de Léoville.
Maintenant, si de l’investigation extérieure nous passons à l’investigation intime, de l’aspect physique au sentiment moral, des apparences à la réalité, nous verrons que la sérénité de ce visage est en harmonie avec la situation du cœur dont il est le miroir. Ce sourire, qui de temps en temps se dessine sur ses lèvres et qui répond à la rêverie de son âme, est le sourire de l’homme heureux.
Or, suivons donc cet homme si largement doué, qu’il a reçu à la fois naissance et fortune, jeunesse et distinction, beauté et bonheur ; car c’est le héros de notre histoire.
Après avoir, en sortant de chez lui, mis son cheval au petit trot, après avoir, toujours marchant du même pas, atteint le boulevard, dépassé la Madeleine, enfilé le faubourg Saint-Honoré, il arriva rue d’Angoulême.
Là, un léger mouvement d’arrêt donna à son cheval une allure plus lente, tandis que ses yeux, jusqu’alors vagues et indifférents, commencèrent à se fixer vers un point de la rue dans laquelle il entrait.
Ce point de la rue était un charmant petit hôtel situé entre une cour pleine de fleurs et fermée par une grille, et un de ces vastes jardins que notre industrieux Paris voit de jour en jour disparaître pour faire place à ces masses de pierre sans air, sans espace et sans verdure, qu’on appelle si improprement des maisons. Parvenu à cet endroit, le cheval s’arrêta tout seul comme obéissant à une habitude prise ; mais après avoir jeté un long regard sur deux fenêtres, dont les rideaux hermétiquement fermés s’opposaient à toute indiscrète investigation, le jeune homme continua son chemin, non sans retourner plus d’une fois la tête en arrière, non sans s’assurer à sa montre qu’il n’était pas encore l’heure qui sans doute devait lui ouvrir les portes de cet hôtel.
Dès lors il s’agissait visiblement, pour notre jeune homme, de tuer le temps : il descendit d’abord chez Lepage, puis là s’amusa à casser quelques poupées, passa aux œufs et des œufs aux mouches.
Tout exercice d’adresse éveille l’amour-propre. Or, quoique le tireur n’eût d’autres spectateurs que les garçons, comme il tirait admirablement et que ceux-ci, qui n’avaient rien à faire, restaient groupés pour le voir, il gagna à peu près trois quarts d’heure à cet exercice après quoi il remonta à cheval, prit au trot le chemin du Bois, et en quelques minutes se trouva à l’allée de Madrid. Là, il rencontra un de ses amis, avec lequel il causa du dernier steeple-chase et des prochaines courses de Chantilly, ce qui lui fit encore passer une demi-heure.
Enfin, un troisième promeneur, que l’on trouva à la porte Saint-James, et qui arrivait depuis trois jours d’Orient, parla avec tant d’intérêt de la vie intérieure qu’il avait menée au Caire et à Constantinople, qu’une heure s’écoula encore sans trop d’impatience. Mais cette heure écoulée, notre héros ne put y tenir davantage, et prenant congé de ses deux amis, il remit son cheval au galop, et, sans s’arrêter ni changer d’allure, il revint du même trait à l’extrémité de la rue d’Angoulême, qui donne dans les Champs-Élysées.
Là, il s’arrêta, regarda sa montre, et voyant qu’elle marquait une heure, il descendit de cheval, jeta la bride au bras de son domestique, s’avança vers la maison devant laquelle il s’était arrêté le matin, et sonna.
Si Amaury avait éprouvé quelque crainte, cette crainte eût pu paraître bizarre, car au sourire successif qui, à sa vue, apparut sur les lèvres des domestiques, depuis le concierge qui lui ouvrit la porte de la grille jusqu’au valet de chambre qui se tenait dans le vestibule, on eût pu voir que le jeune homme était familier de la maison.
Aussi, quand le visiteur demanda si M. d’Avrigny était visible, le domestique lui répondit comme à quelqu’un qui peut passer pardessus certaines convenances sociales.
– Non, monsieur le comte, mais les dames sont au petit salon.
Puis, comme il allait prendre les devants pour annoncer le jeune homme, celui-ci lui fit signe que cette formalité était chose inutile. Amaury, en homme qui sait le chemin, prit donc un petit couloir sur lequel s’ouvraient toutes les portes de dégagement, et en un instant fut à celle du petit salon, qui, entrebâillée qu’elle était, permit à son regard de pénétrer librement dans l’intérieur.
Un instant il s’arrêta sur le seuil.
Deux jeunes filles de dix-huit à dix-neuf ans étaient assises presque en face l’une de l’autre et brodaient au même métier tandis que dans l’embrasure d’une fenêtre une vieille gouvernante anglaise, au lieu de lire, regardait ses deux élèves.
C’est que jamais la peinture, cette reine des arts, n’avait produit un groupe plus charmant que celui que formaient, en se touchant presque, les têtes des deux jeunes filles, si parfaitement opposées d’aspect et de caractère, que l’on eût dit que Raphaël lui-même les avait rapprochées l’une de l’autre pour faire une étude de deux types également gracieux, quoique contrastant l’un avec l’autre.
En effet, l’une des deux jeunes filles, blonde et pâle, aux longs cheveux bouclés à l’anglaise, aux yeux bleus, au col peut-être un peu exagéré, semblait une frêle et transparente vierge ossianique, faite pour glisser sur les vapeurs que le vent du nord roule au front des montagnes arides de l’Écosse ou des brumeuses plaines de la Grande-Bretagne ; c’était une de ces visions demi-humaines, demi-féeriques, comme Shakespeare seul en a eu, et qu’à force de génie il est parvenu à faire passer du fantastique à la réalité, délicieuses créations que nul n’avait devinées avant sa naissance, que nul n’a atteintes depuis sa mort, et qu’il a baptisées des doux noms de Cordélia, d’Ophélie ou de Miranda.
L’autre, au contraire, aux cheveux noirs et nattés, dont la double tresse encadrait le visage rosé, aux yeux étincelants, aux lèvres de pourpre, aux mouvements vifs et décidés, semblait une de ces jeunes filles au teint doré par le soleil de l’Italie que Boccace rassemble dans la villa Palmieri, pour écouter les joyeux contes du Décameron. En elle tout était vie et santé ; l’esprit qui ne pouvait sortir par sa bouche pétillait dans son regard ; sa tristesse, car il n’y a physionomie si joyeuse qui de temps en temps ne s’assombrisse, sa tristesse ne pouvait voiler entièrement l’expression habituellement riante de son visage. À travers sa mélancolie, on devinait son sourire, comme à travers un nuage d’été on sent encore le soleil.
Telles étaient les deux jeunes filles qui, comme nous l’avons dit, assises en face l’une de l’autre et penchées au même métier, faisaient éclore sous leurs aiguilles un bouquet de fleurs, dans lequel, toujours fidèles à leur caractère, l’une créait le lis blanc et les pâles jacinthes, tandis que l’autre animait de leurs vives couleurs les tulipes, les oreilles d’ours et les œillets.
Après une ou deux minutes de muette contemplation, Amaury poussa la porte.
Au bruit qu’il fit, les deux jeunes filles se retournèrent et poussèrent un petit cri, comme eussent fait deux gazelles surprises ; seulement, une vive, mais fugitive nuance de carmin monta aux yeux de la jeune fille aux cheveux blonds, tandis qu’au contraire sa compagne pâlit imperceptiblement.
– Je vois bien que j’ai eu tort de ne point me faire annoncer, dit le jeune homme en s’avançant vivement vers la jeune fille blonde, sans s’occuper de son amie, car je vous ai fait peur, Madeleine. Pardonnez-moi, je me crois toujours le fils adoptif de M. d’Avrigny, et j’en agis dans cette maison comme si j’avais encore le droit d’être un de ses commensaux.
– Et vous faites bien, Amaury, répondit Madeleine. D’ailleurs, vous voudriez faire autrement que vous ne le pourriez pas, je crois ; on ne perd pas ainsi en six semaines des habitudes de dix-huit ans. Mais dites donc bonjour à Antoinette...
Le jeune homme tendit, en souriant, sa main à la jeune fille brune.
– Excusez-moi, dit-il, chère Antoinette ; mais je devais d’abord demander pardon de ma maladresse à celle que ma maladresse avait effrayée ; j’ai entendu le cri de Madeleine, et je suis accouru à elle. Puis se retournant vers la gouvernante : – Mistress Brown, dit-il, tous mes compliments...
Antoinette sourit avec une légère nuance de tristesse en serrant la main du jeune homme, car elle pensa en elle-même qu’elle aussi avait poussé un cri pareil à celui de Madeleine, mais qu’Amaury ne l’avait pas entendu.
Quant à mistress Brown, elle n’avait rien vu, ou plutôt elle avait tout vu, mais son regard s’était arrêté à la surface des choses.
– Ne vous excusez pas, monsieur le comte, dit-elle ; il serait bon au contraire, que l’on fit souvent ce que vous venez de faire, ne fût-ce que pour guérir cette belle enfant de ses folles terreurs et de ses subits tressaillements. Savez-vous à quoi cela tient ? à ses rêveries. Elle s’est fait un monde à elle, dans lequel elle se retire aussitôt qu’on cesse de la maintenir dans le monde réel. Que se passe-t-il dans ce monde-là ? je n’en sais rien ; mais ce que je sais, c’est que si cela continue, elle finira par abandonner l’un pour l’autre, et alors ce sera le rêve qui deviendra sa vie, tandis que sa vie deviendra le rêve.
Madeleine leva sur le jeune homme un long et doux regard qui voulait dire :
– Vous savez bien à qui je pense quand je rêve, n’est-ce pas, Amaury ?
Antoinette vit ce regard, elle demeura un instant debout et hésitante, puis, au lieu de se remettre au métier, elle alla s’asseoir devant le piano et laissa aller ses doigts sur les touches, jouant de mémoire une fantaisie de Thalberg.
Madeleine se remit à l’ouvrage, et Amaury s’assit près d’elle.
II
– Quel supplice, chère Madeleine, dit tout bas Amaury, d’être maintenant si rarement seuls et libres ! Est-ce donc le hasard qui dispose les choses ainsi ? est-ce un ordre donné par votre père ?
– Hélas ! je n’en sais rien, mon ami, répondit la jeune fille, mais croyez bien que je souffre comme vous. Quand nous pouvions nous voir tous les jours et à chaque heure du jour, nous ne connaissions pas notre bonheur ; comme en toute chose, il nous a fallu l’ombre pour nous faire regretter le soleil.
– Mais ne pourriez-vous dire à Antoinette, ou du moins lui faire comprendre qu’elle nous rendrait un grand service en éloignant de temps en temps cette bonne mistress Brown, qui reste ici plutôt par habitude que par prudence, et qui, d’ailleurs, je le crois, n’a pas reçu l’ordre positif de nous garder à vue ?
– J’en ai eu vingt fois l’idée, Amaury ; mais je ne sais vraiment à quoi attribuer le sentiment qui me retient. Au moment où j’ouvre la bouche pour parler de vous à ma cousine, la voix me manque, et cependant que lui apprendrais-je de nouveau ? elle sait bien que je vous aime.
– Et moi aussi, Madeleine ; mais j’ai besoin de vous l’entendre dire à haute voix. Tenez, j’ai bien du bonheur à vous voir, mais, en vérité, je crois que j’aimerais mieux me priver de ce bonheur que de vous voir devant des étrangers, devant des gens froids et indifférents qui vous forcent à déguiser votre voix et à composer votre visage, et même dans ce moment-ci je ne puis vous dire ce que je souffre de cette contrainte.
Madeleine se leva en souriant.
– Amaury, dit-elle, voulez-vous m’aider à cueillir dans le jardin et dans la serre quelques fleurs ? J’ai commencé à peindre un bouquet, et comme celui d’hier est fané, je voudrais le renouveler.
Antoinette se leva vivement.
– Madeleine, dit-elle en échangeant avec la jeune fille un regard d’intelligence, tu as tort de sortir par ce temps gris et froid. Laisse-moi me charger de ce soin, et je m’en acquitterai avec une intelligence qui me fera honneur. Ma chère mistress Brown, dit-elle, faites-moi le plaisir d’aller prendre dans la chambre de Madeleine le bouquet que vous trouverez sur la petite table ronde de Boule, dans un vase du Japon, et de me l’apporter dans le jardin ; ce n’est qu’en voyant celui-là que je puis composer l’autre exactement de la même façon.
À ces mots, Antoinette sortit par une des fenêtres du salon qui faisait porte, et descendit dans le jardin par le perron, tandis que mistress Brown, qui n’avait reçu aucun ordre à l’endroit des deux jeunes gens et qui connaissait les liens qui les unissaient l’un à l’autre depuis leur enfance, sortait par une porte latérale sans faire aucune objection.
Amaury suivit la bonne gouvernante des yeux, puis aussitôt qu’il se vit seul avec la jeune fille, il lui saisit la main.
– Enfin, chère Madeleine, lui dit-il avec l’expression du plus ardent amour, nous voilà donc seuls un instant ! Hâtez-vous de me regarder, de me dire que vous m’aimez toujours ; car, en vérité, depuis le changement étrange de votre père à mon égard, je commence à douter de tout. Oh ! quant à moi, vous savez que je suis à vous corps et âme ; quant à moi enfin, vous savez si je vous aime !
– Oh ! oui, dit la jeune fille avec un de ces soupirs joyeux qui soulèvent une poitrine oppressée ; oui, dites-moi que vous m’aimez, car il me semble que, frêle créature que je suis, c’est votre amour seul qui me fait vivre. Voyez-vous, Amaury, quand vous êtes là, je respire et je me sens forte. Avant votre arrivée ou après votre départ, l’air me manque ; et vous êtes bien souvent absent depuis que vous n’habitez plus avec nous. Quand donc aurai-je le droit de ne plus vous quitter, vous mon souffle, vous mon âme !
– Écoutez, Madeleine, quoi qu’il puisse arriver, ce soir même j’écrirai à votre père.
– Et que voulez-vous qui vous arrive, sinon que les projets de notre enfance se réalisent enfin ? Depuis que vous avez eu vingt ans et moi quinze, n’avons-nous pas été habitués à nous sentir destinés l’un à l’autre ? Écrivez hardiment à mon père, Amaury, et vous verrez qu’il ne résistera pas, d’un côté à votre lettre, et de l’autre à ma prière.
– Je voudrais partager votre confiance, Madeleine ; mais, en vérité, depuis quelque temps votre père change singulièrement à mon égard. Après m’avoir traité quinze ans comme son fils, n’en est-il pas venu peu à peu à ne voir en moi qu’un étranger ? Après avoir été dans cette maison comme votre frère, n’en suis-je pas arrivé à vous faire pousser un cri lorsque j’entre maintenant sans être annoncé ?
– Ah ! ce cri, c’était un cri de joie, Amaury ; votre présence ne me surprend jamais, je l’attends toujours ; mais je suis si faible, si nerveuse, que toutes mes sensations se trahissent par des mouvements extrêmes. Il ne faut pas faire attention à cela, mon ami, il faut me traiter comme cette pauvre sensitive que nous nous amusions à tourmenter l’autre jour, sans songer qu’elle a sa vie à elle comme nous avons la nôtre, et que nous lui faisions bien mal peut-être. Eh bien ! moi je suis comme elle, votre présence me fait éprouver le bien-être qu’autrefois je ressentais, enfant, sur les genoux de ma mère. Dieu, en me la reprenant, vous a offert à moi pour la continuer. Je lui dois ma première vie, je vous dois la seconde. Elle m’a fait naître au jour du monde, vous au jour de l’âme. Amaury, pour que je renaisse tout à vous, regardez-moi souvent.
– Oh ! toujours, toujours ! s’écria Amaury en saisissant la main de la jeune fille et en y appuyant ses lèvres ardentes. Oh ! Madeleine, je t’aime, je t’aime !
Mais au contact de ce baiser la pauvre enfant se leva toute frémissante et fiévreuse, et posant la main sur son cœur :
– Oh ! pas ainsi, pas ainsi ! dit-elle, votre voix est trop passionnée et me bouleverse tout entière ; vos lèvres me brûlent. Ménagez-moi, je vous en prie. Rappelez-vous la pauvre sensitive ; j’ai été hier pour la revoir, elle était morte.
– Eh bien ! Madeleine, eh bien ! comme vous voudrez. Asseyez-vous, Madeleine, et laissez-moi me mettre sur ce coussin à vos pieds ; et puisque mon amour vous fait mal, eh bien ! je me contenterai de causer fraternellement cœur à cœur avec vous. Oh ! merci, mon Dieu ! Voilà vos joues qui reprennent leur teinte ordinaire ; elles n’ont plus l’éclat étrange qui me frappait tout à l’heure, ni la morne pâleur qui les couvrait à mon arrivée. Vous êtes mieux, vous êtes bien, Madeleine, ma sœur, mon amie !
La jeune fille se laissa tomber sur le fauteuil plutôt qu’elle ne s’assit, appuyée sur son bras, inclinant en avant son visage voilé de ses longs cheveux blonds, dont l’extrémité des boucles venait se jouer au front du jeune homme.
Placée ainsi, son haleine se confondait avec celle de son amant.
– Oui, dit-elle, oui, Amaury, vous me faites rougir et pâlir à votre volonté ! Vous êtes pour moi ce qu’est le soleil aux fleurs.
– Oh ! quelle ivresse de vous vivifier ainsi avec un coup d’œil ! de vous ranimer ainsi avec un mot ! Madeleine, je vous aime, je vous aime !
Il y eut entre les deux jeunes gens un moment de silence, pendant lequel leur âme tout entière semblait s’être concentrée dans leur regard.
Tout à coup un léger bruit se fit entendre dans le salon. Madeleine releva la tête, Amaury se retourna.
M. d’Avrigny, debout derrière eux, les examinait dans une attitude sévère.
– Mon père ! s’écria Madeleine en se rejetant en arrière.
– Mon cher tuteur !... dit avec embarras Amaury en se relevant et en saluant.
M. d’Avrigny, sans répondre, ôta lentement ses gants, posa son chapeau sur un fauteuil, et de la même place et après un instant de silence qui fut une heure de supplice pour les deux jeunes gens :
– Vous, encore, Amaury ! dit-il d’une voix brève et saccadée ; savez-vous que vous deviendrez un très habile diplomate si vous continuez ainsi à étudier la politique dans les boudoirs, et à vous rendre compte des besoins et des intérêts des peuples en regardant faire de la tapisserie ; vous ne resterez pas longtemps simple attaché, et vous passerez immédiatement premier secrétaire à Londres ou à Saint-Pétersbourg, si vous approfondissez si à propos les ressources de la pensée des Talleyrand et des Metternich dans la compagnie d’une pensionnaire.
– Monsieur, répondit Amaury avec un mélange d’amour filial et de fierté blessée, il se peut qu’à vos yeux je néglige un peu les études de la carrière à laquelle vous avez bien voulu me destiner, mais le ministre ne s’est jamais aperçu de cette négligence, et hier, sur la lecture d’un travail qu’il m’avait demandé...
– Le ministre vous a fait demander un travail, à vous ! et sur quoi ? sur la formation d’un second jockey-club, sur les éléments de la boxe ou de l’escrime, sur les règles du sport en général, ou du steeple-chase en particulier. Oh ! alors je ne m’étonne plus de sa satisfaction.
– Mais, mon cher tuteur, reprit Amaury avec un léger sourire, oserai-je vous faire observer que tous ces talents d’agrément auxquels vous me reprochez de me livrer, c’est à votre sollicitude presque paternelle que je les dois ? Les armes et l’équitation, vous me l’avez toujours dit, sont, avec les quelques langues étrangères que je parle, le complément de l’éducation d’un gentilhomme au dix-neuvième siècle.
– Oui, je le sais bien, monsieur, quand il fait de ces talents une distraction à des travaux sérieux, mais non des travaux sérieux une espèce d’ombre au plaisir. Ah ! que vous êtes bien le type des hommes de notre époque, qui se figurent savoir tout de science infuse sans avoir rien appris ; qui, parce qu’ils ont été une heure à la Chambre le matin, une heure à la Sorbonne l’après-midi, une heure au spectacle le soir, se posent en Mirabeau, en Cuvier et en Geoffroy, jugeant tout du haut de leur génie, et laissant tomber dédaigneusement leurs arrêts de salon dans la balance où se pèsent les destinées du monde ! Le ministre vous a fait des compliments hier, dites-vous ? eh bien ! allez vivre sur ces glorieuses espérances, escomptez ces éloges pompeux, et au jour de l’échéance le sort vous fera banqueroute. Parce qu’à vingt-trois ans, piloté par un tuteur commode, vous vous êtes trouvé docteur en droit, bachelier ès lettres, attaché d’ambassade ; parce que vous allez aux galas de la cour avec un habit brodé d’or au collet ; parce qu’on vous a promis la croix de la Légion d’honneur peut-être, comme à tous ceux qui ne l’ont pas encore, il vous semble que tout est fait et que vous n’avez plus qu’à attendre la fortune. Je suis riche, dites-vous, donc je puis rester inutile ; et, d’après ce beau raisonnement, votre titre de gentilhomme vous devient un brevet d’oisiveté.
– Mais, cher père, s’écria Madeleine, effrayée de la chaleur croissante des paroles de M. d’Avrigny, que dites-vous donc là ? Je ne vous ai jamais entendu parler ainsi à Amaury.
– Monsieur ! monsieur ! balbutiait le jeune homme.
– Oui, reprit M. d’Avrigny avec un accent plus calme mais plus amer, mes reproches vous blessent d’autant plus qu’ils sont mérités, n’est-ce pas ? Il faut vous y habituer cependant, si vous continuez à mener cette vie sans but que vous menez, ou bien il faut renoncer à voir un tuteur maussade et exigeant. Oh ! vous n’êtes émancipé que d’hier, mon pupille. Les droits que mon vieil ami le comte de Léoville m’a légués sur vous n’existent plus selon la loi, mais n’ont pas cessé selon la morale, et je dois vous avertir que dans nos temps de troubles, où biens et honneurs dépendent d’un caprice de la foule ou d’une émeute populaire, il ne faut compter que sur soi-même, et que tout millionnaire et tout comte que vous êtes, un père de famille haut placé ferait prudemment en vous refusant sa fille, et en considérant vos triomphes aux courses et vos grades au jockey-club comme des garanties fort peu solides.
M. d’Avrigny s’exaltait de sa parole, il marchait à grands pas sans regarder ni sa fille tremblante comme la feuille, ni Amaury debout et les sourcils froncés.
Les yeux du jeune homme, que le respect avait peine à contenir, erraient de M. d’Avrigny irrité, sans qu’il pût comprendre la cause de cette irritation, à Madeleine stupéfaite comme lui.
– Mais vous n’avez donc pas compris, continua M. d’Avrigny en s’arrêtant devant les deux jeunes gens, devenus muets devant cette colère inattendue, vous n’avez donc pas compris, mon cher Amaury, pourquoi je vous avais prié de ne pas demeurer plus longtemps avec nous ? C’est qu’il ne sied pas à un jeune homme de nom et de fortune de consumer son temps à des papotages avec de petites filles ; c’est que ce qui convient à douze ans devient ridicule à vingt-trois ; c’est qu’après tout, l’avenir de ma fille, quoiqu’il n’ait rien à démêler avec le vôtre, peut souffrir comme le vôtre de ces perpétuelles visites.
– Oh ! monsieur, monsieur ! s’écria Amaury, mais ayez donc pitié de Madeleine ; vous voyez bien que vous la tuez !
En effet, plus blanche qu’une statue, Madeleine était tombée sans mouvement sur son fauteuil, frappée au cœur par les terribles paroles de son père.
– Ma fille ! ma fille ! s’écria M. d’Avrigny en devenant aussi pâle qu’elle, ma fille ! Ah ! c’est vous qui la ferez mourir, Amaury.
Et, s’élançant vers Madeleine, il la prit dans ses bras comme il eût fait d’un enfant, et l’emporta dans la chambre voisine.
Amaury voulut le suivre.
– Restez, monsieur, dit-il en l’arrêtant sur la porte, restez, je vous l’ordonne.
– Mais, s’écria Amaury les mains jointes, mais elle a besoin de secours !
– Eh bien ! dit M. d’Avrigny, ne suis-je pas médecin ?
– Pardon, monsieur, balbutia Amaury ; c’est que je croyais... c’est que je n’aurais pas voulu m’éloigner avant de savoir...
– Grand merci, mon cher... grand merci de votre intérêt. Mais, soyez tranquille, Madeleine reste avec son père, et mes soins ne lui manqueront pas. Ainsi donc, portez-vous bien, et adieu !
– Au revoir ! dit le jeune homme.
– Adieu ! reprit M. d’Avrigny avec un regard glacé, et, du pied, il poussa la porte, qui se referma sur lui et sur Madeleine.
Amaury demeura à la place où il était, immobile, anéanti.
En ce moment, on entendit retentir la sonnette qui appelait la femme de chambre ; en même temps, Antoinette rentra avec mistress Brown.
– Mon Dieu ! s’écria Antoinette, qu’avez-vous donc, Amaury, et d’où vient que vous êtes si pâle et si défait ? Où est Madeleine ?
– Mourante ! mourante ! s’écria le jeune homme. Allez, mistress Brown, allez près d’elle, elle a besoin de vos secours.
Mistress Brown s’élança dans la chambre qu’Amaury lui montrait de la main.
– Mais vous, lui dit Antoinette, pourquoi n’entrez-vous pas ?
– Parce qu’il m’a chassé, Antoinette ! s’écria Amaury.
– Qui cela ?
– Lui, M. d’Avrigny, le père de Madeleine.
Et, prenant son chapeau et ses gants, le jeune homme s’élança comme un fou hors de l’appartement.
III
En rentrant chez lui, Amaury trouva un de ses amis qui l’attendait.
C’était un jeune avocat, son camarade de collège à Sainte-Barbe, puis ensuite de droit et de baccalauréat. Il était du même âge à peu près qu’Amaury ; seulement, quoique jouissant d’une fortune indépendante, c’est-à-dire d’une vingtaine de mille livres de rente à peu près, il était d’une famille plébéienne et sans aucune illustration dans les siècles passés.
On l’appelait Philippe Auvray.
Amaury avait été prévenu par son valet de chambre de cette visite intempestive, et un instant il avait pensé à monter directement à sa chambre et à laisser attendre Philippe jusqu’à ce qu’il se lassât d’attendre.
Mais Philippe était un si bon garçon, qu’Amaury pensa que ce serait pitié que de le traiter ainsi. Il entra donc dans le petit cabinet de travail où son ami avait été introduit.
En l’apercevant, Philippe se leva et vint à lui.
– Pardieu ! mon cher, lui dit le jeune avocat, je t’attends depuis près d’une heure. Je commençais à désespérer et j’allais quitter la place, ce que j’eusse fait, au reste, depuis longtemps, si je n’avais un service de la plus haute importance à te demander.
– Mon cher Philippe, dit Amaury, tu sais comme je t’aime, tu ne te blesseras donc pas de ce que je vais te dire. As-tu perdu au jeu, ou as-tu un duel ? les deux seules choses qui ne puissent se remettre ; faut-il que tu payes aujourd’hui ? faut-il que tu te battes demain ? Dans les deux cas, ma bourse et ma personne sont à ta disposition.
– Non, dit Philippe, c’est pour une chose beaucoup plus importante, mais évidemment moins pressée.
– En ce cas, mon ami, dit Amaury, il m’arrive dans ce moment une de ces choses qui bouleversent complètement un homme. À peine si j’ai l’esprit à moi. Ce que tu me diras, vois-tu, malgré toute l’amitié que je te porte, ce seraient autant de paroles perdues.
– Pauvre ami, dit Philippe ; mais, de mon côté, puis-je quelque chose pour toi ?
– Rien, que de remettre à deux ou trois jours la confidence que tu venais me faire ; rien, que de me laisser seul avec moi-même et l’événement qui m’arrive.
– Toi malheureux ! Amaury malheureux avec un des plus beaux noms et une des plus belles fortunes de France ! Malheureux, quand on est comte de Léoville et qu’on a cent mille livres de rente ! Ma foi ! je t’avoue qu’il faut que ce soit toi qui me le dises pour que je le croie.
– Eh bien ! c’est cependant ainsi, mon cher ; oui... oui... malheureux... bien malheureux ! et il me semble que c’est lorsque nos amis sont malheureux qu’il faut les laisser seuls avec leur douleur. Philippe, tu n’as jamais été malheureux, si tu ne comprends pas cela.
– Que je comprenne ou non, quand tu me demandes quelque chose, Amaury, tu sais bien que mon habitude est de faire ce que tu me demandes. Tu veux être seul, pauvre ami, adieu, adieu !
– Adieu ! dit Amaury, en tombant dans un fauteuil.
Puis, comme Philippe sortait :
– Philippe, dit-il, préviens mon valet de chambre que je n’y suis pour personne, et que je lui défends d’entrer sans que je l’appelle. Je ne veux pas voir figure humaine.
Philippe fit signe à son ami qu’il allait s’acquitter de la commission, et, après l’avoir faite, s’éloigna, cherchant vainement dans son esprit quelle circonstance étrange avait pu faire tomber Amaury dans un si profond accès de misanthropie.
Quant à Amaury, dès qu’il fut seul, il laissa aller sa tête dans ses deux mains, tâchant de se rappeler en quoi il avait pu mériter la colère de son tuteur, mais sans rien retrouver dans sa mémoire, si scrupuleusement qu’il l’interrogeât, qui pût lui donner l’explication de cette colère inattendue qui tout à coup avait grondé sur lui, et cependant, en un instant, toute sa vie écoulée repassait jour par jour devant lui.
Amaury, nous l’avons dit, était un de ces hommes doués sous tous les rapports.
La nature, en le créant, l’avait fait beau, élégant et distingué, et son père, en mourant, lui avait laissé un vieux nom qui avait retrempé son lustre monarchique aux guerres de l’Empire, une fortune de plus d’un million et demi confiée aux soins de M. d’Avrigny, un des médecins les plus distingués de l’époque, et qu’une ancienne amitié liait à son père.
De plus, il avait vu sa fortune, habilement dirigée par son tuteur, s’augmenter de près d’un tiers entre ses mains.
Mais ce n’était pas assez que M. d’Avrigny se fût occupé avec soin des intérêts pécuniaires de son pupille, il avait veillé lui-même sur son éducation, comme il eût veillé sur celle de son propre fils.
Il en résulta qu’Amaury, élevé près de Madeleine, de trois ou quatre ans seulement plus âgé qu’elle, s’était pris d’une tendresse profonde pour celle qui le regardait comme son frère, et d’un amour plus que fraternel pour celle qu’il avait longtemps appelée sa sœur.
Aussi, dès leur jeunesse, les deux enfants avaient formé, dans l’innocence de leur âme et dans la pureté de leur cœur, le beau projet de ne jamais se quitter.
L’amour immense que M. d’Avrigny avait reporté de sa femme, morte à vingt-deux ans de la poitrine, sur sa fille, son unique enfant, le sentiment presque paternel qu’Amaury sentait lui avoir inspiré, faisaient que les jeunes gens n’avaient pas douté un instant de l’assentiment de M. d’Avrigny.
Tout avait donc concouru à les bercer de l’espérance d’un seul et même avenir, et c’était l’objet éternel de leurs entretiens depuis que tous deux avaient vu clair dans leur propre cœur.
Les absences continuelles de M. d’Avrigny, qui était forcé de se donner presque en entier à sa clientèle, à l’hôpital dont il était le directeur, à l’Institut dont il était membre, leur laissaient, au reste, tout le temps de bâtir de charmants châteaux de cartes auxquels la mémoire du passé et l’espérance de l’avenir donnaient l’apparente solidité d’édifices de granit.
Ils en étaient donc à cet endroit de leur vie, Madeleine ayant atteint sa dix-septième et Amaury sa vingt-deuxième année, lorsque l’humeur ordinairement si douce et si sereine de M. d’Avrigny s’altéra.
D’abord on crut que ce changement de caractère était causé par la mort d’une sœur qu’il aimait beaucoup et qui laissait une fille de l’âge de Madeleine, son amie constante et la compagne de ses études et de ses jeux.
Mais les jours, mais les mois s’écoulèrent, et le temps, loin d’éclaircir le visage de M. d’Avrigny, le rembrunissait au contraire de plus en plus ; et, chose étrange, c’était sur Amaury que se portait presque toujours cette mauvaise humeur qui, de temps en temps, jaillissait, sans qu’on sût comment ni pourquoi, sur Madeleine, cette enfant adorée, pour la jeunesse de laquelle M. d’Avrigny avait répandu ce trésor d’amour que contient seul le cœur d’une mère ; puis, par une bizarrerie aussi étrange que celle que nous avons dite, c’était la folle et joyeuse Antoinette qui paraissait être devenue la favorite de M. d’Avrigny, et qui avait hérité de Madeleine du privilège de tout lui dire.
Il y avait plus, M. d’Avrigny vantait sans cesse Antoinette devant Amaury, et plus d’une fois il avait donné à entendre qu’Amaury entrerait dans ses intentions en abandonnant les projets que lui-même autrefois avait formés sur son pupille et sur Madeleine, pour tourner ses vues du côté de cette nièce qu’il avait fait venir chez lui et sur laquelle il semblait avoir concentré tout le côté visible de ses affections.
Cependant Amaury et Madeleine, aveuglés par l’habitude, n’avaient vu dans ces bizarreries de M. d’Avrigny que des contrariétés momentanées, et non une douleur réelle.
Ils étaient donc restés dans leur confiance presque entière, et un jour ils jouaient comme deux enfants qu’ils étaient encore, tournant autour du billard, Madeleine pour défendre, Amaury pour conquérir une fleur, quand tout à coup la porte s’ouvrit, et M. d’Avrigny parut.
– Eh bien ! dit-il avec cette amertume que l’on commençait à remarquer dans ses paroles, qu’est-ce donc que tous ces enfantillages ? Avez-vous encore dix ans, Madeleine ? N’en avez-vous plus que quinze, Amaury ? Croyez-vous courir sur la pelouse du château de Léoville ? Pourquoi voulez-vous prendre cette fleur que Madeleine a raison de vous refuser ? Je croyais que ce n’étaient plus que les bergers et les bergères de l’Opéra qui faisaient de ces passes chorégraphiques ; il paraît que je m’étais trompé.
– Mais, mon père, hasarda Madeleine, qui avait cru d’abord que M. d’Avrigny plaisantait et qui venait de s’apercevoir seulement qu’il n’avait, au contraire, jamais été plus sérieux ; mais, mon père, hier encore...
– Hier n’engage pas aujourd’hui, Madeleine, reprit sèchement M. d’Avrigny ; obéir ainsi au passé, c’est abdiquer l’avenir. Et puisque vous refaites si volontiers ce que vous avez fait, en vérité, je vous demanderai pourquoi vous avez renoncé à vos joujoux et à vos poupées ; si vous ne voyez pas qu’avec l’âge les devoirs et les convenances changent, je me chargerai, moi, de vous le rappeler.
– Mais, mon bon tuteur, reprit Amaury, il me semble que vous êtes bien sévère pour nous. Vous nous trouvez trop enfants ? Eh ! mon Dieu, vous m’avez dit si souvent qu’une des plaies de notre siècle était que les enfants voulussent faire les hommes !
– Vous ai-je dit cela, monsieur ? c’était peut-être vrai pour les échappés de collège qui font de la politique humanitaire, pour ces Richelieu de vingt ans qui font les hommes blasés, pour ces poètes en herbe qui font du désenchantement une dixième muse. Mais vous, mon cher Amaury, sinon par l’âge, du moins par la position, vous devez avoir des prétentions au sérieux. Si vous n’en avez pas la réalité, gardez-en donc au moins les apparences ; d’ailleurs je venais pour vous parler de choses graves. Retirez-vous, Madeleine.
Madeleine sortit en jetant sur son père un de ces beaux regards suppliants qui, autrefois, faisaient tomber à l’instant même toute la colère de M. d’Avrigny.
Mais sans doute M. d’Avrigny se rappela pour qui ces beaux yeux suppliaient, et il demeura froid et irrité.
Resté seul avec Amaury, M. d’Avrigny se promena quelque temps de long en large sans rien dire, tandis qu’Amaury le suivait des yeux avec anxiété.
Enfin il s’arrêta devant le jeune homme, et sans que son visage perdît rien de sa sévérité :
– Amaury, lui dit-il, il y a peut-être longtemps que j’aurais dû vous annoncer ce que vous allez entendre et que j’ai trop tardé à vous dire, c’est que vous ne pouvez, vous, jeune homme de vingt et un ans, rester dans la même maison que deux jeunes filles, dont vous n’êtes le parent à aucun degré. Il m’en coûte sans doute de me séparer de vous, et voilà pourquoi j’ai si longtemps tardé à vous dire que cette séparation était nécessaire. Mais, aujourd’hui, hésiter plus longtemps à prendre cette mesure serait, de ma part, une faute impardonnable. Ne faites donc pas de réflexions, elles seraient inutiles ; ne préparez pas d’objections, vos dilemmes ne me convaincraient pas ; ma résolution est prise à cet égard, et rien ne m’en fera changer.
– Mais, mon bon et cher tuteur, dit Amaury d’une voix tremblante, il m’avait semblé que vous étiez si bien habitué à me voir près de vous et à m’appeler votre fils, que vous aviez fini par me considérer comme étant de votre famille, ou, du moins, comme pouvant avoir un jour espoir d’y entrer. Vous ai-je offensé sans le savoir ? et, pour me condamner à cet exil, ne m’aimez-vous donc plus ?
– Mon cher pupille, dit M. d’Avrigny, il me semblait que je n’avais d’autres comptes à vous rendre que vos comptes de tutelle, et que ceux-là étant réglés, nous étions quittes l’un envers l’autre.
– Vous vous trompez, monsieur, répondit Amaury, car, moi du moins, je ne me regarderai jamais comme quitte envers vous : vous avez été pour moi plus qu’un tuteur fidèle, vous avez été un père prévenant et tendre ; vous m’avez élevé, vous m’avez fait ce que je suis, vous m’avez mis ce que j’ai dans le cœur et dans l’âme ; vous avez été pour moi tout ce qu’un homme peut être pour un autre homme : tuteur, père, gouverneur, guide et ami. Je dois donc, avant toutes choses, vous obéir avec respect, et c’est ce que je fais en me retirant. Adieu, mon père, j’espère qu’un jour vous rappellerez votre fils !
À ces mots, Amaury s’approcha de M. d’Avrigny, prit, presque malgré lui, sa main qu’il baisa, et sortit.
Le lendemain, il se fit annoncer chez M. d’Avrigny comme s’il eût déjà été étranger, et lui apprit avec une fermeté de voix que démentaient ses yeux humides qu’il avait loué un petit hôtel dans la rue des Mathurins, qu’on y transportait ses effets et qu’il venait lui présenter ses adieux.
Madeleine était là ; elle penchait la tête, pauvre lys ployé par le vent glacé du caprice paternel, et lorsqu’elle releva les yeux pour jeter un regard à la dérobée sur Amaury, son père la vit si pâle qu’il tressaillit.
Alors, sans doute, M. d’Avrigny pensa que son inexplicable fantaisie devait paraître odieuse à sa fille, car sa sévérité sembla se relâcher un peu, et, tendant la main au jeune homme :
– Amaury, lui dit-il, vous vous êtes trompé à mes intentions ; votre départ n’est point un bannissement. Loin de là, cette maison demeure toujours la vôtre, et tant que vous y voudrez venir, vous serez le bienvenu.
Un rayon de joie qui passa dans les beaux yeux languissants de Madeleine, un sourire qui erra sur ses lèvres blanches furent la récompense de M. d’Avrigny.
Mais, comme si Amaury eût deviné que c’était pour sa fille seulement que M. d’Avrigny avait fait cette concession, il salua humblement son tuteur, baisa la main de Madeleine avec un sentiment de si profonde tristesse que, dans cette action, la douleur semblait exclure l’amour.
Puis il sortit.
Ce fut de cette heure seulement, et lorsqu’ils furent séparés l’un de l’autre, que les deux jeunes gens comprirent combien ils s’aimaient véritablement, et jusqu’à quel point ils étaient devenus nécessaires à l’existence l’un de l’autre.
Tous ces désirs de se revoir quand on s’est quitté, tous ces tressaillements soudains en se revoyant, ces tristesses sans sujet, ces joies sans cause qui sont les symptômes de cette maladie de l’âme qu’on nomme amour, furent successivement éprouvés par eux sans qu’aucun de ces symptômes, au reste, échappât à l’œil pénétrant de M. d’Avrigny, qui, plus d’une fois déjà, avait paru se repentir de la concession faite à Amaury en lui permettant de revenir chez lui, lorsque arriva la scène que nous venons de raconter.
Tous ces événements venaient donc de repasser devant les yeux d’Amaury comme nous venons de les mettre sous le regard du lecteur, sans que le jeune homme, en sondant ses souvenirs les plus secrets, y eût trouvé une cause au changement qui s’était opéré tout à coup.
Il pensa à cette idée, la seule qui pût raisonnablement lui expliquer la conduite de son tuteur : c’est que, regardant son mariage avec Madeleine comme arrêté naturellement, il n’en avait jamais parlé à M. d’Avrigny. Or, M. d’Avrigny aurait peut-être pu croire que son pupille, tout en demeurant chez lui, tout en continuant d’y venir depuis qu’il n’y demeurait plus, avait d’autres projets d’avenir que ceux qu’il lui avait supposés d’abord.
Il s’arrêta donc à cette idée que son oubli avait blessé la sollicitude paternelle, et se décida à écrire officiellement à M. d’Avrigny pour lui demander la main de sa fille.





























