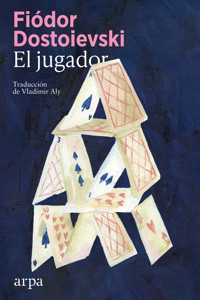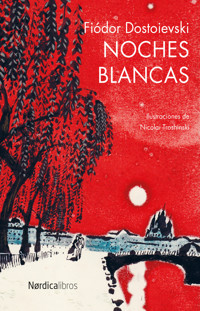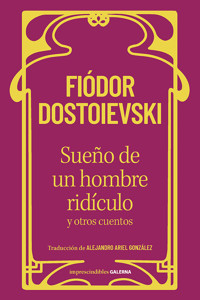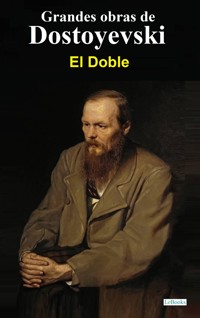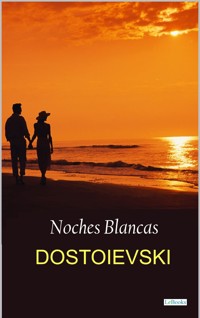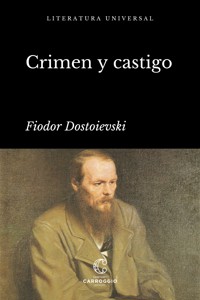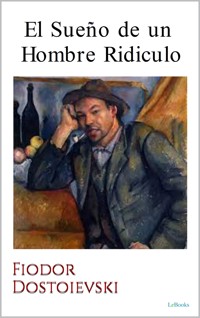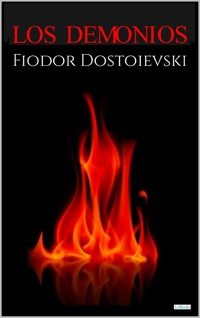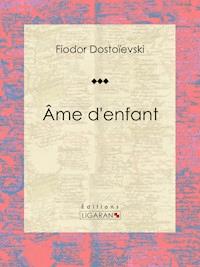
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Extrait : "Je m'éveillai dans un lit bien blanc et bien doux et j'aperçus autour de moi, dans la chambre, des tapis épais, des meubles magnifiques. Le demi-jour qui filtrait entre les rideaux demi-clos de la fenêtre immense mettait sur toutes choses un air fantastique et mystérieux. Est-ce que je rêvais?"
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de qualité de grands livres de la littérature classique mais également des livres rares en partenariat avec la BNF. Beaucoup de soins sont apportés à ces versions ebook pour éviter les fautes que l'on trouve trop souvent dans des versions numériques de ces textes.
LIGARAN propose des grands classiques dans les domaines suivants :
• Livres rares
• Livres libertins
• Livres d'Histoire
• Poésies
• Première guerre mondiale
• Jeunesse
• Policier
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 179
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EAN : 9782335055733
©Ligaran 2015
Je m’éveillai dans un lit bien blanc et bien doux et j’aperçus autour de moi, dans la chambre, des tapis épais, des meubles magnifiques. Le demi-jour qui filtrait entre les rideaux demi clos de la fenêtre immense mettait sur toutes choses un air fantastique et mystérieux.
Est-ce que je rêvais ?
Non, c’était bien la réalité telle que la mort me l’avait faite, et cette demeure princière ajoutait à mon désespoir.
J’étais bien une orpheline, j’étais seule désormais, et chez des étrangers.
Pour la première fois je regrettai en pleurant notre triste mansarde ; le mobilier incrusté d’écaille de la maison du prince ne pouvait me faire oublier le vieux divan et la commode boiteuse familiers à ma première enfance.
Je fus bientôt rétablie et pus faire connaissance avec la maison et avec ses hôtes, car mes premiers souvenirs, quand on m’avait ramassée dans la rue, s’étaient dissipés comme un affreux cauchemar et je ne revoyais clairement que la physionomie douce et grave du prince.
J’observai dès les premiers jours les nouveaux visages et tâchai de me familiariser avec eux.
Tout dans cette maison me paraissait extraordinaire ; je revois encore ces pièces immenses et somptueuses, ces salles si longues que j’avais peur de les traverser et que je craignais de m’y perdre.
Je n’étais pas guérie tout à fait et mon état d’esprit était, comme cette habitation, solennellement triste. Une angoisse inconnue remplissait mon cœur d’enfant. Je m’arrêtais parfois étonnée devant un tableau, un miroir, une cheminée d’un travail curieux, où une statue, qui semblait me guetter dans sa niche profonde, me suivait du regard et me faisait peur.
J’avais vu bien peu de personnes pendant ma maladie. Seul, un vieux monsieur, aux yeux bleus et doux, me tenait parfois compagnie.
J’aurais bien voulu lui parler, mais j’étais retenue par une sorte de frayeur. Il était toujours triste et ne me causait que par caprices. C’était le prince, mon bienfaiteur, celui même qui m’avait recueillie dans la rue.
Il m’apportait des bonbons, quelques friandises, des livres d’images, et s’efforçait de me rendre plus gaie.
Un jour il m’annonça que j’allais avoir bientôt une amie de mon âge, sa fille Katia, qui était alors à Moscou.
Ce fut pour moi une grande joie, car en dehors du prince personne jusque-là n’avait paru me porter intérêt dans la maison. Le prince d’ailleurs vivait fort retiré et la princesse était parfois des semaines entières sans le voir.
On eût dit qu’il n’habitait pas sa maison.
Un matin pourtant on m’habilla et on me coiffa avec plus de soin que de coutume, on me mit une robe neuve à galons blancs, ce qui m’étonna beaucoup. Ces préparatifs terminés, je fus conduite dans les appartements de la princesse. Sa seule présence me fit perdre contenance ; j’étais éblouie à la fois par le luxe de l’ameublement et les manières de la grande dame.
Je m’étais bien, en m’habillant, préparée à une séance pénible, mais je ne pensais pas que je serais aussi impressionnée.
Le malheur m’avait rendue défiante et craintive à l’excès. Je tremblais en baisant la main de ma bienfaitrice et me trouvai incapable de répondre un mot à ses questions.
C’était une dame bien belle, mais qui me semblait si au-dessus de moi que je n’osais même pas la regarder.
Elle me fit asseoir sur un tabouret tout près d’elle et voulut faire connaissance avec cette petite sauvage dont elle voulait être la mère. Je ne sus qu’être maussade et renfermée, ce qui la surprit et la découragea peut-être, car elle me donna un livre d’images et se mit à écrire des lettres.
Je feuilletais le livre mais j’étais mal à l’aise. Je me sentais examinée par une étrangère et j’aurais voulu être bien loin.
Quand elle me parlait je ne pouvais répondre que par monosyllabes et ma timidité ressemblait fort à de la bêtise.
On s’attendait sans doute à découvrir en moi une enfant extraordinaire et l’on ne trouvait qu’une sotte petite fille.
Je sentais que j’avais déplu tout d’abord et ma gaucherie en augmentait.
J’aurais donné bien des choses en ce moment pour pouvoir être aimable, mais le chagrin me montait à la gorge, et après tout je n’étais qu’une enfant de dix ans.
À trois heures commencèrent les visites. Je crus que mon supplice allait finir et que je pouvais quitter mon malheureux livre d’images pour me réfugier dans un coin : je me trompais.
Il arriva, l’une après l’autre, une quantité de personnes auxquelles la princesse me présenta comme un petit phénomène. Elle avait alors pour moi toutes sortes d’attentions qui me gênaient de plus en plus. Je me rappelle d’un petit monsieur vieux et maigre qui me regardait avec un monocle et qui était tout parfumé ! Un autre voulut m’embrasser.
Quand il y eut beaucoup de monde réuni dans son salon, la princesse crut le moment opportun pour raconter mon histoire.
J’en fus vraiment confuse ; je ne sais si j’étais rouge ou pâle, mais mon cœur était bouleversé.
Il était bien triste pour moi d’entendre raconter à des indifférents, que ce père que j’avais tant aimé était une espèce de musicien, à moitié fou, un homme extraordinaire incompris jusqu’à sa mort ; que l’arrivée du musicien Schurmann à Pétersbourg avait fini par lui détraquer la cervelle et avait été la cause de sa mort tragique. Que ma mère enfin était une pauvre femme que la misère avait tuée et qui avait cru jusqu’au dernier jour au génie de son mari.
Tout cela, je me le rappelais avec un morne désespoir et je cachais mes larmes tandis que les messieurs bien gantés faisaient cercle autour de ma bienfaitrice, poussant des petits grognements et jetant sur moi de temps à autre des regards tout remplis de méprisante compassion.
Quelle cruauté que cette présentation ! On croyait sans doute que je ne savais rien, que je ne sentais rien, qu’à dix ans on ne peut souffrir de l’amour-propre et du cœur.
J’étais orgueilleuse je ne sais pourquoi. J’étais fière d’être la fille de mon père, de ce pauvre fou qui m’avait laissée un jour dans la neige pour s’en aller à la mort.
Je me reportais à mon passé, à notre vie dans un grenier, à ces longues soirées silencieuses, et les sanglots me montaient à la gorge… J’aurais voulu m’enfuir quelque part sous la terre. Je ne connaissais pas la vie et déjà j’aurais voulu être morte…
Enfin les visites se terminèrent.
La princesse n’était pas satisfaite de sa protégée, aussi me renvoya-t-elle d’un air maussade, peu flattée de mon entrée dans le monde.
Je fus bien contente lorsqu’on me reconduisit dans les appartements du haut où se trouvait ma chambre.
J’avais la fièvre en m’endormant ; tout ce que j’avais vu ce jour-là me tourmentant, je fis de mauvais rêves.
Je m’étais aperçue bien vite que j’avais déplu à la princesse, toujours est-il qu’elle ne me fit pas revenir chez elle.
J’étais au fond très heureuse de ma solitude. J’aimais à courir dans les appartements, à me cacher dans les coins et derrière les meubles pour observer les gens de la maison sans crainte de les fâcher.
Cette existence nouvelle avait pour moi beaucoup d’attraits au point que j’en oubliais la terrible catastrophe qui l’avait précédée.
Seuls, les évènements anciens revenaient à ma mémoire, et surtout le violon de mon père, et cette idée qu’il était un grand génie.
J’étais libre, et pourtant je me sentais très surveillée par les domestiques et je m’en inquiétais. Je ne comprenais pas pourquoi on agissait ainsi avec moi. Il me semblait qu’on avait des desseins sur moi, qu’on voulait m’employer à quelque chose.
Je cherchai à pénétrer dans les endroits les plus secrets de la maison afin de m’y cacher au besoin.
Un jour j’arrivai dans un grand escalier de marbre, large, couvert de tapis, orné de fleurs et de magnifiques vases. À chaque palier, deux grands domestiques silencieux, en habit écarlate, gantés et cravatés de blanc, se tenaient debout. Je les regardai, étonnée, sans comprendre pourquoi ils restaient ainsi muets et immobiles.
Ces promenades solitaires me plaisaient par-dessus tout. À l’étage supérieur habitait une vieille tante du prince, qui ne sortait presque jamais de sa chambre. Elle était avec le prince le personnage le plus important de la maison. Dans ses relations avec elle, tout le monde observait une étiquette sévère.
La princesse, si orgueilleuse et si hautaine, lui faisait visite deux fois par semaine.
Ces visites étaient courtes et solennelles.
La haute société s’était jadis fait un devoir de rendre ses respects à cette vieille dame considérée comme une des gardiennes des dernières traditions aristocratiques, une relique vivante des boyards de pur sang.
Invariablement vêtue d’une robe de laine noire, la vieille tante portait des cols bien plissés, qui lui donnaient l’air d’une religieuse. Elle allait régulièrement à la messe en voiture, ne quittait pas son chapelet, recevait des ecclésiastiques, lisait des livres pieux, faisait maigre tous les jours et menait en somme une vie très austère.
On n’entendait aucun bruit à l’étage qu’elle habitait, et le moindre tapage lui était insupportable.
Quinze jours après mon arrivée dans la maison, la vieille tante s’aperçut de ma présence et s’en informa.
On lui raconta mon histoire et elle se plaignit de ce qu’on ne m’eût pas encore présentée.
Le lendemain, je fus coiffée, lavée, tiraillée de tous les côtés par les bonnes qui s’occupaient de moi ; après m’avoir appris à marcher et à saluer, on demanda pour moi une audience.
La réponse fut qu’on remettait la visite au lendemain, après la messe.
Je dormis mal cette nuit-là, et on me raconta ensuite que j’avais rêvé tout haut de la vieille dame. Je m’approchais d’elle et la priais de me pardonner quelque chose.
La présentation se fit enfin.
Je trouvai, assise, dans un grand fauteuil, une petite vieille, maigre. Elle me fit plusieurs signes de la tête et ; pour me voir mieux, posa ses lunettes sur son nez.
Je voyais que je ne lui plaisais pas du tout. J’étais pour elle tout à fait sauvage, ne sachant ni faire la révérence, ni baiser la main. La tante me questionna, mais je lui répondis à peine. Et quand elle m’interrogea sur mon père et sur ma mère, je me mis à pleurer. Mécontente de ma trop grande sensibilité, elle me consola pourtant en disant d’avoir confiance en Dieu. Elle me demanda quand j’étais allée à l’église pour la dernière fois. Et comme je ne comprenais pas trop bien, car mon éducation religieuse avait été très négligée, elle resta stupéfaite. On fit demander la princesse, oh tint conseil, et il fut décidé qu’on me conduirait à l’église le dimanche suivant. La tante promit de prier pour moi jusque-là, mais, en attendant, elle ordonna de m’emmener, car je laissais après moi une impression pénible, disait-elle. Il n’y avait là rien de surprenant.
Le même jour, elle envoya dire que je faisais trop de bruit et qu’on m’entendait de partout ; or, je n’avais pas bougé de la journée. Il était clair que la vieille ne m’aimait pas. Le lendemain on me fit la même observation. Puis il m’arriva de laisser tomber une tasse et de la briser. La gouvernante française et les bonnes furent consternées. On me mena alors, pour jouer, dans la chambre la plus écartée.
Voilà pourquoi j’étais heureuse d’errer dans les grandes salles d’en bas, sachant que là, au moins, je ne gênais personne.
Un jour, seule dans un des salons, j’avais caché mon visage dans mes mains, et je restais ainsi à rêver.
Je pensais, je pensais toujours. Mon esprit, encore peu développé, ne s’expliquait pas ce chagrin qui me devenait de plus en plus insupportable. Tout à coup, une voix douce me demanda :
– Qu’as-tu ? ma pauvre petite.
Je levai la tête : le prince était devant moi. Son visage exprimait la plus grande commisération. Je le regardai d’un air douloureusement affecté, une larme coula de ses yeux.
– Pauvre orpheline, dit-il en me caressant les cheveux.
– Non ! non ! pas orpheline ! non ! m’écriai-je en gémissant. Je me levai, je saisis sa main que je baisai en la mouillant de mes pleurs et je continuai d’une voix suppliante :
– Non, non, pas orpheline, non !
– Mon enfant, qu’as-tu ? ma mignonne, ma pauvre Netotchka ! Qu’as-tu donc ?
– Où est ma maman ? où est ma maman ? criai-je en sanglotant, sans pouvoir me contenir, et je tombai à genoux.
– Où est ma maman ? dis-moi où est ma maman.
– Pardonne-moi, mon enfant ! Hélas ! je la lui ai rappelée ! Qu’ai-je fait ? Viens avec moi, Netotchka.
Il me prit la main et nous sortîmes.
Le prince était très ému. Nous entrâmes dans une grande salle comme je n’en avais jamais vue. C’était une chapelle. Il y faisait sombre. La flamme des veilleuses se reflétait sur les ornements dorés et sur les pierres précieuses des images saintes. Les saints se dessinaient en noir sur un fond d’or éclatant. Cette salle ne ressemblait en rien aux autres pièces de la maison ; tout y était mystérieux et solennel.
Le prince me fit mettre à genoux devant l’image de la sainte Vierge et s’agenouilla auprès de moi.
– Fais ta prière, mon enfant ? nous prierons ensemble ! – me dit-il à voix basse.
Mais je ne pouvais prier tant j’avais peur.
Le prince venait de me répéter les mêmes paroles que m’avait dites mon père devant le corps inanimé de ma mère ; je tombai dans une crise de nerfs. Il fallut m’emporter dans mon lit.
J’étais de nouveau malade quand un matin, un nom connu frappa mes oreilles. C’était celui de Schurmann. Quelqu’un de la maison l’avait prononcé près de mon lit. Je tressaillis à ce nom et j’en rêvai jusqu’au délire.
Je me réveillai très tard. Tout était sombre autour de moi. La veilleuse s’était éteinte et la bonne qui me gardait s’était absentée. Soudain j’entendis les sons mélodieux d’une musique lointaine. Parfois elle cessait tout à fait, puis elle recommençait, en paraissant se rapprocher. Une émotion extraordinaire s’empara de moi. Je me levai, et m’habillai à la hâte (je ne sais où j’en trouvai la force), je sortis de la chambre à tâtons.
Je traversai deux pièces désertes. J’arrivai dans le corridor. La musique était déjà plus distincte. Un escalier très éclairé me conduisit dans les salons du rez-de-chaussée. J’entendis des pas et je me blottis dans un coin ; puis le bruit s’éteignit et je pénétrai dans un second corridor. La musique partait d’une pièce voisine. On y entendait un bruit de conversation, comme s’il y avait là des milliers de personnes. Une des portes de cette salle était cachée par une double portière de velours pourpre. Je soulevai un des pans de la tenture et je me cachai derrière. Mon cœur battait si fort, que je pouvais à peine me tenir debout. Quelques instants s’écoulèrent. Je maîtrisai mon trouble et je soulevai un coin de la seconde portière. Mon Dieu ! c’était ce grand et lugubre salon où je craignais tant d’entrer autrefois ; il était éclairé aujourd’hui par des milliers de lumières. Il me semblait que je baignais dans une mer de clarté ! Mes yeux habitués à l’obscurité ne pouvaient soutenir tant d’éclat.
Une atmosphère aromatisée et un air chaud me frappaient au visage. Une quantité de personnes marchaient de tous côtés. Tout le monde me paraissait très gai ; les dames portaient de splendides costumes ; je voyais tous les yeux briller de satis faction. J’étais émerveillée. Je croyais avoir déjà vu cela dans un rêve. Je me rappelai en même temps notre grenier à la nuit tombante ; la haute fenêtre d’où l’on apercevait la rue ; tout en bas, avec ses réverbères allumés, puis les fenêtres de la maison aux rideaux rouges, les voitures stationnant devant le perron, les hennissements des équipages, les cris, les ombres passant derrière les vitres et la musique lointaine… Voilà donc où était ce paradis ! Voilà où je voulais venir avec mon pauvre père… Ce n’était pas un rêve… Oui ! C’est bien ainsi que je l’avais vu dans mes songes !… Mon imagination surexcitée par la maladie, était en feu, et dans un transport inexplicable, je me mis à pleurer. Je cherchai des yeux mon père.
– Il doit être ici ! Il est ici !… pensai-je.
Mon cœur à cet espoir battit plus vile. Je sentis la respiration me manquer. Cependant la musique se tait et j’entends dans le salon immense comme un murmure d’admiration.
Je regarde, les yeux grands ouverts tous ces visages qui passent devant moi, mais sans les reconnaître. Alors se produit un mouvement extraordinaire.
Un vieillard grand et maigre monte sur une estrade magnifiquement ornée.
Son visage pâle est souriant. Il salue gauchement de tous les côtés. Il a un violon à la main. Le silence se fait aussitôt profond, religieux, et chacun même semble retenir son souffle.
Tous les regards sont fixés sur le grand vieillard.
Tout à coup les cordes frémissent et vibrent sous l’archet.
Une angoisse terrible s’empare de moi. J’écoute de toutes les forces de mon âme. Il me semble qu’une fois déjà j’ai entendu les sons qui frappent mon oreille. La voix de l’instrument s’élargit, se multiplie, monte, se confond en gémissements désespérés.
On dirait qu’elle supplie cette foule, qu’elle me parle, à moi… Mes souvenirs se réveillent poignants et douloureux. Je serre les dents pour ne point crier, je me retiens aux rideaux pour ne pas tomber. Je revois cette nuit où mon père… Il a joué ce même air, plus de doute. Il n’est pas mort, c’est lui qui est là, c’est son violon dont la voix vient de fendre mon âme…
– Père ! Père !… Ce fut un éclair dans ma tête… Il est ici ! C’est lui ! Il m’appelle ! C’est son violon !…
Des applaudissements bruyants éclatèrent dans la salle ; en même temps un sanglot aigu s’échappa de ma poitrine. Je n’y tiens plus… Je soulève la portière et je me précipite dans le salon.
– Papa ! Papa ! c’est toi ! Où es-tu ? m’écriai-je. Je ne sais comment j’arrivai jusqu’au grand vieillard. Tout le monde s’était écarté, pour me laisser passer. Je me jetai sur lui avec un cri frénétique. Je croyais avoir retrouvé mon père !… Tout à coup je me sentis enlevée par des mains longues et maigres. Des yeux noirs me fixaient ; leur flamme paraissait vouloir me brûler. Je regardai le vieillard.
– Non ! Ce n’était pas mon père, c’était son assassin !…
Quelle fatalité avait voulu me faire rencontrer. Schurmann dans cette maison même où l’on m’avait recueillie après la mort épouvantable des miens ?
Étais-je poursuivie par le destin, moi pauvre enfant qui ne demandais qu’à vivre et que le malheur avait déjà si cruellement éprouvée ? Déjà j’avais tant souffert et j’avais connu si peu de joies que je pouvais bien le croire.
Mon père, pauvre musicien sans chance et sans fortune n’avait pu me donner aucune de ces choses qui font trouver la vie belle, mais du moins il m’avait aimée.
Toute ma première enfance avait d’ailleurs été désolée. Vainement je chercherais à me souvenir d’un seul jour de bonheur. De cette existence bornée par les murs d’une chambre basse il m’est resté dans l’âme une tristesse décevante.
Je me rappelle de notre chambre, la veilleuse brûlante dans un coin sombre devant les icônes, le lit où je couchais avec ma mère, le froid de la nuit et mes cauchemars d’enfant. Je revois la petite fenêtre haute, qui devait nous donner du soleil et devant laquelle le ciel sombre, coupé par les lignes monotones des toits, se déroulait à l’infini.
Notre mobilier comprenait un vieux canapé recouvert d’une toile cirée crevée et grasse, d’une table de bois commun, de deux chaises de paille, et encore d’une commode boiteuse, du lit de ma mère et d’un paravent déchiré.
Quel contraste avec les splendeurs du palais que j’habitais aujourd’hui ! Je me souviens de l’aspect de notre taudis le soir à la nuit tombante. Il y avait à terre des chiffons, des bouteilles cassées, de la vaisselle de bois. Et, au milieu de tout cela, mon père ivre et ma mère pleurante.
C’était une nature étrange que celle de mon père, du moins de celui qui m’a servi de père, car je n’ai pas connu le mien et mon beau-père avait épousé ma mère lorsque j’étais âgée déjà de trois ans.
Il était né musicien, fut violoniste de grand talent, mais la misère et l’alcool l’avaient peu à peu fait descendre cette pente fatale qui aboutit à la folie.
C’était l’ambition et la conscience de sa valeur artistique qui l’avaient fait venir à Pétersbourg. Là, il n’avait pu renoncer à ses habitudes d’ivrognerie, s’était senti baisser et n’avait pu survivre à la ruine de son talent.