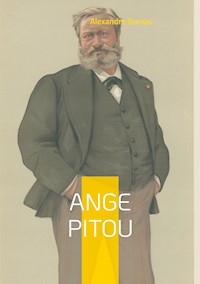
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Le lendemain se leva ; brillant et pur comme la veille, un soleil éblouissant dorait les marbres et le sable de Versailles. Les oiseaux groupés par milliers sur les premiers arbres du parc saluaient de leurs cris assourdissants le nouveau jour de chaleur et de gaieté promis à leurs amours. La reine était levée à cinq heures. Elle fit prier le roi de passer chez elle aussitôt qu'on l'aurait réveillé. Louis XVI, un peu fatigué par la réception d'une députation de l'Assemblée qui était venue la veille, et à laquelle il avait été forcé de répondre R c'était le commencement des discours R, Louis XVI avait dormi un peu plus tard pour réparer sa fatigue et pour qu'il ne fût pas dit qu'en lui la nature perdrait quelque chose. Aussi, à peine l'eut-on habillé, que la prière de la reine lui parvint comme il passait l'épée ; il fronça légèrement le sourcil.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 435
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Sommaire
Chapitre XXXV
Chapitre XXXVI
Chapitre XXXVII
Chapitre XXXVIII
Chapitre XXXIX
Chapitre XL
Chapitre XLI
Chapitre XLII
Chapitre XLIII
Chapitre XLIV
Chapitre XLV
Chapitre XLVI
Chapitre XLVII
Chapitre XLVIII
Chapitre XLIX
Chapitre L
Chapitre LI
Chapitre LII
Chapitre LIII
Chapitre LIV
Chapitre LV
Chapitre LVI
Chapitre LVII
Chapitre LVIII
Chapitre LIX
Chapitre LX
Chapitre LXI
Chapitre LXII
Chapitre LXIII
Chapitre LXIV
Chapitre LXV
Chapitre LXVI
Chapitre LXVII
Chapitre LXVIII
Chapitre LXIX
Chapitre LXX
Chapitre XXXV
Le plastron
Le lendemain se leva ; brillant et pur comme la veille, un soleil éblouissant dorait les marbres et le sable de Versailles.
Les oiseaux groupés par milliers sur les premiers arbres du parc saluaient de leurs cris assourdissants le nouveau jour de chaleur et de gaieté promis à leurs amours.
La reine était levée à cinq heures. Elle fit prier le roi de passer chez elle aussitôt qu’on l’aurait réveillé.
Louis XVI, un peu fatigué par la réception d’une députation de l’Assemblée qui était venue la veille, et à laquelle il avait été forcé de répondre – c’était le commencement des discours –, Louis XVI avait dormi un peu plus tard pour réparer sa fatigue et pour qu’il ne fût pas dit qu’en lui la nature perdrait quelque chose.
Aussi, à peine l’eut-on habillé, que la prière de la reine lui parvint comme il passait l’épée ; il fronça légèrement le sourcil.
– Quoi ! dit-il, la reine est déjà levée ?
– Oh ! depuis longtemps, Sire.
– Est-elle malade encore ?
– Non, Sire.
– Et que me veut la reine de si bon matin ?
– Sa Majesté ne l’a pas dit.
Le roi prit un premier déjeuner, qui se composait d’un bouillon avec un peu de vin, et passa chez Marie-Antoinette.
Il trouva la reine tout habillée, comme pour la cérémonie. Belle, pâle, imposante, elle accueillit son mari avec ce froid sourire qui brillait comme un soleil d’hiver sur les joues de la reine, alors que, dans les grandes réceptions de la cour, il fallait jeter un rayon à la foule.
Ce regard et ce sourire, le roi n’en comprit pas la tristesse. Il se préoccupait déjà d’une chose, à savoir de la résistance probable qu’allait faire Marie-Antoinette au projet arrêté la veille.
– Encore quelque nouveau caprice, pensait-il.
Voilà pourquoi il fronçait le sourcil.
La reine ne manqua point de fortifier en lui par les premiers mots qu’elle fit entendre, cette opinion.
– Sire, dit-elle, depuis hier, j’ai bien réfléchi.
– Allons, nous y voilà, s’écria le roi.
– Renvoyez, je vous prie, tout ce qui n’est pas de l’intimité.
Le roi, maugréant, donna ordre à ses officiers de s’éloigner.
Une seule des femmes de la reine demeura près de Leurs Majestés : c’était madame Campan.
Alors, la reine, appuyant ses deux belles mains sur le bras du roi :
– Pourquoi êtes-vous déjà tout habillé ? dit-elle ; c’est mal.
– Comment, mal ! Pourquoi ?
– Ne vous avais-je point fait demander de ne vous point habiller avant de passer ici ? Je vous vois la veste et l’épée. J’espérais que vous seriez venu en robe de chambre.
Le roi la regarda tout surpris.
Cette fantaisie de la reine éveillait en lui une foule d’idées étranges, dont la nouveauté même rendait l’invraisemblance encore plus forte.
Son premier mouvement fut la défiance et l’inquiétude.
– Qu’avez-vous ? dit-il à la reine. Prétendez-vous retarder ou empêcher ce dont nous sommes convenus hier ensemble ?
– Nullement, Sire.
– Je vous en prie, n’est-ce pas, plus de raillerie sur un sujet de cette gravité. Je dois, je veux aller à Paris ; je ne puis plus m’en dispenser. Ma maison est commandée ; les personnes qui m’accompagneront sont dès hier soir désignées.
– Sire, je ne prétends rien, mais…
– Songez, dit le roi en s’animant par degrés pour se donner du courage, songez que déjà la nouvelle de mon voyage à Paris a dû parvenir aux Parisiens, qu’ils se sont préparés, qu’ils m’attendent ; que les sentiments très favorables que selon la prédiction de Gilbert ce voyage a jetés dans les esprits, peuvent se changer en une hostilité désastreuse. Songez enfin…
– Mais, Sire, je ne vous conteste pas ce que vous me faites l’honneur de me dire ; je me suis hier résignée, résignée je suis aujourd’hui.
– Alors, madame, pourquoi ces préambules ?
– Je n’en fais pas.
– Pardon ; pourquoi ces questions sur mon habillement, sur mes projets ?
– Sur l’habillement, à la bonne heure, reprit la reine, en essayant encore de ce sourire qui, à force de s’évanouir, devenait de plus en plus funèbre.
– Que voulez-vous de mon habillement ?
– Je voudrais, Sire, que vous quittassiez votre habit.
– Ne vous paraît-il pas séant ? C’est un habit de soie d’une couleur violette. Les Parisiens sont accoutumés à me voir ainsi vêtu ; ils aimaient chez moi cette couleur, sur laquelle, d’ailleurs, un cordon bleu fait bien. Vous me l’avez dit vous-même assez souvent.
– Je n’ai, Sire, aucune objection à faire contre la nuance de votre habit.
– Alors ?
– C’est contre la doublure.
– Vraiment, vous m’intriguez avec cet éternel sourire… la doublure… quelle plaisanterie !…
– Je ne plaisante plus, hélas !
– Bon, voilà que vous palpez ma veste, à présent ; vous déplaît-elle aussi ? Taffetas blanc et argent, garniture que vous m’avez brodée vous-même, une de mes vestes favorites.
– Je n’ai rien non plus contre la veste.
– Que vous êtes singulière ! c’est le jabot, c’est la chemise de batiste brodée qui vous offusquent ? Eh ! ne dois-je pas faire toilette pour aller voir ma bonne ville de Paris ?
Un amer sourire plissa les lèvres de la reine ; sa lèvre inférieure surtout, celle qu’on lui reprochait tant, à l’Autrichienne, s’épaissit et s’avança comme si elle se fût gonflée de tous les poisons de la colère et de la haine.
– Non, dit-elle, je ne vous reproche pas votre belle toilette, Sire, c’est toujours la doublure, toujours, toujours.
– La doublure… de ma chemise brodée ! ah ! expliquez-vous, enfin.
– Eh bien ! je m’explique ; le roi, haï, gênant, qui va se jeter au milieu de sept cent mille Parisiens ivres de leurs triomphes et de leurs idées révolutionnaires, le roi n’est pas un prince du moyen âge, et cependant il devrait faire au-jourd’hui son entrée à Paris dans une bonne cuirasse de fer, sous un armet de bon acier de Milan ; il devrait s’y prendre de façon, ce prince, que pas une balle, pas une flèche, pas une pierre, pas un couteau ne pût trouver le chemin de sa chair.
– C’est vrai, au fond, dit Louis XVI pensif ; mais ma bonne amie, comme je ne m’appelle ni Charles VIII, ni François Ier, ni même Henri IV, comme la monarchie d’aujourd’hui est nue sous le velours et la soie, j’irai nu sous mon habit de soie, et pour mieux dire… j’irai avec un point de mire qui pourra guider les balles. J’ai la plaque des ordres sur le cœur.
La reine poussa un gémissement étouffé.
– Sire, dit-elle, nous commençons à nous entendre. Vous allez voir, vous allez voir que votre femme ne plaisante plus.
Elle fit un signe à madame Campan, qui était restée au fond de la chambre, et celle-ci prit dans un tiroir du chiffonnier de la reine un objet de forme large, plate et oblongue, caché dans une enveloppe de soie.
– Sire, dit la reine, le cœur du roi appartient d’abord à la France, c’est vrai, mais je crois beaucoup qu’il appartient à sa femme et à ses enfants. Pour ma part, je ne veux pas que ce cœur soit exposé aux balles ennemies. J’ai pris mes mesures pour sauver de tout péril mon époux, mon roi, le père de mes enfants.
En même temps elle développait du linge de soie qui l’enfermait un gilet de fines mailles d’acier croisées avec un art si merveilleux qu’on eût dit une étoffe arabe, tant le point de la trame imitait la moire, tant il y avait de souplesse et d’élasticité dans les tissus et le jeu des surfaces.
– Qu’est cela ? dit le roi.
– Regardez, Sire.
– Un gilet, ce me semble.
– Mais oui, Sire.
– Un gilet qui ferme jusqu’au col.
– Avec un petit collet destiné, comme vous le voyez, à doubler le col de la veste ou de la cravate.
Le roi prit le gilet dans ses mains et l’examina curieusement.
La reine, voyant cette bienveillante attention, était pénétrée de joie.
Le roi, lui, semblait compter avec bonheur chacune des mailles de ce réseau merveilleux qui ondulait sous ses doigts avec la malléabilité d’un tricot de laine.
– Mais, dit-il, c’est là de l’admirable acier.
– N’est-ce pas, Sire ?
– Et un travail miraculeux.
– N’est-ce pas ?
– Je ne sais vraiment pas où vous avez pu vous procurer cela.
– Je l’ai acheté hier soir d’un homme qui depuis longtemps me l’avait offert pour le cas où vous iriez en campagne.
– C’est admirable ! admirable ! dit le roi, examinant en artiste.
– Et cela doit aller comme un gilet de votre tailleur, Sire.
– Oh ! croyez-vous ?
– Essayez.
Le roi ne dit mot ; il défit lui-même son habit violet.
La reine tremblait de joie ; elle aida Louis XVI à déposer les ordres, et madame Campan le reste.
Cependant le roi ôtait lui-même son épée. Quiconque à ce moment eût contemplé la figure de la reine l’eût vue illuminée d’une de ces triomphales clartés que reflète la félicité suprême.
Le roi se laissa dépouiller de sa cravate sous laquelle les mains délicates de la reine glissèrent le col d’acier.
Puis Marie-Antoinette elle-même attacha les agrafes de ce corselet qui prenait admirablement la forme du corps, couvrait les entournures, doublé partout d’une fine buffleterie destinée à amortir la pression de l’acier sur les chairs.
Ce gilet descendait plus bas qu’une cuirasse, il défendait tout le corps.
Placées par-dessus, la veste et la chemise le couvraient complètement. Il n’augmentait pas d’une demi-ligne l’épaisseur du corps. Il permettait les gestes sans amener aucune gêne.
– Est-ce bien pesant ? dit la reine.
– Non.
– Voyez donc, mon roi, quelle merveille, n’est-ce pas ? dit la reine, en battant des mains, à madame Campan qui achevait de fermer les boutons des manches du roi.
Madame Campan manifesta sa joie tout aussi naïvement que la reine.
– J’ai sauvé mon roi ! s’écria Marie-Antoinette. Cette cuirasse invisible, essayez-la, placez-la sur une table, essayez de l’entamer avec un couteau, essayez de la trouer avec une balle, essayez ! essayez !
– Oh ! fit le roi d’un air de doute.
– Essayez ! répéta-t-elle dans son enthousiasme.
– Je le ferais volontiers par curiosité, dit le roi.
– Ne le faites pas, c’est inutile, Sire.
– Comment, il est inutile que je vous prouve l’excellence de votre merveille !
– Ah ! que voilà les hommes ! Croyez-vous que j’eusse ajouté foi aux témoignages d’un autre, d’un indifférent lors-qu’il s’agissait de la vie de mon époux, du salut de la France ?
– Il me semble pourtant que c’est là ce que vous avez fait, Antoinette, vous avez ajouté foi…
Elle secoua la tête avec une obstination charmante.
– Demandez, fit-elle en désignant la femme qui était là, demandez à cette bonne Campan ce qu’elle et moi nous avons fait ce matin.
– Quoi donc, mon Dieu ? demanda le roi tout intrigué.
– Ce matin, que dis-je, cette nuit, comme deux folles, nous avons éloigné tout le service, et nous nous sommes enfermées dans sa chambre, à elle, qui est reculée au fond du dernier corps de logis des pages ; or, les pages sont partis hier soir pour les logements à Rambouillet. Nous nous sommes assurées que personne ne pouvait nous surprendre avant que nous eussions effectué notre projet.
– Mon Dieu ! mais vous m’effrayez véritablement. Quels desseins avaient donc ces deux Judith ?
– Judith fit moins, dit la reine ; moins de bruit, surtout. Sauf cela, la comparaison serait merveilleuse. Campan tenait le sac qui renfermait ce plastron ; moi, je portais un long couteau de chasse allemand de mon père, cette lame infaillible qui tua tant de sangliers.
– Judith ! toujours Judith ! s’écria le roi en riant.
– Oh ! Judith n’avait pas ce lourd pistolet que j’ai pris à vos armes et que j’ai fait charger par Weber.
– Un pistolet !
– Sans doute. Il fallait nous voir dans la nuit, peureuses, troublées au moindre bruit, nous dérobant aux indiscrets, filant comme deux souris gourmandes par les corridors déserts. Campan ferma trois portes, matelassa la dernière ; nous accrochâmes le plastron au mur sur le mannequin qui sert à étendre mes robes ; et moi, d’une main solide, je vous jure, j’appliquai un coup de couteau à la cuirasse ; la lame plia, bondit hors de mes mains, et alla se ficher dans le parquet, à notre grande épouvante.
– Peste ! fit le roi.
– Attendez.
– Pas de trou ? demanda Louis XVI.
– Attendez, vous dis-je. Campan ramassa la lame, et me dit : « Vous n’êtes pas assez forte, madame, et votre main tremblait peut-être ; moi, je serai plus robuste, vous allez voir. » Elle saisit donc le couteau et en bourra au mannequin fixé sur le mur un coup tellement bien appliqué, que ma pauvre lame allemande se brisa net sur les mailles. Tenez, voici les deux morceaux, Sire ; je veux vous faire faire un poignard avec ce qui reste.
– Oh ! mais c’est fabuleux, cela, dit le roi ; et pas de brèche ?
– À peu près une égratignure au chaînon supérieur, et il y en a trois l’un sur l’autre, s’il vous plaît.
– Je voudrais voir.
– Vous verrez.
Et la reine se mit à déshabiller le roi avec une prestesse merveilleuse, pour lui faire admirer son idée et ses hauts faits.
– Voici une place un peu gâtée, ce me semble, dit le roi en montrant du doigt une légère dépression produite sur une surface d’environ un pouce.
– C’est la balle du pistolet, Sire.
– Comment, vous avez tiré un coup de pistolet à balles, vous ?
– Je vous montre la balle aplatie, noire encore. Tenez, croyez-vous maintenant que votre existence soit en sûreté ?
– Vous êtes un ange tutélaire, dit le roi qui se mit à dégrafer lentement le gilet pour mieux observer la trace du coup de couteau et la trace de la balle.
– Jugez de ma frayeur, cher roi, dit Marie-Antoinette, quand il me fallut lâcher le coup de pistolet sur la cuirasse. Hélas ! ce n’était rien encore que de faire cet affreux bruit dont j’ai tant de peur ; mais c’est qu’il me semblait, en tirant sur le gilet destiné à vous protéger, que je tirais sur vous-même ; c’est que j’avais crainte de voir un trou dans les mailles, et alors mon travail, mes peines, mon espoir étaient à jamais ruinés.
– Chère femme, dit Louis XVI en dégrafant complètement le gilet, que de reconnaissance !
Et il déposa le plastron sur une table.
– Eh bien ! que faites-vous donc ? demanda la reine.
Et elle prit le gilet qu’elle présenta une seconde fois au roi.
Mais lui, avec un sourire plein de grâce et de noblesse :
– Non, dit-il, merci.
– Vous refusez ? s’écria la reine.
– Je refuse.
– Oh ! mais, songez-y donc, Sire.
– Sire !… supplia madame Campan.
– Mais c’est le salut, mais c’est la vie !
– C’est possible, dit le roi.
– Vous refusez le secours que Dieu lui-même nous envoie.
– Assez ! assez ! dit le roi.
– Oh ! vous refusez ! vous refusez !
– Oui, je refuse.
– Mais ils vous tueront !
– Ma chère, quand les gentilshommes sont en campagne, au XVIIIème siècle, ils y sont en habit de drap, veste et chemise, c’est pour les balles ; quand ils vont sur le terrain d’honneur, ils ne gardent que la chemise, c’est assez pour l’épée. Moi, je suis le premier gentilhomme de France, je ne ferai ni plus ni moins que mes amis. Il y a plus : là où ils prennent du drap, j’ai seul le droit de porter de la soie. Merci, ma chère femme, merci, ma bonne reine, merci.
– Ah ! s’écria la reine, à la fois désespérée et ravie ; pourquoi son armée ne l’entend-elle pas ?
Quant au roi, il avait achevé de s’habiller tranquillement, sans même paraître comprendre l’acte d’héroïsme qu’il venait d’accomplir.
– Est-ce donc une monarchie perdue, murmura la reine, que celle qui trouve de l’orgueil en de pareils moments ?
Chapitre XXXVI
Le départ
En sortant de chez la reine, le roi se trouva immédiatement entouré de tous les officiers et de toutes les personnes de sa maison désignées par lui pour faire avec lui le voyage de Paris.
C’étaient MM. de Beauvau, de Villeroy, de Nesle et d’Estaing.
Gilbert attendit, confondu au milieu de la foule, que Louis XVI l’aperçût, ne fût-ce que pour lui jeter en passant un regard.
Il était visible que tout ce monde-là était dans le doute, et qu’on ne pouvait croire à la persistance de cette décision.
– Après déjeuner, messieurs, dit le roi, nous partons.
Puis, apercevant Gilbert :
– Ah ! vous voilà, docteur, continua-t-il ; très bien. Vous savez que je vous emmène.
– À vos ordres, Sire.
Le roi passa dans son cabinet, où il travailla deux heures.
Il entendit ensuite la messe avec toute sa maison, puis, vers neuf heures, il se mit à table.
Le repas se fit avec le cérémonial accoutumé ; seulement, la reine, que l’on voyait depuis la messe avec des yeux gonflés et rouges, voulut, sans y prendre part le moins du monde, assister au repas du roi, afin de demeurer plus longtemps devant lui.
La reine avait amené ses deux enfants, qui, tous deux émus déjà sans doute par les conseils maternels, promenaient leurs yeux inquiets du visage de leur père à la foule des officiers et des gardes.
Les enfants, de temps en temps, essuyaient, en outre, sur l’ordre de leur mère, une larme qui venait poindre à leurs cils, et ce spectacle animait de pitié les uns, de colère les autres, de douleur toute l’assemblée.
Le roi mangea stoïquement. Il parla plusieurs fois à Gilbert sans le regarder ; il parla presque constamment à la reine, et toujours avec une affection profonde.
Enfin il donna des instructions à ses capitaines.
Il achevait son repas lorsqu’on lui vint annoncer qu’une colonne épaisse d’hommes à pied, venant de Paris, apparaissait à l’extrémité de la grande allée qui aboutit à la place d’Armes.
À l’instant même, officiers et gardes s’élancèrent hors de la salle ; le roi leva la tête, regarda Gilbert, mais voyant que Gilbert souriait, il se remit tranquillement à manger.
La reine pâlit, se pencha vers M. de Beauvau pour le prier de s’informer.
M. de Beauvau courut précipitamment dehors.
La reine s’avança vers la fenêtre.
Cinq minutes après, M. de Beauvau rentra.
– Sire, dit-il en rentrant, ce sont les gardes nationaux de Paris qui, sur le bruit qui s’est répandu hier dans la capitale du dessein qu’aurait Votre Majesté d’aller voir les Parisiens, se sont réunis au nombre d’une dizaine de mille pour venir au-devant de vous ; et, tout en venant au-devant de vous, voyant que vous tardiez, ont poussé jusqu’à Versailles.
– Quelles intentions paraissent-ils avoir ? demanda le roi.
– Les meilleures du monde, répondit M. de Beauvau.
– N’importe ! dit la reine, fermez les grilles.
– Gardez-vous-en bien, dit le roi ; c’est bien assez que les portes du palais restent fermées.
La reine fronça le sourcil et lança un coup d’œil à Gilbert.
Celui-ci attendait ce regard de la reine, car la moitié de sa prédiction était réalisée déjà. Il avait promis l’arrivée de vingt mille hommes ; il y en avait déjà dix mille.
Le roi se retourna vers M. de Beauvau.
– Veillez à ce que l’on donne des rafraîchissements à ces braves gens, dit-il.
M. de Beauvau descendit une seconde fois et transmit aux sommeliers les ordres du roi.
Puis il remonta.
– Eh bien ? demanda le roi.
– Eh bien ! Sire, nos Parisiens sont en grande discussion avec MM. les gardes.
– Comment ! fit le roi, il y a discussion ?
– Oh ! de pure courtoisie. Comme ils ont appris que le roi part dans deux heures, ils veulent attendre le départ du roi et marcher derrière le carrosse de Sa Majesté.
– Mais, demanda à son tour la reine, ils sont à pied, je suppose ?
– Oui, madame.
– Eh bien ! mais le roi a des chevaux à sa voiture, et le roi va vite, très vite. Vous savez, monsieur de Beauvau, que le roi a l’habitude d’aller très vite.
Ces mots ainsi accentués signifiaient : « Attachez des ailes à la voiture de Sa Majesté. »
Le roi fit de la main signe d’arrêter le colloque.
– J’irai au pas, dit-il.
La reine poussa un soupir qui ressemblait presque à un cri de colère.
– Il n’est pas juste, ajouta tranquillement Louis XVI, que je fasse courir ces braves gens qui se sont dérangés pour me faire honneur. J’irai au pas, et même au petit pas, afin que tout le monde puisse me suivre.
L’assemblée témoigna son admiration par un murmure approbatif ; mais en même temps on vit sur plusieurs visages le reflet de cette improbation qui éclatait manifestement dans les traits de la reine pour tant de bonté d’âme qu’elle traitait de faiblesse.
Une fenêtre s’ouvrit.
La reine se retourna, étonnée : c’était Gilbert, qui, en sa qualité de médecin, usait de son droit de faire ouvrir pour renouveler l’air de la salle à manger épaissi par l’odeur des mets et la respiration de plus de cent personnes.
Le docteur se plaça derrière les rideaux de cette fenêtre ouverte, et, par la fenêtre ouverte, montèrent les voix de la foule assemblée dans les cours.
– Qu’est-ce que cela ? demanda le roi.
– Sire, répondit Gilbert, ce sont les gardes nationaux qui sont sur le pavé, au grand soleil, et qui doivent avoir bien chaud.
– Pourquoi ne pas les inviter à venir déjeuner avec le roi ? dit tout bas à la reine un de ses officiers favoris.
– Il faudrait les conduire à l’ombre, les mettre dans la cour de marbre, sous les vestibules, partout où il y aura un peu de fraîcheur, dit le roi.
– Dix mille hommes dans les vestibules ! s’écria la reine.
– Répartis partout, ils tiendront, dit le roi.
– Répartis partout ! dit Marie-Antoinette ; mais, monsieur, vous allez leur apprendre le chemin de votre chambre à coucher.
Prophétie de l’effroi, qui devait se réaliser à Versailles même, avant qu’il fût trois mois.
– Ils ont beaucoup d’enfants avec eux, madame, dit doucement Gilbert.
– Des enfants ? fit la reine.
Oui, madame, un grand nombre ont amené leurs enfants comme pour une promenade. Les enfants sont habillés en petits gardes nationaux, tant l’enthousiasme est grand pour la nouvelle institution.
La reine ouvrit la bouche, mais presque aussitôt elle baissa la tête.
Elle avait eu envie de dire une bonne parole, l’orgueil et la haine l’avaient arrêtée.
Gilbert la regarda attentivement.
– Eh ! s’écria le roi, ces pauvres enfants ! Quand on emmène des enfants avec soi, c’est qu’on n’a pas envie de mal faire à un père de famille ; raison de plus pour les mettre à l’ombre, ces pauvres petits. Faites entrer, faites entrer.
Gilbert, secouant alors doucement la tête, parut dire à la reine, qui avait gardé le silence :
– Voilà, madame, voilà ce que vous auriez du dire, je vous en fournissais l’occasion. Le mot eût été répété, et vous y gagniez deux ans de popularité.
La reine comprit ce langage muet de Gilbert, et la rougeur lui monta au front.
Elle sentit sa faute et s’excusa aussitôt par un sentiment d’orgueil et de résistance qu’elle renvoya comme réponse à Gilbert. Pendant ce temps-là, M. de Beauvau s’acquittait auprès des gardes nationaux de la commission du roi.
Alors on entendit des cris de joie, et les bénédictions de cette foule armée admise, d’après les ordres du roi, dans l’intérieur du palais.
Les acclamations, les vœux, les vivats montèrent en tourbillons épais jusqu’aux deux époux, qu’ils rassurèrent sur les dispositions de ce Paris tant redouté.
– Sire, dit M. de Beauvau, quel ordre Votre Majesté fixe-t-elle à son cortège ?
– Et cette discussion de la garde nationale avec mes officiers ? demanda le roi.
– Oh ! Sire, évaporée, évanouie, les braves gens sont tellement heureux, qu’ils disent maintenant : « Nous irons où l’on nous mettra. Le roi est à nous aussi bien qu’aux autres ; partout où il ira, il sera à nous. »
Le roi regarda Marie-Antoinette crispée par un sourire ironique, sa lèvre dédaigneuse.
– Dites aux gardes nationaux, dit Louis XVI, qu’ils se mettent où ils voudront.
– Votre Majesté, dit la reine, n’oubliera pas que c’est un droit inaliénable de ses gardes du corps d’entourer le carrosse.
Les officiers, voyant le roi un peu incertain, s’approchèrent pour appuyer la reine.
– C’est juste, au fond, dit le roi. Eh bien ! on verra.
M. de Beauvau et M. de Villeroy partirent pour prendre leurs rangs et donner les ordres.
Dix heures sonnaient à Versailles.
– Allons, dit le roi, je travaillerai demain. Ces braves gens ne doivent pas attendre.
Le roi se leva.
Marie-Antoinette ouvrit les bras et vint embrasser le roi. Les enfants se pendirent en pleurant au cou de leur père ; Louis XVI, attendri, s’efforça de se soustraire doucement à leurs étreintes : il voulait cacher l’émotion qui n’aurait pas tardé à déborder.
La reine arrêtait tous les officiers, saisissait celui-ci par le bras, celui-là par son épée.
– Messieurs ! messieurs ! disait-elle.
Et cette éloquente exclamation leur recommandait le roi qui venait de descendre.
Tous mirent la main à leur cœur et à leur épée.
La reine sourit pour remercier.
Gilbert demeurait parmi les derniers.
– Monsieur, lui dit la reine, c’est vous qui avez conseillé ce départ au roi ; c’est vous qui avez décidé le roi, malgré mes supplications. Songez, monsieur, que vous avez pris une effrayante responsabilité devant l’épouse et devant la mère !
– Je le sais, madame, répondit froidement Gilbert.
– Et vous me ramènerez le roi sain et sauf, monsieur ! dit la reine avec un geste solennel.
– Oui, madame.
– Songez que vous me répondez de lui sur votre tête !
Gilbert s’inclina.
– Songez-y, sur votre tête ! répéta Marie-Antoinette avec la menace et l’impitoyable autorité d’une reine absolue.
– Sur ma tête, dit le docteur en s’inclinant, oui, madame, et ce gage, je le regarderais comme un otage de peu de valeur si je croyais le roi menacé ; mais je l’ai dit, madame, c’est au triomphe que je conduis aujourd’hui Sa Majesté.
– Je veux des nouvelles toutes les heures, ajouta la reine.
– Vous en aurez, madame, je vous jure.
– Partez maintenant, monsieur, j’entends les tambours ; le roi va se mettre en route.
Gilbert s’inclina, et disparaissant par le grand escalier, se trouva en face d’un aide de camp de la maison du roi qui le cherchait de la part de Sa Majesté.
On le fit monter dans un carrosse qui appartenait à M. de Beauvau, le grand-maître des cérémonies n’ayant pas voulu qu’il se plaçât, n’ayant pas fait ses preuves, dans un des carrosses du roi.
Gilbert sourit en se voyant seul dans ce carrosse armorié, M. de Beauvau étant à cheval et caracolant près de la portière royale.
Puis, il lui vint à l’idée qu’il était ridicule à lui d’occuper ainsi une voiture ayant couronne et blason.
Ce scrupule lui durait encore, quand au milieu de la foule des gardes nationaux qui serrait les carrosses, il entendit ces mots chuchotés par des gens qui se penchaient curieusement pour le regarder :
– Ah ! celui-là, c’est le prince de Beauvau !
– Eh ! dit un camarade, tu te trompes.
– Mais si, puisque le carrosse est aux armes du prince.
– Aux armes… aux armes… Je te dis que cela n’y fait rien. Pardieu ! les armes, qu’est-ce que cela prouve ?
– Cela prouve que si les armes de M. de Beauvau sont sur la voiture, c’est M. de Beauvau qui doit être dedans.
– M. de Beauvau, est-ce un patriote ? demanda une femme.
– Heuh ! fit le garde national.
Gilbert sourit encore.
– Mais je te dis, répliqua le premier contradicteur, que ce n’est pas le prince ; le prince est gras, celui-là est maigre ; le prince a un habit de commandant des gardes ; celui-là est en habit noir c’est l’intendant.
Un murmure désobligeant accueillit la personne de Gilbert défiguré par ce titre peu flatteur.
– Eh non ! mort diable ! cria une grosse voix au son de laquelle tressaillit Gilbert, la voix d’un homme qui, avec ses coudes et ses poings, se fit passage vers la voiture ; non, ce n’est ni M. de Beauvau, ni son intendant, c’est ce brave et fameux patriote et même le plus fameux des patriotes. Eh ! monsieur Gilbert, que diable faites-vous dans le carrosse d’un prince ?
– Tiens, c’est vous, père Billot, s’écria le docteur. Vous ici !
– Pardieu ! je me suis bien gardé de manquer l’occasion, répondit le fermier.
– Et Pitou ? demanda Gilbert.
– Oh ! il n’est pas loin. Holà ! Pitou, avance ici ; voyons, passe.
Et Pitou, sur cette invitation, se glissa, par un rude jeu des épaules, jusqu’auprès de Billot, et vint saluer avec admiration Gilbert.
– Bonjour, monsieur Gilbert, dit-il.
– Bonjour, Pitou ; bonjour, mon ami.
– Gilbert ! Gilbert ! qui est cela ? demanda la foule.
– Ce que c’est que la gloire ! pensait le docteur. Bien connu à Villers-Cotterêts, oui, mais à Paris, vive la popularité !
Il descendit du carrosse, qui se remit à aller au pas, et, s’appuyant sur le bras de Billot, il continua la route à pied au milieu de la foule.
Il raconta alors en peu de mots au fermier sa visite à Versailles, les bonnes dispositions du roi et de la famille royale. Il fit en quelques minutes une telle propagande de royalisme dans ce groupe, que, naïfs et charmés, ces braves gens, encore faciles aux bonnes impressions, poussèrent un long cri de « Vive le roi ! » qui s’en alla, grossi par les files précédentes, assourdir Louis XVI en son carrosse.
– Je veux voir le roi, dit Billot électrisé, il faut que je le voie de près. J’ai fait le chemin pour cela. Je le veux juger par son visage. Un œil d’honnête homme, cela se devine. Approchons, approchons, monsieur Gilbert, voulez-vous ?
– Attendez, cela va nous être aisé, dit Gilbert, car je vois un aide de camp de M. de Beauvau qui cherche quelqu’un de ce côté.
En effet, un cavalier, manœuvrant avec toutes sortes de précautions parmi ces groupes de marcheurs fatigués mais joyeux, cherchait à gagner la portière du carrosse qu’avait quitté Gilbert.
Gilbert l’appela.
– N’est-ce pas le docteur Gilbert que vous cherchez, monsieur ? demanda-t-il.
– Lui-même, répondit l’aide de camp.
– En ce cas, c’est moi.
– Bon ! M. de Beauvau vous fait appeler de la part du roi.
Ces mots retentissants firent ouvrir les yeux à Billot, et les rangs à la foule ; Gilbert s’y glissa, suivi de Billot et de Pitou, à la suite du cavalier qui répétait :
– Ouvrez-vous, messieurs, ouvrez-vous ; passage, au nom du roi ! messieurs, passage.
Gilbert arriva bientôt à la portière du carrosse royal, qui marchait au pas des bœufs de l’époque mérovingienne.
Chapitre XXXVII
Le voyage
Ainsi poussant, ainsi poussés, mais suivant toujours l’aide de camp de M. de Beauvau, Gilbert, Billot et Pitou arrivèrent enfin près du carrosse dans lequel le roi, accompagné de MM. d’Estaing et de Villequier, s’avançait lentement au milieu d’une foule croissante.
Spectacle curieux, inouï, inconnu, car il se produisait pour la première fois. Tous ces gardes nationaux de la campagne, soldats improvisés, accouraient avec des cris de joie sur le passage du roi, le saluant de leurs bénédictions, essayant de se faire voir, et, au lieu de s’en retourner chez eux, prenaient rang dans le cortège et accompagnaient la marche du roi.
Pourquoi ? nul n’aurait pu le dire. Obéissait-on à l’instinct ? On avait vu, on voulait revoir encore ce roi bien-aimé.
Car, il faut le dire, à cette époque, Louis XVI était un roi adoré, à qui les Français eussent élevé des autels, sans ce profond mépris que M. de Voltaire avait inspiré aux Français pour les autels.
Louis XVI n’en eut donc pas, mais uniquement parce que les esprits forts l’estimaient trop à cette époque pour lui infliger cette humiliation.
Louis XVI aperçut Gilbert appuyé au bras de Billot ; derrière eux marchait Pitou, traînant toujours son grand sabre.
– Ah ! docteur, le beau temps et le beau peuple !
– Vous voyez, Sire, répliqua Gilbert.
Puis se penchant vers le roi :
– Qu’avais-je promis à Votre Majesté !
– Oui, monsieur, oui, et vous avez tenu dignement votre parole.
Le roi releva la tête, et, avec l’intention d’être entendu :
– Nous marchons bien lentement, dit-il, mais il me semble que nous marchons encore trop vite pour tout ce qu’il y a aujourd’hui à voir.
– Sire, dit M. de Beauvau, vous faites cependant, au pas que Votre Majesté marche, une lieue en trois heures. Il est difficile d’aller plus lentement.
En effet, les chevaux s’arrêtaient à chaque instant ; des échanges de harangues et de répliques avaient lieu ; les gardes nationales fraternisaient – on venait de trouver le mot – avec les gardes du corps de Sa Majesté.
– Ah ! se disait Gilbert, qui contemplait en philosophe ce curieux spectacle, si l’on fraternise avec les gardes du corps, c’est donc qu’avant d’être des amis, ils étaient des ennemis ?
– Dites donc, monsieur Gilbert, dit Billot à demi voix, je l’ai joliment regardé le roi, je l’ai joliment écouté. Eh bien ! mon avis est que le roi est un brave homme.
Et l’enthousiasme qui amenait Billot fit qu’il accentua ces derniers mots de telle façon que le roi et l’état-major les entendirent.
L’état-major se mit à rire.
Le roi sourit ; puis, avec un mouvement de tête :
– Voilà un éloge qui me plaît, dit-il.
Ces mots furent prononcés assez haut pour que Billot les entendît.
– Oh ! vous avez raison, Sire, car je ne le donne pas à tout le monde, répliqua Billot, entrant de plain-pied dans la conversation avec son roi, comme Michaud avec Henri IV.
– Ce qui me flatte d’autant plus, dit le roi fort embarrassé et ne sachant comment faire pour garder la dignité de roi en parlant gracieusement comme bon patriote.
Hélas ! le pauvre prince, il n’était pas encore accoutumé à s’appeler le roi des Français.
Il croyait s’appeler encore le roi de France.
Billot, transporté d’aise, ne se donna pas la peine de réfléchir si Louis, au point de vue philosophique, venait d’abdiquer le titre de roi pour prendre le titre d’homme, Billot, qui sentait combien ce langage se rapprochait de la bonhomie rustique, Billot s’applaudissait de comprendre un roi et d’en être compris.
Aussi, à partir de ce moment, Billot ne cessa pas de s’enthousiasmer de plus en plus : il buvait dans les traits du roi, selon l’expression virgilienne, un long amour de la royauté constitutionnelle, et le communiquait à Pitou, lequel, trop plein de son propre amour et du superflu de l’amour de Billot, répandait le tout au dehors, en cris puissants d’abord, puis glapissants, puis rauques de :
– Vive le roi ! Vive le père du peuple !
Cette modification dans la voix de Pitou s’opérait au fur et à mesure qu’il s’enrouait.
Pitou était complètement enroué lorsque le cortège arriva au Point-du-Jour, où M. de La Fayette, à cheval sur le fameux coursier blanc, tenait en haleine les cohortes indisciplinées et frémissantes de la garde nationale, échelonnées depuis cinq heures du matin sur le terrain pour faire cortège au roi.
Or, il était près de deux heures.
L’entrevue du roi et du nouveau chef de la France armée se passa d’une manière satisfaisante pour les assistants.
Cependant, le roi commençait à se fatiguer ; il ne parlait plus et se contentait de sourire.
Le général en chef des milices parisiennes, de son côté, ne commandait plus, il gesticulait.
Le roi eut la satisfaction de voir que l’on criait presque autant « Vive le roi » que « Vive La Fayette ! » Malheureusement, ce plaisir d’amour-propre, c’était la dernière fois qu’il était destiné à le goûter.
Du reste, Gilbert était toujours placé à la portière du roi, Billot près de Gilbert, Pitou près de Billot.
Gilbert, fidèle à sa promesse, avait trouvé moyen depuis qu’il avait quitté Versailles, d’expédier quatre courriers à la reine.
Ces courriers n’avaient porté que de bonnes nouvelles, car partout sur son passage le roi voyait les bonnets sauter en l’air ; seulement, à tous ces bonnets brillait une cocarde aux couleurs de la nation, sorte de reproche adressé aux cocardes blanches que les gardes du roi et le roi lui-même portaient à leur chapeau.
Au milieu de sa joie et de son enthousiasme, cette divergence des cocardes était la seule chose qui contrariât Billot.
Billot avait à son tricorne une énorme cocarde tricolore.
Le roi avait une cocarde blanche à son chapeau ; le sujet et le roi n’avaient donc pas des goûts absolument semblables.
Cette idée le préoccupait tellement qu’il s’en ouvrit à Gilbert, au moment où celui-ci ne causait plus avec Sa Majesté.
– Monsieur Gilbert, lui demanda-t-il, pourquoi le roi n’a-t-il pas pris la cocarde nationale ?
– Parce que, mon cher Billot, ou le roi ne sait pas qu’il y a une nouvelle cocarde, ou le roi estime que sa cocarde à lui doit être la cocarde de la nation.
– Non pas, non pas, puisque sa cocarde à lui est blanche et que notre cocarde à nous est tricolore.
– Un moment ! fit Gilbert, arrêtant Billot à l’instant où celui-ci allait se lancer à corps perdu dans les phrases de journaux, la cocarde du roi est blanche comme le drapeau de la France est blanc. Ce n’est pas la faute du roi, cela. Cocarde et drapeau étaient blancs bien avant qu’il ne vînt au monde ; au reste, mon cher Billot, le drapeau a fait ses preuves, et aussi la cocarde blanche. Il y avait une cocarde blanche au chapeau du bailly de Suffren lorsqu’il rétablit notre pavillon dans la presqu’île de l’Inde. Il y avait une cocarde blanche au chapeau d’Assas, et c’est à cela que les Allemands le reconnurent, la nuit, quand il se fit tuer plutôt que de laisser surprendre ses soldats. Il y avait une cocarde blanche au chapeau du maréchal de Saxe, lorsqu’il battit les Anglais à Fontenoy. Il y avait enfin, une cocarde blanche au chapeau de M. de Condé, lorsqu’il battit les impériaux à Ro-croy, à Fribourg et à Lens. Voilà ce qu’a fait la cocarde blanche, et bien d’autres choses encore, mon cher Billot ; tandis que la cocarde nationale, qui fera peut-être le tour du monde, comme l’a prédit La Fayette, n’a encore eu le temps de rien faire, attendu qu’elle existe depuis trois jours. Je ne dis pas qu’elle restera oisive, comprenez-vous ; mais enfin, n’ayant encore rien fait, elle donne au roi le droit d’attendre qu’elle fasse.
– Comment, la cocarde nationale n’a rien fait encore, dit Billot, est-ce qu’elle n’a pas pris la Bastille ?
– Si fait, dit tristement Gilbert, vous avez raison, Billot.
– Voilà pourquoi, repartit triomphalement le fermier, voilà pourquoi le roi devrait la prendre.
Gilbert donna un grand coup de coude dans les côtes de Billot, car il s’était aperçu que le roi écoutait. Puis, tout bas :
– Êtes-vous fou, Billot ? lui dit-il ; et contre qui donc a été prise la Bastille ? contre la royauté, ce me semble. Et voilà que vous voulez faire porter au roi les trophées de votre triomphe et les insignes de sa défaite ? Insensé ! le roi est plein de cœur, de bonté, de franchise, et voilà que vous en voulez faire un hypocrite !
– Mais, dit Billot plus humblement, mais cependant sans s’être rendu tout à fait, ce n’est pas précisément contre le roi que la Bastille a été prise, c’est contre le despotisme.
Gilbert haussa les épaules, mais avec cette délicatesse de l’homme supérieur qui ne veut pas mettre le pied sur son inférieur, de peur de l’écraser.
– Non, continua Billot en s’animant, ce n’est pas contre notre bon roi que nous avons combattu, c’est contre ses satellites.
En cette époque, on disait, en politique, satellites au lieu de soldats, comme on disait, au théâtre, coursier au lieu de cheval.
– D’ailleurs, continua Billot avec une apparence de raison, il les désapprouve, puisqu’il vient au milieu de nous ; et s’il les désapprouve, il nous approuve ! C’est pour notre bonheur et pour son honneur que nous avons travaillé, nous autres, vainqueurs de la Bastille.
– Hélas ! hélas ! murmura Gilbert, qui ne savait trop lui-même comment concilier ce qui se passait sur le visage du roi avec ce qui se passait dans son cœur.
Quant au roi, il commençait, au milieu du murmure confus de la marche, à percevoir quelques mots de la discussion engagée à ses côtés.
Gilbert, qui s’apercevait de l’attention que le roi prêtait à la discussion, faisait tous ses efforts pour conduire Billot sur un terrain moins glissant que celui sur lequel il s’était engagé.
Tout à coup on s’arrêta, on était arrivé au Cours-la-Reine, à l’ancienne porte de la Conférence, dans les Champs-Élysées.
Là, une députation d’électeurs et d’échevins, présidée par le nouveau maire Bailly, se tenait rangée en bon ordre, avec une garde de trois cents hommes commandée par un colonel, et trois cents membres au moins de l’Assemblée nationale pris, comme on le pense bien, dans les rangs du tiers.
Deux des électeurs combinaient leurs forces et leur adresse réunies pour tenir en équilibre un plat de vermeil sur lequel reposaient deux énormes clefs, les clefs de la ville de Paris du temps de Henri IV.
Ce spectacle imposant fit taire toutes les conversations particulières, et chacun, soit dans les groupes, soit dans les rangs, s’occupa, selon les circonstances, d’entendre les discours qui allaient être échangés à cette occasion.
Bailly, le digne savant, le brave astronome, qu’on avait fait député malgré lui, maire malgré lui, orateur malgré lui, avait préparé un long discours d’honneur. Ce discours avait pour exorde, selon les plus strictes lois de la rhétorique, un éloge du roi, depuis l’avènement au pouvoir de M. Turgot jusqu’à la prise de la Bastille. Peu s’en fallait même, tant l’éloquence a de privilège, d’attribuer au roi l’initiative des événements, que le pauvre prince avait tout au plus subis, et subis, comme nous l’avons vu, à contre-cœur.
Bailly était fort content de son discours, lorsqu’un incident – c’est Bailly qui raconte lui-même cet incident dans ses mémoires –, lorsqu’un incident lui fournit un nouvel exorde, bien autrement pittoresque que celui qu’il avait préparé ; le seul d’ailleurs qui soit resté dans la mémoire du peuple, toujours prêt à saisir les bonnes et surtout les belles phrases bâties sur un fait matériel.
Tout en cheminant avec les échevins et les électeurs, Bailly s’alarmait de la pesanteur de ces clefs qu’il allait présenter au roi.
– Croyez-vous donc, dit-il en riant, qu’après avoir montré ce monument au roi, je me fatiguerai à le rapporter à Paris ?
– Qu’en ferez-vous donc ? demanda un électeur.
– Ce que j’en ferai, dit Bailly, je vous les donnerai, ou bien je les jetterai dans quelque fossé au pied d’un arbre.
– Gardez-vous-en bien, s’écria l’électeur scandalisé. Ne savez-vous pas que ces clefs sont les mêmes que la ville de Paris offrit à Henri IV après le siège ? Elles sont précieuses : c’est une antiquité inestimable.
– Vous avez raison, repartit Bailly, les clefs offertes à Henri IV, conquérant de Paris, on les offre à Louis XVI qui… Eh ! mais, se dit le digne maire, voilà une assez belle antithèse à produire.
Et aussitôt, prenant un crayon, il écrivit, au-dessus de son discours préparé, l’exorde que voici :
« Sire, j’apporte à Votre Majesté les clefs de la bonne ville de Paris. Ce sont les mêmes qui on été offertes à Henri IV. Il avait reconquis son peuple, aujourd’hui le peuple a reconquis son roi. »
La phrase était belle, elle était juste, elle s’incrusta dans l’esprit des Parisiens, et, de tout le discours de Bailly, des œuvres même de Bailly, c’est tout ce qui survécut.
Quant à Louis XVI, il l’approuva de la tête, mais tout en rougissant, car il en sentait l’épigrammatique ironie déguisée sous le respect et les fleurs oratoires.
Puis, tout bas :
– Marie-Antoinette, murmura Louis XVI, ne se laisserait pas prendre à cette fausse vénération de M. Bailly et répondrait tout autrement que je ne vais le faire au malencontreux astronome.
Ce qui fut cause que Louis XVI, pour avoir trop bien entendu le commencement du discours de M. Bailly, n’en écouta point du tout la fin ; non plus que de celui de M. De-lavigne, président des électeurs, dont il n’écouta ni le commencement ni la fin.
Cependant, les discours terminés, le roi craignant de ne point paraître assez réjoui de ce qu’on avait voulu lui dire d’agréable répliqua d’un ton très noble, et sans faire allusion à rien de ce qui s’était dit, que les hommages de la ville de Paris et des électeurs lui agréaient infiniment.
Après quoi il donna l’ordre du départ.
Seulement, avant de se mettre en route, il congédia ses gardes du corps, afin de répondre par une gracieuse confiance aux demi-politesses que venait de lui faire la municipalité par l’organe des électeurs et de M. Bailly.
Seule, alors, au milieu de la masse énorme des gardes nationaux et des curieux, la voiture s’avança plus rapidement.
Gilbert et son compagnon Billot continuaient de se tenir à la portière de droite.
Au moment où la voiture traversait la place Louis XV, un coup de feu retentit de l’autre côté de la Seine, et une blanche fumée monta comme un voile d’encens dans le ciel bleu, où elle s’évanouit aussitôt.
Comme si le bruit de ce coup de feu avait un écho en lui, Gilbert s’était senti frappé d’une violente secousse. Une seconde la respiration lui manqua, et il porta la main à sa poitrine, où il venait de ressentir une vive douleur.
En même temps un cri de détresse retentit autour de la voiture royale : une femme était tombée percée d’une balle reçue au-dessous de l’épaule droite.
Un des boutons de l’habit de Gilbert, bouton d’acier noir, large et taillé à facettes, selon la mode du temps, venait d’être frappé de biais par cette même balle.
Il avait fait cuirasse et l’avait renvoyée ; de là, la douleur et la secousse éprouvées par Gilbert.
Une partie de son gilet noir et de son jabot avaient été enlevées.
Cette balle, renvoyée par le bouton de Gilbert, venait de tuer la malheureuse femme que l’on s’empressa d’emporter mourante et ensanglantée.
Le roi avait entendu le coup, mais n’avait rien vu.
Il se pencha en souriant vers Gilbert.
– On brûle là-bas de la poudre en mon honneur, dit-il.
– Oui, Sire, répondit Gilbert.
Seulement il se garda bien de dire à Sa Majesté ce qu’il pensait de l’ovation qu’on lui faisait.
Mais en lui-même et tout bas il s’avoua que la reine avait eu quelque raison de craindre, puisque sans lui, qui fermait hermétiquement la portière, cette balle, qui avait ricoché sur son bouton d’acier, arrivait droit au roi.
Maintenant, de quelle main partait ce coup si bien dirigé ?
On ne voulut pas le savoir alors… de sorte qu’on ne le saura jamais.
Billot, pâle de ce qu’il venait de voir, les yeux attirés sans cesse par cette déchirure de l’habit, du gilet et du jabot de Gilbert, Billot força Pitou à redoubler ses cris de : « Vive le Père des Français. »
L’événement était si grand, au reste, que l’épisode fut vite oublié.
Enfin, Louis XVI arriva devant l’Hôtel de Ville, après avoir été salué au Pont-Neuf par une salve de canons, qui, au moins, eux, n’étaient point chargés à balles.
Sur la façade de l’Hôtel de Ville s’étalait une inscription en grosses lettres, noires le jour, mais qui, la nuit venue, devait s’éclairer et briller en transparent.
Cette inscription était due aux ingénieuses élucubrations de la municipalité.
Voici ce qu’on lisait sur cette inscription :
« À Louis XVI, père des Français et roi d’un peuple libre. »
Autre antithèse bien autrement importante que celle du discours de Bailly, et qui faisait pousser des cris d’admiration à tous les Parisiens assemblés sur la place.
Cette inscription attira l’œil de Billot.
Mais comme Billot ne savait pas lire, il se fit lire l’inscription par Pitou.
Billot se la fit redire une seconde fois, comme s’il n’avait pas entendu à la première.
Puis, quand Pitou eut répété la phrase sans y changer un seul mot :
– Il y a cela ? s’écria-t-il ; il y a cela ?
– Sans doute, dit Pitou.
– La municipalité a fait écrire que le roi était roi d’un peuple libre ?
– Oui, père Billot.
– Alors, s’écria Billot, si la nation est libre, elle a le droit d’offrir au roi sa cocarde.
Et d’un bond, s’élançant au-devant de Louis XVI, qui descendait de son carrosse en face des degrés de l’Hôtel de Ville :
– Sire, dit-il, vous avez vu que sur le Pont-Neuf le Henri IV de bronze a la cocarde nationale.
– Eh bien ? fit le roi.
– Eh bien ! Sire, si Henri IV porte la cocarde tricolore, vous pouvez bien la porter, vous.
– Certes, dit Louis XVI embarrassé, et si j’en avais une…
– Eh bien ! dit Billot en haussant la voix et en élevant la main, au nom du peuple, je vous offre celle-ci en place de la vôtre, acceptez-la.
Bailly intervint.
Le roi était pâle. Il commençait à sentir la progression. Il regarda Bailly, comme pour l’interroger.
– Sire, dit celui-ci, c’est le signe distinctif de tout Français.
– En ce cas, je l’accepte, dit le roi prenant la cocarde des mains de Billot.
Et, mettant de côté la cocarde blanche, il fixa la cocarde tricolore à son chapeau.
Un immense hourra de triomphe retentit sur la place.
Gilbert se détourna, profondément blessé.
Il trouvait que le peuple empiétait trop vite, et que le roi ne résistait point assez.
– Vive le roi ! cria Billot, qui donna ainsi le signal d’une seconde salve d’applaudissements.
– Le roi est mort, murmura Gilbert. Il n’y a plus de roi en France.
Une voûte d’acier avait été formée par un millier d’épées étendues, depuis l’endroit où le roi descendait de sa voiture jusqu’à la salle où il était attendu.
Il passa sous cette voûte et disparut dans les profondeurs de l’Hôtel de Ville.
– Ce n’est point un arc de triomphe, dit Gilbert ce sont les fourches Caudines.
Puis, avec un soupir :
– Ah ! que dira la reine !
Chapitre XXXVIII
Ce qui se passait à Versailles tandis que le roi écoutait les discours de la municipalité
À l’intérieur de l’Hôtel de Ville le roi reçut un accueil bien flatteur : on l’appela le Restaurateur de la liberté.
Invité à parler – car la soif des discours devenait de jour en jour plus intense, et le roi voulait savoir enfin le fond des pensées de chacun –, le roi mit la main sur son cœur et dit seulement :
– Messieurs, vous pouvez toujours compter sur mon amour.
Tandis qu’il écoutait à l’Hôtel de Ville les communications du gouvernement – car à partir de ce jour il y eut un véritable gouvernement constitué en France à côté du trône et de l’Assemblée nationale – le peuple, au dehors, se familiarisait avec les beaux chevaux du roi, la voiture dorée, les laquais et les cochers de Sa Majesté.
Pitou, depuis l’entrée du roi à l’Hôtel de Ville s’était, grâce à un louis donné par le père Billot, amusé à faire, avec force rubans bleus, blancs et rouges, une collection de cocardes nationales de toutes grandeurs, dont il décorait les oreilles des chevaux, les harnais et tout l’équipage.
Ce que voyant, le public imitateur avait littéralement transformé la voiture de Sa Majesté en une boutique de cocardes.
Le cocher et les valets de pied en étaient ornés à profusion.
On en avait en outre glissé quelques douzaines de rechange dans l’intérieur.





























