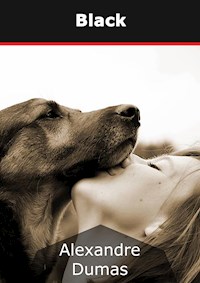
2,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Un beau jour de 1842 alors que le chevalier de la Graverie fait sa promenade quotidienne dans la ville de Chartres, un chien le prend en affection et le suit jusqu'à chez lui. Ne désirant pas s'attacher, il le chasse dans un premier temps avant de repenser à ce que lui avait dit son cher ami le capitaine Dusmenil juste avant de mourir: "...je prie le bon dieu de me confier la peau du premier chien venu pour te rejoindre...". Aussi, lorsque après trois semaines de recherches infructueuses il le retrouve enfin accompagnant une jeune fille, il n'hésite pas à l'enlever, intimement convaincu que ce chien nommé Black n'est autre que son ami "réincarné". Mais six mois plus tard, le chien s'enfuit et le chevalier le poursuit jusqu'au chevet de la jeune fille mourante et enceinte. Il se rend compte alors que son geste a eu des conséquences bien néfastes sur l'honneur de cette dernière, qui privée de la protection de son chien, a cédé à un militaire, celui-ci ayant profité de la ressemblance et de l'amour qu'elle portait à son frère jumeau. Faisant fi des médisances du voisinage, le chevalier installe la jeune fille chez lui, d'autant plus qu'elle ressemble énormément à sa femme qu'il n'a pas revue depuis la découverte de son infidélité... Et si cette jeune Thérèse était le fruit des amours de sa femme et de son amant?...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 540
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Black
Alexandre DumasIIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIXIIIXIVXVXVIXVIIXVIIIXIXXXXXIXXIIXXIIIXXIVXXVXXVIXXVIIXXVIIIXXIXXXXXXXIXXXIIXXXIIIXXXIVXXXVXXXVIXXXVIIPage de copyrightAlexandre Dumas
Black
Édition de référence :
Paris, Dufour, Mulat et Boulangers, Éditeurs, 1859.
I
Où le lecteur fait connaissance avec les deux premiers personnages du livre.
M. le chevalier de La Graverie en était à son second tour de ville.
Peut-être serait-il plus logique d’entrer en matière en apprenant au lecteur ce que c’était que M. le chevalier de La Graverie, et dans lequel des quatre-vingt-six départements de la France était située la ville dont il longeait l’enceinte.
Mais nous avons résolu, dans un moment d’humour qui nous a probablement été inspiré par le brouillard que nous avons respiré dernièrement en Angleterre, de faire un roman complètement neuf : c’est-à-dire de le faire à l’envers des autres romans.
Voilà pourquoi, au lieu de commencer par le commencement, comme on a fait jusqu’à présent, nous le commencerons par la fin, certain que l’exemple sera imité, et que, d’ici à quelque temps, on ne commencera plus les romans que par la fin.
D’ailleurs, il y a encore un autre motif qui nous détermine à adopter cette façon de procéder.
Nous craignons que l’aridité des détails biographiques ne rebute le lecteur et ne lui fasse fermer le livre à la fin du premier feuillet.
Nous nous contenterons donc de lui dire pour le moment, et cela parce que nous ne pouvons pas le lui cacher, que la scène se passe, vers 1842, à Chartres en Beauce, sur la promenade ombragée d’ormes qui serpente autour des vieilles fortifications de l’antique capitale des Carnutes, promenade qui est à la fois les Champs-Élysées et la petite Provence de toutes les générations de Chartrains qui se sont succédé depuis deux cents ans.
Puis, ayant posé nos réserves à l’endroit de l’individualité rétrospective de notre héros, ou plutôt de l’un de nos héros, afin que le lecteur ne nous accuse pas de lui avoir ménagé un coup de Jarnac, nous continuons.
Le chevalier de La Graverie en était donc à son second tour de ville.
Il arrivait à cette partie du boulevard qui domine le quartier de la cavalerie et d’où l’œil embrasse dans tous leurs détails les vastes cours de cette caserne.
Le chevalier s’arrêta.
C’était sa halte.
Tous les jours, le chevalier de La Graverie, qui sortait de chez lui à midi précis après avoir pris son café pur et avoir mis trois ou quatre morceaux de sucre dans la poche de derrière de son habit, pour grignoter chemin faisant, ralentissait ou précipitait la seconde partie de sa promenade, de façon à se trouver au même endroit, c’est-à-dire à celui que nous venons d’indiquer, au moment précis où la trompette appelait les cavaliers au pansage de leurs chevaux.
Ce n’est point que rien au monde, à part le ruban rouge qu’il portait à son habit, indiquât, dans le chevalier de La Graverie, une tendance vers les exercices militaires ; il s’en fallait du tout au tout : le chevalier de La Graverie était, au contraire, ce que l’on peut imaginer de plus bonhomme.
Mais il aimait à voir ce tableau pittoresque et mouvementé qui le ramenait au temps où lui-même – nous dirons plus tard dans quelles circonstances – avait été mousquetaire ; ce dont il était très fier depuis qu’il ne l’était plus.
Car, sans chercher, ostensiblement du moins, dans les souvenirs d’une autre époque, ses consolations du présent, tout en portant philosophiquement des cheveux qui avaient passé du jaune tendre au gris-perle ; tout en paraissant aussi satisfait de son enveloppe qu’une chrysalide peut l’être de la sienne ; tout en ne voltigeant pas sur les ailes du papillon d’un ci-devant jeune homme, le chevalier de La Graverie n’était point fâché de se poser en connaisseur aux yeux des pacifiques bourgeois qui, comme lui, venaient chercher leur distraction quotidienne en face des écuries du quartier et de faire dire à ses voisins :
– Savez-vous que vous aussi, chevalier, vous avez dû être un joli officier dans votre temps ?
Supposition qui était d’autant plus agréable au chevalier de La Graverie qu’elle était complètement dénuée de fondement.
L’égalité des rides, qui ne fait que préluder, chez les hommes, à la grande égalité de la mort, est la consolation de ceux qui ont à se plaindre de la nature.
Or, le chevalier de La Graverie n’avait point à s’en louer, de cette capricieuse nature, nourrice débonnaire des uns, marâtre capricieuse des autres.
Et c’est ici le moment, je crois, de dire ce qu’était physiquement le chevalier de La Graverie ; le moral se développera plus tard.
C’était un petit homme de quarante-sept à quarante-huit ans, grassouillet à la manière des femmes et des eunuques, lequel avait eu, comme nous l’avons dit, des cheveux jaunes qui, dans ses signalements, étaient généralement portés comme cheveux blonds ; qui avait encore de grands yeux bleu-faïence dont l’expression habituelle était l’inquiétude quand la rêverie, car le chevalier rêvait quelquefois, ne leur donnait pas une fixité morne ; de grandes oreilles sans ourlets, molles et branlantes ; des lèvres grosses et sensuelles dont l’inférieure pendait légèrement à la manière autrichienne ; enfin, un teint rougeaud par places, presque blafard là où il n’était pas rouge.
Cette première partie de son corps était supportée par un cou gros et court sortant d’un torse qui s’était porté tout entier vers l’abdomen, au détriment de bas étriqués et manquant de longueur.
Enfin, ce torse se mouvait à l’aide de petites jambes rondes comme des saucissons et légèrement cagneuses du genou.
L’ensemble était vêtu, au moment où nous le présentons au lecteur : la tête, d’un chapeau noir à larges bords et à forme lasse ; le cou, d’une cravate de fine batiste brodée ; le torse, d’un gilet de piqué blanc recouvert d’un habit bleu à boutons d’or ; enfin, la partie inférieure du corps, d’un pantalon de nankin un peu court, serré au genou et à la cheville, laissant à découvert des bas de coton mouchetés qui se perdaient dans des escarpins à gros rubans.
Tel qu’il était, nous l’avons dit, le chevalier de La Graverie avait fait du pansage l’incident récréatif de la course qu’il accomplissait tous les jours avec la sollicitude religieuse que, arrivés à un certain âge, les caractères méthodiques mettent à accomplir une prescription médicale.
Il le gardait pour la bonne bouche ; il en était friand comme un gastronome est friand d’un plat d’entremets.
Arrivé en face d’un banc de bois placé au bord du talus qui descend aux écuries, M. de La Graverie s’arrêta et regarda si la scène allait bientôt commencer ; puis il s’assit méthodiquement, comme un vieil habitué se fût assis à l’orchestre de la Comédie française, attendant, le menton appuyé sur ses deux mains et les deux mains appuyées sur sa canne à pomme d’or, que le son de la trompette remplaçât les trois coups du régisseur .
Et vraiment, ce jour-là, l’intéressant spectacle du pansage en eût arrêté et captivé beaucoup d’autres moins curieux et plus blasés que notre chevalier ; non pas que l’opération quotidienne eût en elle-même quelque chose d’insolite et d’inaccoutumé : non, c’étaient bien les mêmes chevaux bais, alezans, rouans, noirs, gris, blancs, tigrés, pies, hennissant ou frémissant sous la brosse et l’étrille ; c’étaient bien les mêmes cavaliers en sabots et en pantalon de treillis, les mêmes sous-lieutenants ennuyés, le même adjudant-major grave et compassé guettant une infraction aux règlements comme le chat guette la souris, ou comme le pion, les écoliers.
Mais, le jour où nous rencontrons le chevalier de La Graverie, un beau soleil d’automne reluisait sur cette masse grouillante de bipèdes et de quadrupèdes, et triplait la valeur de l’ensemble et des détails.
Jamais les croupes des chevaux n’avaient été si miroitantes, jamais les casques n’avaient renvoyé tant de feux, jamais les sabres n’avaient fait jaillir tant d’éclairs, jamais les physionomies n’avaient été si accentuées, jamais, enfin, le cadre n’avait été si splendide !
Les deux majestueuses flèches qui dominent l’immense cathédrale s’enflammaient sous un chaud rayon que l’on eût cru emprunté au ciel d’Italie ; les moindres détails de leurs fines dentelures s’accusaient par la vigueur des ombres, et les feuilles des arbres qui bordent la rivière d’Eure se nuançaient de mille teintes de vert, de pourpre et d’or !
Bien que le chevalier n’appartînt aucunement à l’école romantique, qu’il n’eût jamais eu l’idée de lire les Méditations poétiques de Lamartine ou les Feuilles d’automne de Victor Hugo, ce soleil, ce mouvement, ce bruit, cette majesté du paysage le fascinèrent, et comme tous les esprits paresseux, au lieu de dominer la scène et de rêver à sa volonté en dirigeant sa rêverie par la route qui pouvait lui être le plus agréable, il fut bientôt absorbé par elle et tomba dans cet affaiblissement intellectuel pendant lequel la pensée semble quitter le cerveau et l’âme, le corps, où l’on regarde sans voir, où l’on écoute sans entendre, et où la foule des songes, se succédant les uns aux autres comme les facettes coloriées du kaléidoscope, et cela sans que le songeur ait la force d’accrocher un de ses rêves au passage et de s’y arrêter, finit par produire une ivresse qui rappelle de loin celle des fumeurs d’opium et des mangeurs de hachich !
Il y avait quelques minutes que le chevalier de La Graverie se laissait envahir par cette somnolence, lorsqu’il fut ramené au sentiment de la vie réelle par une sensation des plus positives.
Il lui sembla qu’une main audacieuse cherchait furtivement à se glisser dans la poche gauche de sa redingote.
Le chevalier de La Graverie se retourna brusquement, et, à sa grande surprise, au lieu de la face patibulaire d’un tire-laine ou d’un vide-gousset, il aperçut la physionomie honnête et placide d’un chien qui, sans être le moins du monde embarrassé de la circonstance du flagrant délit, continuait de convoiter la poche du chevalier en agitant doucement sa queue et en se léchant amoureusement les babines.
L’animal qui venait d’arracher si inopinément le chevalier à sa rêverie appartenait à cette grande race d’épagneuls qui nous sont venus d’Écosse en même temps que les secours que Jacques Ier envoya à son cousin Charles VII. Il était noir, nous parlons de l’épagneul, bien entendu, avec une raie blanche qui, commençant à la gorge, lui traversait, en s’élargissant, le poitrail et, descendant entre ses pattes de devant, lui formait une espèce de jabot ; sa queue était longue et ondoyante ; son poil soyeux avait des reflets métalliques ; ses oreilles, fines, longues et placées bas, encadraient des yeux intelligents, presque humains, entre lesquels s’allongeait un museau légèrement teinté de feu à son extrémité.
Pour tous le monde, c’était un magnifique animal qui valait grandement la peine d’être admiré ; mais le chevalier de La Graverie, qui se piquait d’indifférence à l’endroit de toutes les bêtes en général, et des chiens en particulier, ne prêta qu’une médiocre attention aux charmes extérieurs de celui-ci.
Il était désappointé.
Pendant la seconde qui avait suffi à la perception de ce qui se passait derrière son dos, le chevalier de La Graverie avait bâti tout un drame.
Il y avait des voleurs à Chartres !
Une bande de pickpockets avait fait invasion dans la capitale de la Beauce, à l’intention d’exploiter les poches de ses bourgeois, bien connus pour les gonfler de valeurs de toutes sortes. Ces audacieux scélérats, démasqués, appréhendés au corps, traînés en cour d’assises, envoyés au bagne, tout cela grâce à la perspicacité, à la susceptibilité de sens d’un simple flâneur : c’était splendide de mise en scène, et l’on comprend qu’il était cruel de retomber de ces hauteurs accidentées dans le calme monotone des rencontres quotidiennes du tour de ville.
Aussi, dans son premier mouvement de mauvaise humeur contre l’auteur de cette déception, le chevalier essaya-t-il de chasser l’importun par un froncement de sourcil olympien à la toute-puissance duquel il lui paraissait impossible que l’animal pût résister.
Mais le chien essuya intrépidement le feu de ce regard et contempla, au contraire, son adversaire d’un air aimable. Il fit rayonner avec tant d’expression ses grandes prunelles jaunes, tout humides, que ce miroir du cœur qu’on appelle les yeux chez les chiens comme chez les hommes dit clairement au chevalier de La Graverie :
– La charité, monsieur, s’il vous plaît !
Et cela avec un accent si humble, si piteux que le chevalier se sentit remué jusqu’au fond de l’âme, déplissa son front, puis, fouillant dans cette même poche où l’épagneul avait tenté d’introduire son museau pointu, il en tira un des morceaux de sucre qui avaient excité la convoitise du larron.
Le chien le reçut avec toute la délicatesse imaginable ; en le voyant ouvrir la gueule pour y laisser choir cette friande aumône, jamais on n’eût pu croire qu’une mauvaise pensée, une pensée de vol, fût venue dans cet honnête cerveau ; peut-être un observateur eût-il désiré une expression de physionomie un peu plus reconnaissante tandis que le sucre craquait entre les dents blanches de l’animal ; mais la gourmandise, qui est un des sept péchés capitaux, faisait partie des vices aimables du chevalier, lequel la regardait comme une de ces faiblesses qui charment les relations sociales. Il en résulta qu’au lieu d’en vouloir au chien de l’expression plus sensuelle que reconnaissante de sa physionomie, il suivit avec une admiration véritable et presque envieuse les témoignages de jouissance gastronomique que lui donnait l’animal.
Au reste, l’épagneul était décidément de la race des gueux !
Le bienfait ne fut pas plus tôt absorbé que l’animal ne sembla s’en souvenir que pour en solliciter un autre ; ce qu’il fit en se léchant amoureusement les lèvres et avec les mêmes jeux de physionomie suppliants, les mêmes attitudes humbles et caressantes dont il venait d’expérimenter la valeur ; il ne se doutait pas que, comme presque tous les mendiants, d’intéressant il devenait importun ; mais, au lieu de lui en vouloir de son importunité, le chevalier encouragea ses méchantes inclinations en lui prodiguant les morceaux de sucre et en ne s’arrêtant que quand sa poche fut entièrement vide.
Le quart d’heure de Rabelais de la reconnaissance allait sonner. M. le chevalier de La Graverie ne le voyait pas venir sans une certaine appréhension ; il y a toujours une nuance de fatuité et d’égoïsme même dans le bienfait qui s’adresse à un chien ; on aime à croire que la main dont il dérive en constitue tout le prix, et le chevalier avait vu si souvent débiteurs, obligés, courtisans tourner les talons aux plats nettoyés que, malgré le brin de suffisance que nous signalons, il n’osait trop espérer qu’un simple membre de la communauté canine ne suivît pas les traditions et les exemples donnés à ses pareils par les fils d’Adam depuis la succession des siècles.
Quelque philosophe qu’une longue expérience de la vie eût dû le faire à cet endroit, il en coûtait au chevalier de La Graverie d’expérimenter, une fois de plus à ses dépens, l’ingratitude universelle ; il ne demandait donc pas mieux que de sauver sa connaissance improvisée des embarras de cette terrible épreuve et de s’épargner à lui-même les humiliations qui pouvaient en résulter : aussi, après avoir une dernière fois sondé la profondeur de sa redingote ; après s’être bien convaincu qu’il n’y avait pas moyen de prolonger ces agréables relations de la durée d’un morceau de sucre ; après avoir, aux yeux de l’épagneul, retourné sa poche pour donner une preuve de complète bonne foi, il fit au chien une amicale caresse ayant pour but de lui tenir lieu à la fois d’adieu et d’encouragement ; puis, se levant, il reprit sa promenade sans oser regarder derrière lui.
Tout cela, vous le voyez, ne vous dénonce pas le chevalier de La Graverie comme un mauvais homme, ni l’épagneul comme un mauvais chien.
C’est déjà beaucoup, ayant à vous mettre un homme et un chien en scène, que l’homme ne soit pas méchant ni le chien enragé. Aussi me crois-je obligé, vu cette première invraisemblance, de vous répéter que ce n’est pas un roman, mais une histoire que je vous raconte.
Le hasard avait, cette fois, réuni un bon homme et un bon chien.
Une fois n’est pas coutume !
Où mademoiselle Marianne donne le programme de son caractère.
Nous avons vu que le chevalier avait repris sa promenade sans oser détourner la tête pour s’assurer si le chien le suivait oui ou non.
Mais il n’était pas au milieu de la butte Saint-Michel, endroit bien connu non seulement des Chartrains, mais des habitants de tout le canton, que sa résolution avait déjà subi un rude assaut, et ce n’était point sans une véritable force morale qu’il avait résisté aux suggestions du démon de la curiosité.
Cette curiosité, au moment où le chevalier de La Graverie arriva au pont de la Courtille, était si fort excitée, que le passage de la diligence de Paris, qui arrivait au triple galop de ses cinq chevaux, lui servit de prétexte pour se ranger ; et en se rangeant, comme par mégarde, il retourna la tête, et, à sa grande surprise, il aperçut le chien qui emboîtait son pas et le suivait gravement, méthodiquement, en animal qui a la conscience de ce qu’il fait, et qui accomplit une action selon sa conscience.
– Mais je n’ai plus rien à te donner, pauvre brave bête ! s’écria le chevalier en secouant ses poches flasques.
On eût dit que le chien avait compris le sens et la portée de ses paroles, car il s’élança en avant, fit deux ou trois gambades folles, comme pour témoigner de sa reconnaissance ; après quoi, voyant le chevalier arrêté, et ne sachant pas combien de temps durerait la halte, il s’allongea à plat-ventre sur le sol, appuya sa tête sur ses pattes de devant étendues, lança dans l’air trois ou quatre abois joyeux, et attendit que son nouvel ami se remît en marche.
Au premier mouvement que fit le chevalier, le chien se redressa sur ses quatre pattes et bondit en avant.
De même que l’animal avait paru comprendre les paroles de l’homme, l’homme parut comprendre les gestes de l’animal.
Le chevalier de La Graverie s’arrêta, et levant et laissant retomber ses deux bras :
– Bon, dit-il, tu veux que nous nous en allions de compagnie, je te comprends ; mais, malheureux, je ne suis pas ton maître, moi, et, pour me suivre, tu dois abandonner quelqu’un, quelqu’un qui t’a élevé, logé, nourri, choyé, caressé, un aveugle dont tu es le bâton peut-être, une douairière dont tu es la consolation sans doute ; quelques méchants morceaux de sucre te l’ont fait oublier, comme sans doute tu m’oublierais à mon tour si j’étais assez faible pour t’adopter. Allons, allez-vous-en, Médor ! dit le chevalier, s’adressant cette fois à l’animal, vous n’êtes qu’un chien, vous n’avez pas le droit d’être ingrat. Ah ! si vous étiez un homme, continua, comme entre parenthèses, le chevalier, ce serait autre chose.
Mais le chien, au lieu d’obéir à l’ordre ou de se rendre à la considération philosophique du chevalier, redoubla ses abois, ses gambades, ses invitations à la promenade.
Par malheur, cette seconde série de pensées qui était montée au cerveau du chevalier comme une marée crépusculaire dont chaque vague s’avance plus ténébreuse, l’avait assombri ; sans doute, il avait de prime-abord été flatté d’inspirer l’attachement subit que lui avait témoigné l’animal ; mais, par un retour naturel, il avait réfléchi que cet attachement cachait sans doute une ingratitude plus ou moins noire ; il avait pesé la stabilité d’une amitié si primesautière, il s’était enfin fortifié dans un parti qui semblait pris chez lui depuis nombre d’années, parti d’après lequel, nous l’expliquerons plus tard, ni hommes, ni femmes, ni bêtes, ne devaient avoir à l’avenir aucune part dans ses affections.
Par cet aperçu habilement ménagé, le lecteur doit commencer à s’apercevoir que le chevalier de La Graverie appartient à cette honorable religion qui a pour dieu Timon, pour messie Alceste, et que l’on appelle misanthropie.
Aussi, bien décidé à trancher dans le vif, en rompant dès son début cette liaison, M. de La Graverie essaya d’abord de renvoyer le chien par la persuasion. Après l’avoir, comme nous avons vu, appelé Médor, en l’invitant la première fois à se retirer, il lui renouvela la même invitation en l’appelant tour à tour des noms mythologiques de Pyrame, Morphée, Jupiter, Castor, Pollux, Actéon, Vulcain ; puis des noms antiques de César, Nestor, Romulus, Tarquin, Ajax ; puis des noms scandinaves d’Ossian, de Fingal, d’Odin, de Thor, de Feuris ; de ces noms il passa aux noms anglais de Trim, Tom, Dick, Nick, Milord, Stopp ; des noms anglais, il passa aux noms pittoresques de Sultan, Phanor, Turc, Ali, Mouton, Perdreau ; enfin, il épuisa depuis les temps fabuleux jusqu’à nos temps positifs, tout ce que le martyrologe des chiens put lui fournir de noms pour faire entrer dans la tête de l’épagneul obstiné qu’il était impossible qu’il continuât de cheminer à sa suite ; mais, s’il y a un proverbe qui dit à propos des hommes, qu’il n’y a pire sourd que celui qui ne veut pas entendre ; il était évident, dans cette circonstance du moins, que le proverbe devait s’étendre jusqu’aux chiens.
En effet, l’épagneul si prompt à deviner tout à l’heure la pensée de son nouvel ami, paraissait être maintenant à mille lieues de le comprendre ; plus la physionomie du chevalier de La Graverie devenait menaçante et sévère, et il cherchait dans sa gorge des notes métalliques et cuivrées, plus l’animal prenait des attitudes allègres et provocantes, et semblait donner la réplique à un agréable badinage ; enfin lorsque le chevalier, bien malgré lui, mais contraint par la nécessité de rendre sa pensée claire et saisissable, se décida, en levant sa canne à pomme d’or, à employer l’ultima ratio des chiens, la pauvre bête se coucha tristement sur le dos, et tendit d’un air résigné ses flancs au bâton.
Des malheurs, malheurs dont nous ne comptons aucunement faire un secret à nos lecteurs, avaient pu rendre le chevalier misanthrope, mais la nature ne l’avait pas créé méchant.
Aussi, cette humble attitude de l’épagneul désarma-t-elle complètement le chevalier : il fit passer sa canne de sa main droite dans sa main gauche, s’essuya le front, car cette scène qu’il venait de jouer, et dans laquelle il avait joint le geste au dialogue, l’avait mis en nage, et, s’avouant vaincu, tout en conservant à son amour-propre l’espoir d’une revanche :
– Sac à papier ! s’écria-t-il, viens si tu veux, chien de... chien ! mais du diable si tu me suis plus loin que ma porte.
Mais le chien était probablement de cet avis que, qui gagne du temps gagne tout ; car il se remit immédiatement sur ses quatre pattes, et, en animal parfaitement consolé et nullement inquiet, il anima le reste de la promenade par mille cabrioles autour du maître qu’il paraissait avoir choisi, le traitant si bien en vieil ami, que tous les Chartrains qui rencontrèrent le chevalier s’arrêtèrent ébaubis et rentrèrent chez eux, enchantés d’avoir à poser à leurs amis et connaissances cette énigme, sous la forme d’interrogation affirmative :
– Ah çà ! mais M. de La Graverie a donc un chien, à présent ?
M. de La Graverie, dont la ville s’occupait et, pendant deux ou trois jours peut-être, allait s’occuper, M. de La Graverie fut très digne : il se montra tout à la fois complètement insoucieux de la curiosité qu’il soulevait sur son passage et d’une superbe indifférence vis-à-vis de son compagnon, s’arrêtant, absolument comme s’il eût été seul, partout où il avait l’habitude de s’arrêter : devant la porte de Guillaume, dont on restaurait les vieux créneaux ; en face du jeu de paume, mal animé par la maladresse de six joueurs et les cris d’une douzaine de gamins qui se disputaient l’emploi de marqueurs de chasse ; auprès d’un cordier qui avait établi son atelier le long de la butte des Charbonniers, et dont, chaque jour, il inspectait le travail avec un intérêt dont jamais il n’avait même essayé de se rendre compte.
Si parfois une mine gracieuse, une caresse provocante du chien arrachait malgré lui un sourire au chevalier, il le refoulait soigneusement en dedans, et, à l’instant même, reprenait son air gourmé, comme un ferrailleur qui, découvert par une feinte de son adversaire, se remet soigneusement en garde.
Ce fui ainsi qu’ils arrivèrent tous deux au n° 9 de la rue des Lices, domicile, depuis nombre d’années, du chevalier de La Graverie.
Arrivé à cette porte, ce dernier comprit que tout le reste n’avait été qu’une espèce de prologue et que c’était là que la véritable lutte allait s’engager.
Mais le chien ne paraissait, lui, avoir rien compris du tout, sinon qu’il était arrivé au but de sa promenade.
Pendant que le chevalier glissait son passe-partout dans la serrure, l’épagneul, exempt, en apparence du moins, de toute inquiétude, attendait, placidement assis sur sa queue, que la porte s’ouvrît, comme si une longue habitude lui avait fait considérer la maison comme sienne ; aussi, dès que le chevalier en eût fait tourner les gonds, l’animal, s’élançant vivement entre ses jambes, allongea-t-il le nez sur le seuil ; mais le maître du logis tira si vivement à lui la porte, entrebâillée au tiers, qu’elle se referma sur le nez du chien, et que, de la secousse, la clef rejaillit au milieu de la rue.
L’épagneul s’élança après la clef, et, malgré la répugnance qu’éprouvent en général les chiens, si bien dressés qu’ils soient, à toucher du fer avec leurs dents, il prit délicatement la clef entre sa mâchoire supérieure et sa mâchoire inférieure, et la rapporta à M. de La Graverie, et cela, comme on dit en termes de chasse, à l’anglaise, lui tournant le dos et se dressant sur ses pattes de derrière, afin de ne point le salir avec ses pattes de devant.
Cette manœuvre, sans toucher M. de La Graverie, si séduisante qu’elle fût, donna cependant dans son cerveau matière à un certain nombre de réflexions.
La première fut qu’il n’avait point affaire au premier chien venu, et que, sans être précisément un chien savant, celui qui venait de lui donner cette preuve d’éducation était un chien bien élevé.
Sans que sa résolution première en fût ébranlée, il comprit cependant que l’épagneul méritait quelques égards, et, comme deux ou trois personnes s’étaient déjà arrêtées à le regarder, comme les rideaux de quelques fenêtres s’écartaient, il résolut de ne pas compromettre sa dignité dans une lutte qui pourrait bien, vu l’entêtement et la vigueur de l’animal, ne pas demeurer à son avantage, et, cette résolution prise, il se décida à appeler une tierce personne à son secours.
En conséquence, il remit dans sa poche la clef que l’épagneul venait de lui rapporter, et, tirant une patte de chevreuil suspendue à une petite chaîne de fer, il fit retentir la sonnette à l’intérieur.
Malgré son retentissement parvenu distinctement à l’oreille du chevalier, la sonnette ne fit aucun effet ; la maison resta muette comme si le chevalier eût sonné à la porte du château de la Belle-au-Bois-Dormant, et ce ne fut que lorsque le chevalier eut redoublé ses appels, avec un rapprochement de tentative et un redoublement d’effets indiquant qu’il ne se lasserait pas le premier, qu’une fenêtre à guillotine glissa dans son châssis, au premier étage, et que la tête rechignée d’une femme, de cinquante ans à peu près, s’y encadra.
Cette tête s’avança avec autant de précaution que si quelque nouvelle invasion de Normands ou de Cosaques eût menacé la ville, et chercha à reconnaître l’auteur de cet étrange charivari.
Mais M. de La Graverie, qui s’attendait naturellement à voir s’ouvrir la porte du rez-de-chaussée et non la fenêtre du premier, s’était effacé contre la porte, afin d’avoir moins de chemin à faire pour s’élancer à l’intérieur, et disparaissait à l’ombre d’une corniche toute chargée de giroflées de muraille, poussant là vertes et drues comme en plein parterre.
Il fut donc impossible à la femme de ménage de l’apercevoir ; elle vit seulement le chien, qui, assis sur son derrière à trois pas du seuil, et attendant comme le chevalier que la porte s’ouvrit, leva la tête et regarda avec son œil intelligent le nouveau personnage qui entrait en scène.
La vue de ce chien n’était point faite pour rassurer Marianne, c’était le nom de la vieille femme de ménage, sa couleur non plus ; on se rappelle que l’épagneul, à part deux taches de feu au museau et un jabot blanc au cou, était noir comme un corbeau ; et Marianne ne se rappelait aucune des connaissances de M. de La Graverie ayant un chien noir, et ne voyait guère que le diable qui eût un chien de cette couleur.
Or, comme elle savait que le chevalier avait fait serment de n’avoir jamais de chien, elle fut bien loin de se douter que ce chien accompagnât le chevalier.
D’ailleurs, le chevalier ne sonnait point.
Le chevalier, qui n’aimait pas attendre, avait son passe-partout qui ne le quittait jamais.
Enfin, après un instant d’hésitation, elle se hasarda à interroger.
– Qui est là ? demanda-t-elle timidement.
Le chevalier, guidé à la fois par le son de la voix et par le regard de l’épagneul, quitta son poste, fit trois pas dans la rue et leva la tête à son tour, en se faisant un abat-jour de sa main.
– Ah ! c’est vous, Marianne, dit-il ; descendez.
Mais, du moment où elle avait reconnu son maître, Marianne avait cessé de craindre ; aussi, au lieu d’obéir à l’ordre qui lui était donné :
– Descendre ? demanda-t-elle, et pourquoi faire ?
– Mais pour m’ouvrir, apparemment, répondit M. de La Graverie.
Le visage de Marianne, de doucereux et timide qu’il avait été d’abord, devint acariâtre et revêche.
Elle arracha une longue aiguille fichée entre son bonnet et ses cheveux, et, reprenant son tricot interrompu :
– Pour vous ouvrir ? dit-elle, pour vous ouvrir ? – Sans doute. N’avez-vous point votre passe-partout ? – Que je l’aie ou que je ne l’aie point, je vous dis de descendre. – Bon ! voilà que vous l’avez perdu ; car je suis sûr que vous l’aviez ce matin : pendant que je brossais vos habits, il est tombé de la poche de votre pantalon, et je l’y ai remis. Eh bien, c’est une étourderie dont je ne vous croyais point capable à votre âge ; mais, Dieu merci ! on apprend tous les jours. – Marianne, reprit le chevalier en donnant de légères marques d’impatience qui prouvaient qu’il n’était point autant que l’on pouvait le croire sous la domination de sa femme de charge, je vous dis de descendre. – Il l’a perdu ! s’écria celle-ci sans avoir remarqué l’imperceptible nuance qui s’était faite dans le ton du chevalier : il l’a perdu ! Ah ! mon Dieu, qu’allons-nous devenir ? Il me va falloir courir la ville, faire changer la serrure, la porte peut-être ; car je ne dormirai certainement pas dans une maison dont la clef court les grands chemins. – J’ai la clef, Marianne, dit le chevalier s’impatientant de plus en plus ; mais j’ai des raisons pour ne pas m’en servir. – Jésus Dieu ! et quelles raisons, je vous le demande, peut avoir un homme qui a réellement son passe-partout, pour ne pas rentrer avec son passe-partout, au lieu de faire courir les escaliers et les corridors à une pauvre femme déjà écrasée d’ouvrage... Et justement, cela me rappelle que mon dîner est sur le feu. Ah ! il brûle, il brûle, je le sens ! À quoi pensez-vous, mon Dieu ?
Et mademoiselle Marianne fit un mouvement pour rentrer.
Mais le chevalier de La Graverie était à bout de patience ; d’un geste impératif il cloua la vieille fille à sa place, en disant d’une voix sévère :
– Allons, trêve de paroles, et venez m’ouvrir, vieille folle ! – Vieille folle ! vous ouvrir ! s’écria Marianne en élevant convulsivement son tricot au-dessus de sa tête, à la façon des imprécations antiques. Comment ! vous avez votre clef, vous l’avouez, vous me la montrez même, et vous voulez me faire courir par la maison et traverser la cour ? Cela ne sera pas, monsieur ; non, cela ne sera pas ! il y a longtemps que je suis lasse de vos caprices, et je ne me prêterai point à celui-là. – Oh ! l’abominable mégère ! murmura le chevalier de La Graverie tout étonné de cette résistance, et déjà brisé de sa lutte avec le chien ; je crois, en vérité, que, malgré sa supériorité dans les bisques d’écrevisses et les coulis de lapin, je serai forcé de m’en séparer ; seulement, comme je ne veux qu’à aucun prix cet épagneul maudit entre dans la maison, cédons-lui, quitte à reprendre notre revanche plus tard.
Alors, plus doucement :
– Marianne, dit-il, je comprends que vous vous étonniez de mon apparente inconséquence ; mais voici le fait : vous voyez ce chien... – Certainement que je le vois, dit l’acariâtre personne sentant qu’elle regagnait en force tout ce que consentait à perdre le chevalier. – Eh bien, il m’a suivi malgré moi depuis la caserne des dragons ; je ne sais comment m’en débarrasser, et je voudrais que vous vinssiez le chasser tandis que je rentrerai. – Un chien ! s’écria Marianne ; et c’est pour un chien que vous dérangez une honnête fille qui est depuis dix ans à votre service ? Un chien !... Ah bien, moi, je vais vous montrer comment on les chasse, les chiens.
El Marianne, pour cette fois, disparut de la fenêtre.
Le chevalier de La Graverie, convaincu que, si Marianne avait quitté la fenêtre, c’était dans le dessein de descendre et de venir l’aider dans le petit programme d’expulsion, honnête et modéré, qu’il s’était tracé vis-à-vis de l’animal, se rapprocha de la porte ; de son côté, le chien, décidément résolu à cultiver la connaissance d’un homme de la poche duquel sortaient de si bons morceaux de sucre, se rapprocha de M. de La Graverie.
Tout à coup, une espèce de cataclysme sépara l’homme de l’animal.
Une véritable avalanche d’eau, une chute du Rhin, un Niagara, tombant du premier étage, les inonda tous deux.
Le chien poussa un hurlement et s’enfuit.
Quant au chevalier, il tira son passe-partout de sa poche et l’introduisit dans la serrure, ouvrit la porte et en franchit le seuil dans un état d’exaspération facile à comprendre, et au moment même où Marianne faisait entendre cette recommandation un peu tardive :
– Prenez garde à vous, monsieur le chevalier !
III
L’extérieur et l’intérieur de la maison du chevalier de La Graverie.
Le numéro 9 de la rue des Lices consistait en un corps de logis, un jardin et une cour. Le corps de logis était situé entre la cour et le jardin. Seulement, il n’avait pas, comme d’habitude, la cour devant et le jardin derrière. Non : il avait la cour à gauche et le jardin à droite. Flanquée de cette cour et de ce jardin, la maison faisait face à la rue.
Dans la cour, par laquelle on pénétrait d’ordinaire, on ne trouvait pour tout ornement qu’une vieille vigne qui, n’ayant pas été taillée depuis dix ans, lançait le long du pignon de la maison voisine, contre laquelle elle était appuyée, des sarments d’une vigueur qui faisait penser aux forêts vierges du Nouveau-Monde.
Bien que cette cour fût pavée de grès, favorisée par l’humidité du sol et l’ombre des toits, l’herbe dans les interstices avait poussé si épaisse, si serrée, qu’elle formait une espèce de damier en relief, dont les cases étaient indiquées par les pavés.
Par malheur le chevalier de La Graverie, n’étant ni joueur d’échecs ni joueur de dames, n’avait jamais songé à tirer parti de cette circonstance, qui eût fait le bonheur de Méry ou de M. Labourdonnais.
Extérieurement, la maison avait cet aspect froid et triste qui caractérise la plupart des habitations de nos vieilles villes ; le mortier qui le recrépissait s’était écaillé par larges plaques, et la chute de ses écailles laissait voir la nature en moellons de la bâtisse, recouverte, de place en place, de lattes clouées à côté les unes des autres ; ce qui donnait à la façade l’apparence d’un visage marbré par une maladie de peau. Les fenêtres, veuves de leur peinture grisâtre et devenues noires de vétusté, étaient à petits carreaux, et encore, par économie, avait-on choisi ces carreaux parmi ceux que l’on appelle des culs de bouteille, carreaux qui ne laissent pénétrer qu’une lumière verdâtre dans les appartements.
Tant que l’on n’avait fait que traverser cette cour, et que l’on était demeuré au rez-de-chaussée, il fallait que la porte de la cuisine fût entrouverte pour que l’on prît une idée passable et une opinion suffisante du maître du logis ; car alors, et par l’entrebâillement, on apercevait des fourneaux de faïence blanche, propres et luisants comme le plancher d’un parloir hollandais, et le plus souvent, empourprés par les rougeâtres reflets d’un charbon incandescent ; à côté du fourneau, un âtre immense, où d’énormes bûches brûlaient bravement et sans parcimonie comme au temps de nos aïeux, servait de rôtissoire à une broche tournant au moyen de cette mécanique classique qui imite si agréablement le tic-tac d’un moulin ; le foyer, carrelé de briques, faisait lit à la braise, sans laquelle il n’y a pas de viande, grillée, braise que rien ne saurait remplacer, et que les économistes modernes, exécrables gastronomes pour la plupart, ont cru remplacer par un four de tôle ; en face de cette cheminée et de ces fourneaux, étincelants comme autant de soleils rougis, s’étalaient une douzaine de casseroles, s’étageant par rang de taille et fourbies tous les jours comme les canons d’un vaisseau de haut rang, depuis l’énorme chaudron non étamé où se brassent les confitures et les sirops, jusqu’au vase microscopique où s’élaborent les coulis, les mirepoix et les espagnoles de la cuisine algébrique.
Pour qui savait déjà que M. de La Graverie vivait seul, sans femme et sans enfants, sans chiens ni chats, sans commensal d’aucune sorte, enfin, avec Marianne pour tout domestique, il y avait toute une révélation dans cet arsenal culinaire, et l’on reconnaissait le fin gourmet, le raffiné gastronome livré aux jouissances de la table, aussi facilement qu’au moyen âge on reconnaissait un alchimiste aux fourneaux, aux creusets, aux cornues, aux alambics et aux lézards empaillés. Maintenant, la porte de la cuisine fermée, voici ce que l’on voyait au rez de-chaussée :
Un vestibule des plus mesquins, sans autre ornement que deux champignons de bois, auxquels le chevalier accrochait, en rentrant, à l’un son chapeau, à l’autre son parapluie, lorsqu’il sortait avec un parapluie au lieu de sortir avec une canne ; qu’un banc de chêne sur lequel s’asseyaient les domestiques quand, par hasard, le chevalier recevait, et que des carreaux de pierres blanches et noires, médiocre contrefaçon du marbre, dont elles avaient la froideur et l’humidité ; humidité et froideur qui persistaient en été comme en hiver.
Une vaste salle à manger et un immense salon, dans lequel on ne faisait de feu que quand le chevalier de La Graverie donnait à dîner, c’est-à-dire deux fois par an, composaient, avec la cuisine et le vestibule, tout le rez-de-chaussée.
Ces deux pièces tenaient, au reste, ce que l’extérieur promettait en fait de délabrement : le parquet en était disjoint et bosselé, le plafond gris et sale ; les tapisseries déchirées, souillées, arrachées, s’agitaient au souffle du vent lorsque l’on ouvrait la porte.
Dans la salle à manger, six chaises de bois peint en blanc forme empire, une table en noyer, un buffet, composaient l’ameublement.
Dans le salon, trois fauteuils et sept chaises couraient les uns après les autres sans jamais parvenir à se joindre, tandis qu’une banquette à dossier, banquette et dossier rembourrés de foin, usurpait audacieusement la place et le nom de canapé ; la décoration et le mobilier de cet appartement de réception, appartement où, sauf les cas signalés, le propriétaire ne pénétrait jamais, était complété par une table ronde à bouillotte avec son flambeau, par une pendule aux aiguilles stagnantes et au balancier immobile, par une glace en deux morceaux reflétant les rideaux de calicot à bandes jaunes et rouges qui pendaient tristement devant les fenêtres.
Mais, au premier étage, c’était différent : le premier étage était, il est vrai, habité par le chevalier de La Graverie en personne ; c’était là qu’eût conduit en droite ligne le fil parti de la cuisine, si le labyrinthe de la rue des Lices avait eu une Ariadne.
Que l’on se figure trois pièces arrangées, meublées, tapissées avec le soin minutieux et la confortable coquetterie qui semblent l’apanage des douairières ou des petites-maîtresses : tout avait été prévu, tout avait été ménagé pour rendre l’existence douce, commode et agréable dans ces trois bonbonnières, dont chacune avait sa spécialité.
Le salon, qui était la pièce principale pour la grandeur, était garni d’un meuble de forme moderne, capitonné avec le plus grand respect et la plus grande prévoyance, dans toutes les parties qui étaient destinées à servir de point d’appui à la grassouillette personne du chevalier ; une bibliothèque en bois noir, avec des incrustations de cuivre qui avaient des prétentions au Boule, était remplie de livres reliés en maroquin rouge, que la main du chevalier, il faut le dire, ne tourmentait que rarement et jamais pendant de longues séances ; une pendule représentant l’Aurore sur son char, char dont les roues formaient le cadran, flanquée de deux candélabres à cinq branches, indiquait l’heure avec une minutieuse précision ; des rideaux d’un épais lainage, assortis sur le meuble du salon, se drapaient aux fenêtres avec une élégance que n’eût point désavouée un boudoir de la Chaussée-d’Antin, tandis que des lambris à fond blanc, conservant quelques vestiges dorés, faisaient foi, dans les locataires ou les propriétaires qui avaient précédé M. de La Graverie, d’une élégance encore supérieure à la sienne.
Du salon, on passait dans la chambre à coucher.
Ce qui attirait tout d’abord les regards en entrant dans cette chambre à coucher, c’était un lit monumental comme largeur et comme hauteur. Ce lit était si élevé, que la première idée qui se présentait à l’esprit de celui qui le voyait, c’est que quiconque avait l’ambitieuse prétention de dormir dans ce lit, devait l’escalader au moyen d’une échelle ; une fois arrivé sur cette montagne de laine et de duvet, entourée par un triple rang de rideaux, le conquérant, du milieu d’une alcôve ouatée et capitonnée comme un nid de chardonneret, dominait toute la position : de là il pouvait, en ramenant son regard sur tous les points de la chambre, passer la revue des chaises, des fauteuils, des chauffeuses, des sofas et canapés, des tabourets, des coussins, des peaux de renard, s’élevant, s’étalant, s’allongeant sur une moquette épaisse et sourde comme un tapis de Smyrne, tout cela recouvert les uns ou les unes, pour l’hiver, d’étoffes souples et moelleuses ; les autres, pour l’été, de cuir ou de basane ; tous ou toutes d’une forme savante, d’une combinaison confortable, d’une courbe ingénieuse, appropriés au repos et à la sieste, et paraissant garder à leur centre une cheminée chargée de flambeaux et de candélabres, garnie de son écran, et combinée de façon à ce que pas un atome de sa chaleur ne fût perdu. Cette pièce, la plus éloignée de la rue, donnait sur le jardin de manière à ce qu’aucun bruit de charrette et de voiture, à ce qu’aucun cri de marchand ou aboiement de chiens ne vînt inquiéter le sommeil du dormeur.
En repassant de la chambre dans le salon et en traversant celui-ci dans toute sa longueur, on allait se heurter à un énorme paravent en vieux laque, non seulement originaire de Chine, mais de Coromandel, qui masquait une porte ouvrant sur une troisième pièce ; cette dernière, drapée de tapisseries, n’avait pour tout meuble qu’une petite table ronde en acajou, un seul fauteuil en acajou et une servante également en acajou, dont le dessus de marbre supportait deux seaux de plaqué destinés à faire rafraîchir le vin de Champagne ; mais, sur toutes ses faces, la chambre, bien entendu, elle était garnie d’un rang d’armoires vitrées dont le contenu en faisait le digne et précieux appendice de la cuisine.
Chacune de ces armoires, en effet, avait sa spécialité.
Dans l’une étincelait une massive argenterie, un service de porcelaine blanche à filets vert et or, et au chiffre du chevalier ; des cristaux de Bohême rouges et blancs, dont la finesse et la forme devaient certainement ajouter à la saveur des vins qu’ils étaient chargés de conduire à la bouche et de présenter, à travers deux lèvres sensuelles, aux houppes délicates du palais.
La seconde armoire contenait des pyramides d’un linge de table dont les reflets soyeux faisaient deviner la finesse.
Dans la troisième s’étalaient, comme dans une revue de soldats bien disciplinés, se tenant immobiles et rangés sur deux ou trois de hauteur, des vins d’entremets et de dessert colligés en France, en Autriche, en Allemagne, en Italie, en Sicile, en Espagne, en Grèce, emprisonnés dans leurs bouteilles nationales, les unes au col court et ramassé dans les épaules, les autres au col allongé et gracieux, celles-ci à l’estomac ventru portant étiquette, celles-là enveloppées de tresses de paille ou de roseaux, toutes attrayantes, pleines de promesses parlant à la fois à l’imagination et à la curiosité, et flanquées, comme un corps d’armée de troupes légères ; de liqueurs cosmopolites, dans leurs cuirasses de verre de toutes couleurs et de toutes formes.
Dans la dernière enfin, et c’était la plus grande ; s’accrochaient à la muraille, pendaient aux angles, se prélassaient sur les planches, des comestibles de toute espèce, terrines de Nérac, saucissons d’Arles et de Lyon, pâtes d’abricots d’Auvergne, gelées de pommes de Rouen, confitures de Bar, conserves du Mans, pots de gingembre de Chine, pickles et sauces anglaises de tout acabit, piment, anchois, sardines, poivre de Cayenne, fruits secs, fruits confits ; enfin, tout ce que le bon et savant Dufouilloux dénombre et désigne par ces quatre mots d’expression et dignes de rester dans la mémoire de tous les gourmands : le harnois de gueule.
Après cette visite domiciliaire, peut-être un peu minutieuse, mais qui cependant nous a paru nécessaire, le lecteur devinera sans peine que M. le chevalier de La Graverie était un homme très charitablement occupé de sa personne et fort soucieux des satisfactions de son estomac ; seulement, nous ajouterons, pour ne pas laisser dans l’ombre un seul des traits de cette esquisse que nous sommes, en train de tracer de lui, que cette tendance bien caractérisée vers la gourmandise était contrariée par la manie qu’avait le digne gentilhomme de se croire constamment malade et de se tâter le pouls tous les quarts d’heure.
Nous ajouterons encore qu’il était collectionneur de roses enragé ; puis, arrivé à ce point de notre récit et sentant l’impossibilité d’aller plus loin, non seulement sans faire une halte, mais même sans retourner de quarante-huit à cinquante ans en arrière, nous demanderons à nos lecteurs la permission de leur raconter comment ces trois infirmités morales étaient venues au pauvre chevalier.
IV
Comment et dans quelles circonstances naquit le chevalier de La Graverie.
Qu’on ne s’étonne pas trop de ce retour rétrospectif, que le lecteur a dû prévoir, au reste, en voyant que nous prenions notre héros à l’âge où d’habitude les aventures les plus intéressantes de la vie, c’est-à-dire les aventures d’amour, sont terminées ; nous nous engageons à ne pas dépasser l’an 1793.
En 1793, donc, M. le baron de La Graverie, père du chevalier, était dans les prisons de Besançon, sous la double accusation d’incivisme et de correspondance avec les émigrés.
M. le baron de La Graverie eût bien pu alléguer pour sa défense qu’à son point de vue, à lui, il n’avait fait qu’obéir aux lois les plus sacrées de la nature, en faisant parvenir quelque argent à son fils aîné et à son frère, tous deux à l’étranger ; il y a des moments où les lois sociales passent avant les lois naturelles, et cette allégation, il n’avait pas même songé à la faire ; or, le crime du baron de La Graverie était un de ceux qui, à cette époque, conduisaient le plus sûrement un homme à l’échafaud.
Aussi madame la baronne de La Graverie, restée libre, fit-elle, malgré un étal avancé de grossesse, les démarches les plus actives pour faire évader son mari.
Grâce à l’or qu’avait prodigué la pauvre femme, son petit complot marchait assez bien. Le geôlier avait promis d’être aveugle ; le guichetier avait porté au prisonnier une lime et des cordes à l’aide desquelles il devait scier un barreau et gagner la rue, dans laquelle madame de La Graverie l’attendrait pour quitter la France.
La fuite était fixée au lendemain 14 mai.
Jamais heures ne semblèrent plus longues que les heures de cette fatale journée ne le parurent à la pauvre femme. À chaque instant elle regardait l’horloge et maudissait sa lenteur. Parfois, le sang refluait à son cœur et l’étouffait tout à coup, et elle se disait qu’il était impossible qu’elle vit jamais luire l’aurore de ce lendemain si désiré.
Vers quatre heures du soir, n’y pouvant plus tenir, elle résolut, pour adoucir les terribles angoisses qui l’agitaient, d’aller trouver un prêtre réfractaire qu’une de ses amies cachait dans sa cave, et de lui demander d’unir ses prières aux siennes pour appeler la miséricorde divine sur le malheureux prisonnier.
Madame de La Graverie sortit donc.
En essayant de traverser, malgré son encombrement, une des ruelles qui conduisaient au marché, elle entendit sur la place le bruit sourd et continu d’une grande multitude. Elle essaya alors de revenir sur ses pas ; mais c’était chose impossible, la foule fermait l’issue ; marchant en avant, cette foule l’emporta sur un de ses flots, et, de même qu’un fleuve se jette dans la mer, le courant qui l’entraînait déboucha sur la place.
La place était encombrée de monde, et, au-dessus des têtes de tout ce monde, se dressait la rouge silhouette du bourreau et la guillotine, au haut de laquelle étincelait, empourpré par un dernier rayon de soleil couchant, le fatal couperet, terrible emblème de l’égalité, sinon devant la loi, du moins devant la mort.
Madame de La Graverie frissonna et voulut fuir.
C’était encore plus impossible que la première fois ; un nouveau flot de peuple avait envahi la place et l’avait poussée au centre, et il ne fallait pas songer à rompre les rangs pressés de la multitude ; l’essayer, c’était risquer de se faire reconnaître pour aristocrate et compromettre dans sa personne non seulement son propre salut, mais encore celui de son mari.
L’intelligence de madame de La Graverie, tendue depuis quelques jours vers un seul but, celui de l’évasion du baron, avait acquis un admirable degré de lucidité.
Elle songeait à tout.
Elle se résigna et se fit forte pour supporter avec courage, et sans trop témoigner son horreur, L’épouvantable spectacle qui allait se passer sous ses yeux.
Elle ne voila pas son visage de ses mains, démonstration qui eût attiré sur elle l’attention de ses voisins ; mais elle ferma les yeux.
Une immense clameur, qui gagnait de proche en proche, comme fait une traînée de poudre enflammée, annonça l’arrivée des victimes.
Il se fit bientôt un refoulement indiquant que la charrette passait et prenait sa place.
Quoique pressée, ballottée, soulevée même par la foule, madame de La Graverie, jusque-là, avait tenu bon et n’avait point regardé ; mais en ce moment une force invisible et invincible surtout lui relevait les paupières. Elle ouvrit donc les yeux, aperçut à quelques pas d’elle la charrette des condamnés, et dans cette charrette, son mari !
À cette vue, elle s’élança en avant en poussant un cri si terrible, que les curieux qui l’entouraient s’écartèrent pour laisser passer cette femme éperdue, haletante, aux yeux hagards ; elle refoula ceux qui la séparaient encore du tombereau, avec la toute-puissance que la femme la plus frêle trouve dans le paroxysme de la douleur poussée jusqu’au désespoir, et faisant, pour ainsi dire, le trou du boulet de canon dans cette masse compacte, elle atteignit la charrette.
Son premier sentiment et son premier effort furent de l’escalader pour arriver à son mari ; mais les gendarmes, revenus de leur première surprise, la repoussèrent.
Alors elle se cramponna aux ridelles de la voiture et fit entendre des hurlements de folle ; puis, s’arrêtant tout à coup sans transition, elle se mit à supplier les bourreaux de son mari, comme jamais patient n’avait supplié les siens.
Ce fut un spectacle si horrible, que, malgré les appétits sanguinaires que la quotidienneté de ces horribles drames avait nécessairement développés dans la multitude, plus d’un farouche sans-culotte, plus d’une de ces abominables mégères des halles que l’on désignait du nom effroyablement caractéristique de lécheuses de guillotine, sentirent de grosses larmes ruisseler le long de leurs joues. Aussi, lorsque la nature eut succombé sous l’étreinte de la douleur, lorsque madame de La Graverie, sentant ses forces l’abandonner, fut forcée de lâcher la charrette et s’évanouit, la pauvre créature trouva autour d’elle des cœurs compatissants empressés à la secourir.
On la rapporta chez elle, et le médecin fut immédiatement appelé.
Mais la secousse avait été trop violente ; la pauvre femme mourut au bout de quelques heures, dans un accès de délire, tout en donnant naissance, deux mois avant terme, à un enfant faible et captif comme un roseau, qui fut ce même chevalier de La Graverie dont nous écrivons aujourd’hui l’intéressante histoire.
La sœur aînée de madame de La Graverie, la chanoinesse de Beauterne, se chargea du pauvre petit orphelin, qui, venu à sept mois, était si délicat, que le médecin regardait comme impossible que l’on arrivât à le faire vivre.
Mais la douleur que lui causait la mort tragique de sa sœur et de son beau-frère développa chez cette vieille fille les instincts ; maternels que Dieu a mis au cœur de chaque femme, mais que le célibat dessèche et raccornit dans celui des vieilles filles.
Le vœu le plus ardent de madame de Beauterne était d’aller retrouver ceux qu’elle pleurait, après avoir dignement et pieusement accompli la tâche que leur mort lui avait léguée ; elle voulut, avec cet entêtement qui caractérise les célibataires, que l’enfant vécût, et, en dépensant des trésors de patience et d’abnégation, elle arriva à faire mentir l’horoscope de l’homme de science, bien plus certain, cependant, lorsqu’il prédit la mort que lorsqu’il promet la vie.
Aussitôt que les chemins furent libres, nantie de son trésor, c’est ainsi que madame de Beauterne appelait Stanislas-Dieudonné de La Graverie, elle alla s’enfermer dans la communauté de chanoinesses allemandes dont elle faisait partie.
Une communauté de chanoinesses, hâtons-nous de donner cette explication à nos lecteurs, n’est pas un couvent : c’est bien plutôt, et presque au contraire, devrions-nous dire, une réunion de femmes du monde, rapprochées autant par leurs goûts et par leurs besoins que par les rigueurs de la dévotion ; elles sortent quand bon leur semble, reçoivent qui leur plaît ; leur toilette même se ressent de la facilité de leurs vœux, et, tant que l’élégance et même la coquetterie ne semblent compromettre que le salut du prochain, elles sont tolérées dans l’ordre.
Ce fut dans ce milieu moitié mondain, moitié religieux, que le petit La Graverie fut élevé. Ce fut entre ces bonnes et aimables femmes qu’il grandit.
Les lugubres accidents qui avaient signalé sa naissance intéressèrent prodigieusement à sa destinée toute la petite congrégation ; aussi jamais enfant, fût-il l’héritier d’un prince, d’un roi ou d’un empereur, ne fut choyé, ne fut dorloté, ne fut gâté comme celui-là. C’était entre les bonnes dames une émulation de gâteries dans laquelle, malgré sa tendresse pour le jeune Dieudonné, madame de Beauterne était presque toujours distancée ; une larme de l’enfant causait une migraine générale à toute la communauté ; chacune de ses dents amena dix nuits d’insomnie, et, n’était le rigoureux cordon sanitaire que la tante avait établi contre les friandises, l’impitoyable système de douanes qu’elle exerçait vis-à-vis des poches, le jeune de La Graverie eût succombé dans son bas âge, gorgé de douceurs, bourré de bonbons comme Vert-Vert, de sorte que notre narration serait déjà finie, ou plutôt n’aurait jamais commencé.
La sollicitude générale à son égard fut si grande, que son éducation s’en ressentit quelque peu.
En effet, la proposition que madame de Beauterne hasarda un beau jour, et qui ne tendait pas à moins qu’à envoyer Dieudonné parfaire son éducation chez les jésuites de Fribourg, fit jeter les hauts cris à toutes les chanoinesses. On la taxa de dureté envers le pauvre enfant, et le projet rencontra une réprobation si universelle, que la bonne tante, dont le cœur ne demandait pas mieux que de se rendre, n’essaya pas même de la braver.
En conséquence, le petit bonhomme resta libre de n’apprendre que ce qui lui plairait, ou à peu près ; et, comme la nature ne lui avait pas départi des inclinations scientifiques exagérées, il en résulta qu’il demeura très ignorant ;
Il eût été déraisonnable d’espérer que les bonnes et dignes femmes cultiveraient le moral de leur élève avec plus de perspicacité qu’elles ne faisaient de son intelligence ; elles ne lui apprirent donc non seulement rien des hommes parmi lesquels il était destiné à vivre, ni des usages auxquels il devait se heurter, mais encore, par le soin avec lequel elles éloignèrent de leur petite poupée les réalités brutales de ce monde, les sensations qui pouvaient froisser sa tendresse, les secousses qui pouvaient faire tressaillir son cœur, elles développèrent outre mesure cette sensibilité nerveuse déjà disposée à être excessive par les émotions dont l’enfant, comme Jacques Ier, avait subi le contrecoup dans le sein maternel.
Quant aux études physiques qui constituent l’éducation d’un gentilhomme, il en fut de même ; on ne voulut jamais permettre que le jeune Dieudonné prît des leçons d’équitation, de sorte que l’enfant n’eut jamais d’autre monture que l’âne du jardinier, et encore, lorsqu’il montait sur cet âne, l’animal était-il conduit par une des bonnes dames, qui remplissait bénévolement près du jeune de La Graverie le rôle qu’accomplissait avec tant de répugnance Aman près de Mardochée.
Il y avait dans la ville où était située la communauté religieuse un excellent maître d’armes, et l’on discuta un instant si l’on ne ferait pas apprendre l’escrime au jeune Dieudonné ; mais, outre que c’était un exercice fatigant, quelle chance qu’avec son charmant caractère, si plein de douceur et d’aménité, le chevalier de La Graverie eût jamais une querelle ! Il eût fallu être un monstre de noirceur et de méchanceté pour lui vouloir du mal, et, Dieu merci ! les monstres sont rares,
À cent pas du couvent coulait une rivière magnifique, qui étendait, à travers les prés bariolés de pâquerettes et de boutons d’or, ses eaux au cours insensible et unies comme un miroir ; les jeunes gens de l’université voisine allaient là tous les jours accomplir des prouesses près desquelles celles du plongeur de Schiller étaient bien pâles ; on pouvait envoyer le jeune Dieudonné trois fois par semaine à cette rivière, et, sous la direction d’un excellent nageur, faire de lui un pêcheur de perles ; mais la rivière était un composé d’eaux de sources dont la fraîcheur pouvait avoir sur la santé de l’enfant une influence désastreuse ; Dieudonné se contenta de barboter deux fois par semaine dans la baignoire de sa tante.
Dieudonné ne sut donc ni nager, ni faire des armes, ni monter à cheval.
Il y avait là, comme on le voit, une grande ressemblance entre son éducation et celle d’Achille. Seulement si, au milieu des bonnes dames qui entouraient le chevalier de La Graverie, un Ulysse quelconque eût apparu, tirant une épée du fourreau, il est probable qu’au lieu de sauter sur le glaive, comme fit le fils de Thétis et de Pélée, Dieudonné, ébloui de l’éclair du soleil sur la lame, se fût sauvé au plus profond des caves de la communauté.
Tout cela faisait à Dieudonné un tempérament physique et moral des plus déplorables.
Il avait seize ans, qu’il ne pouvait pas voir une larme trembler à la paupière d’autrui, sans se mettre à l’instant même à pleurer à l’unisson ; la mort de son moineau ou de son serin lui donnait des attaques de nerfs ; il composait de touchantes élégies sur le trépas d’un hanneton écrasé par mégarde ; le tout à la grande satisfaction et à l’applaudissement unanime des chanoinesses, qui exaltaient l’exquise délicatesse de son cœur, sans se douter que cette exagération de sensibilité devait nécessairement conduire leur idole à une fin prématurée, ou amener une réaction égoïste dans ces sentiments par trop philanthropiques.
D’après ces prémisses, on ne doit point s’attendre à voir Dieudonné recevoir de ses institutrices des préceptes sur l’art de plaire et des leçons sur la science d’aimer.
Il en fut pourtant ainsi.
Madame de Florsheim, une des compagnes de madame de Beauterne, comme celle-ci son neveu, avait sa nièce auprès d’elle.
Cette nièce, de deux ans plus jeune que Dieudonné, s’appelait Mathilde.
Elle était blonde, comme toutes les Allemandes ; comme toutes les Allemandes elle avait, en sortant du maillot, deux grands yeux bleus qui pleuraient le sentiment.
Or, dès que les deux petites créatures purent marcher sans lisières, il sembla divertissant aux bonnes chanoinesses de les pousser l’une vers l’autre.
Donc, si l’on n’apprit pas ou ne fit pas apprendre à Dieudonné à monter à cheval, à faire des armes et à nager, on lui apprit autre chose.
Quand, après avoir couru dans le parterre de la communauté, vêtu, comme un berger de Watteau, d’un habit et d’une culotte de satin bleu de ciel, d’un gilet blanc, de bas de soie et de souliers à talons rouges, Dieudonné revenait avec un bouquet de myosotis ou une branche de chèvrefeuille, on lui apprenait à présenter cette branche de chèvrefeuille ou ce bouquet de myosotis à sa jeune amie, et cela, en fléchissant le genou, selon les traditions de l’antique chevalerie.
Quand le temps était mauvais et que l’on ne pouvait sortir, que madame de Beauterne se mettait à son épinette et jouait l’air du Menuet d’Exaudet, on voyait s’avancer comme deux petites poupées à ressorts, se tenant par la main, Dieudonné et Mathilde, cette dernière, bien entendu, aussi bergère que son danseur était berger ; et alors commençait une représentation chorégraphique qui épanouissait les yeux et les cœurs des bonnes chanoinesses.
Enfin, lorsque le menuet fini, Dieudonné baisait galamment la petite main blanche et parfumée de sa danseuse, alors c’était un ravissement général : les bonnes dames se pâmaient d’aise, pressaient les enfants dans leurs bras et les étouffaient de baisers.
Ce n’était plus Dieudonné, ce n’était plus Mathilde ; c’était le petit mari, c’était la petite femme ; et, quand on les voyait s’enfoncer sous les grands arbres du parc, comme deux miniatures d’amants, au lieu de leur crier : « N’allez point là, enfants, la solitude est dangereuse et le demi-jour est à craindre », les bonnes chanoinesses eussent, si cela leur eût été possible, changé le demi-jour en crépuscule, et chassé de la solitude jusqu’aux rouge-gorges et aux grillons.
Il en résultait que les deux bambins dédaignaient les jeux de leur âge pour des afféteries de sentiment qui énervaient prématurément leurs sens et défloraient leurs âmes.
Aussi, quelque purs, quelque angéliques que dussent sembler ces amours aux bonnes fées qui les protégeaient, le diable, qui les regardait du coin de l’œil, se promettait de n’y perdre rien.
C’était, en effet, fort imprudent de la part de ces saintes femmes de se conduire ainsi.
Mais que voulez-vous !
Les deux pauvres enfants étaient pour les mondaines recluses le regard de regret que le voyageur donne à la belle et riante vallée qu’il vient de traverser et qu’il quitte pour entrer dans la région des sables arides et désolés ; il est vrai que, si ce spectacle reposait momentanément ces pauvres vieux cœurs endoloris, s’il redorait pour quelques instants les illusions de jeunesse perdues, s’il faisait oublier momentanément les dents d’ivoire et les cheveux cendrés, il est certain que, dans le retour que les pauvres femmes refaisaient sur elles, il leur coûtait, en définitive, plus de larmes que de sourires ; qu’après les joies éphémères de ce mirage, la résignation devenait plus difficile, l’espérance plus confuse, la foi plus tiède, et que bien des soupirs, qui ne venaient pas de cœurs contrits, se mêlaient aux prières qui venaient de cœurs souffrants.
Enfin, chose plus grave, sans paraître s’en douter le moins du monde, les graves dames profanaient ce qu’il y a de plus saint et de plus sacré sur terre, l’enfance.





























