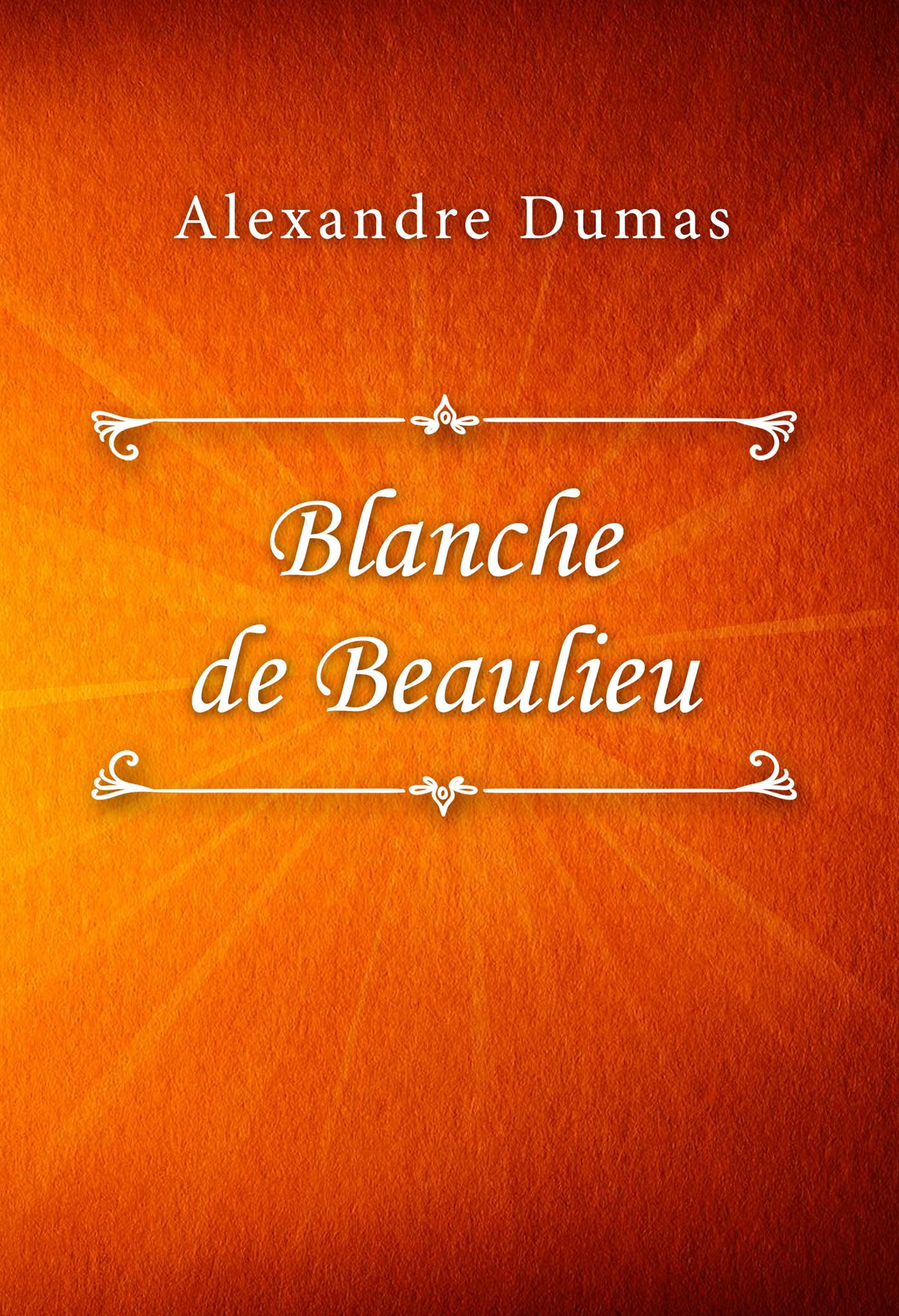
0,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Classica Libris
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
1793: Olivier et d’Hervilly, deux généraux républicains, sont envoyés pour surprendre une messe clandestine dans le bocage vendéen; ils assistent écoeurés à un carnage qu’ils ne cautionnent pas. Soudain, un jeune Vendéen vient supplier Olivier de le sauver. Olivier dépouille un cadavre républicain de son uniforme et revient pour en revêtir le Vendéen qui a perdu connaissance.
En dégrafant son habit, Olivier découvre qu’il s’agit d’une jeune fille. Elle s’appelle Blanche. Olivier et d’Hervilly la prenne sous leur protection et Olivier demande une permission pour se rendre à Nantes où réside sa famille et mettre sa protégée en sécurité. Avant leur départ, ils doivent dîner avec le représentant du peuple Delmar qui remarque la pâleur et l’effroi du très jeune soldat qui accompagne Olivier.
A Nantes, Blanche reprend des vêtements de femme et devient l’amie des sœurs d’Olivier. Mais un soir, Delmar, qui vient rendre visite à Carrier, reconnaît en Blanche le soldat inquiet avec qui il a dîné quelques jours plus tôt. Dès le lendemain, Olivier reçoit l’ordre de rejoindre l’armée. Ne pouvant désobéir, il quitte Nantes et Blanche dont il est éperdument amoureux. Il vient de parcourir quelques lieues quand il est rejoint par d’Hervilly qui lui annonce l’arrestation de Blanche.
Olivier retourne en ville et force les portes de la prison. Là, il demande à Blanche de devenir sa femme, persuadé que Carrier n’exécutera pas l’épouse d’un général républicain. Les amants reçoivent la bénédiction d’un prêtre réfractaire et Olivier part à bride abattue vers Paris où Robespierre accepte de gracier Blanche. Olivier revient vers Nantes. Malgré sa célérité, il arrive au moment où le bourreau lève la tête de Blanche pour la montrer à la foule.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Alexandre Dumas
BLANCHE DE BEAULIEU
et autres histoires
Copyright
First published in 1852
Copyright © 2020 Classica Libris
Blanche de Beaulieu
ou La Vendéenne
I
Celui qui, dans la soirée du 15 décembre 93, serait parti de la petite ville de Clisson pour se rendre au village de Saint-Crépin, et se serait arrêté sur la crête de la montagne au pied de laquelle coule la rivière de la Moine, aurait vu de l’autre côté de la vallée un étrange spectacle.
D’abord, à l’endroit où sa vue aurait cherché le village perdu dans les arbres, au milieu d’un horizon déjà assombri par le crépuscule, il eût aperçu trois ou quatre colonnes de fumée, qui, isolées à leur base, se joignaient en s’élargissant, se balançaient un instant comme un dôme bruni, et, cédant mollement à un vent humide d’ouest, roulaient dans cette direction, confondus avec les nuages d’un ciel bas et brumeux ; il eût vu cette base rougir lentement, puis toute fumée cesser, et, des toits des maisons, des langues de feu aiguës s’élancer à leur place avec un frémissement sourd, tantôt se tordant en spirales, tantôt se courbant et se relevant comme le mât d’un vaisseau ; il lui eût semblé que bientôt toutes les fenêtres s’ouvraient pour vomir du feu ; de temps en temps, quand un toit s’enfonçait, il eût entendu un bruit sourd ; il eût distingué une flamme plus vive, mêlée de milliers d’étincelles, et, à la lueur sanglante de l’incendie s’agrandissant, des armes luire, un cercle de soldats s’étendre au loin ; il eût entendu des cris et des rires, et il eût dit avec terreur : Dieu me pardonne, c’est une armée qui se chauffe avec un village.
Effectivement, une brigade républicaine de douze ou quinze cents hommes avait trouvé le village de Saint-Crépin abandonné et y avait mis le feu.
Ce n’était point une cruauté, mais un moyen de guerre, un plan de campagne comme un autre ; l’expérience prouva qu’il était le seul qui fût bon.
Cependant une chaumière isolée ne brûlait pas, on semblait même avoir pris toutes les précautions nécessaires pour que le feu ne pût l’atteindre. Deux sentinelles veillaient à la porte, et, à chaque instant, des officiers d’ordonnance, des aides de camp entraient, puis bientôt sortaient pour porter des ordres.
Celui qui donnait ces ordres était un jeune homme qui paraissait âgé de vingt à vingt-deux ans ; de longs cheveux blonds séparés sur le front tombaient en ondulant de chaque côté de ses joues blanches et maigres ; toute sa figure portait l’empreinte de cette tristesse fatale qui s’attache au front de ceux qui doivent mourir jeunes. Son manteau bleu, en l’enveloppant, ne le cachait pas si bien qu’il ne laissât apercevoir les signes de son grade, deux épaulettes de général ; seulement ces épaulettes étaient de laine, les officiers républicains ayant fait à la Convention l’offrande patriotique de tout l’or de leurs habits. Il était courbé sur une table, une carte géographique était déroulée sous ses yeux, et il y traçait au crayon, à la clarté d’une lampe qui s’effaçait elle-même devant la lueur de l’incendie, la route que ses soldats allaient suivre. C’était le général Marceau, qui, trois ans plus tard, devait être tué à Altenkirchen.
– Alexandre ! dit-il en se relevant à demi... Alexandre ! éternel dormeur, rêves-tu de Saint-Domingue, que tu dors si longtemps ?
– Qu’y a-t-il ? dit en se levant tout debout et en sursaut celui auquel il s’adressait, et dont la tête toucha presque le plafond de la cabane ; qu’y a-t-il ? est-ce l’ennemi qui nous vient ? et ces paroles furent dites avec un léger accent créole qui leur conservait de la douceur même au milieu de la menace.
– Non, mais un ordre du général en chef Westermann qui nous arrive.
Et pendant que son collègue lisait cet ordre, car celui qu’il avait apostrophé était son collègue, Marceau regardait avec unecuriosité d’enfant les formes musculeuses de l’Hercule mulâtre qu’il avait devant les yeux.
C’était un homme de vingt-huit ans, aux cheveux crépus et courts, au teint brun, au front découvert et aux dents blanches, dont la force presque surnaturelle était connue de toute l’armée, qui lui avait vu, dans un jour de bataille, fendre un casque jusqu’à la cuirasse, et un jour de parade, étouffer entre ses jambes un cheval fougueux qui l’emportait. Celui-là n’avait pas longtemps à vivre non plus ; mais moins heureux que Marceau, il devait mourir loin du champ de bataille, empoisonné par l’ordre d’un roi. C’était le général Alexandre Dumas, c’était mon père.
– Qui t’a apporté cet ordre ? dit-il.
– Le représentant du peuple, Delmar.
– C’est bien. Et où doivent se rassembler ces pauvres diables ?
– Dans un bois à une lieue et demie d’ici ; vois sur la carte, c’est là.
– Oui, mais sur la carte il n’y a pas les ravins, les montagnes, les arbres coupés, les mille chemins qui embarrassent la vraie route, où l’on a peine à se reconnaître, même dans le jour... Infernal pays... Avec cela qu’il y fait toujours froid.
– Tiens, dit Marceau, en poussant la porte du pied, et en lui montrant le village en feu, sors, et tu te chaufferas... Hé ! qu’est-ce là, citoyens ?
Ces paroles étaient adressées à un groupe de soldats qui, en cherchant des vivres, avaient découvert, dans un espèce de chenil attenant à la chaumière où étaient les deux généraux, un paysan vendéen qui paraissait tellement ivre, qu’il était probable qu’il n’avait pu suivre les habitants du village, lorsqu’ils l’avaient abandonné.
Que le lecteur se figure un métayer à visage stupide, au grand chapeau, aux cheveux longs, à la veste grise ; être ébauché à l’image de l’homme, espèce de degré au-dessous de la bête ; car il était évident que l’instinct manquait à cette masse. Marceau lui fit quelques questions ; le patois et le vin rendirent ses réponses inintelligibles. Il allait l’abandonner comme un jouet aux soldats, lorsque le général Dumas donna brusquement l’ordre d’évacuer la chaumière et d’y enfermer le prisonnier. Il était encore à la porte, un soldat le poussa dans l’intérieur, il alla en trébuchants’appuyer contre le mur, chancela un instant en oscillant sur ses jambes demi-ployées ; puis, tombant lourdement étendu, demeura sans mouvement. Un factionnaire resta devant la porte, et l’on ne prit pas même la peine de fermer la fenêtre.
– Dans une heure nous pourrons partir, dit le général Dumas à Marceau ; nous avons un guide.
– Lequel ?
– Cet homme.
– Oui, si nous voulons nous mettre en route demain, soit. Il y a dans ce que ce drôle a bu du sommeil pour vingt-quatre heures.
Dumas sourit :
– Viens, lui dit-il ; et il le conduisit sous le hangar où le paysan avait été découvert ; une simple cloison le séparait de l’intérieur de la cabane, encore était-elle sillonnée de fentes qui laissaient distinguer ce qui s’y passait, et avaient dû permettre d’entendre jusqu’à la moindre parole des deux généraux qui un instant auparavant s’y trouvaient.
– Et maintenant, ajouta-t-il en baissant la voix, regarde.
Marceau obéit, cédant à l’ascendant qu’exerçait sur lui son ami, même dans les choses habituelles de la vie. Il eut quelque peine à distinguer le prisonnier, qui, par hasard, était tombé dans le coin le plus obscur de la chaumière. Il gisait encore à la même place, immobile ; Marceau se retourna pour chercher son collègue, il avait disparu.
Lorsqu’il reporta ses regards dans la cabane, il lui sembla que celui qui l’habitait avait fait un léger mouvement ; sa tête était replacée dans une direction qui lui permettait d’embrasser d’un coup d’œil tout l’intérieur. Bientôt il ouvrit les yeux avec le bâillement prolongé d’un homme qui s’éveille, et il vit qu’il était seul.
Un singulier éclair de joie et d’intelligence passa sur son visage.
Dès lors il fut évident pour Marceau qu’il eût été la dupe de cet homme, si un regard plus clairvoyant n’avait tout deviné. Il l’examina donc avec une nouvelle attention ; sa figure avait repris sa première expression, ses yeux étaient refermés, ses mouvements étaient ceux d’un homme qui se rendort ; dans l’un d’eux, il accrocha du pied la table légère qui soutenait la carte et l’ordre du général Westermann que Marceau avait rejeté sur cette table, tout tomba pêle-mêle, le soldat de faction entrouvrit la porte,avança la tête à ce bruit, vit ce qui l’avait causé, et dit en riant à son camarade : « C’est le citoyen qui rêve. »
Cependant, celui-ci avait entendu ces paroles, ses yeux s’étaient rouverts, un regard de menace poursuivit un instant le soldat ; puis, d’un mouvement rapide, il saisit le papier sur lequel était écrit l’ordre, et le cacha dans sa poitrine.
Marceau retenait son souffle ; sa main droite semblait collée à la poignée de son sabre, sa main gauche supportait avec son front tout le poids de son corps appuyé contre la cloison.
L’objet de son attention était alors posé sur le côté ; bientôt, en s’aidant du coude et du genou, il s’avança lentement toujours couché vers l’entrée de la cabane ; l’intervalle qui se trouvait entre le seuil et la porte lui permit d’apercevoir les jambes d’un groupe de soldats qui se tenaient devant. Alors, avec patience et lenteur, il se remit à ramper vers la fenêtre entrouverte ; puis arrivé à trois pieds d’elle, il chercha dans sa poitrine une arme qui y était cachée, ramassa son corps sur lui-même, et d’un seul bond, d’un bond de jaguar, s’élança hors de la cabane. Marceau jeta un cri, il n’avait eu le temps ni de prévoir ni d’empêcher cette fuite. Un autre cri répondit au sien : celui-là était de malédiction. Le Vendéen, en tombant hors de la fenêtre, s’était trouvé face à face avec le général Dumas ; il avait voulu le frapper de son couteau, mais celui-ci, lui saisissant le poignet, l’avait ployé contre sa poitrine, et il n’avait plus qu’à pousser pour que le Vendéen se poignardât lui-même.
– Je t’avais promis un guide, Marceau, en voici un, et intelligent, je l’espère.
– Je pourrais te faire fusiller, drôle, dit-il au paysan, il m’est plus commode de te laisser vivre. Tu as entendu notre conversation, mais tu ne la reporteras pas à ceux qui t’ont envoyé. – Citoyens, – il s’adressait aux soldats que cette scène curieuse avait amenés –, que deux de vous prennent chacun une main à cet homme, et se placent avec lui à la tête de la colonne, il sera notre guide ; si vous apercevez qu’il vous trompe, s’il fait un mouvement pour fuir, brûlez-lui la cervelle, et jetez-le par-dessus la haie.
Puis quelques ordres donnés à voix basse allèrent agiter cette ligne rompue de soldats qui s’étendait alentour des cendres qui avaient été un village. Ces groupes s’allongèrent, chaque pelotonsembla se souder à l’autre. Une ligne noire se forma, descendit dans le long chemin creux qui sépare Saint-Crépin de Montfaucon, s’y emboîta comme une roue dans une ornière, et, lorsque, quelques minutes après, la lune passa entre deux nuages, et se réfléchit un instant sur ce ruban de baïonnettes qui glissaient sans bruit, on eût cru voir ramper dans l’ombre un immense serpent noir à écailles d’acier.
II
C’est une triste chose pour une armée qu’une marche de nuit. La guerre est belle par un beau jour, quand le ciel regarde la mêlée, quand les peuples, se dressant alentour du champ de bataille comme aux gradins d’un cirque, battent des mains aux vainqueurs ; quand les sons frémissants des instruments de cuivre font tressaillir les fibres courageuses du cœur, quand la fumée de mille canons vous couvre d’un linceul, quand amis et ennemis sont là pour voir comme vous mourrez bien : c’est sublime ! Mais la nuit, la nuit... ! Ignorer comment on vous attaque et comment vous vous défendez, tomber sans voir qui vous frappe ni d’où le coup part, sentir ceux qui sont debout encore vous heurter du pied sans savoir qui vous êtes, et marcher sur vous... ! Oh ! alors, on ne se pose pas comme un gladiateur, on se roule, on se tord, on mord la terre, on la déchire des ongles ; c’est horrible !
Voilà pourquoi cette armée marchait triste et silencieuse ; c’est qu’elle savait que de chaque côté de sa route se prolongeaient de hautes haies, des champs entiers de genêts et d’ajoncs et qu’au bout de ce chemin il y avait un combat, un combat de nuit.
Elle marchait depuis une demi-heure ; de temps en temps, comme je l’ai dit, un rayon de la lune filtrait entre deux nuages et laissait apercevoir, à la tête de cette colonne, le paysan qui servait de guide, l’oreille attentive au moindre bruit, et toujours surveillé par les deux soldats qui marchaient à ses côtés. Parfois onentendait sur les flancs un froissement de feuilles, la tête de la colonne s’arrêtait tout à coup ; plusieurs voix criaient qui vive... ? Rien ne répondait, et le paysan disait en riant : C’est un lièvre qui part du gîte. Quelquefois les deux soldats croyaient voir devant eux s’agiter quelque chose qu’ils ne pouvaient distinguer, ils se disaient l’un à l’autre : « Regarde donc... ! » et le Vendéen répondait : « C’est votre ombre, marchons toujours. » Tout à coup, au détour du chemin, ils virent se dresser devant eux deux hommes ; ils voulurent crier ; l’un des soldats tomba sans avoir eu le temps de proférer une parole ; l’autre chancela une seconde, et n’eut que le temps de dire : « À moi ! »
Vingt coups de fusil partirent à l’instant ; à la lueur de cet éclair, on put distinguer trois hommes qui fuyaient ; l’un d’eux chancela, se traîna un instant le long du talus, espérant atteindre l’autre côté de la haie. On courut à lui, ce n’était pas le guide ; on l’interrogea, il ne répondit point ; un soldat lui perça le bras de sa baïonnette pour voir s’il était bien mort : il l’était.
Ce fut alors Marceau qui devint le guide. L’étude qu’il avait faite des localités lui laissait l’espoir de ne point s’égarer. Effectivement, après un quart d’heure de marche, on aperçut la masse noire de la forêt. Ce fut là que, selon l’avis qu’en avaient reçu les républicains, devaient se rassembler, pour entendre une messe, les habitants de quelques villages, les débris de plusieurs armées, dix-huit cents hommes à peu près.
Les deux généraux séparèrent leur petite troupe en plusieurs colonnes, avec ordre de cerner la forêt et de se diriger par toutes les routes qui tendraient au centre ; on calcula qu’une demi-heure suffirait pour prendre les positions respectives. Un peloton s’arrêta à la route qui se trouvait en face de lui ; les autres s’étendirent en cercle sur les ailes ; on entendit encore un instant le bruit cadencé de leurs pas, qui allait s’affaiblissant ; il s’éteignit tout à fait, et le silence s’établit. – La demi-heure qui précède un combat passe vite. À peine si le soldat a le temps de voir si son fusil est bien amorcé, et de dire au camarade : « J’ai vingt ou trente francs dans le coin de mon sac ; si je meurs, tu les enverras à ma mère. »
Le mot en avantretentit, et chacun tressaillit, comme s’il ne s’y attendait pas.
Au fur et à mesure qu’il s’avançaient, il leur semblait que le carrefour qui forme le centre de la forêt était éclairé ; en approchant, ils distinguèrent des torches qui flamboyaient ; bientôt les objets devinrent plus distincts, et un spectacle dont aucun d’eux n’avait l’idée s’offrit à leur vue.
Sur un autel grossièrement représenté par quelques pierres amoncelées, le curé de Sainte-Marie-de-Rhé disait une messe, des vieillards entouraient l’autel, une torche à la main, et tout alentour des femmes, des enfants, priaient à deux genoux. Entre les républicains et ce groupe, une muraille d’hommes était placée, et sur un front plus rétréci présentait le même plan de bataille pour la défense que pour l’attaque : il eût été évident qu’ils avaient été prévenus, quand même on n’eût pas reconnu au premier rang le guide qui avait fui ; maintenant, c’était un soldat vendéen avec son costume complet, portant sur le côté gauche de la poitrine le cœur d’étoffe rouge qui servait de ralliement, et au chapeau le mouchoir blanc qui remplaçait le panache.
Les Vendéens n’attendirent pas qu’on les attaquât : ils avaient répandu des tirailleurs dans les bois, ils commencèrent la fusillade, les républicains s’avancèrent l’arme au bras, sans tirer un coup de fusil, sans répondre au feu réitéré de leurs ennemis, sans proférer d’autres paroles après chaque décharge que celles-ci : Serrez les rangs, serrez les rangs.
Le prêtre n’avait pas achevé sa messe, et il continuait ; son auditoire semblait étranger à ce qui se passait et demeurait à genoux. Les soldats républicains avançaient toujours. Quand ils furent à trente pas de leurs ennemis, le premier rang se mit à genoux ; trois lignes de fusils s’abaissèrent comme des épis que le vent courbe. La fusillade éclata ; on vit s’éclaircir les rangs vendéens ; et quelques balles passant au travers allèrent jusqu’au pied de l’autel tuer des femmes et des enfants. Il y eut dans cette foule un instant de cris et de tumulte. Le prêtre leva Dieu, les têtes se courbèrent jusqu’à terre, et tout rentra dans le silence.
Les républicains firent leur seconde décharge à dix pas, avec autant de calme qu’à une revue, avec autant de précision que devant une cible. Les Vendéens ripostèrent, puis ni les uns ni les autres n’eurent le temps de recharger leurs armes : c’était le tourde la baïonnette, et ici tout l’avantage était aux républicains, régulièrement armés. – Le prêtre disait toujours la messe.
Les Vendéens reculèrent, des rangs entiers tombaient sans autre bruit que des malédictions. Le prêtre s’en aperçut, il fit un signe ; les torches s’éteignirent, le combat rentra dans l’obscurité. Ce ne fut plus alors qu’une scène de désordre et de carnage, où chacun frappa sans voir, avec rage, et mourut sans demander merci, merci qu’on n’accorde guère quand on se la demande dans la même langue.
Et cependant ces mots : Grâce ! grâce ! étaient prononcés d’une voix déchirante aux genoux de Marceau qui allait frapper.
C’était un jeune Vendéen, un enfant sans armes, qui cherchait à sortir de cette horrible mêlée.
– Grâce, grâce, disait-il, sauvez-moi, au nom du Ciel, au nom de votre mère.
Le général l’entraîna à quelques pas du champ de bataille pour le soustraire aux regards de ses soldats, mais bientôt il fut forcé de s’arrêter : le jeune homme s’était évanoui. Cet excès de terreur l’étonna de la part d’un soldat, il ne s’empressa pas moins de le secourir, il ouvrit son habit pour lui donner de l’air : c’était une femme.
Il n’y avait pas un instant à perdre, les ordres de la Convention étaient précis, tout Vendéen pris les armes à la main ou faisant partie d’un rassemblement, quel que fût son sexe ou son âge, devait périr sur l’échafaud. Il assit la jeune fille au pied d’un arbre, courut vers le champ de bataille. Parmi les morts, il distingua un jeune officier républicain, dont la taille lui parut être à peu près celle de l’inconnue, il lui enleva promptement son uniforme et son chapeau, et revint auprès d’elle. La fraîcheur de la nuit la tira bientôt de son évanouissement.
– Mon père, mon père, furent ses premiers mots ; puis elle se leva et appuya ses mains sur son front, comme pour y fixer ses idées. – Oh ! c’est affreux, j’étais avec lui ; je l’ai abandonné ; mon père, mon père ! il sera mort !
– Notre jeune maîtresse, mademoiselle Blanche, dit une tête qui parut tout à coup derrière l’arbre, le marquis de Beaulieu vit, il est sauvé. Vive le roi et la bonne cause !
Celui qui avait dit ces mots disparut comme une ombre, mais cependant pas si vite que Marceau n’eût le temps de reconnaître le paysan de Saint-Crépin.
– Tinguy, Tinguy ! s’écria la jeune fille étendant ses bras vers le métayer.
– Silence ! un mot vous dénonce, je ne pourrais pas vous sauver, et je veux vous sauver, moi ! Mettez cet habit et ce chapeau, et attendez ici.
Il retourna sur le champ de bataille, donna aux soldats l’ordre de se retirer sur Cholet, laissa à son collègue le commandement de la troupe, et revint près de la jeune Vendéenne.
Il la trouva prête à le suivre. Tous deux se dirigèrent vers une espèce de grande route qui traverse la Romagne, où le domestique de Marceau l’attendait avec des chevaux de main, qui ne pouvaient pénétrer dans l’intérieur du pays, où les routes ne sont que ravins et fondrières. Là, son embarras redoubla : il craignait que sa jeune compagne ne sût pas monter à cheval, et n’eût pas la force de marcher à pied ; mais elle l’eût bientôt rassuré, en manœuvrant sa monture avec moins de force, mais autant de grâce que le meilleur cavalier[1]. Elle vit la surprise de Marceau et sourit.
– Vous serez moins étonné, lui dit-elle, lorsque vous me connaîtrez. Vous verrez par quelle suite de circonstances les exercices des hommes me sont devenus familiers ; vous avez l’air si bon, que je vous dirai tous les événements de ma vie si jeune et déjà si tourmentée.
– Oui, oui, mais plus tard, dit Marceau ; nous aurons le temps, car vous êtes ma prisonnière, et pour vous-même je ne veux pas vous rendre votre liberté. Maintenant ce que nous avons à faire est de gagner Cholet au plus vite. Ainsi donc affermissez-vous sur votre selle, et au galop, mon cavalier.
– Au galop, reprit la Vendéenne, et trois quarts d’heure après ils entraient à Cholet. Le général en chef était à la mairie. Marceau monta, laissant à la porte son domestique et sa prisonnière. Il rendit compte en quelques mots de sa mission, et revint avec sa petite escorte chercher un gîte à l’hôtel des Sans-Culottes, inscription qui avait remplacé sur l’enseigne les mots : Au grand saint Nicolas.
Marceau retint deux chambres ; il conduisit la jeune fille à l’une d’elles, l’invita à se jeter tout habillée sur son lit, pour y prendre quelques instants d’un repos dont elle devait avoir grand besoin après la nuit affreuse qu’elle venait de passer, et alla s’enfermer dans la sienne, car maintenant il avait la responsabilité d’une existence, et il fallait qu’il songeât au moyen de la conserver.
Blanche, de son côté, avait à rêver aussi, à son père d’abord, puis à ce jeune général républicain à la figure et à la voix douces. Tout cela lui semblait un songe. Elle marchait pour s’assurer qu’elle était bien éveillée, s’arrêtait devant une glace pour se convaincre que c’était bien elle, puis elle pleurait en songeant à l’abandon dans lequel elle se trouvait ; l’idée de sa mort, de la mort de l’échafaud ne lui vint même pas ; Marceau avait dit avec sa voix douce : Je vous sauverai.
Puis pourquoi, elle née d’hier, l’aurait-on fait mourir ? Belle et inoffensive, pourquoi les hommes auraient-ils demandé sa tête et son sang ? À peine pouvait-elle croire elle-même qu’elle courût un danger. Son père, au contraire, chef vendéen, il tuait et pouvait être tué ; mais elle, elle pauvre jeune fille, donnant encore la main à l’enfance... Oh ! bien loin de croire à de tristes présages, le vie était belle et joyeuse, l’avenir immense ; cette guerre finirait, le château vide verrait revenir ses hôtes. Un jour un jeune homme fatigué y demanderait l’hospitalité, il aurait vingt-quatre ou vingt-cinq ans, une voix douce, des cheveux blonds, un habit de général, il resterait longtemps ; rêve, rêve, pauvre Blanche.
Il y a un âge de la jeunesse où le malheur est si étranger à l’existence, qu’il semble qu’il ne pourra jamais s’y acclimater ; quelque triste que soit une idée, elle s’achève par un sourire. C’est que l’on ne voit la vie que d’un côté de l’horizon ; c’est que le passé n’a pas encore eu le temps de faire douter de l’avenir.
Marceau rêvait aussi, mais lui voyait déjà dans la vie ; il connaissait les haines politiques du moment ; il savait les exigences d’une révolution ; il cherchait un moyen de sauver Blanche qui dormait. Un seul se présentait à son esprit : c’était de la conduire lui-même à Nantes, où habitait sa famille. Depuis trois ans, il n’avait vu ni sa mère ni ses sœurs, et se trouvant à quelques lieues seulement de cette ville il paraissait tout naturel qu’il demandât une permission au général en chef. Il s’arrêta à cette idée. Le jour commençait à paraître, il se rendit chez le général Westermann ; ce qu’il demandait lui fut accordé sans difficulté. Il voulait qu’elle lui fût remise à l’instant même, ne croyant pas que Blanche pût partir assez tôt ; mais il fallait que cette permission portât une seconde signature, celle du représentant du peuple Delmar. Il n’y avait qu’une heure qu’il était arrivé avec la troupe de l’expédition, il prenait dans la chambre voisine quelques instants de repos, et aussitôt son réveil le général en chef promit à Marceau de la lui envoyer.
En rentrant à l’auberge, il rencontra le général Dumas qui le cherchait. Les deux amis n’avaient pas de secrets l’un pour l’autre ; bientôt il sut toute l’aventure de la nuit. Tandis qu’il faisait préparer le déjeuner, Marceau monta chez sa prisonnière, qui l’avait déjà fait demander ; il lui annonça la visite de son collègue, qui ne tarda pas à se présenter : ses premiers mots rassurèrent Blanche, et après un instant de conversation elle n’éprouvait plus que la gêne inséparable de la position d’une jeune fille, placée au milieu de deux hommes qu’elle connaît à peine.
Ils allaient se mettre à table lorsque la porte s’ouvrit. Le représentant du peuple Delmar parut sur le seuil.
À peine avons-nous eu le temps au commencement de cette histoire de dire un mot de ce nouveau personnage.
C’était un de ces hommes que Robespierre mettait comme un bras au bout du sien pour atteindre en province, qui croyaient avoir compris son système de régénération, parce qu’il leur avait dit : Il faut régénérer, et entre les mains desquels la guillotine était plus active qu’intelligente.
Cette apparition sinistre fit tressaillir Blanche, avant même qu’elle sût qui il était.
– Ah ! ah ! dit-il à Marceau, tu veux déjà nous quitter, citoyen général, mais tu t’es si bien conduit cette nuit, que je n’ai rien à terefuser ; cependant je t’en veux un peu d’avoir laissé échapper le marquis de Beaulieu ; j’avais promis à la Convention de lui envoyer sa tête.
Blanche était debout, pâle et froide, comme une statue de la terreur. Marceau, sans affectation, se plaça devant elle.
– Mais ce qui est différé n’est pas perdu, continua-t-il, les limiers républicains ont bon nez et bonnes dents, et nous suivons sa piste. – Voilà la permission, ajouta-t-il, elle est en règle, tu partiras quand tu voudras ; mais auparavant je viens te demander à déjeuner, je n’ai pas voulu quitter un brave tel que toi, sans boire au salut de la République et à l’extermination des brigands.
Dans la position où se trouvaient les deux généraux, cette marque d’estime ne leur était rien moins qu’agréable ; Blanche s’était assise, et avait repris quelque courage. On se mit à table, et la jeune fille, pour ne pas se trouver en face de Delmar, fut obligée de prendre place à ses côtés. Elle s’assit assez loin de lui pour ne pas le toucher, et se rassura peu à peu en s’apercevant que le représentant du peuple s’occupait plus du repas que des convives qui le partageaient avec lui. Cependant de temps en temps une ou deux paroles sanglantes tombaient de ses lèvres, et faisaient passer un frison dans les veines de la jeune fille ; mais du reste aucun danger réel ne paraissait exister pour elle, les généraux espéraient qu’il les quitterait sans même lui adresser une parole directe. Le désir de partir était pour Marceau un prétexte d’abréger le repas ; il touchait à sa fin, chacun commençait à respirer plus à l’aise, lorsqu’une décharge de mousqueterie se fit entendre sur la place de la ville, située en face de l’auberge ; les généraux sautèrent sur leurs armes qu’ils avaient déposées près d’eux. Delmar les arrêta :
– Bien, mes braves, dit-il en riant et en balançant sa chaise ; bien, j’aime à voir que vous êtes sur vos gardes ; mais remettez-vous à table, il n’y a rien à faire là pour vous.
– Qu’est-ce donc que ce bruit ? dit Marceau.
– Rien, reprit Delmar, les prisonniers de cette nuit qu’on fusille.
Blanche jeta un cri de terreur :
– Oh ! les malheureux ! s’écria-t-elle.
Delmar posa son verre qu’il allait porter à ses lèvres, se retourna lentement vers elle.
– Ah ! voilà qui va bien, dit-il ; si maintenant les soldats tremblent comme des femmes, il faudra habiller les femmes en soldats ; il est vrai que tu es bien jeune, ajouta-t-il en lui prenant les deux mains et en la regardant en face ; mais tu t’y habitueras.
– Oh ! jamais, jamais ! s’écria Blanche, sans songer combien il était dangereux pour elle de manifester ses sentiments devant un semblable témoin. Jamais je ne m’habituerai à de telles horreurs.
– Enfant, reprit Delmar, en lâchant ses mains, crois-tu que l’on puisse régénérer une nation sans lui tirer du sang, réprimer les factions sans dresser d’échafauds ? As-tu jamais vu une révolution passer sur un peuple le niveau de l’égalité, sans abattre quelques têtes ; malheur alors, malheur aux grands, car la baguette de Tarquin les a désignés !
Il se tut un instant, puis continua :
– D’ailleurs, qu’est-ce que la mort ? un sommeil sans songe, sans réveil ; qu’est-ce que le sang ? une liqueur rouge à peu près semblable à celle que contient cette bouteille, et qui ne produit d’effet sur notre esprit que par l’idée qu’on y attache : Sombreuil en a bu. Eh bien ! tu te tais : voyons, n’as-tu pas à la bouche quelque argument philanthropique ? à ta place, un girondin ne resterait pas court.
Blanche était donc forcée de continuer cette conversation.
– Oh ! dit-elle en tremblant, êtes-vous bien sûr que Dieu vous ait donné le droit de frapper ainsi ?
– Dieu ne me frappe-t-il pas, lui ?
– Oui, mais il voit au-delà de la vie, tandis que l’homme, quand il tue, ne sait ni ce qu’il donne ni ce qu’il ôte.
– Soit ; eh bien ! l’âme est immortelle ou elle ne l’est pas ; si le corps n’est que matière, est-ce un crime de rendre un peu plus tôt à la matière ce que Dieu lui avait emprunté ? Si une âme l’habite, et que cette âme soit immortelle, je ne puis la tuer, le corps n’est qu’un vêtement que je lui ôte, ou plutôt une prison dont je la tire. Maintenant, écoute un conseil, car je veux bien t’en donner un ; garde tes réflexions philosophiques et tes arguments de collège pour défendre ta propre vie, si jamais tu tombes entre les mains de Charette ou de Bernard de Marigny, car ils ne te feraient pas plus grâce que je ne l’ai faite à leurs soldats. Quant à moi, tu te repentirais peut-être de les répéter une seconde fois en ma présence : souviens-t’en.
Il sortit.
Il y eut un moment de silence. Marceau posa ses pistolets qu’il avait armés pendant cette conversation.
– Oh ! dit-il en le suivant du doigt, jamais homme sans s’en douter n’a touché la mort de si près que tu viens de le faire. Blanche, savez-vous que si un geste, un mot, lui étaient échappés qui prouvassent qu’il vous reconnaissait, savez-vous que je lui brûlais la cervelle ?
Elle n’écoutait pas. Une seule idée la possédait : c’est que cet homme était chargé de poursuivre les débris de l’armée que commandait le marquis de Beaulieu.
– Ô mon Dieu ! disait-elle en cachant sa tête dans ses mains... ô mon Dieu, quand je pense que mon père peut tomber aux mains de ce tigre ; que s’il eût été fait prisonnier cette nuit, il était possible que là devant... C’est exécrable, c’est atroce ; n’est-il donc plus de pitié dans ce monde ? Oh ! pardon, pardon, dit-elle à Marceau, qui plus que moi doit savoir le contraire ? Mon Dieu, mon Dieu... !
Dans ce moment, le domestique entra et annonça que les chevaux étaient prêts.
– Partons, au nom du ciel, partons ! Il y a du sang dans l’air qu’on respire ici.
– Partons, répondit Marceau, et tous trois descendirent à l’instant.
III
Marceau trouva à la porte un détachement de trente hommes que le général en chef avait fait monter à cheval pour l’escorter jusqu’à Nantes. Dumas les accompagna quelque temps ; mais à une lieue de Cholet, son ami insista fortement pour qu’il y retournât ; de plus loin il eût été dangereux de revenir seul. Il prit donc congé d’eux, mit son cheval au galop, et disparut bientôt à l’angle d’un chemin.
Puis Marceau désirait se trouver seul avec la jeune Vendéenne. Elle avait l’histoire de sa vie à lui raconter, et il lui semblait que cette vie devait être pleine d’intérêt. Il rapprocha son cheval de celui de Blanche.
– Eh bien ! lui dit-il, maintenant que nous sommes tranquilles et que nous avons une longue route à faire, causons, causons de vous. Je sais qui vous êtes, mais voilà tout. Comment vous trouviez-vous dans ce rassemblement ? d’où vous vient cette habitude de porter des habits d’homme ? Parlez : nous autres soldats, nous sommes habitués à entendre des paroles brèves et dures. Parlez-moi longtemps de vous, de votre enfance, je vous en prie.
Marceau, sans savoir pourquoi, ne pouvait s’habituer à employer, en parlant à Blanche, le langage républicain de l’époque.
Blanche alors lui raconta sa vie, comment jeune sa mère était morte et l’avait laissée tout enfant aux mains du marquis de Beaulieu ; comment son éducation, donnée par un homme, l’avait familiarisée avec des exercices qui, lorsque éclata l’insurrection de la Vendée, lui étaient devenus si utiles, et lui avaient permis de suivre son père. Elle lui déroula tous les événements de cette guerre, depuis l’émeute de Saint-Florent jusqu’au combat où Marceau lui sauva la vie. Elle parla longtemps, comme il le lui avait demandé, car elle voyait qu’on l’écoutait avec bonheur. Au moment où elle achevait son récit, on aperçut à l’horizon Nantes, dont les lumières tremblaient dans la brume. La petite troupe traversa la Loire, et, quelques instants après, Marceau était dans les bras de sa mère.
Après les premiers embrassements, il présenta à sa famille sa jeune compagne de voyage : quelques mots suffirent pour intéresser vivement sa mère et ses sœurs. À peine Blanche eut-elle manifesté le désir de reprendre les habits de son sexe, que les deux jeunes filles l’entraînèrent à l’envi, et se disputèrent le plaisir de lui servir de femme de chambre.
Cette conduite, si simple qu’elle paraisse au premier abord, acquérait cependant un grand prix par les circonstances du moment. Nantes se débattait sous le proconsulat de Carrier.
C’est un étrange spectacle pour l’esprit et les yeux que celui d’une ville entière toute saignante des morsures d’un seul homme. On se demande d’où vient cette force que prend une volonté sur quatre-vingt mille individus qu’elle domine, et comment, quand un seul dit : Je veux, tous ne se lèvent point pour dire : c’est bien... ! mais nous ne voulons pas, nous ! C’est qu’il y a habitude de servilité dans l’âme des masses, que les individus seuls ont parfois d’ardents désirs d’être libres. C’est que le peuple, comme le dit Shakespeare, ne connaît d’autre moyen de récompenser l’assassin de César, qu’en le faisant César. Voilà pourquoi il y a des tyrans de liberté, comme il y a des tyrans de monarchie.
Donc le sang coulait à Nantes par les rues, et Carrier qui était à Robespierre ce qu’est l’hyène au tigre et le chacal au lion, se gorgeait du plus pur de ce sang, en attendant qu’il le rendît mêlé au sien.
C’étaient des moyens tout nouveaux de massacre, la guillotine s’ébrèche si vite ! Il imagina les noyades, dont le nom est devenu inséparable de son nom ; des bateaux furent confectionnés exprès dans le port, on savait dans quel but, on venait les voir sur le chantier ; c’était chose curieuse et nouvelle que ces soupapes de vingt pieds qui s’ouvraient pour précipiter à fond d’eau les malheureux destinés à ce supplice, et le jour de leur essai il y eut presque autant de peuple sur la rive que lorsqu’on lance un vaisseau avec un bouquet à son grand mât, et des pavillons à toutes ses vergues.





























