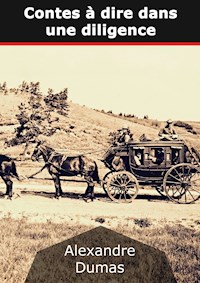
2,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Französisch
Je n'ai jamais vu d'aspect plus original que celui de cette petite ville, placée entre l'étang de Berre et le canal de Bouc, et bâtie non pas au bord de la mer, mais dans la mer. Martigues est à Venise ce qu'est une charmante paysanne à une grande dame ; mais il n'eût fallu qu'un caprice de roi pour faire de la villageoise une reine...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 336
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Contes à dire dans une diligence
Pages de titreLa chemise de la Sainte ViergeLa TarasqueLes onze mille viergesLe rocher du DragonComment saint Éloi fut guéri de la vanitéL’expiation du roi RodrigueRoland, de retour de RoncevauxSaint Goar le batelierLa sirène du RhinLa maison de l’AngeHistoire du démon familier du sire de CorasseLes chasses du comte de FoixLe diable et la cathédrale de CologneLa ruelle des lutinsLa fée des eauxLe nain du lac et la dame NoireLe pont du DiableLes deux chemisesLe dragon des chevaliers de Saint-JeanPonce Pilate chez les SuissesLes deux bossusLe chemin du diableLe cigare de don JuanLe tailleur de CatanzaroLe moine de Sant’AntimoHistoire d’un chienPage de copyrightAlexandre Dumas
Contes à dire dans
une diligence
La chemise de la Sainte Vierge
Je n’ai jamais vu d’aspect plus original que celui de cette petite ville, placée entre l’étang de Berre et le canal de Bouc, et bâtie non pas au bord de la mer, mais dans la mer. Martigues est à Venise ce qu’est une charmante paysanne à une grande dame ; mais il n’eût fallu qu’un caprice de roi pour faire de la villageoise une reine.
Martigues fut, assure-t-on, bâtie par Marius. Le général romain, en l’honneur de la prophétesse Martha, qui le suivait, comme chacun sait, lui donna le nom qu’elle porte encore aujourd’hui. L’étymologie peut n’être point fort exacte ; mais, comme on le sait, l’étymologie est de toutes les serres chaudes celle qui fait éclore les plus étranges fleurs.
Ce qui frappe d’abord dans Martigues, c’est sa physionomie joyeuse ; ce sont ses rues, toutes coupées de canaux et jonchées de cyatis et d’algues aux senteurs marines ; ce sont ses carrefours, où il y a des barques comme autre part il y a des charrettes. Puis, de pas en pas, des squelettes de navires surgissent ; le goudron bout, les filets sèchent. C’est un vaste bateau où tout le monde pêche, les hommes au filet, les femmes à la ligne, les enfants à la main ; on pêche dans les rues, on pêche de dessus les ponts, on pêche par les fenêtres, et le poisson, toujours renouvelé et toujours stupide, se laisse prendre ainsi au même endroit et par les mêmes moyens depuis deux mille ans.
Et cependant, ce qui est bien humiliant pour les poissons, c’est que la simplicité des habitants de Martigues est telle que, dans le patois provençal, leur nom lé Martigao est proverbial. Lé Martigao sont les Champenois de la Provence ; et comme malheureusement il ne leur est pas né le moindre La Fontaine, ils ont conservé leur réputation première dans toute sa pureté.
C’est un Martigao, ce paysan qui, voulant couper une branche d’arbre, prend sa serpe, monte à l’arbre, s’assied sur la branche, et la coupe entre lui et le tronc.
C’est un Martigao qui, entrant dans une maison de Marseille, voit pour la première fois un perroquet, s’approche et lui parle familièrement comme on parle en général à un volatile.
– S... cochon, répond le perroquet avec sa grosse voix de mousquetaire aviné.
– Mille pardons, monsieur, dit le Martigao en ôtant son bonnet ; je vous avais pris pour un oiseau.
Ce sont trois députés martigaos qui, envoyés à Aix pour présenter une requête au Parlement, se font indiquer aussitôt leur arrivée la demeure du premier président et sont introduits dans l’hôtel. Conduits par un huissier, ils traversent quelques pièces dont le luxe les émerveille ; l’huissier les laisse dans le cabinet qui précède la salle d’audience, et étendant la main vers la porte, il leur dit : « Entrez » et se retire. Mais la porte que leur avait montrée l’huissier était fermée hermétiquement par une lourde tapisserie, ainsi que c’était la coutume de l’époque ; de sorte que les pauvres députés, ne voyant, entre les larges plis de la portière, ni clef, ni bouton, ni issue, s’arrêtèrent très embarrassés et ne sachant comment faire pour passer outre. Ils tinrent alors conseil, et au bout d’un instant le plus avisé des trois dit :
« Attendons que quelqu’un entre ou sorte, et nous ferons comme il fera. » L’avis parut bon, fut adopté, et les députés attendirent.
Le premier qui vint fut le chien du président, qui passa sans façon par-dessous le rideau.
Les trois députés se mirent aussitôt à quatre pattes, passèrent à l’instar du chien, et comme leur requête leur fut accordée, leurs concitoyens ne doutèrent pas un instant que ce ne fût à la manière convenable dont ils l’avaient présentée, plus encore qu’à la justice de la demande, qu’ils devaient leur prompt et entier succès.
Il y a encore une foule d’autres histoires non moins intéressantes que les précédentes ; par exemple, celle d’un Martigao qui, après avoir longtemps étudié le mécanisme d’une paire de mouchettes, afin de se rendre compte de l’utilité de ce petit ustensile, mouche la chandelle avec ses doigts et dépose proprement la mouchure sur le récipient ; mais je craindrais que quelques-unes de ces charmantes anecdotes ne perdissent beaucoup de leur valeur par l’exportation.
Tant il y a que sur les lieux elles ont une vogue charmante, et que depuis l’époque de sa fondation, qui remonte, comme nous l’avons dit, à Marius, Martigues défraye d’histoires et de coqs-à-l’âne toutes les villes, libéralité dont, à ce que m’assurait notre aubergiste, elle commence tant soit peu à se lasser.
Martigues a pourtant fourni un saint au calendrier ; ce saint est le bienheureux Gérard Tenque, de son vivant épicier dans la ville de Marius. Étant allé pour son commerce à Jérusalem, il fut indigné des mauvais traitements que les pèlerins éprouvaient dans les saints lieux ; dès lors il résolut de se dévouer au soulagement de ces pieux voyageurs, après avoir fait à la chrétienté le sacrifice de sa boutique, qui, comme on le voit par le voyage que Gérard avait entrepris, devait avoir une certaine importance. En conséquence il céda son fonds, réalisa son bien, puis, faisant de l’argent que lui rapporta cette double vente une masse première, il se mit immédiatement en mesure de doubler et de tripler cette masse en allant quêter pour les pauvres, le bourdon à la main, auprès des négociants d’Alexandrie, du Caire, de Jaffa, de Beyrouth et de Damas, avec lesquels il était en relations d’affaires. Dieu bénit son intention et permit qu’elle eût le saint résultat que Gérard s’était proposé. En effet, sa quête ayant été plus abondante qu’il ne l’espérait lui-même, Gérard Tenque fit construire un hospice destiné à recueillir et à héberger tous les chrétiens que leur dévotion pour les saints lieux attirerait en Judée. La première croisade le surprit au milieu de cette pieuse fondation, à laquelle la conquête de Godefroi de Bouillon donna bientôt une immense importance, et dont les privilèges et les statuts, confirmés par lettres de Rome, devinrent ceux des chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem. Ainsi cet ordre magnifique, qui n’admettait dans ses rangs que les chevaliers de la plus haute noblesse et du plus grand courage, avait eu pour fondateur un pauvre épicier.
Dans le partage des reliques qui s’était fait entre les chrétiens après la prise de Jérusalem, Gérard Tenque avait obtenu pour sa part la chemise que portait la Sainte Vierge le jour où l’ange Gabriel vint la saluer comme mère du Christ. La relique était d’autant plus précieuse, que, comme preuve d’authenticité, la chemise était marquée d’un M, d’un T et d’un L, ce qui voulait incontestablement dire : Marie de la tribu de Lévy.
Après sa mort, Gérard Tenque fut canonisé ; aussi, lorsque l’île de Rhodes fut reprise par les infidèles, les chevaliers, qui ne voulaient pas laisser les saints ossements de leur fondateur entre les mains des infidèles, exhumèrent son cercueil et le transférèrent au château de Manosque, dont la seigneurie appartenait à l’ordre de Malte. Là, le commandeur, qui, pour l’incrédulité, était une espèce de saint Thomas, sachant que la chemise de la Vierge avait été enterrée avec le défunt, fit ouvrir le cercueil, afin de s’assurer de l’identité des reliques qu’on lui donnait en garde : le corps était parfaitement conservé et la chemise était à sa place.
Alors le commandeur jugea avec beaucoup de sagacité que, puisque le bienheureux Gérard était canonisé, il n’avait pas besoin d’une aussi importante relique que celle qu’il avait accaparée, et qui, après avoir efficacement, sans doute, contribué à son salut, pouvait, non moins efficacement encore, contribuer au salut des autres. Or, comme charité bien ordonnée est de commencer par soi-même, le bon commandeur s’appropria la chemise, qu’il fit mettre dans une très belle châsse, et qu’il transporta en son château de Calissane en Provence, où elle fit force miracles. Au moment de mourir, à son tour, le commandeur, qui naturellement mourait sans postérité, ne voulut pas exposer une si sainte relique à tomber entre les mains de collatéraux, et la légua à la principale église de la ville murée, la plus proche de son château, attendu qu’un si précieux dépôt ne pouvait pas être confié à une ville ouverte.
On comprend que, lorsque la teneur du testament fut connue, il fit grand bruit dans les cités avoisinantes ; chaque ville envoya ses géomètres, qui mesurèrent, la toise à la main, à quelle distance elle était du château de Calissane. La ville de Berre fut reconnue être celle qui avait les droits les plus incontestables à la sainte relique, et la chemise miraculeuse lui fut adjugée par l’archevêque d’Arles, au grand désespoir de Martigues, qui avait perdu d’une demi-toise.
À partir de ce moment, c’est-à-dire de la moitié du XVe siècle à peu près, la bienheureuse chemise fut exposée tous les ans, le jour de Sainte-Marie ; mais à l’époque de la Révolution elle disparut sans qu’on n’ait jamais pu savoir ce qu’elle était devenue.
La Tarasque
Le vieux château qui domine Beaucaire, et qui a fait grand bruit au XIIe siècle avec ses machines de guerre et au XVIe avec ses canons, est bâti sur des substructions romaines ; ses différents ouvrages de guerre sont du XIe, du XIIIe et du XIVe siècle. Du haut de ses remparts on aperçoit un magnifique paysage, dont le premier plan est Tarascon et Beaucaire, séparés par le Rhône et liés par un pont, et le dernier Arles, la ville romaine, Arles, l’Herculanum de la France, engloutie et recouverte par la lave de la barbarie.
Nous descendîmes de notre vieux château, dans lequel il ne reste de complet qu’une charmante cheminée du temps de Louis XIII ; nous traversâmes le pont suspendu, qui est long de cinq cent cinquante pas, c’est-à-dire d’environ quinze cents pieds ; nous passâmes au pied de la forteresse, bâtie par le roi René, et nous entrâmes dans l’église, édifiée au XIIe siècle, restaurée au XIVe.
Cette église est sous l’invocation de sainte Marthe, l’hôtesse du Christ. Toute une pieuse et sainte histoire se rattache à son érection : la science la nie, mais la foi la consacre, et dans cette lutte de l’âme qui croit et de l’esprit qui doute, c’est la science qui a été vaincue.
Marthe naquit à Jérusalem. Son père Syrus et sa mère Eucharie étaient de sang royal. Elle avait un frère aîné qui s’appelait Lazare ; elle avait une sœur cadette qui s’appelait Madeleine.
Lazare était un beau cavalier, moitié asiatique, moitié romain, qui, ne pouvant employer son temps à la guerre, puisque Octave avait fait la paix au monde, le passait en chasse et en plaisirs. Il avait de jeunes esclaves achetés en Grèce ; il avait de beaux chevaux amenés d’Arabie ; et plus d’une fois, dans un char à quatre roues orné d’ivoire et d’airain, précédé par un coureur à robe retroussée, il avait croisé le fils de Dieu marchant pieds nus au milieu de son cortège de pauvres.
Madeleine était une belle courtisane, à la manière de Julie, la fille de l’empereur ; elle avait de longs cheveux blonds, qu’une esclave de Lesbos assemblait tous les matins sur sa tête en les nouant avec une chaîne de perles ; elle portait le manteau ouvert par-devant, qui laissait voir une gorge merveilleuse, soutenue par un réseau d’or, et que les Latins appelaient cæsicium, à cause des blessures qu’il faisait au cœur des hommes. Elle avait des tuniques parsemées de grandes fleurs d’or et de pourpre, qu’on nommait à Rome patagiata, du nom d’une maladie nommée patagus, qui laissait des taches sur tout le corps ; et comme ses pieds délicats et parfumés, tout couverts de bagues et de pierreries, n’étaient point faits pour marcher, on lui amenait des litières avec des rideaux d’étoffes asiatiques, où elle se faisait porter comme une matrone romaine par des esclaves vêtus de panulæ, tandis qu’une suivante, l’accompagnant à pied, étendait entre elle et le soleil un grand éventail recouvert de plumes de paon ; et les coureurs africains, qui marchaient devant elle pour ouvrir le chemin, firent plus d’une fois ranger devant l’équipage de la riche courtisane cette pauvre Marie qui était la mère du Sauveur.
Marthe voyait toutes ces choses avec peine, et souvent elle tenta de réformer l’existence dissipée de son frère et la vie dissolue de sa sœur ; car des premières elle avait écouté et recueilli la parole du Christ ; mais toujours tous deux avaient ri à ses discours. Enfin, elle leur proposa de venir recueillir la manne sainte que le Sauveur laissait tomber de ses lèvres. Madeleine et Lazare y consentirent ; ils y allèrent joyeux, railleurs et incrédules ; ils écoutèrent la parabole du trésor, de la perle et du filet ; ils entendirent la prédiction du dernier jugement ; ils virent Jésus marcher sur les eaux, et ils revinrent pensifs1.
Et le soir même, Lazare dit à Marthe : Ma sœur, vendez mes biens et distribuez-les aux pauvres.
Et le lendemain, tandis que le fils de Dieu dînait chez Simon le pharisien, Madeleine entra, portant un vase d’albâtre plein d’huile de parfum.
Et se tenant derrière le Sauveur, elle s’agenouilla à ses pieds, et commença à les arroser de ses larmes, et elle les essuyait avec ses cheveux, les baisait et y répandait ce parfum.
Ce que voyant le pharisien qui l’avait invité, il dit en lui-même : Si cet homme était prophète, il saurait qui est celle qui le touche, et que c’est une femme de mauvaise vie.
Alors Jésus, prenant la parole, lui dit : Simon, j’ai quelque chose à vous dire. – Il répondit : Maître, dites.
Un créancier avait deux débiteurs : l’un lui devait cinq cents deniers, et l’autre cinquante.
Mais comme ils n’avaient pas de quoi les lui rendre, il leur remit à tous deux leur dette. Lequel des deux l’aimera donc davantage ?
Simon répondit : Je crois que ce sera celui auquel il a le plus remis. – Jésus lui dit : Vous avez fort bien jugé.
Et se retournant vers la femme, il dit à Simon : Je suis entré dans votre maison, vous ne m’avez point donné d’eau pour me laver les pieds ; et elle, au contraire, a arrosé mes pieds de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux.
Vous me m’avez point donné de baiser ; mais elle, au contraire, depuis qu’elle est entrée, n’a cessé de baiser mes genoux.
Vous n’avez point répandu d’huile sur ma tête ; et elle a répandu ses parfums sur mes pieds.
C’est pourquoi je vous déclare que beaucoup de péchés lui seront remis, parce qu’elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on remet moins aime moins.
Alors il dit à cette femme : Vos péchés vous sont remis.
Et ceux qui étaient à table avec lui commencèrent à dire : Qui est celui qui remet même les péchés ?
Et Jésus dit encore à cette femme : Votre foi vous a sauvée ; allez en paix2.
Et quelque temps après, Jésus, étant en chemin avec ses disciples, entra dans un bourg, et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison.
Elle avait une sœur nommée Marie-Madeleine, qui, se tenant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole.
Mais Marthe était fort occupée à préparer tout ce qu’il fallait ; et s’arrêtant devant Jésus, elle lui dit : Seigneur, ne considérez-vous point que ma sœur me laisse servir toute seule ? Dites-lui donc qu’elle m’aide.
Mais le Seigneur lui dit : Marthe, Marthe, vous vous empressez et vous vous troublez dans le soin de beaucoup de choses.
Cependant une seule est nécessaire ; Marie a choisi la meilleure part, qui ne lui sera point ôtée3.
Or, vers le temps où Jésus, déclarant qu’il était la porte du bercail et le bon pasteur, prouvait sa mission et sa divinité par ses œuvres, un homme tomba malade, nommé Lazare, qui était du bourg de Béthanie, où demeuraient Marie et Marthe sa sœur.
Cette Marie était celle qui répandit sur le Seigneur une huile de parfums, et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux, et Lazare, qui était alors malade, était son frère.
Ses sœurs envoyèrent donc dire à Jésus : Seigneur, celui que vous aimez est malade.
Ce que Jésus ayant entendu, il dit : Cette maladie ne va point à la mort, mais elle n’est que pour la gloire de Dieu et afin que le fils de Dieu en soit glorifié.
Or, Jésus aimait Marthe, et Marie sa sœur, et Lazare.
Ayant donc entendu qu’il était malade, il demeura encore deux jours au lieu où il était.
Et il dit ensuite à ses disciples : Retournez en Judée ; notre ami Lazare dort, et je m’en vais le réveiller.
Ses disciples lui répondirent : Seigneur, s’il dort il sera guéri.
Jésus leur dit alors clairement : Lazare est mort.
Jésus étant arrivé trouva qu’il y avait déjà quatre jours que Lazare était dans le tombeau.
Et comme Béthanie n’était éloignée de Jérusalem que d’environ quinze stades, il y avait quantité de Juifs qui étaient venus voir Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère.
Marthe ayant donc appris que Jésus venait alla au-devant de lui, et Marie demeura dans la maison.
Alors Marthe dit à Jésus : Seigneur, si vous eussiez été ici, mon frère ne serait pas mort.
Mais je sais que présentement même Dieu vous accordera tout ce que vous lui demanderez.
Jésus lui répondit : Votre frère ressuscitera.
Marthe lui répondit : Je sais qu’il ressuscitera en la résurrection qui se fera au dernier jour.
Jésus lui répondit : Je suis la résurrection et la vie ; celui qui croit en moi, quand il serait mort, vivra.
Et quiconque vit et croit en moi ne mourra point à jamais, croyez-vous cela ?
Elle lui répondit : Oui, Seigneur, je crois que vous êtes le Christ, le fils du Dieu vivant, qui êtes venu dans ce monde.
Lorsqu’elle eut parlé ainsi, elle s’en alla et appela secrètement Marie, sa sœur, en lui disant : Le maître est venu, et il vous demande.
Ce qu’elle n’eut pas plus tôt entendu qu’elle se leva et vint le trouver.
Car Jésus n’était pas encore entré dans le bourg, mais il était au même lieu où Marthe l’avait rencontré.
Cependant les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, ayant vu qu’elle s’était levée si promptement et qu’elle était sortie, la suivirent en disant : Elle s’en va au sépulcre pour y pleurer.
Lorsque Marie fut venue au lieu où était Jésus, l’ayant vu, elle se jeta à ses pieds et lui dit : Seigneur, si vous eussiez été ici, mon frère ne serait point mort.
Jésus, voyant qu’elle pleurait et que les Juifs qui étaient venus avec elle pleuraient aussi, frémit en son esprit et se troubla lui-même.
Et il leur dit : Où l’avez-vous mis ? – Ils lui répondirent : Seigneur, venez et voyez.
Alors Jésus pleura.
Et les Juifs dirent entre eux : Voyez comme il l’aimait.
Mais il y en eut aussi quelques-uns qui dirent : Ne pouvait-il pas empêcher qu’il ne mourût, lui qui a ouvert les yeux à un aveugle-né ?
Jésus, frémissant donc de nouveau en lui-même, vint au sépulcre : c’était une grotte, et on avait mis une pierre par-dessus.
Jésus dit : Ôtez la pierre. – Marthe, qui était la sœur du mort, lui dit : Seigneur, il sent déjà mauvais ; car il y a quatre jours qu’il est là.
Jésus lui répondit : Ne vous ai-je pas dit que si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu ?
Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus, levant les yeux en haut, dit ces paroles : Mon père, je vous rends grâce de ce que vous m’avez exaucé.
Pour moi, je savais que vous m’exaucez toujours ; mais je dis ceci pour ce peuple qui m’environne, afin qu’il croie enfin que c’est vous qui m’avez envoyé.
Ayant dit ces mots, il cria d’une voix forte : Lazare, sortez dehors.
Et à l’heure même le mort sortit, ayant les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d’un linge. Alors Jésus leur dit : Déliez-le et le laissez aller.
Plusieurs donc d’entre les Juifs qui étaient venus voir Marthe et Marie, et qui avaient vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui4.
Or, la même année, six jours avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie, où était mort Lazare, qu’il avait ressuscité.
On lui apprêta là à souper ; Marthe servait, et Lazare était de ceux qui étaient à table avec lui.
Mais Marie ayant pris une livre d’huile de parfum de vrai nard, qui était de grand prix, elle le répandit sur les pieds de Jésus, et, comme la première fois, elle les essuya avec ses cheveux, et toute la maison fut remplie de l’odeur de ce parfum.
Alors un de ses disciples, à savoir Judas Iscariote, qui devait le trahir, dit : Pourquoi n’a-t-on pas vendu ce parfum trois cents deniers, qu’on aurait donnés aux pauvres ?
Mais Jésus lui dit : Laissez-la faire, parce qu’elle a gardé ce parfum pour le jour de ma sépulture.
Car vous aurez toujours des pauvres parmi vous, et moi vous ne m’aurez pas toujours.
Quelque temps après, accomplissant sa prophétie, Jésus mourait, léguant sa mère à saint Jean, et le monde à saint Pierre.
Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine vint dès le matin au sépulcre, lorsqu’il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre avait été ôtée du sépulcre.
Et comme elle pleurait, s’étant baissée pour regarder dans le sépulcre, elle vit deux anges vêtus de blanc assis au lieu où avait été le corps de Jésus, l’un à la tête et l’autre aux pieds.
Ils lui dirent : Femme, pourquoi pleurez-vous ? – Elle leur répondit : C’est qu’ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais où ils l’ont mis.
Ayant dit cela, elle se retourna, et vit Jésus debout, sans savoir néanmoins que ce fût Jésus.
Alors Jésus lui dit : Femme, pourquoi pleurez-vous ? qui cherchez-vous ? – Elle, pensant que c’était le jardinier, lui dit : Seigneur si c’est vous qui l’avez enlevé, dites-moi où vous l’avez mis, et je l’emporterai.
Jésus lui dit : Marie ! – Aussitôt elle se retourna et lui dit : Rabboni – c’est-à-dire : Mon maître.
Jésus lui répondit : Ne me touchez point, car je ne suis pas encore monté vers mon père ; mais allez trouver mes frères, et dites-leur de ma part : « Je monte vers mon père et votre père, vers mon Dieu et votre Dieu5. »
Ici s’arrête l’histoire écrite par les saints apôtres eux-mêmes, et commence la tradition.
Les Juifs, pour punir Marthe, Madeleine, Lazare, Maximin et Marcelle, d’être restés fidèles au Christ au-delà du tombeau, les forcèrent d’entrer dans une barque, et, un jour d’orage, lancèrent la barque à la mer. La barque était sans voile, sans gouvernail et sans aviron ; mais elle avait la foi pour pilote : aussi à peine les condamnés eurent-ils commencé de chanter les hymnes de grâce au Sauveur, que le vent s’abaissa, que les flots se calmèrent, que le ciel devint pur, et qu’un rayon de soleil vint entourer la barque d’une auréole de flamme. Tandis qu’une partie de ceux qui voyaient ce miracle blasphémait le Dieu qui l’avait fait, l’autre tombait à genoux pour l’adorer ; et cependant la barque, glissant comme poussée par une main divine, aborda aux côtes de Marseille, et les ouvriers de Dieu, les envoyés de sa parole, les apôtres de sa religion, se dispersèrent dans la province pour distribuer à ceux qui avaient faim la sainte nourriture qu’ils apportaient de la Judée.
Tandis que Marthe était à Aix avec Madeleine et Maximin, qui fut le premier évêque de cette ville, les députés d’une ville voisine, attirés par le bruit de ses miracles, accoururent à elle : ils venaient la supplier de les délivrer d’un monstre qui ravageait leur pays. Marthe prit congé de Madeleine et de Maximin, et suivit ces hommes.
En arrivant aux portes de la ville, elle y trouva tout le peuple qui était venu au-devant d’elle. À son approche il s’agenouilla, lui disant qu’il n’avait d’espoir qu’en elle, et elle répondit en demandant où était le monstre. Alors on lui montra un bois près de la ville, et elle s’achemina aussitôt seule et sans défense vers ce bois.
À peine y était-elle entrée qu’on entendit de longs rugissements, et chacun trembla, car tous pensèrent que c’en était fait de la pauvre femme, qui avait entrepris une chose que nul n’osait entreprendre, et qui était allée sans armes où aucun homme armé n’osait aller : mais bientôt les rugissements cessèrent, et Marthe reparut, tenant une petite croix de bois d’une main, et de l’autre le monstre, attaché au bout d’un ruban qui nouait la taille de sa robe.
Elle s’avança ainsi au milieu de la ville, glorifiant le nom du Sauveur, et amenant au peuple, pour lui servir de jouet, le dragon, encore tout sanglant de la dernière proie qu’il avait dévorée.
Voilà sur quelle légende repose la vénération qu’ont vouée à sainte Marthe les habitants de Tarascon. Une fête annuelle perpétue le souvenir de la victoire de la sainte sur la Tarasque, car le monstre a pris le nom de la cité qu’il désolait. La veille de ce jour solennel le maire de la ville fait publier à son de trompe que, s’il arrive quelque accident le lendemain, personne n’en sera responsable ; qu’il prévient les blessés qu’ils n’auront aucun droit de se plaindre, et que qui aura le mal le gardera. Grâce à ce formidable avis qui devrait cloîtrer chacun chez soi, dès le point du jour toute la ville est dans la rue ; quant à la Tarasque, elle attend sous son hangar.
C’est un animal d’un aspect tout à fait rébarbatif, et dont l’intention visible est de rappeler l’antique dragon qu’il représente. Il peut avoir vingt pieds de long, une grosse tête ronde, une gueule immense, qui s’ouvre et se ferme à volonté ; des yeux remplis de poudre apprêtée en artifice ; un cou qui rentre et s’allonge ; un corps gigantesque, destiné à renfermer les personnes qui le font mouvoir ; enfin, une queue longue et raide comme une solive, vissée à l’échine d’une manière assez triomphante pour casser bras et jambes à ceux qu’elle atteint.
Le second jour de la fête de la Pentecôte, à six heures du matin, trente chevaliers de la Tarasque, vêtus de tuniques et de manteaux, et institués par le roi René, viennent chercher l’animal sous son hangar ; douze portefaix lui entrent dans le ventre. Une jeune fille vêtue en sainte Marthe lui attache un ruban bleu autour du cou ; et le monstre se met en marche aux grands applaudissements de la multitude. Si quelque curieux passe trop près de sa tête, la Tarasque allonge le cou et le happe par le fond de sa culotte, qui lui reste ordinairement dans la gueule.
Si quelque imprudent s’aventure derrière elle, la Tarasque prend sa belle, et d’un coup de queue elle le renverse. Enfin, si elle se sent trop pressée de tous côtés, la Tarasque allume ses artifices, ses yeux jettent des flammes ; elle bondit, fait un tour sur elle-même, et tout ce qui se trouve à sa portée, dans une circonférence de soixante-quinze pieds est impitoyablement brûlé ou culbuté. Au contraire, si quelque personnage considérable de la ville se trouve sur son passage, elle va à lui, faisant mille gentillesses, caracolant en preuve de joie, ouvrant la gueule en signe de faim ; et l’individu, qui sait ce que cela veut dire, lui jette dans la gueule une bourse qu’elle digère incontinent au profit des portefaix qu’elle a dans le ventre.
En 93, les Arlésiens et les Tarasconnais étant en guerre, les Tarasconnais furent vaincus, et Tarascon fut prise. Alors les Arlésiens ne trouvèrent rien de mieux pour humilier leurs ennemis que de brûler la Tarasque sur la place publique. C’était un monstre de la plus grande magnificence, d’un mécanisme aussi compliqué qu’ingénieux, et qui avait coûté vingt mille francs à confectionner.
Depuis cette époque, les Tarasconnais n’ont jamais pu dignement remplacer l’ancienne Tarasque, qui est encore l’objet des regrets les plus vifs. On en a fait faire une, mais mesquine et pauvre en comparaison de son aînée ; c’est celle-là que nous visitâmes, et qui nous parut, malgré les lamentations de notre guide, d’un aspect encore très confortable.
Maintenant, comme dans toute tradition il y a un côté qui tourne à l’histoire, et dans tout miracle un point qui peut s’expliquer, il est probable qu’un crocodile venu d’Égypte, comme celui qui fut tué dans le Rhône, et dont la peau fut conservée jusqu’à la Révolution dans l’hôtel de ville de Lyon, avait établi son domicile dans les environs de Tarascon, et que Marthe, qui avait appris au bord du Nil comment on attaquait cet animal, parvint à délivrer de ce monstre la ville où son souvenir est en si grand honneur.
Histoire de sainte Marthe.
Évangile selon saint Luc.
Évangile selon saint Luc.
Évangile selon saint Jean.
Évangile selon saint Jean.
Les onze mille vierges
Après le dôme de la cathédrale, les deux églises les plus visitées par les étrangers sont celles de Saint-Pierre et de Sainte-Ursule.
Saint-Pierre vu, nous nous rendîmes aussitôt à la ci-devant abbaye des Dames de Sainte-Ursule. Sans aucun doute nos lecteurs ont entendu parler des onze mille martyres anglaises, mais peut-être ne connaissent-ils pas leur histoire dans tous ses principaux détails. Les voici ; car il est impossible de ne pas conter quelque chronique bien étrange quand on parle de l’Allemagne.
C’était vers l’an 220 de Jésus-Christ : Dionest et Daria régnaient dans la Grande-Bretagne, et n’avaient point d’héritiers ; aussi priaient-ils ardemment le ciel de leur en envoyer un. Le ciel, l’on ne sait pourquoi, ne fit les choses qu’à moitié ; il leur envoya une fille : il est vrai que cette fille devait être une sainte.
L’enfant si longtemps et si ardemment attendue reçut le nom d’Ursule. Dès sa jeunesse, trompant l’espérance de ses parents, qui, à défaut d’un fils, comptaient au moins sur un petit-fils, Ursule promit au Seigneur de se vouer à son service exclusif. Cette promesse imprudente fit grand peine à Dionest et à Daria, mais ils étaient trop religieux tous deux pour forcer la sainte inclination de leur fille ; si bien que des députés étant venus de la part d’Agrippinus, prince germain, afin de demander Ursule en mariage pour son fils, le prince Coman, Dionest refusa d’abord cette union. Mais un ange descendit la nuit suivante au chevet d’Ursule, la releva de son serment de la part de Dieu, et lui ordonna d’épouser le prince Coman.
Dionest et Daria n’étaient point gens à laisser partir leur fille sans lui donner une suite digne d’elle. Ils choisirent parmi les meilleures familles de la Grande-Bretagne onze mille vierges, pour servir de cortège à Ursule, et l’accompagner d’abord à Rome, où, selon le désir de son père, elles devaient être baptisées une seconde fois et revenir avec elle dans le pays des Germains. Ursule partit avec ses onze mille demoiselles d’honneur, et, en arrivant sur le port, elle trouva le plus grand vaisseau du roi son père qui l’attendait avec ses matelots et son capitaine. Elle renvoya tout l’équipage, s’assit au gouvernail, ordonna la manœuvre, et le vaisseau obéissant, s’éloigna de la terre, emportant vers les côtes bataves sa blanche volée de colombes.
Les ambassadeurs venaient derrière sur un autre bâtiment, et comme ils suivaient le sillage du premier, ils étaient fort récréés par les cantiques que chantaient toutes les belles jeunes filles qui les précédaient.
À cette époque, le Rhin ne se perdait point dans le sable ; il se jetait tout bonnement dans la mer, ainsi que doit le faire tout fleuve qui a la conscience de la mission, de sorte que les onze mille vierges, toujours guidées par Ursule, s’engagèrent dans le fleuve et le remontèrent jusqu’à Cologne. Aquilinus, préfet romain qui gouvernait alors la ville pour Septime Sévère, empereur régnant, les reçut avec de grands honneurs ; mais comme l’intention d’Ursule était de pousser jusqu’à Rome pour y recevoir un second baptême, elle ne fit que toucher terre à Cologne et se rembarqua aussitôt avec toute sa suite pour Bâle. Là, elle quitta son vaisseau qui, si bien manœuvré qu’il fût, aurait eu peine à remonter la chute du Rhin, et accompagnée de Pantulus, autre préfet romain, qu’une si bonne société tentait, elle traversa la Suisse et les Alpes à pied. Pantulus, qui était parti seulement pour faire quelques lieues avec elle, l’accompagna jusqu’à Rome : ce fut une heureuse idée, qui lui valut plus tard les honneurs de la canonisation.
Arrivées à Rome, les onze mille vierges firent leurs dévotions, furent baptisées par le pape Cyriaque, qui, touché de la foi qu’il trouvait dans toutes ces saintes filles, résolut de faire ce qu’avait fait Pantulus ; en conséquence, il donna sa démission de pape, et quand elles quittèrent Rome, il les accompagna à son tour avec une grande partie de son clergé.
De retour à Bâle, les onze mille vierges s’embarquèrent de nouveau sur le Rhin et descendirent jusqu’à Mayence ; Ursule y trouva Coman, son fiancé. C’était un prince païen, jusque-là même fort attaché à sa fausse religion ; mais lorsqu’il vit sa belle fiancée, lorsqu’il entendit sa douce voix, il pensa que le Dieu qu’adorait un pareil ange devait être le vrai Dieu, et il se convertit à la foi catholique. Le pape Cyriaque ne laissa pas refroidir son zèle, et le baptisa à l’instant même. Les deux fiancés descendirent ensuite vers Cologne, où devait se célébrer le mariage.
Mais à peine étaient-ils arrivés qu’une invasion de Goths fondit sur la ville. Les portes furent fermées, et les habitants, encouragés par Coman, firent la plus belle défense. Pendant ce temps, les onze mille vierges étaient en prières ; mais, malgré les prières d’Ursule et le courage de Coman, le ciel avait décidé que les Goths seraient vainqueurs. Donc, la ville fut prise et les onze mille vierges placées dans l’alternative d’épouser onze mille Goths ou d’être onze mille martyres. Leur choix ne fut pas douteux, elles choisirent le martyre, et le supplice commença.
Toutes furent massacrées en un jour, avec des raffinements de cruauté dont les Goths étaient seuls capables ; une seule, nommée Cordula, parvint d’abord à se sauver, en se glissant dans un bateau et en restant cachée sous un banc ; mais la nuit venue, ayant vu le ciel s’ouvrir et recevoir ses dix mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf compagnes, elle eut une si grande honte de sa faiblesse qu’à l’instant même elle alla se livrer aux bourreaux, et ayant été immédiatement mise à mort, arriva encore assez à temps pour entrer avec les autres avant que la porte des cieux se fût refermée.
Les os des saintes filles furent recueillis avec soin et portés dans une église. Les plus précieux manquaient, car quelques recherches qu’on eût faites on n’avait pu retrouver le corps de sainte Ursule. Mais un jour que saint Cumbert disait la messe, une colombe vint voler autour de sa tête ; or, le saint pensa bien que la messagère du Seigneur ne venait point ainsi à lui sans une mission particulière ; il la suivit dans la campagne. Arrivée au pied d’un peuplier, la colombe se mit à gratter la terre avec ses petites pattes roses. On creusa en cet endroit et on y trouva le corps de sainte Ursule.
Le rocher du Dragon
Au village de Rhungsdof, au bord du Rhin, nous trouvâmes plusieurs barques à l’affût des voyageurs ; en quelques minutes encore nous fûmes transportés à Kœnigswinter, joli petit bourg situé sur l’autre rive. Nous nous informâmes de l’heure à laquelle passait le bateau à vapeur, on nous répondit qu’il passait à midi. Cela nous donnait une marge de près de cinq heures ; c’était plus de temps qu’il n’en fallait pour visiter les ruines du Drachenfelds.
Après trois quarts d’heure de montée à peu près, par un joli sentier qui contourne la montagne, nous arrivâmes au premier sommet, où se trouvent une auberge et une pyramide.
De cette première plate-forme, un joli chemin tournant et sablé comme celui d’un jardin anglais conduit au sommet du Drachenfelds. On arrive d’abord à une première tour carrée, dans laquelle on pénètre assez difficilement par une crevasse ; puis à une tour ronde, qui, entièrement éventrée par le temps, offre un accès plus facile. Cette tour est située sur le rocher même du Dragon. Le Drachenfelds tire son nom d’une vieille tradition qui remonte au temps de Julien l’Apostat. Dans une caverne que l’on montre encore, à moitié chemin de la montagne, s’était retiré un dragon énorme, si parfaitement réglé dans ses repas que lorsqu’on oubliait de lui amener chaque jour un prisonnier ou un coupable, à l’endroit où il avait l’habitude de le trouver, il descendait dans la plaine et dévorait la première personne qu’il rencontrait. Il est bien entendu que le dragon était invulnérable.
C’était, comme nous l’avons dit, au temps où Julien l’Apostat vint avec ses légions camper sur les bords du Rhin. Or, les soldats romains, qui n’avaient pas plus de vocation pour être dévorés que les naturels du pays, profitèrent de ce qu’ils étaient en guerre avec quelques peuplades des environs pour nourrir le monstre sans qu’il leur en coûtât rien. Parmi les prisonniers, il se trouva une jeune fille si belle que deux centurions se la disputèrent, et qu’aucun des deux ne voulant la céder à l’autre, ils étaient près de s’entrégorger, lorsque le général décida que, pour les mettre d’accord, la jeune fille serait offerte au monstre. On admira fort la sagesse de ce jugement, que quelques-uns comparèrent à celui de Salomon, et l’on s’apprêta à jouir du spectacle.
Au jour dit, la jeune fille fut conduite, vêtue de blanc et couronnée de fleurs, au sommet du Drachenfelds : on la lia à l’arbre, comme Andromède à son rocher ; seulement elle demanda qu’on lui laissât les mains libres, et l’on ne crut pas devoir lui refuser une si petite faveur.
Le monstre, nous l’avons dit, avait une vie très régulière, il dînait comme on dîne encore en Allemagne, de deux heures à deux heures et demie. Aussi, au moment où il était attendu, sortit-il de sa caverne et monta-t-il, moitié rampant, moitié volant, vers l’endroit où il savait trouver sa pâture. Il avait l’air, ce jour-là, plus féroce et plus affamé que d’habitude. La veille, soit hasard, soit raffinement de cruauté, on lui avait servi un vieux prisonnier barbare, fort dur et qui n’avait que la peau sur les os ; de sorte que chacun se promit un double plaisir de ce redoublement d’appétit. Le monstre lui-même, en voyant quelle délicate victime on lui avait offerte, en rugit de joie, fouetta l’air de sa queue écaillée et s’élança vers elle.
Mais lorsqu’il était prêt à l’atteindre, la jeune fille tira de sa poitrine un crucifix et le présenta au monstre. Elle était chrétienne.
À la vue du Sauveur, le monstre resta pétrifié ; puis, voyant qu’il n’y avait là rien à faire pour lui, il s’enfuit en sifflant dans sa caverne.
C’était la première fois que les populations voyaient fuir le dragon. Aussi, tandis que quelques-uns couraient à la jeune fille et la déliaient, le reste des habitants poursuivit le dragon, et encouragé par sa frayeur, introduisit dans la caverne force fagots sur lesquels on versa du soufre et de la poix résine, puis on y mit le feu.
Pendant trois jours la montagne jeta des flammes comme un volcan ; pendant trois jours on entendit le dragon se débattre en sifflant dans son antre ; enfin les sifflements cessèrent : le monstre était rôti.
On voit encore aujourd’hui la trace des flammes et la voûte de pierre, calcinée par la chaleur, s’écraser en poussière aussitôt qu’on la touche.
On conçoit qu’un pareil miracle aida fort à la propagation de la foi chrétienne. Dès la fin du IVe siècle, il y avait déjà force sectateurs du Christ sur les bords du Rhin.
Comment saint Éloi fut guéri de la vanité
Annibal et Charlemagne, comme Bonaparte, ont franchi les Alpes et à peu près conquis l’Italie ; mais derrière eux, effaçant les vestiges de leur passage, les défilés des montagnes se sont refermés, les pics du mont Genèvre et du petit Saint-Bernard se sont recouverts de neige, et les générations qui ont succédé à celles de leurs enfants, ne retrouvant aucune trace de la route qu’ils avaient suivie que dans la tradition des localités et dans la mémoire des populations, se sont prises à douter de ses miracles, et ont presque nié les dieux qui les avaient opérés. Bonaparte n’a pas voulu qu’il en fût ainsi pour lui, et afin que sa religion guerrière n’eût point à souffrir des ravages de l’oubli et de l’atteinte du doute, il a lié l’Italie à la France comme une esclave à sa maîtresse ; il a étendu une chaîne à travers les montagnes ; il a mis le premier anneau aux mains de Genèvre, sa nouvelle fille, et le dernier au pied de Milan, notre vieille conquête : ce souvenir de notre descente en Italie, cette chaîne dorée par le commerce, cette voie tracée par le passage de nos armées et battue par la sandale d’un géant, c’est la route du Simplon.





























