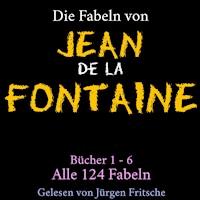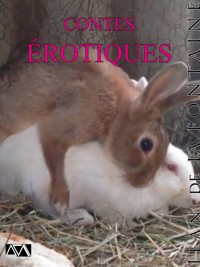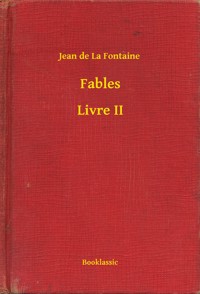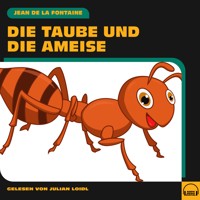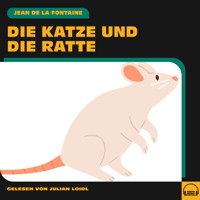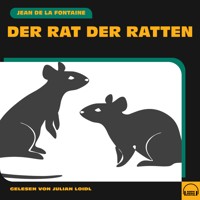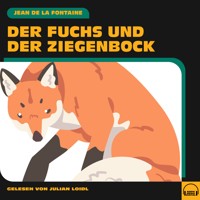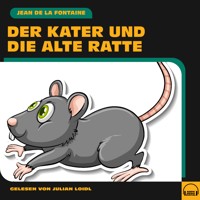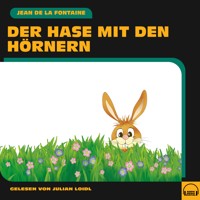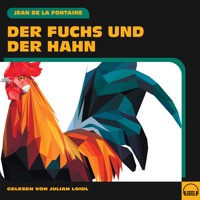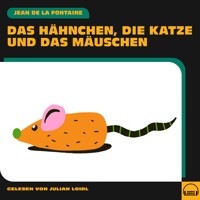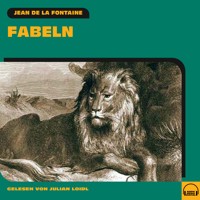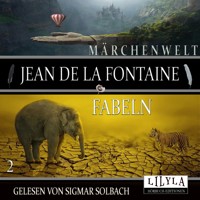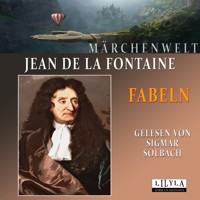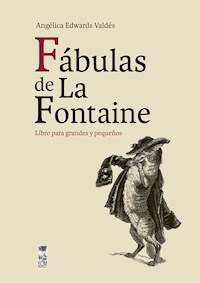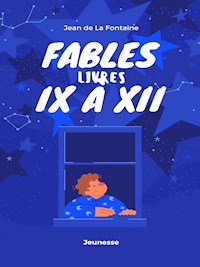0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Jean de La Fontaine
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
La Fontaine attachait autant d'importance à ses Contes et Nouvelles qu'à ses Fables. Inspirés du Décaméron, de l'Arioste, de Machiavel autant que de Rabelais et du fonds gaulois, ils sont tous un hommage à l'amour physique, au jeune désir, au fruit défendu, le seul qui compte, au plaisir dérobé mais toujours pardonné. Bacheliers et nonnains, galantes commères et maris trompés y composent une humanité de gaillardise et de ruse évoquée avec un cynisme souriant qui fait des Contes un des chefs-d'œuvre de la littérature licencieuse.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Contes et Nouvelles en vers - Livre I
Jean de La Fontaine
Poète, fabuliste, moraliste, dramaturge, librettiste et romancier français. Ses fables constituent l'un des chefs d'oeuvre, universellement connu, de la littérature française.
LIVRE PREMIER
Avertissement
Figure uniquement dans les Nouvelles en vers tirées de Boccace et de L’Arioste. Librairie Claude Barbin 1665. Il a été supprimé ensuite.
Les nouvelles en vers dont ce livre fait part au public, et dont l’une est tirée de l’Arioste, l’autre de Boccace, quoique d’un style bien différent, sont toutefois d’une même main. L’auteur a voulu éprouver lequel caractère est le plus propre pour rimer des contes. Il a cru que les vers irréguliers ayant un air qui tient beaucoup de la prose, cette manière pourrait sembler la plus naturelle, et par conséquent la meilleure. D’autre part aussi le vieux langage, pour les choses de cette nature, a des grâces que celui de notre siècle n’a pas. Les Cent Nouvelles nouvelles, les vieilles traductions de Boccace et des Amadis, Rabelais, nos anciens poètes nous en fournissent des preuves infaillibles.
L’auteur a donc tenté ces deux voies sans être encore certain laquelle est la bonne. C’est au lecteur à le déterminer là-dessus ; car il ne prétend pas en demeurer là, et il a déjà jeté les yeux sur d’autres nouvelles pour les rimer. Mais auparavant il faut qu’il soit assuré du succès de celles-ci, et du goût de la plupart des personnes qui les liront. En cela comme en d’autres choses, Térence lui doit servir de modèle. Ce poète n’écrivait pas pour se satisfaire seulement, ou pour satisfaire un petit nombre de gens choisis ; il avait pour but, Populo ut placerent quas fecisset fabulas.
Préface
J’avais résolu de ne consentir à l’impression de ces contes, qu’après que j’y pourrais joindre ceux de Boccace, qui sont le plus à mon goût ; mais quelques personnes m’ont conseillé de donner dès à présent ; ce qui me reste de ces bagatelles ; afin de ne pas laisser refroidir la curiosité de les voir qui est encore en son premier feu. Je me suis rendu à cet avis sans beaucoup de peine ; et j’ai cru pouvoir profiter de l’occasion. Non seulement cela m’est permis mais ce serait vanité à moi de mépriser un tel avantage. Il me suffit de ne pas vouloir qu’on impose en ma faveur à qui que ce soit ; et de suivre un chemin contraire à celui de certaines gens qui ne s’acquièrent des amis que pour s’acquérir des suffrages par leur moyen ; créatures de la cabale, bien différents de cet Espagnol qui se piquait d’être fils de ses propres œuvres. Quoique j’aie autant de besoin de ces artifices que pas un autre, je ne saurais me résoudre à les employer : seulement, je m’accommoderai, s’il m’est possible, au goût de mon siècle, instruit que je suis par ma propre expérience, qu’il n’y a rien de plus nécessaire. En effet on ne peut pas dire que toutes saisons soient favorables pour toutes sortes de livres. Nous avons vu les Rondeaux, les Métamorphoses, les Bouts-rimés régner tour à tour : maintenant ces galanteries sont hors de mode, et personne ne s’en soucie : tant il est certain que ce qui plaît en un temps peut ne pas plaire en un autre.
Il n’appartient qu’aux ouvrages vraiment solides, et d’une souveraine beauté, d’être bien reçus de tous les esprits, et dans tous les siècles, sans avoir d’autre passeport que le seul mérite dont ils sont pleins. Comme les miens sont fort éloignes d’un si haut degré de perfection, la prudence veut que je les garde en mon cabinet, à moins que de bien prendre mon temps pour les en tirer. C’est ce que j’ai fait, ou que j’ai cru faire dans cette seconde édition, ou je n’ai ajouté de nouveaux contes, que parce qu’il m’a semblé qu’on était en train d’y prendre plaisir. Il y en a que j’ai étendus, et d’autres que j’ai accourcis ; seulement pour diversifier, et me rendre moins ennuyeux. On en trouvera même quelques- uns que j’ai prétendu mettre en épigrammes. Tout cela n’a fait qu’un petit recueil, aussi peu considérable par sa grosseur, que par la qualité des ouvrages qui le composent. Pour le grossir j’ai tiré de mes papiers je ne sais quelle Imitation des Arrêts d’amour, avec un fragment où l’on me raconte le tour que Vulcan fit à Mars et à Vénus, et celui que Mars et Vénus lui avaient fait. Il est vrai que ces deux pièces n’ont ni le sujet ni le caractère du tout semblables au reste du livre mais à mon sens elles n’en sont pas entièrement éloignées. Quoi que c’en soit, elles passeront : je ne sais même si la variété n’était point plus à rechercher en cette rencontre qu’un assortissement si exact.
Mais je m’amuse à des choses auxquelles on ne prendra peut-être pas garde, tandis que j’ai lieu d’appréhender des objections bien plus importantes. On m’en peut faire deux principales : l’une que ce livre est licencieux ; l’autre qu’il n’épargne pas assez le beau sexe ! Quant à la première, je dis hardiment que la nature du conte le voulait ainsi ; étant une loi indispensable selon Horace, ou plutôt selon la raison et le sens commun, de se conformer aux choses dont on écrit. Or qu’il ne m’ait pas été permis d’écrire de celles-ci, comme tant d’autres l’ont fait, et avec succès, je ne crois pas qu’on le mette en doute : et l’on ne me saurait condamner que l’on ne condamne aussi l’Arioste devant moi, et les anciens devant l’Arioste. On me dira que j’eusse mieux fait de supprimer quelques circonstances, ou tout au moins de les déguiser. Il n’y avait rien de plus facile ; mais cela aurait affaibli le conte, et lui aurait ôté de sa grâce. Tant de circonspection n’est nécessaire que dans les ouvrages qui promettent beaucoup de retenue dès l’abord, ou par leur sujet, ou par la manière dont on les traite. Je confesse qu’il faut garder en cela des bornes, et que les plus étroites sont les meilleures : aussi faut-il m’avouer que trop de scrupule gâterait tout. Qui voudrait réduire Boccace à la même pudeur que Virgile, ne ferait assurément rien qui vaille, et pécherait contre les lois de la bienséance en prenant à tache de les observer. Car afin que l’on ne s’y trompe pas, en matière de vers et de prose, l’extrême pudeur et la bienséance sont deux choses bien différentes. Cicéron fait consister la dernière à dire ce qu’il est à propos qu’on die, eu égard au lieu, au temps, et aux personnes qu’on entretient. Ce principe une fois posé ce n’est pas une faute de jugement que d’entretenir les gens d’aujourd’hui de contes un peu libres. Je ne pèche pas non plus en cela contre la morale. S’il y a quelque chose dans nos écrits qui puisse faire impression sur les âmes, ce n’est nullement la gaieté de ces contes ; elle passe légèrement : je craindrais plutôt une douce mélancolie, ou les romans les plus chastes et les plus modestes sont très capables de nous plonger, et qui est une grande préparation pour l’amour. Quant à la seconde objection, par laquelle on me reproche que ce livre fait tort aux femmes ; on aurait raison si je parlais sérieusement ; mais qui ne voit que ceci est jeu, et par conséquent ne peut porter coup ? il ne faut pas avoir peur que les mariages en soient à l’avenir moins fréquents, et les maris plus fort sur leurs gardes. On me peut encore objecter que ces contes ne sont pas fondés, ou qu’ils ont partout un fondement aisé à détruire, enfin qu’il y a des absurdités, et pas la moindre teinture de vraisemblance. Je réponds en peu de mots que j’ai mes garants : et puis ce n’est ni le vrai ni le vraisemblable qui font la beauté et la grâce de ces choses-ci ; c’est seulement la manière de les conter.
Voilà les principaux points sur quoi j’ai cru être obligé de me défendre. J’abandonne le reste aux censeurs : aussi bien serait-ce une entreprise infinie que de prétendre répondre à tout. Jamais la critique ne demeure court, ni ne manque de sujets de s’exercer : quand ceux que je puis prévoir lui seraient ôtés, elle en aurait bientôt trouvé d’autres.
Joconde
Jadis régnait en Lombardie
Un prince aussi beau que le jour,
Et tel, que des beautés qui régnaient a sa cour
La moitié lui portait envie,
L’autre moitié brûlait pour lui d’amour.
Un jour en se mirant : Je fais, dit-il, gageure
Qu’il n’est mortel dans la nature
Qui me soit égal en appas
Et gage, si l’on veut, la meilleure province
De mes états ;
Et s’il s’en rencontre un, je promets foi de prince
De le traiter si bien, qu’il ne s’en plaindra pas.
À ce propos s’avance un certain gentilhomme
D’auprès de Rome.
« Sire, dit-il, si Votre Majesté
Est curieuse de beauté,
Qu’elle fasse venir mon frère ;
Aux plus charmants il n’en doit guerre :
Je m’y connais un peu ; soit dit sans vanité.
Toutefois en cela pouvant m’être flatté,
Que je n’en sois pas cru, mais les cœurs de vos dames :
Du soin de guérir leurs flammes
Il vous soulagera, si vous le trouvez bon :
Car de pourvoir vous seul au tourment de chacune,
Outre que tant d’amour vous serait importune,
Vous n’auriez jamais fait, il vous faut un second.
Là-dessus Astolphe répond
(C’est ainsi qu’on nommait ce roi de Lombardie) :
Votre discours me donne une terrible envie
De connaître ce frère : amenez-le-nous donc.
Voyons si nos beautés en seront amoureuses,
Si ses appas le mettront en crédit :
Nous en croirons les connaisseuses,
Comme très bien vous avez dit. »
Le gentilhomme part, et va quérir Joconde.
(C’est le nom que ce frère avait).
À la campagne il vivait,
Loin du commerce et du monde.
Marié depuis peu : content, je n’en sais rien.
Sa femme avait de la jeunesse,
De la beauté, de la délicatesse ;
Il ne tenait qu’à lui qu’il ne s’en souvint bien.
Son frère arrive, et lui fait l’ambassade ;
Enfin il le persuade.
Joconde d’une part regardait l’amitié
D’un roi puissant, et d’ailleurs fort aimable ;
Et d’autre part aussi, sa charmante moitié
Triomphait d’être inconsolable,
Et de lui faire des adieux
À tirer les larmes des yeux.
« Quoi tu me quittes, disait-elle,
As-tu bien l’âme assez cruelle,
Pour préférer à ma constante amour,
Les faveurs de la cour ?
Tu sais qu’à peine elles durent un jour ;
Qu’on les conserve avec inquiétude,
Pour les perdre avec désespoir.
Si tu te lasses de me voir,
Songe au moins qu’en ta solitude
Le repos règne jour et nuit :
Que les ruisseaux n’y font du bruit,
Qu’afin de t’inviter à fermer la paupière.
Crois-moi, ne quitte point les hôtes de tes bois,
Ces fertiles vallons, ces ombrages si cois,
Enfin moi qui devrais me nommer la première :
Mais ce n’est plus le temps, tu ris de mon amour
Va cruel, va montrer ta beauté singulière,
Je mourrai, je l’espère, avant la fin du jour. »
L’histoire ne dit point, ni de quelle manière
Joconde put partir, ni ce qu’il répondit,
Ni ce qu’il fit, ni ce qu’il dit ;
Je m’en tais donc aussi de crainte de pis faire.
Disons que la douleur l’empêcha de parler ;
C’est un fort bon moyen de se tirer d’affaire.
Sa femme le voyant tout prêt de s’en aller,
L’accable de baisers, et pour comble lui donne
Un bracelet de façon fort mignonne ;
En lui disant : « Ne le perds pas ;
Et qu’il soit toujours à ton bras,
Pour te ressouvenir de mon amour extrême :
Il est de mes cheveux, je l’ai tissu moi-même ;
Et voilà de plus mon portrait,
Que j’attache à ce bracelet. »
Vous autres bonnes gens eussiez cru que la dame
Une heure après eut rendu l’âme ;
Moi qui sais ce que c’est que l’esprit d’une femme,
Je m’en serais a bon droit défié.
Joconde partit donc ; mais ayant oublie
Le bracelet et la peinture,
Par je ne sais quelle aventure.
Le matin même il s’en souvient.
Au grand galop sur ses pas il revient,
Ne sachant quelle excuse il ferait a sa femme :
Sans rencontrer personne, et sans être entendu,
Il monte dans sa chambre, et voit près de la dame
Un lourdaud de valet sur son sein étendu.
Tous deux dormaient : dans cet abord, Joconde
Voulut les envoyer dormir en l’autre monde :
Mais cependant il n’en fit rien ;
Et mon avis est qu’il fit bien.
Le moins de bruit que l’on peut faire
En telle affaire,
Est le plus sûr de la moitié.
Soit par prudence, ou par pitié,
Le Romain ne tua personne.
D’éveiller ces amants, il ne le fallait pas,
Car son honneur l’obligeait en ce cas,
De leur donner le trépas.
« Vis, méchante, dit-il tout bas ;
À ton remords je t’abandonne. »
Joconde là-dessus se remet en chemin,
Rêvant à son malheur tout le long du voyage,
Bien souvent il s’écrie, au fort de son chagrin :
« Encor si c’était un blondin
Je me consolerais d’un si sensible outrage ;
Mais un gros lourdaud de valet !
C’est à quoi j’ai plus de regret :
Plus j’y pense et plus j’en enrage.
Ou l’Amour est aveugle, ou bien il n’est pas sage
D’avoir assemblé ces amants.
Ce sont, hélas ! ses divertissements !
Et possible est-ce par gageure
Qu’il a causé cette aventure. »
Le souvenir fâcheux d’un si perfide tour
Altérait fort la beauté de Joconde :
Ce n’était plus ce miracle d’amour
Qui devait charmer tout le monde.
Les dames, le voyant arriver à la cour,
Dirent d’abord : « Est-ce là ce Narcisse
Qui prétendait tous nos cœurs enchaîner ?
Quoi ! le pauvre homme a la jaunisse !
Ce n’est pas pour nous la donner.
À quel propos nous amener
Un galant qui vient de jeûner
La quarantaine ?
On se fût bien passé de prendre tant de peine. »
Astolphe était ravi ; le frère était confus,
Et ne savait que penser là-dessus ;
Car Joconde cachait avec un soin extrême
La cause de son ennui.
On remarquait pourtant en lui,
Malgré ses yeux cavés, et son visage blême,
De fort beaux traits ; mais qui ne plaisaient point,
Faute d’éclat et d’embonpoint.
Amour en eut pitié ; d’ailleurs cette tristesse
Faisait perdre a ce dieu trop d’encens et de vœux ;
L’un des plus grands suppôts de l’empire amoureux
Consumait en regrets la fleur de sa jeunesse.
Le Romain se vit donc à la fin soulage
Par le même pouvoir qui l’avait afflige.
Car un jour étant seul en une galerie,
Lieu solitaire, et tenu fort secret :
Il entendit en certain cabinet,
Dont la cloison n’était que de menuiserie,
Le propre discours que voici :
« Mon cher Curtade, mon souci,
J’ai beau t’aimer, tu n’es pour moi que glace :
Je ne vois pourtant Dieu merci
Pas une beauté qui m’efface :
Cent conquérants voudraient avoir ta place,
Et tu sembles la mépriser ;
Aimant beaucoup mieux t’amuser
À jouer avec quelque page
Au lansquenet,
Que me venir trouver seule en ce cabinet.
Dorimène tantôt t’en a fait le message ;
Tu t’es mis contre elle a jurer,
À la maudire, à murmurer,
Et n’as quitte le jeu que ta main étant faite,
Sans te mettre en souci de ce que je souhaite. »
Qui fut bien étonné, ce fut notre Romain.
Je donnerais jusqu’à demain,
Pour deviner qui tenait ce langage,
Et quel était le personnage
Qui gardait tant son quant-à-moi.
Ce bel Adon était le nain du roi,
Et son amante était la reine.
Le Romain, sans beaucoup de peine,
Les vit en approchant les yeux
Des fentes que le bois laissait en divers lieux.
Ces amants se fiaient au soin de Dorimène ;
Seule elle avait toujours la clef de ce lieu-là,
Mais la laissant tomber, Joconde la trouva,
Puis s’en servit, puis en tira
Consolation non petite :
Car voici comme il raisonna :
« Je ne suis pas le seul, et puisque même on quitte
Un prince si charmant, pour un nain contrefait,
Il ne faut pas que je m’irrite,
D’être quitte pour un valet.
Ce penser le console : il reprend tous ses charmes,
Il devient plus beau que jamais ;
Telle pour lui verse des larmes,
Qui se moquait de ses attraits.
C’est à qui l’aimera, la plus prude s’en pique,
Astolphe y perd mainte pratique.
Cela n’en fut que mieux ; il en avait assez.
Retournons aux amants que nous avons laissés.
Après avoir tout vu le Romain se retire,
Bien empêché de ce secret.
Il ne faut à la cour ni trop voir, ni trop dire ;
Et peu se sont vantés du don qu’on leur a fait
Pour une semblable nouvelle :
Mais quoi, Joconde aimait avecque trop de zèle
Un prince libéral qui le favorisait,
Pour ne pas l’avertir du tort qu’on lui faisait.
Or comme avec les rois il faut plus de mystère
Qu’avecque d’autres gens sans doute il n’en faudroit,
Et que de but en blanc leur parler d’une affaire,
Dont le discours leur doit déplaire,
Ce serait être maladroit ;
Pour adoucir la chose, il fallut que Joconde,
Depuis l’origine du monde,
Fît un dénombrement des rois et des césars,
Qui sujets comme nous à ces communs hasards,
Malgré les soins dont leur grandeur se pique,
Avaient vu leurs femmes tomber
En telle ou semblable pratique,
Et l’avaient vu sans succomber
À la douleur, sans se mettre en colère,
Et sans en faire pire chère.
« Moi qui vous parle, Sire, ajouta le Romain,
Le jour que pour vous voir je me mis en chemin,
Je fus forcé par mon destin,
De reconnaître Cocuage
Pour un des dieux du mariage,
Et comme tel de lui sacrifier. »
Là-dessus il conta, sans en rien oublier,
Toute sa déconvenue ;
Puis vint à celle du roi.
« Je vous tiens, dit Astolphe, homme digne de foi ;
Mais la chose, pour être crue,
Mérite bien d’être vue :
Menez-moi donc sur les lieux. »
Cela fut fait, et de ses propres yeux
Astolphe vit des merveilles,
Comme il en entendit de ses propres oreilles.
L’énormité du fait le rendit si confus,
Que d’abord tous ses sens demeurèrent perclus :
Il fut comme accablé de ce cruel outrage :
Mais bientôt il le prit en homme de courage,
En galant homme, et pour le faire court,
En véritable homme de cour.
« Nos femmes, ce dit-il, nous en ont donne d’une ;
Nous voici lâchement trahis :
Vengeons-nous-en, et courons le pays ;
Cherchons partout notre fortune.
Pour réussir dans ce dessein,
Nous changerons nos noms, je laisserai mon train,
Je me dirai votre cousin,
Et vous ne me rendrez aucune déférence :
Nous en ferons l’amour avec plus d’assurance,
Plus de plaisir, plus de commodité,
Que si j’étais suivi selon ma qualité. »
Joconde approuva fort le dessein du voyage.
« Il nous faut dans notre équipage,
Continua le prince, avoir un livre blanc :
Pour mettre les noms de celles
Qui ne seront pas rebelles,
Chacune selon son rang.
Je consens de perdre la vie,
Si devant que sortir des confins d’Italie
Tout notre livre ne s’emplit ;
Et si la plus sévère à nos vœux ne se range :
Nous sommes beaux ; nous avons de l’esprit ;
Avec cela bonnes lettres de change ;
Il faudrait être bien étrange,
Pour résister à tant d’appas,
Et ne pas tomber dans les lacs
De gens qui sèmeront l’argent et la fleurette,
Et dont la personne est bien faite. »
Leur bagage étant prêt, et le livre surtout,
Nos galants se mettent en voie.
Je ne viendrais jamais à bout
De nombrer les faveurs que l’Amour leur envoie :
Nouveaux objets, nouvelle proie :
Heureuses les beautés qui s’offrent à leurs yeux !
Et plus heureuse encor celle qui peut leur plaire !
Il n’est en la plupart des lieux
Femme d’échevin, ni de maire,
De podestat, de gouverneur,
Qui ne tienne à fort grand honneur
D’avoir en leur registre place.
Les cœurs que l’on croyait de glace
Se fondent tous à leur abord.
J’entends déjà maint esprit fort
M’objecter que la vraisemblance
N’est pas en ceci tout à fait.
« Car, dira-t-on, quelque parfait
Que puisse être un galant dedans cette science,
Encor faut-il du temps pour mettre un cœur à bien. »
S’il en faut, je n’en sais rien
Ce n’est pas mon métier de cajoler personne :
Je le rends comme on me le donne ;
Et l’Arioste ne ment pas.
Si l’on voulait à chaque pas
Arrêter un conteur d’histoire,
Il n’aurait jamais fait, suffit qu’en pareil cas
Je promets à ces gens quelque jour de les croire.
Quand nos aventuriers eurent goûté de tout
(De tout un peu, c’est comme il faut l’entendre)
« Nous mettrons, dit Astolphe, autant de cœurs à bout
Que nous voudrons en entreprendre
Mais je tiens qu’il vaut mieux attendre.
Arrêtons-nous pour un temps quelque part
Et cela plus tôt que plus tard ;
Car en amour, comme à la table,
Si l’on en croit la Faculté,
Diversité de mets peut nuire à la santé.
Le trop d’affaires nous accable ;
Ayons quelque objet en commun ;
Pour tous les deux c’est assez d’un. »
« J’y consens, dit Joconde, et je sais une dame
Près de qui nous aurons toute commodité.
Elle a beaucoup d’esprit, elle est belle, elle est femme
D’un des premiers de la cité.
Rien moins, reprit le roi, laissons la qualité :
Sous les cotillons des grisettes,
Peut loger autant de beauté,
Que sous les jupes des coquettes.
D’ailleurs, il n’y faut point faire tant de façon,
Être en continuel soupçon,
Dépendre d’une humeur fière, brusque, ou volage :
Chez les dames de haut parage
Ces choses sont à craindre, et bien d’autres encor.
Une grisette est un trésor ;
Car sans se donner de la peine,
Et sans qu’aux bals on la promène,
On en vient aisément à bout ;
On lui dit ce qu’on veut, bien souvent rien du tout.
Le point est d’en trouver une qui soit fidèle
Choisissons-la toute nouvelle,
Qui ne connaisse encor ni le mal ni le bien.
« Prenons, dit le Romain, la fille de notre hôte ;
Je la tiens pucelle sans faute.
De plus puceau que cette belle ;
Sa poupée en sait autant qu’elle.
– J’y songeais, dit le roi, parlons-lui des ce soir.
Il ne s’agit que de savoir
Qui de nous doit donner à cette jouvencelle,
Si son cœur se rend à nos vœux,
La première leçon du plaisir amoureux.
Je sais que cet honneur est pure fantaisie
Toutefois étant roi, l’on me le doit céder,
Du reste il est aisé de s’en accommoder.
– Si c’était, dit Joconde, une cérémonie,
Vous auriez droit de prétendre le pas,
Mais il s’agit d’un autre cas.
Tirons au sort, c’est la justice ;
Deux pailles en feront l’office.
De la chape à l’évêque hélas ils se battaient,
Les bonnes gens qu’ils étaient.
Quoi qu’il en soit, Joconde eut l’avantage
Du prétendu pucelage.
La belle étant venue en leur chambre le soir,
Pour quelque petite affaire ;
Nos deux aventuriers près d’eux la firent seoir,
Louèrent sa beauté, tachèrent de lui plaire,
Firent briller une bague à ses yeux.
À cet objet si précieux
Son cœur fit peu de résistance.
Le marché se conclut, et dès la même nuit,
Toute l’hôtellerie étant dans le silence,
Elle les vient trouver sans bruit.
Au milieu d’eux ils lui font prendre place,
Tant qu’enfin la chose se passe
Au grand plaisir des trois, et surtout du Romain,
Qui crut avoir rompu la glace.
Je lui pardonne, et c’est en vain
Que de ce point on s’embarrasse.
Car il n’est si sotte après tout
Qui ne puisse venir à bout
De tromper à ce jeu le plus sage du monde :
Salomon qui grand clerc étoit
Le reconnaît en quelque endroit,
Dont il ne souvint pas au bonhomme Joconde.
Il se tint content pour le coup,
Crut qu’Astolphe y perdait beaucoup ;
Tout alla bien, et maître Pucelage
Joua des mieux son personnage.
Un jeune gars pourtant en avait essayé.
Le temps à cela près fut fort bien employé,
Et si bien que la fille en demeura contente.
Le lendemain elle le fut encor,
Et même encor la nuit suivante
Le jeune gars s’étonna fort
Du refroidissement qu’il remarquait en elle :
Il se douta du fait, la guetta, la surprit,
Et lui fit fort grosse querelle.
Afin de l’apaiser la belle lui promit,
Foi de fille de bien, que sans aucune faute,
Leurs hôtes déloges, elle lui donnerait
Autant de rendez-vous qu’il en demanderait.
« Je n’ai souci, dit-il, ni d’hôtesse ni d’hôte :
Je veux cette nuit même, ou bien je dirai tout.
– Comment en viendrons-nous a bout ?
(Dit la fille fort affligée)
De les aller trouver je me suis engagée :
Si j’y manque, adieu l’anneau,
Que j’ai gagné bien et beau,
– Faisons que l’anneau vous demeure,
Reprit le garçon, tout à l’heure.
Dites-moi seulement, dorment-ils fort tous deux ?
– Oui, reprit-elle, mais entre eux
Il faut que toute nuit je demeure couchée
Et tandis que je suis avec l’un d’eux empêchée
L’autre attend sans mot dire et s’endort bien souvent,
Tant que le siège soit vacant
C’est là leur mot. » Le gars dit à l’instant :
« Je vous irai trouver pendant leur premier somme. »
Elle reprit : « Ah ! gardez-vous-en bien ;
Vous seriez un mauvais homme.
– Non, non, dit-il, ne craignez rien,
Et laissez ouverte la porte. »
La porte ouverte elle laissa ;
Le galant vint, et s’approcha
Des pieds du lit ; puis fit en sorte,
Qu’entre les draps il se glissa :
Et Dieu sait comme il se plaça ;
Et comme enfin tout se passa :
Et de ceci, ni de cela,
Ne se douta le moins du monde,
Ni le roi lombard ni Joconde.
Chacun d’eux pourtant s’éveilla
Bien étonné de telle aubade.
Le roi lombard dit à part soi :
« Qu’a donc mangé mon camarade ?
Il en prend trop ; et sur ma foi,
C’est bien fait s’il devient malade. »
Autant en dit de sa part le Romain.
Et le garçon ayant repris haleine,
S’en donna pour le jour, et pour le lendemain ;
Enfin pour toute la semaine.
Puis les voyant tous deux rendormis à la fin,
Il s’en alla de grand matin,
Toujours par le même chemin,
Et fut suivi de la donzelle,
Qui craignait fatigue nouvelle.
Eux éveillés, le roi dit au Romain :
« Frère, dormez jusqu’à demain :
Vous en devez avoir envie,
Et n’avez à présent besoin que de repos.
– Comment ? dit le Romain : mais vous-même, à propos
Vous avez fait tantôt une terrible vie.
– Moi ? dit le roi, j’ai toujours attendu :
Et puis voyant que c’était temps perdu,
Que sans pitié ni conscience
Vous vouliez jusqu’au bout tourmenter ce tendron,
Sans en avoir d’autre raison
Que d’éprouver ma patience,
Je me suis, malgré moi, jusqu’au jour rendormi.
Que s’il vous eut plu, notre ami,
J’aurais couru volontiers quelque poste.
C’eut été tout, n’ayant pas la riposte
Ainsi que vous : qu’y ferait-on ?
– Pour Dieu, reprit son compagnon,
Cessez de vous railler, et changeons de matière.
Je suis votre vassal vous l’avez bien fait voir.
C’est assez que tantôt il vous ait plu d’avoir
La fillette tout entière :
Disposez-en ainsi qu’il vous plaira ;
Nous verrons si ce feu toujours vous durera.
– Il pourra, dit le roi, durer toute ma vie,
Si j’ai beaucoup de nuits telles que celle-ci.
– Sire, dit le Romain, trêve de raillerie,
Donnez-moi mon congé, puisqu’il vous plaît ainsi. »
Astolphe se piqua de cette repartie ;
Et leurs propos s’allaient de plus en plus aigrir,
Si le roi n’eut fait venir
Tout incontinent la belle.
Ils lui dirent : « Jugez-nous »,
En lui contant leur querelle.
Elle rougit, et se mit à genoux ;
Leur confessa tout le mystère.
Loin de lui faire pire chère,
Ils en rirent tous deux : l’anneau lui fut donné,
Et maint bel écu couronné,
Dont peu de temps après on la vit mariée,
Et pour pucelle employée.
Ce fut par là que nos aventuriers
Mirent fin à leurs aventures,
Se voyant chargés de lauriers
Qui les rendront fameux chez les races futures :
Lauriers d’autant plus beaux, qu’il ne leur en coûta
Qu’un peu d’adresse, et quelques feintes larmes ;
Et que loin des dangers et du bruit des alarmes,
L’un et l’autre les remporta.
Tout fiers d’avoir conquis les cœurs de tant de belles,
Et leur livre étant plus que plein,
Le roi lombard dit au Romain :
« Retournons au logis par le plus court chemin :
Si nos femmes sont infidèles,
Consolons-nous, bien d’autres le sont qu’elles.
La constellation changera quelque jour :
Un temps viendra que le flambeau d’Amour
Ne brûlera les cœurs que de pudiques flammes :
À présent on dirait que quelque astre malin
Prend plaisir aux bons tours des maris et des femmes.
D’ailleurs tout l’univers est plein
De maudits enchanteurs, qui des corps et des âmes,
Font tout ce qu’il leur plaît : savons-nous si ces gens
(Comme ils sont traîtres et méchants,
Et toujours ennemis, soit de l’un, soit de l’autre)
N’ont point ensorcelé mon épouse et la vôtre ?
Et si par quelque étrange cas,
Nous n’avons point cru voir chose qui n’était pas ?
Ainsi que bons bourgeois achevons notre vie,
Chacun près de sa femme, et demeurons-en la.
Peut-être que l’absence, ou bien la jalousie,
Nous ont rendu leurs cœurs, que l’Hymen nous ôta. »
Astolphe rencontra dans cette prophétie.
Nos deux aventuriers, au logis retournés,
Furent très bien reçus, pourtant un peu grondés ;
Mais seulement par bienséance.
L’un et l’autre se vit de baisers régalé :
On se récompensa des pertes de l’absence,
Il fut dansé, sauté, ballé ;
Et du nain nullement parlé,
Ni du valet comme je pense.
Chaque époux s’attachant auprès de sa moitié,
Vécut en grand soulas, en paix, en amitié,
Le plus heureux, le plus content du monde.
La reine à son devoir ne manqua d’un seul point :
Autant en fit la femme de Joconde :
Autant en font d’autres qu’on ne sait point.
Richard Minutolo
C’est de tout temps qu’à Naples on a vu
Régner l’amour et la galanterie :
De beaux objets cet état est pourvu,
Mieux que pas un qui soit en Italie.
Femmes y sont, qui font venir l’envie
D’être amoureux, quand on ne voudrait pas.
Une surtout ayant beaucoup d’appas
Eut pour amant un jeune gentilhomme,
Qu’on appelait Richard Minutolo :
Il n’était lors de Paris jusqu’à Rome
Galant qui sut si bien le numéro.
Force lui fut ; d’autant que cette belle
(Dont sous le nom de madame Catelle
Il est parlé dans le Décaméron)
Fut un long temps si dure et si rebelle,
Que Minutol n’en sut tirer raison.
Que fait-il donc ? comme il voit que son zèle
Ne produit rien, il feint d’être guéri ;
Il ne va plus chez madame Catelle ;
Il se déclare amant d’une autre belle ;
Il fait semblant d’en être favori.
Catelle en rit ; pas grain de jalousie.
Sa concurrente était sa bonne amie :
Si bien qu’un jour qu’ils étaient en devis,
Minutolo pour lors de la partie,
Comme en passant mit dessus le tapis
Certains propos de certaines coquettes,
Certain mari, certaines amourettes,
Qu’il controuva sans personne nommer ;
Et fit si bien que madame Catelle
De son époux commence à s’alarmer,
Entre en soupçon, prend le morceau pour elle.
Tant en fut dit, que la pauvre femelle,
Ne pouvant plus durer en tel tourment,
Voulut savoir de son défunt amant,
Qu’elle tira dedans une ruelle,
De quelles gens il entendait parler :
Qui, quoi, comment, et ce qu’il voulait dire.
« Vous avez eu, lui dit-il, trop d’empire
Sur mon esprit pour vous dissimuler.
Votre mari voit Madame Simone :
Vous connaissez la galande que c’est :
Je ne le dis pour offenser personne ;
Mais il y va tant de votre intérêt,
Que je n’ai pu me taire davantage.
Si je vivais dessous votre servage,
Comme autrefois, je me garderais bien
De vous tenir un semblable langage,
Qui de ma part ne serait bon à rien.
De ses amants toujours on se méfie.
Vous penseriez que par supercherie
Je vous dirais du mal de votre époux ;
Mais grâce à Dieu je ne veux rien de vous.
Ce qui me meut n’est du tout que bon zèle.
Depuis un jour j’ai certaine nouvelle,
Que votre époux chez Janot le baigneur
Doit se trouver avecque sa donzelle.
Comme Janot n’est pas fort grand seigneur,
Pour cent ducats vous lui ferez tout dire ;
Pour cent ducats il fera tout aussi.
Vous pouvez donc tellement vous conduire,
Qu’au rendez-vous trouvant votre mari,
Il sera pris sans s’en pouvoir dédire.
Voici comment. La dame a stipulé
Qu’en une chambre, ou tout sera fermé,
L’on les mettra ; soit craignant qu’on ait vue
Sur le baigneur ; soit que sentant son cas,
Simone encor n’ait toute honte bue.
Prenez sa place, et ne marchandez pas :
Gagnez Janot ; donnez-lui cent ducats ;
Il vous mettra dedans la chambre noire ;
Non pour jeûner, comme vous pouvez croire :
Trop bien ferez tout ce qu’il vous plaira.
Ne parlez point, vous gâteriez l’histoire,
Et vous verrez comme tout en ira. »
L’expédient plus très fort à Catelle.
De grand dépit Richard elle interrompt :
« Je vous entends, c’est assez, lui dit-elle,
Laissez-moi faire ; et le drôle et sa belle
Verront beau jeu si la corde ne rompt.
Pensent-ils donc que je sois quelque buse ? »
Lors pour sortir elle prend une excuse,
Et tout d’un pas s’en va trouver Janot,
À qui Richard avait donné le mot.
L’argent fait tout : si l’on en prend en France
Pour obliger en de semblables cas,
On peut juger avec grande apparence,
Qu’en Italie on n’en refuse pas.
Pour tout carquois, d’une large escarcelle
En ce pays le dieu d’amour se sert.
Janot en prend de Richard, de Catelle ;
Il en eut pris du grand diable d’enfer.
Pour abréger, la chose s’exécute
Comme Richard s’était imaginé.
Sa maîtresse eut d’abord quelque dispute
Avec Janot qui fit le réservé :
Mais en voyant bel argent bien compté,
Il promet plus que l’on ne lui demande.
Le temps venu d’aller au rendez- vous,
Minutolo s’y rend seul de sa bande ;
Entre en la chambre ; et n’y trouve aucuns trous
Par où le jour puisse nuire à sa flamme.
Guère n’attend : il tardait à la dame
D’y rencontrer son perfide époux,
Bien préparée à lui chanter sa gamme.
Pas n’y manqua, l’on peut s’en assurer.
Dans le lieu dit Janot la fit entrer,
Là ne trouva ce qu’elle allait chercher :
Point de mari, point de Dame Simone
Mais au lieu d’eux Minutol en personne,
Qui sans parler se mit à l’embrasser.
Quant au surplus je le laisse à penser :
Chacun s’en doute assez sans qu’on le die.
De grand plaisir notre amant s’extasie.
Que si le jeu plut beaucoup à Richard,
Catelle aussi, toute rancune à part,
Le laissa faire, et ne voulut mot dire
Il en profite, et se garde de rire ;
Mais toutefois ce n’est pas sans effort
De figurer le plaisir qu’a le sire,
Il me faudrait un esprit bien plus fort
Premièrement il jouit de sa belle ;
En second lieu il trompe une cruelle ;
Et croit gagner les pardons en cela.
Mais à la fin Catelle s’emporta :
« C’est trop souffrir, traître, ce lui dit-elle,
Je ne suis pas celle que tu prétends.
Laisse-moi là ; sinon à belles dents
Je te déchire, et te saute à la vue.
C’est donc cela que tu te tiens en mue,
Fais le malade et te plains tous les jours ;
Te réservant sans doute à tes amours.
Parle, méchant, dis-moi, suis-je pourvue
De moins d’appas ? ai-je moins d’agrément,
Moins de beauté que ta dame Simone ?
Le rare oiseau ! ô la belle friponne !
T’aimais-je moins ? je te hais à présent ;
Et plut à Dieu que je t’eusse vu pendre. »
Pendant cela Richard pour l’apaiser
La caressait, tâchait de la baiser ;
Mais il ne put ; elle s’en sut défendre.
« Laisse-moi là, se mit-elle à crier
Comme un enfant penses-tu me traiter ?
N’approche point, je ne suis plus ta femme :
Rends-moi mon bien, va-t’en trouver ta dame
Va déloyal, va-t’en, je te le dis.
Je suis bien sotte, et bien de mon pays
De te garder la foi de mariage :
À quoi tient-il, que pour te rendre sage,
Tout sur-le-champ, je t’envoie quérir
Minutolo qui m’a si fort chérie ?
Je le devrais afin de te punir ;
Et sur ma foi, j’en ai presque l’envie. »
À ce propos le galant éclata.
« Tu ris, dit-elle, ô dieux ! quelle insolence !
Rougira-t-il ? voyons sa contenance. »
Lors de ses bras la belle s’échappa ;
D’une fenêtre à tâtons approcha ;
L’ouvrit de force ; et fut bien étonnée
Quand elle vit Minutol son amant :
Elle tomba plus d’à demi pâmée.
« Ah ! qui t’eut cru, dit-elle, si méchant ?
Que dira-t-on ? me voilà diffamée.
– Qui le saura ? dit Richard à l’instant ;
Janot est sûr, j’en réponds sur ma vie.
Excusez donc si je vous ai trahie ;
Ne me sachez mauvais gré d’un tel tour :
Adresse, force, et ruse, et tromperie ;
Tout est permis en matière d’amour.