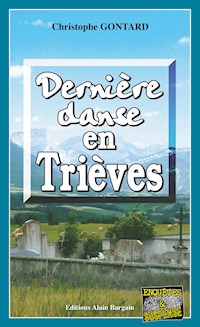
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editions Alain Bargain
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Französisch
Le cadavre d'un Roumain est retrouvé dans un petit village du Trièves...
Un cadavre au Percy. Stupéfaction dans ce petit village du Sud-Dauphiné : il s'agit d'un Roumain. La police a d'abord cru à un suicide. Mais c'était compter sans le flair de Philibert Pont-Rougard, fonctionnaire international, traducteur de roumain, de retour au pays, qui se lance dans l'enquête, sur fond de musique tsigane et par un vent du sud entêtant qui attise les règlements de comptes et fait circuler les pires ragots. Et une xénophobie manifeste envers les Tsiganes ne facilitera guère sa tâche... D'autant que tout s'emballe et que se font jour des révélations pour le moins gênantes... Toute vérité est-elle en effet bonne à dire ?
Philibert Pont-Rougard, fonctionnaire international, saura-il faire la lumière sur cette affaire pleine de révélations et de règlements de compte ? Un roman policier palpitant sur fond de musique tsigane !
EXTRAIT
— Ben, mon salaud, c’est comme ça qu’il est devenu une des plus grosses fortunes de France, le Teodorescu !
— Il paraît que c’est grâce à ses origines roumaines qu’il a pu négocier tout ça avant la privatisation et être le privilégié de l’affaire.
— Oui, sauf que tout ça est complètement illégal. Il a abusé de sa position de ministre.
— Tous les mêmes, je te dis. Et après, ils vont nous faire des leçons. « Va falloir que les Français se serrent encore la ceinture pour sauver l’économie… » Ça fait vingt ans qu’on entend ces conneries pendant qu’eux, ils se gavent.
— Oui, et toi, tu vas tuer un sanglier de trop ou taquiner le lièvre un peu en dehors des dates autorisées, tu risques de te retrouver en taule !
Les conversations continuaient sur le même ton, passant en revue tous les présumés avantages de la République pour les élus. Ça sentait l’antiparlementarisme primaire et corporatiste. En les poussant un peu, certains auraient pu faire un couplet nostalgique sur les régimes autoritaires. C’en était trop pour Philibert qui en avait assez entendu. Ce qu’il venait d’apprendre méritait confirmation, vérification. Mais cela venait s’ajouter aux nombreux autres éléments qui pesaient à charge contre Teodorescu. Comment diable Teodorescu avait-il bien pu négocier avant la chute du régime de Ceaucescu, une opération de privatisation ? Comment Ceaucescu avait-il pu laisser faire cela, lui, le communiste pur et dur opposé à toute forme de capitalisme ? Qu’est-ce qui avait bien pu le pousser à brader le fleuron de son industrie, ses réserves pétrolières, son rêve d’indépendance énergétique ?
À PROPOS DE L'AUTEUR
À 43 ans,
Christophe Gontard, cadre dans une collectivité territoriale, est installé à La Mure en Isère. Il garde d'un passé de voyageur le goût du choc des cultures et la passion des rencontres. Dans ce premier roman, Christophe Gontard nous emmène à travers "son Trièves" où il fut un temps élu maire, et "sa Matheysine", aux confins du Sud-Dauphiné, sur les chemins d'une région où les éléments naturels sont aussi rudes qu'inquiétants. C'est dans cette partie de France profondément rurale et préservée, presque oubliée du monde, qu'il nous donne rendez-vous avec l'Histoire contemporaine, sur fond de relations franco-roumaines.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 349
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Couverture
Page de titre
Cet ouvrage de pure fiction n’a d’autre ambition que de distraire le lecteur. Les événements relatés ainsi que les propos, les sentiments et les comportements des divers protagonistes n’ont aucun lien, ni de près ni de loin, avec la réalité et ont été imaginés de toutes pièces pour les besoins de l’intrigue. Toute ressemblance avec des personnes ou des situations existant ou ayant existé serait pure coïncidence.
Pour Anne.
I
Le vent de sud soufflait comme chaque année à même époque, desséchant tout sur son passage et apportant avec lui une poussière rouge qu’on disait venir du Sahara. Sifflant dans les branches des arbres, luttant avec les tuiles des toits qu’il transformait parfois, les jours de rage, en papillons de terre cuite. Il durait trois, six ou neuf jours, et il suffisait d’un seul pour déchaîner les passions, désinhiber les introvertis et faire dérailler les plus doux.
Quand il ouvrit la porte du bar “Le Sanglier Roi”, Philibert se sentit comme autrefois légèrement mal à l’aise. Certes, il retrouvait avec plaisir les odeurs familières d’anis sucré, de tabac papier maïs, de limonade et de réglisse si caractéristiques des cafés de villages. Et il aimait le spectacle de ces visages connus, fidèles, installés et stables. Ces corps durablement enracinés dans le terroir. Tout ça dégageait une vraie sensation de sérénité. Cependant, il ressentit comme à chaque fois, un léger pincement au cœur lorsque le silence s’imposa d’un seul coup au moment où il poussa la porte pour franchir le seuil du bar. « Rien n’a changé. Les étrangers doivent toujours montrer patte blanche ! », pensa Philibert. Il est vrai qu’il avait quitté le Trièves depuis longtemps et passait maintenant pour un inconnu.
Sa vie avait pris une tournure inhabituelle et un peu fantasque aux yeux du commun des mortels. Souvent en déplacement à l’étranger pour de longs mois, pour des missions confiées par le gouvernement français auprès de divers gouvernements d’Europe de l’Est, des Caraïbes ou d’Afrique, il avait peu à peu coupé les ponts avec sa vie d’antan ici.
À la fois, il le regrettait car un côté de sa personnalité aurait bien flirté avec une activité agricole ou, tout au moins, rurale. L’autre versant, lui, était animé par une soif de réussite sociale, de revanche sur la vie, d’ambition.
Le silence du bar ne dura que quelques secondes, suffisamment pour que chacun puisse scruter le visage du nouveau venu. La plupart des regards que croisait Philibert en entrant le reconnurent apparemment d’emblée. Mais chacun retourna à ses occupations, qui à trinquer la dernière momie, qui à finir un dernier pli avant de mettre capot ses adversaires ou jeter un œil vague sur les pages nécrologiques du Dauphiné Libéré du jour, comme rassurés de la présence d’un homme du pays.
Robert, un ami d’enfance, s’approcha. Robert Grangère, fils de l’Hippolyte Grangère, menuisier de renom, avait repris l’entreprise familiale. Taillé dans le roc, un peu plus âgé que Philibert, Robert était une force de la nature. Grand, fort, il aurait pu intégrer facilement une équipe de rugby. Inlassablement vêtu d’un pantalon de velours côtelé noir et d’une chemise à carreaux, Robert était, par sa passion du terroir et son franc-parler, un personnage incontournable du paysage cantonal. Il ne put cacher son immense joie lorsqu’il reconnut Philibert :
— Oh ben, mon Phil, voilà un bail qu’on t’a pas vu par chez nous, “dis puis” ! T’es en vacances un peu chez la maman ?
— Non, non, je suis de retour, installé à Lalley depuis quelques semaines. Je ne sais pas trop pour combien de temps, mais j’ai eu une opportunité professionnelle à Grenoble, alors me voilà, répondit Philibert un peu gêné. J’ai deux semaines de vacances.
— Ah ben, ça fait plaisir de te voir ! Dis voir, mais approche un peu, mon cochon, mais dis donc, t’as forci, toi ! Ils te nourrissent bien aux antipodes ! Hein, le Guy ! T’as bien reconnu notre Phil ! Tu trouves pas qu’il a forci ? Hein ?
Guy était le plus fidèle client des bistrots du canton. Célibataire endurci, il connaissait tout le monde et avait toujours un mot gentil pour chacun. Lorsqu’il avait encore toute sa tête.
— Ah oui, peut-être bien… Alors t’es par chez nous un peu ? ajouta Guy.
— Oui oui, Guy ! assura Philibert d’un air faussement complice.
— Mais dis-moi. On t’a toujours appelé Phil, mais ton vrai prénom c’est bien Philippe ? Je ne m’en souviens plus, le taquina Guy.
— … Non. C’est Philibert, répondit l’ami de Robert d’un air gêné.
Robert et Philibert avaient été à l’école ensemble. Leurs projets de vie d’hommes les avaient séparés, l’un étant installé dans le Trièves qu’il n’avait jamais quitté et où il exerçait le métier de menuisier, l’autre ayant choisi de courir le monde. Mais ce qui les unissait était plus fort que les distances kilométriques qui avaient pu les séparer durant des années. Ils étaient en parfaite confiance l’un envers l’autre, comme deux frères. Même si leurs échanges étaient rarement personnels et intimes, ils se comprenaient d’un regard, d’un sourire ou d’une moue.
— Bon, j’étais venu acheter le journal, mais qu’est-ce que vous prenez, les gars ? demanda Philibert. Deux momies, un blanc limé ? C’est parti ! Et quoi de neuf ? La famille, ça va ?
— Oui La famille, ça va, le vieux se maintient, mais il devient exigeant avec l’âge. Enfin, tant qu’ils peuvent rester chez eux… Mais si tu veux du neuf, tu arrives à point toi, dis donc. On n’a jamais eu autant de remue-ménage dans Clelles depuis hier, répondit Robert.
— Ah bon ? s’étonna Philibert.
— Oui, on a un meurtre ! s’exclama fièrement Robert, comme heureux de voir son patelin entrer dans les colonnes “faits divers”.
— Ah ? Mais j’ai rien vu dans le journal ni rien entendu à la radio, pourtant en montant dans la voiture j’ai écouté Radio Mont-Aiguille, enfin, quand je captais…
— Non, mais les flics ont tout fait pour pas ébruiter l’affaire. Ils ont eu des ordres. Ça finira bien par filtrer, mais on dit que ça vient de Reyssac.
— Reyssac ! Le château de Teodorescu ? Qu’est-ce qu’il a à voir là-dedans celui-là ?
— Ben, il paraît qu’il veut pas que ce soit dit que dans son fief il y ait de l’insécurité. En tant qu’ancien Ministre des Libertés et de j’sais plus trop quoi… ça se fait pas ! Donc, motus et bouche cousue. Sauf qu’ils sont vachement emmerdés, parce que la victime, c’est pas un Français. Et la femme de la victime, c’est pas une Française non plus, et elle ne parle pas français ! Alors pour les interrogatoires… Mais tu reprendras bien une petite momie… hein, pour la route ? Et un blanc limé pour Guy, hein Guy, je te demande pas. Ah, salut Marcel ! Comment va ?
— Oh ça pourrait mieux gazer si j’avais pas toutes ces emmerdes avec ce meurtre-là, tous ces flics, la presse qui essaie de savoir, le cabinet du Ministre… Tu parles d’une tuile, un dimanche en plus, faut que ça tombe un dimanche ! Juste le jour où j’organisais une battue au-dessus de Bonnardel ! grogna Marcel.
Marcel s’éloignait en bougonnant vers un autre groupe du bar, reprenant à leur intention in extenso la même phrase qu’il venait de sortir, avec le même air dépité et abattu. Marcel Baurry, conseiller général de son état, avait bien profité de la vie : le col de chemise incrusté dans la chair rougie de son cou, il trinquait chaque matin avec ses amis et électeurs en leur narrant de sa voix toute en rondeur les dernières péripéties de l’assemblée départementale.
— T’as reconnu Marcel Baurry ? chuchota Robert.
— Oui. Toujours en pleine forme à ce que je vois. Vice-président du Conseil Général maintenant. Dis donc ! Et pour le coin, ça a apporté des trucs au moins ?
— Ah ça, pour sûr, enfin c’est pas trop lui, ou plutôt si, c’est lui qui demande, c’est lui qui obtient, mais celui qui décide c’est notre ancien ministre, Daniel Teodorescu. Il le tient, parfois, c’en est pitoyable !
— Ben oui mais il a été ministre du gouvernement français pendant plusieurs années quand même, c’est normal qu’il ait un peu de pouvoir et d’ascendant sur un élu local et qu’il fasse tout pour aider un homme qui lui est fidèle… Mais revenons à ce meurtre, t’en as pas dit assez, raconte ! Ça s’est passé comment ? C’est quelqu’un qu’on connaît ?
— Non, tu connais pas. Moi non plus d’ailleurs. C’est un Roumain. Un réfugié ou quelque chose comme ça. En fait, ils faisaient partie d’une troupe de danseurs folkloriques, ils avaient passé quelques semaines dans le département à l’invitation de “Isère-Solidarité-Roumanie” quand ça commençait à aller mal là-bas, en mille neuf cent quatre-vingt-neuf ou quatre-vingt-dix, je ne sais plus trop. Ils ont séjourné principalement dans le Trièves et à La Mure. Ils ont dansé un peu partout. Ils ont été accueillis ici par la “Gigouillette”, tu sais, l’association de danse folklorique à Lalley, le rigodon… Une sorte d’échange culturel, si tu veux. En plus du département, pas mal de communes avaient financé l’opération. Mais ton verre est vide, encore une ?
— Ah, non non !
— Non, c’est ma tournée, tu ne peux pas refuser !
— Mais avant c’était pas déjà ta…
— Allez hop ! Josette, tu remets ça, s’il te plaît !
— J’sais pas comment je vais rentrer moi !
— Bof, ta voiture elle connaît bien la route toute seule depuis le temps, non ?
— Hum !
Les yeux de Robert pétillaient d’impatience. Il saisit l’avant-bras de Philibert tout en lui parlant, comme pour mieux capter son attention.
— Bon, j’ai pas fini… Donc, ces danseurs-là, quand ça a pété en Roumanie, que le “Cha-au-chescu”…
— Ceaucescu, tu veux dire, oui ?
— Oui enfin, quand il a été zigouillé, ils ont pas pu rentrer. Ça rigole pas là-bas, hein ! Mais d’ailleurs tu connais, toi ! Avec tous tes voyages, t’as aussi vécu là-bas en Roumanie, non ? Tu m’avais bien dit que tu parlais roumain, non ?
— Oui, c’est exact on y a vécu quelques années, et je parle couramment le roumain. Je suis même interprète assermenté. Mais continue ton histoire, tu disais que lorsque c’était la révolution en Roumanie…
— Oui, à ce moment-là, ils ont été contraints de rester ici comme réfugiés politiques, je crois. Tout le monde s’est organisé, le curé, le pasteur, les écoles, bref, on leur a trouvé des logements et des petits boulots. Pis ça se passait plutôt bien, des gens discrets et tout, travailleurs à ce qui paraît. Mais voilà que mercredi dernier… oui, attends voir, on est bien dimanche ? Ben oui, c’était mercredi dernier donc. Albert du Percy, tu sais le frère de Colette, qui est cantonnier à la DDE, alors qu’il promenait son chien et cherchait quelques chanterelles, s’est retrouvé nez à nez avec un cadavre dans les bois, juste sous le viaduc de Reyssac. En le voyant comme ça, le gars se serait jeté du train… un suicide.
— Mais tu me disais que c’était un meurtre ?
— Oui, mais au début, ils ont cru à un suicide. Quand les gendarmes de Clelles sont arrivés, ça a été leur verdict. Ce n’est malheureusement pas le premier depuis ce viaduc. Et puis quand ils ont déplacé le corps, ils se sont vite aperçus qu’il y avait quelque chose qui ne collait pas pour un suicide. Le gars, il avait le visage entièrement ravagé comme si on lui avait brûlé la peau, ou jeté de l’eau bouillante, ou encore de l’acide. Ça, c’est l’Alain qui me l’a raconté. Ça lui a levé le cœur, il paraît que t’y voyais les os du nez à vif, et la peau avait été tellement travaillée sous l’effet du produit que les yeux restaient ouverts, complètement sortis des orbites.
— Et la police a une piste ?
— Ben, on ne sait rien. Défiguré comme il était, il n’a pas été possible d’identifier le corps. Une annonce a été passée dans le journal avec la description des vêtements, la corpulence etc. Et hier après-midi, samedi, sa femme s’est présentée à la gendarmerie. Tant bien que mal, puisqu’elle ne parle pas français, elle a fait comprendre que cela pouvait être son mari. Et elle l’aurait reconnu à ses vêtements et effets personnels. En ce moment à ce qu’il paraît, ils essaient de l’interroger, mais apparemment ils y arrivent pas, elle parle pas un mot de français. Alors on sait même pas ce qu’elle a vu, pas vu etc. C’est Claude, tu le connais, le gendarme, il était déjà là quand t’es parti, qui l’a dit.
— Claude ? Le fils d’Eugène ? Claude Barral ? Eh bien, on peut dire que c’est de la police de proximité ici, il connaît tout le monde ! La moitié du canton c’est sa famille ! Côté autorité et impartialité, bonjour ! Mais bon, depuis qu’on a un ancien Ministre des Libertés dans la région ! Cette fois-ci, il faut que j’y aille. Merci pour tout et à très bientôt, on est à Lalley pour la semaine. Passe nous voir si t’as cinq minutes !
— D’accord, on y pensera. Adieu mon ami !
Les premiers pas de Philibert furent une épreuve. Pas question de tituber ou pire encore de trébucher devant tout le monde, sinon, sa réputation était faite. Il se dirigea donc d’un pas rapide et à longues enjambées jusqu’à la porte qu’il saisit avec force. Il lança un « au revoir tout le monde ! » qui apparemment tomba à plat, puis une fois dehors, respira à grandes bouffées l’air vivifiant de cette fin de matinée. Des odeurs de feu de bois flottaient dans l’air. Des feuilles mortes et quelques papiers faisaient une course-poursuite en traversant la place à vive allure, tournoyant autour du monument aux morts, trébuchant parfois dans les branches de la haie de buis.
Philibert tenta de rejoindre sa voiture et se rendit compte que, finalement, il tenait bien le coup. Prendre le volant dans cet état, ce n’était ni prudent, ni raisonnable, ni responsable, pensa-t-il, mais que faire ? Il démarra son véhicule, ouvrit grand la fenêtre et s’engagea dans la montée vers le moulin et la RN75 pour rejoindre Lalley et sa maison où Catherine l’attendait. Après le virage de “Moutarde”, à Monestier du Percy, il avait le vent en pleine face, et en direct de la trouée du col de la Croix Haute. Malgré la puissance de la voiture, il sentit une résistance et entendit des sifflements à travers les joints des portes.
Cette partie du Trièves qui défilait devant ses yeux, Philibert la connaissait bien, tout comme la Matheysine, région d’origine de son épouse. Bien que souvent rivales, comme toutes les régions proches et similaires, le Trièves et la Matheysine, situées à une quarantaine de kilomètres au sud de Grenoble offrent une variété de paysages et un patrimoine d’une richesse authentique : plaines verdoyantes aux gorges profondes et lacs en passant par le massif majestueux de l’Obiou jusqu’aux Pré-alpes du Sud et aux contreforts du Vercors plus à l’ouest… Philibert était toujours fasciné et, chaque jour, émerveillé par la majesté de ces paysages, l’humilité des villages et l’ambition affichée des corps de ferme. Il aimait ces gens qui, des plaines de Prébois aux combes mensoises, s’étaient usés à extirper de cette terre ingrate le blé tant attendu par ceux qui, de l’autre côté du Drac, sous cette même terre, mouraient dans les galeries infiniment noires des mines du plateau.
II
Catherine et Philibert Pont-Rougard étaient mariés depuis une vingtaine d’années. Le couple, solide, forgé par les épreuves de la vie, faisait plaisir à voir. On leur disait souvent qu’ils étaient beaux. Non pas tant en raison de leur physique, somme toute assez banal, mais parce qu’ils laissaient paraître une entente harmonieuse et intelligente. Non pas la fusion possessive de certains couples, ni l’apparente liberté totale d’autres se disant “modernes”, non, juste un équilibre tranquille, serein, alimenté par une confiance forte chaque jour renouvelée.
Pour autant, outre leurs débuts difficiles dans la vie, ils avaient aussi traversé des périodes de crises assez profondes, finalement salutaires, car elles avaient chaque fois permis de relancer le jeu de la séduction et de repartir sur des bases légèrement modifiées, repositionnant chacun dans une nouvelle posture par rapport à l’autre. La famille de Philibert était modeste. Mais il avait coulé dans ces veines-là du sang de haute lignée, il y a fort longtemps. De telles origines, soutenues par une éducation soignée, avaient fait de Philibert un personnage assez distingué. La quarantaine bien passée, il avait une silhouette de jeune homme qu’il entretenait par des activités sportives régulières. Il portait un regard haut que certains trouvaient fier.
Catherine, jolie brune aux yeux verts, du haut de son un mètre soixante, était une femme déterminée.
Issue d’une riche famille de La Mure, elle avait gardé de son éducation stricte et catholique, une froideur et une grande difficulté à parler de soi. Elle ne se confiait donc que très rarement, sauf dans les moments difficiles, et c’était chaque fois une épreuve. Par conséquent, elle bouillonnait souvent, constamment sous pression, les idées jaillissant avec la force d’un volcan en éruption. Elle avait fait de l’éducation de leurs deux filles, Coline et Luce, la priorité de sa vie. Maternelle ou pas, elle avait été programmée ainsi : une mère devait donner tout son temps à l’éducation de ses enfants.
Elle pouvait en être fière aujourd’hui, puisque la plus grande était en Australie, professeur d’histoire et de français au lycée français de Cambera, et la dernière suivait brillamment Sciences Politiques.
La jeune femme abordait donc depuis quelque temps une nouvelle période de sa vie, inédite (car elle avait eu sa première fille à vingt ans) et qui lui laissait du temps pour elle.
Sauf que vingt ans d’éducation chrétienne et bourgeoise ne s’effacent pas comme cela, et se donner le droit de vivre pour soi était un privilège qui ne lui effleurait même pas l’esprit. Catherine avait repris son activité professionnelle comme avocate et passait son temps libre à le donner aux autres : Restos du cœur, ATD Quart monde étaient les lieux qu’elle fréquentait souvent le samedi activement et bénévolement depuis quelques mois, le plus souvent possible à La Mure, ville de son enfance qu’elle affectionnait particulièrement. Elle en revenait toujours énervée, révoltée, prête à déplacer des montagnes. Elle ne supportait pas la misère, non pas par rejet de la différence, mais parce qu’elle ne supportait pas l’injustice. Ce cheminement l’avait lentement fait dériver vers les sphères politiques. Elle n’était membre d’aucun parti, mais elle participait à de nombreuses réunions de préparation de campagnes électorales et avait été repérée par le député du coin comme une recrue de choix et rare en ces temps où la parité devient un pari pour ceux qui sont chargés de constituer des listes de candidats aux élections.
Cette dernière lubie n’était guère du goût de Philibert, qui n’aimait pas cet engagement qu’il assimilait à un embrigadement réducteur de liberté individuelle et surtout de liberté de penser. Ça, c’était ce qu’il disait. En réalité, Philibert ne supportait pas qu’on se fasse remarquer. « Vivons heureux, vivons cachés », aurait bien été sa devise. Étaient-ce les origines lorraines de sa mère et le légendaire rigorisme attaché à cette région ? Toujours est-il qu’il avait adopté pour ligne de conduite de ne jamais déranger, se faire remarquer ou sortir de la norme. Catherine allait donc, aux prochaines élections régionales, probablement faire partie d’une liste en bonne position pour être éligible quoi qu’il arrive. Avec l’aval de Philibert ou pas.
Parallèlement, elle avait des visées sur les municipales, et leur récente installation dans la région lui avait offert l’opportunité d’un engagement public local, compte tenu de ses propres racines, mais également des enjeux qui animaient cette petite ville du Sud-Dauphiné, La Mure. Les déplacements professionnels de Philibert dans de nombreux pays où ils ne restaient pas plus de deux ou trois ans, lui avaient plu au début : plaisirs de la découverte d’un nouveau lieu, dépaysement, charmes de la vie des expatriés. Mais au bout de quelques années, elle avait vite aspiré à de la stabilité, à des relations durables avec des amis, des copains, des voisins, sans l’échéance d’une prochaine mutation.
L’opportunité de la mission de Philibert à Grenoble avait été le déclic. Certes, pour celui-ci, il s’agissait professionnellement d’une nouvelle étape comme une autre, mais pour Catherine c’était le retour aux sources et le désir de s’installer dans la durée. Les choses avaient été claires entre eux et d’ailleurs, c’est Philibert qui en premier l’avait proposé : « on retape la maison de Lalley, on s’y installe, ce sera notre nid, et si je devais repartir pour un autre poste ailleurs, ce serait seul. On s’accommodera de cette vie un peu spéciale du mari présent quelques jours par mois. Au moins, tu pourras enfin te consacrer à ta vie professionnelle sans être obligée de la remettre en cause à chaque nouveau départ et ça apportera de la stabilité à nos relations amicales, aux enfants. » Les choses étaient dites, la famille Pont-Rougard s’installait. Ils avaient décidé de le faire à Lalley, dans la maison familiale de Philibert.
III
Arrivé devant la maison, à Lalley, Philibert coupa le moteur. Avant de descendre, il resta une minute ou deux à contempler sa maison, depuis son siège, derrière le pare-brise. Elle inspirait la sérénité et, bien que restaurée depuis peu en maison pour les vacances, elle avait gardé son caractère authentique des fermes du Trièves : le volume imposant du corps de ferme était couvert par un toit à quatre pans de tuiles “écailles” en terre cuite. Une belle maison du Trièves, censée abriter le bonheur d’une famille “modèle”. Adossée à la pente, le bâtiment tout en longueur comportait côté sud une porte d’écurie, la porte d’entrée et deux petites fenêtres d’origine. À gauche, du côté le plus haut, un montoir permettait d’accéder à ce qui avait été autrefois une grange sur tout le premier niveau. Côté ouest, le haut pignon qui dominait la place du village avait été restauré dans un esprit contemporain : de grandes et larges baies vitrées recouvraient toute la façade, du rez-de-chaussée jusqu’au premier niveau, laissant apparaître de grosses poutres porteuses en chêne.
Ce subtil mélange entre respect de certaines façades d’origine et des matériaux bruts, et touche de modernité avant-gardiste donnait à cette maison une réelle originalité de très bon goût. L’intérieur, grâce aux grandes ouvertures, était baigné de lumière et l’aménagement se rapprochait plus du loft que d’un nid “cocoon”. Pour autant, chacun aimait à se retrouver dans cette demeure et y puiser cette force que l’on retrouve dans les racines. Le choix de s’y installer définitivement avait tout de suite été une idée unanimement approuvée. Philibert aimait cette idée de bonheur simple qui se dégageait de cette douceur de vivre, loin de l’agitation des capitales. Il avait l’impression que c’était dans ce mode de vie rural qu’on se rapprochait le plus de la vérité.
Le vibreur de son téléphone le sortit de ses rêveries. C’était Claude Barral, l’adjudant-chef de la gendarmerie de Clelles. Ils se connaissaient bien pour avoir fréquenté ensemble le collège de Mens dans leur enfance. Il ne se souvenait plus très bien s’ils avaient été ensemble une année dans la même classe, car ce n’était pas vraiment un bon camarade, juste un “collègue” comme on disait. Mais les longs trajets en transport scolaire entre Le Percy et Mens, dans le Peugeot J7 conduit par Jacky qui leur faisait partager matin et soir les douces fumées de ses gitanes “papier maïs” sur fond de “Mike Brant” leur avaient donné le temps de bien se connaître à défaut de s’apprécier.
Si Philibert Pont-Rougard était sérieux, plutôt bon élève, passant pour “l’intello” d’alors, Claude Barral était surtout inspiré par les sorties de chasse de ses oncles dont il vantait les exploits chaque lundi matin et déjà, par l’ambiance sympathique des bars de villages. C’était un étonnement de tous de voir qu’un enfant du coin qui avait toute sa famille encore présente, disséminée dans diverses communes du sud du Trièves, se retrouve en poste à la gendarmerie de Clelles. Mais chacun y trouvait son compte finalement : les enquêtes étaient parfois facilitées par des indics qui étaient tous ses copains et les malencontreux PV d’infraction au code de la route étaient souvent bien symboliques et vite arrangés. Pour Philibert, ce genre de personnage faisait partie d’un autre monde qu’il n’avait jamais apprécié : sorties en boîte tous les samedis à Gresse-en-Vercors et parties de chasse le dimanche n’appartenaient pas à son univers de jeunesse. Claude se rappela à son bon souvenir, sans d’ailleurs lui demander ce qu’il était devenu et en vint rapidement à l’objet de son appel, marquant bien là l’autorité liée à sa fonction. Le gendarme avait appris que Philibert était interprète assermenté pour le roumain et le hongrois. Il souhaitait rapidement disposer de ses aptitudes à manier la langue de Cioran pour faciliter l’avancement de l’enquête liée au meurtre d’un Roumain, justement. Philibert accepta. Mais il avait demandé à Claude le temps de manger quelque chose et lui indiqua qu’il ne serait disponible que quelques jours. Il était en congés pour quinze jours, mais normalement, à partir de la semaine prochaine, il partait sur Grenoble. Claude le rassura en lui indiquant qu’à son avis, comme il s’agissait vraisemblablement d’une histoire mafieuse, l’enquête serait vite classée. Rendez-vous fut donc pris pour quinze heures l’après-midi même dans les locaux de la gendarmerie de Clelles. Philibert raccrocha et entra dans sa maison.
— Hum, tu sens le pastis, toi ! s’exclama Catherine qui l’accueillit bras ouverts avec un baiser sur la bouche. Tu exagères, ça fait une heure qu’on t’attend. Le repas est froid. Je vois que tu reprends vite les bonnes habitudes des bistrots avec tes copains ! J’imagine qu’il y avait Robert ?
— Oui il y avait Robert. Et il m’a raconté les derniers potins, notamment un meurtre un peu bizarre qui a eu lieu sous le viaduc de Reyssac.
— Ben, un meurtre c’est toujours un peu bizarre. Philibert raconta à Catherine dans le détail tout ce qu’il savait et son intention d’apporter sa contribution à l’enquête pour traduire les propos en roumain de la pauvre épouse éplorée. Il avala rapidement quelques bouchées d’une salade de museau, puis du gratin dauphinois.
— Bien réussi ! lança-t-il à Catherine. T’as retrouvé le truc ! C’était la crème, je te dis, qui n’allait pas. La crème des grandes surfaces, allégés et aseptisés, ça vaut rien. Là au moins, avec de la vraie crème de lait de la ferme, regarde comme il est bien ce gratin !
Catherine ne dit rien, mais à son sourire à peine caché, on devinait une certaine fierté. Philibert déplia machinalement le journal qu’il avait acheté à Clelles le matin. Il parcourut rapidement les rubriques locales. Elles retraçaient comme toujours la vie des villages, annonçant ici le changement du jour de collecte des ordures ménagères, le congé maternité de la secrétaire de mairie ou un loto à Monestier du Percy. Juste après les pages nécrologiques, Philibert s’arrêta sur un petit encart qui le fit sourire. On y annonçait la remise de la médaille de chevalier de la légion d’honneur à Isabelle Dumont, à Gap, des mains de Daniel Teodorescu, ancien ministre. Cette femme avait été sa collègue de travail il y a de nombreuses années, à l’étranger, et il était amusé de retrouver ainsi sa trace, qui plus est, dans la région. Il referma le journal et se prépara à partir pour honorer son rendez-vous. Il était maintenant quatorze heures quarante-cinq et il ne fallait plus traîner. L’état vaporeux de sa sortie du bar avait cédé place à une migraine lui rendant pénible toute lumière vive et à une réelle envie de s’assoupir un moment. Mais Philibert s’était engagé, pas question d’arriver en retard, la sieste serait pour plus tard.
IV
Quand Philibert Pont-Rougard passa près de Reyssac, son regard plongea vers la gauche, vers le viaduc du chemin de fer qui enjambait le vallon d’Esparron. Comment a-t-on pu assassiner une personne en un pareil endroit ? Il est vrai que ce lieu inspirait la sérénité, le recueillement. Légèrement encaissé entre les pentes boisées de Platary au nord et de l’Étoilette au sud, le vallon débouchait en aval sur l’immense plateau du Trièves. Avec en fond, la chaîne de l’Obiou, ce havre de paix était protégé de toutes parts par des montagnes. Au bout, se découvrait une vaste prairie, de l’eau à profusion et d’immenses forêts d’épicéas. Les ecclésiastiques ne s’y étaient pas trompés lorsqu’au XIIIe siècle, ils décidèrent d’y fonder un monastère de contemplation. Il dépassa Le Percy, aperçut les toits de Bonnardel en contrebas à droite, avant d’arriver sur les hauteurs de Clelles, à la gendarmerie.
Bâtiment récent sans aucun intérêt, la gendarmerie bénéficiait cependant d’une vue plongeante directe sur tout le bourg situé en contrebas et, plus largement, sur le plateau du Trièves, tel un phare destiné à protéger ses marins ou plutôt un mirador. Philibert poussa la porte et perçut immédiatement une certaine agitation, voire une fébrilité qu’il mit sur le compte du vent du sud qui agaçait tout le monde et qui ne cessait de se renforcer depuis ce matin. Claude Barral s’avança vers lui. Petit, presque chauve, déjà bedonnant, seule sa moustache brune bien taillée donnait un air d’autorité au personnage.
— Bonjour Phil, comment vas-tu ? Tu n’as pas changé ! Merci d’avoir répondu si vite à ma demande, ça va grandement nous faciliter la tâche !
— Salut Claude. Je t’en prie, ce sera avec plaisir. C’est pour moi toujours agréable de parler roumain. Ça m’exerce. Je n’ai pas souvent l’occasion de pratiquer cette langue pourtant bien agréable.
— Au fait, je t’ai toujours appelé Phil, mais je peux t’appeler Philippe, si tu veux. On a passé l’âge des diminutifs peut-être…
— Comme tu voudras, mais moi c’est Philibert, affirma-t-il sans desserrer les dents et rouge de rage.
Sentant qu’il avait abordé un sujet délicat, Claude Barral ne releva pas et passa directement à l’affaire.
— Avant de retrouver madame Dumitrascu, l’épouse de la victime, je préférerais te faire un rapide résumé de la situation… Le corps de monsieur Tudor Dumitrascu a été retrouvé un peu plus haut que Reyssac, au pied du viaduc d’où il a été vraisemblablement jeté. Mais il semble que le meurtre ait eu lieu ailleurs, puisque le visage de la victime a été volontairement ravagé, sûrement avec un acide, ou brûlé. On n’a retrouvé aucune trace sur place. Madame Dumitrascu a reconnu son époux grâce aux vêtements et effets personnels et à quelques signes particuliers sur le corps. Voilà tout ce que je sais. Pour le reste, elle ne comprend apparemment rien à ce qu’on lui dit, et ce qui est certain c’est qu’elle ne parle pas un mot de français. Ah si, j’oubliais, elle et son défunt mari ont tous les deux une carte de séjour de demandeur d’asile. Ils sont domiciliés à La Mure, rue des Alpes. Voilà. Des questions ? À toi de jouer maintenant.
Claude mena Philibert dans un bureau situé derrière la pièce d’accueil de la gendarmerie. L’air de cette pièce était vicié, saturé d’une forte odeur de transpiration, ce qui laissait à penser que la présence de madame Dumitrascu remontait à plusieurs heures. Un vieux bureau métallique gris recouvert d’un faux cuir vert bronze trônait au milieu de la pièce, Claude s’y installa. Il se laissa s’enfoncer dans un fauteuil élimé qui couina sous son poids. Un écran cathodique d’ordinateur encrassé recouvert d’autocollants publicitaires de toutes sortes occupait la partie gauche du bureau.
Sur la droite, seules quelques chemises cartonnées soigneusement empilées donnaient une impression d’activité.
Sous le cadre officiel du portrait du Président de la République, un petit meuble en bois verni abritait deux gros classeurs cartonnés et deux annuaires téléphoniques. Devant la fenêtre, une plante qui avait dû être un ficus, essayait de profiter de la lumière du jour, à défaut de se ressourcer dans la terre de son pot visiblement inchangée depuis des années. Il fallait vraiment regarder avec attention tous les recoins de la pièce pour découvrir dans un fauteuil, en retrait et un peu dans la pénombre, le corps voûté, revêtu de noir de madame Dumitrascu. Elle ne semblait pas avoir remarqué la présence de Philibert, car elle ne releva pas la tête qu’elle tenait dans ses mains.
— Madame Dumitrascu, je vous présente monsieur Philibert Pont-Rougard qui sera votre interprète pendant tous nos entretiens.
Madame Dumitrascu, à l’énoncé de son nom releva doucement la tête et laissa apparaître deux yeux humides et rougis par les larmes. Elle regarda l’adjudant-chef, puis tourna doucement la tête vers Philibert sans aucune expression sur son visage.
— Buna ziua, Doamna. Philibert Pont-Rougard sunt. (Bonjour Madame, je suis Philibert Pont-Rougard.)
À ces quelques mots de roumain, le visage de la pauvre veuve s’illumina et elle se tourna vers Philibert avec un grand sourire avant de répondre :
— Buna ziua. Multumesc. (Bonjour. Merci.)
— Nous allons donc reprendre notre entretien, madame Dumitrascu, si vous le voulez bien. Philibert, si tu veux traduire au fur et à mesure… Et dis-moi si je vais trop vite.
— OK, on y va.
V
Philibert ne dormit pas très bien. Le vent s’était particulièrement déchaîné dans la nuit, grondant dans le conduit de cheminée, faisant vibrer la zinguerie et décrochant çà et là quelques tuiles. Elles avaient fini par glisser dans la pente du toit avant de s’arrêter dans un chéneau dans un fracas qui l’avait fait sursauter plus d’une fois. Bref, on était loin de la nuit paisible qu’on imagine au cœur d’un village isolé de montagne. Et puis l’entretien de la veille avait duré plus de quatre heures et avait été particulièrement pénible.
D’abord, l’adjudant-chef Claude Barral avait une fâcheuse tendance à prendre son interlocutrice de haut sur un ton légèrement humiliant. S’il n’avait pas été dans l’enceinte d’une gendarmerie nationale, Philibert aurait volontiers pris cette attitude pour une pointe de racisme. Ensuite, le sujet était peu habituel pour Philibert Pont-Rougard qui avait davantage l’habitude des conférences internationales sur les flux migratoires ou sur les Roms. Les descriptions des conditions de découverte du corps et du visage massacré à l’acide étaient peu familières à Philibert. Lui qui ne regardait jamais de films d’horreur et qui avait dû récemment quitter prématurément la salle de cinéma lors d’un thriller un peu “gore”… Là, ce n’était pas du cinéma, mais la vraie vie, et Philibert, bien malgré lui, était dedans.
Enfin, il avait dû affronter la douleur de la veuve, une réelle peine, mêlée à l’effroi de se retrouver désormais seule dans ce pays étranger dont elle ne connaissait pas la langue. Réfugiée politique, madame Dumitrascu était arrivée de Roumanie avec son mari en mille neuf cent quatre-vingt-neuf. Originaire de Brasov, une ville située dans les Carpates, aux portes de la Transylvanie et au pied d’une des plus célèbres stations de ski roumaine, elle était “ingénieur économiste” comme quatre-vingts pour cent des Roumains qui ont fait quelques études pendant le régime de Ceaucescu.
Anca Dumitrascu était danseuse dans un groupe folklorique spécialisé dans la “Hora”, une danse nationale roumaine, symbole de l’unité villageoise au départ, puis vite transposée comme représentation de l’unité nationale par le régime communiste. Elle avait fui la Roumanie en quatre-vingt-neuf à l’occasion d’une tournée de son groupe folklorique en France. Après leur tournée dans le Trièves et en Matheysine, essentiellement, et un spectacle au théâtre de Grenoble, le groupe n’avait officiellement pas souhaité repartir en Roumanie. C’était en décembre mille neuf cent quatre-vingt-neuf, le pays était en pleine révolution. Pour eux, aucun avenir n’était sûr là-bas et, grâce à quelques appuis, ils avaient réussi à obtenir assez facilement l’asile politique en France. Actuellement, tous les membres du groupe étaient installés en France, dans le Trièves et en Matheysine, grâce à un immense élan de solidarité locale. Les uns les avaient logés provisoirement, les autres leur avaient trouvé un petit boulot, puis un logement définitif. C’est ainsi que les Dumitrascu avaient atterri à La Mure. Tudor Dumitrascu, la victime, qui en Roumanie était ouvrier boucher dans une boucherie d’état, avait pu trouver un emploi d’aide-préparateur dans la charcuterie la plus réputée de La Mure “Le Cabas du Mineur” qui excellait notamment avec son “murçon”, une excellente saucisse à cuire au goût légèrement anisé. Ils logeaient rue des Alpes, au premier étage d’une ancienne maison occupée au rez-de-chaussée par l’entrepôt d’un artisan chauffagiste. Anca Dumitrascu, elle, n’avait pas trouvé d’emploi et semblait peu intégrée à la vie muroise. Il faut dire que sans enfant et ne parlant pas un mot de français, les relations n’étaient pas évidentes. Le couple avait apparemment des contacts assez réguliers avec les autres membres de la troupe dont un couple logeait également à La Mure. Les autres vivaient à Mens et Clelles.
Philibert avait ressassé toute la nuit la vie tourmentée de cette femme brisée d’avoir fui son pays et les siens, abandonnée aujourd’hui par un destin qui lui ravissait son mari, seule dans un monde inconnu et qu’elle n’avait visiblement pas envie de connaître. Pourtant, ce qui turlupinait Philibert, c’est que lorsqu’on lui avait proposé de l’aider à retourner en Roumanie, elle avait refusé net, de façon brutale et incompréhensible, sans autre argument que celui de ne pas revenir là-dessus. « Pourquoi une telle obstination ? D’autant qu’elle ne demandait pas non plus l’aide de ses anciens camarades de la troupe. Elle demandait simplement à rentrer chez elle et à ce qu’on la laisse tranquille pour préparer les obsèques de son cher époux. »
Philibert avait bien cerné la douleur de cette femme, mais il avait deviné également une immense peur chez elle et beaucoup de non-dits. C’est cette peur inexpliquée qui perturbait le traducteur et il avait des scrupules à la laisser ainsi à elle-même. Et puis il y avait eu à regarder et à commenter les photos de la victime, en plan large, en gros plan, pour bien faire apparaître les coups et blessures, et surtout le visage. Enfin ce qu’il en restait tant les chairs avaient été fondues, brûlées, déformées, laissant apparaître çà et là des taches blanchâtres qui devaient être, aux endroits les plus saillants des pommettes et des arcades sourcilières, les os. Il n’avait pas été établi si la mort provenait de cet acte de barbarie de défiguration ou si cela avait été opéré après coup, comme pour effacer toute trace d’identité de la victime.
Ces images insoutenables avaient hanté la nuit de Philibert Pont-Rougard. Il n’avait pu en parler au réveil à Catherine qui n’aurait pas voulu entendre de telles horreurs, et aussi un peu à cause d’un orgueil viril déplacé qui lui empêchait d’avouer ses faiblesses et sa sensibilité à fleur de peau.
VI
À six heures quinze, comme chaque matin, Honoré Durand quittait sa maison, sa parka couleur kaki sur le dos, pour rejoindre son jardin potager au-dessus de la voie ferrée à la sortie des Blancs, un hameau excentré du Percy. Qu’il pleuve ou qu’il neige, été comme hiver, c’était un rituel. Honoré commençait sa journée par la “tournée” de son “exploitation”. Ce retraité de la SNCF, originaire de la commune, était installé depuis sa retraite dans la maison dont il avait hérité de ses parents. Il avait fait de la culture maraîchère sa passion, une passion à tendance maniaque.
À la belle saison, dès les saints de glace passés, lorsqu’il se rendait à son potager de bon matin, il avait pour but d’y travailler. Binage, bêchage, taille, récolte, arrosage, fumure parvenaient à l’occuper jusqu’à onze heures. Alors le soleil était trop haut, la chaleur trop forte, et la terre trop basse. Il revenait donc avec en retour l’objectif de s’arrêter en route chez son ami Gilbert pour boire ensemble une momie bien méritée. L’hiver, même quand le temps ne le permettait pas, Honoré ne pouvait s’empêcher d’aller jusqu’à ses terres. Les sept cents mètres à parcourir entre sa maison et le jardin entretenaient ses jambes. Il arpentait les allées, humait le sol et méditait un peu comme s’il communiait avec cette terre qu’il solliciterait tant le moment venu. Puis il revenait chez lui, marquant une pause au bord de la route, à l’angle du chemin qui monte à Chabulière. Là se trouvait le regard recouvert d’une grille en fonte, permettant d’accéder à la canalisation du trop-plein du réservoir communal d’eau potable situé cinq cents mètres plus haut.
En période de sécheresse, le trop-plein ne donnait rien, forcément. Et c’était là tout un sujet d’inquiétudes quotidiennes pour tous les habitants de ce village si mal pourvu en ressources en eau. Quand le trop-plein ne donnait plus, cela voulait dire que toute la production de la source était utilisée et que donc, les réserves s’amenuisaient. Honoré avait pris pour habitude chaque matin au retour, de regarder comment se comportait le trop-plein et, un peu plus tard dans la matinée, il pouvait ainsi en informer tous les habitants qu’il rencontrait. Il lui était ainsi arrivé de signaler une fuite à la mairie, car en pleine période de fonte de neige, il avait remarqué du jour au lendemain que le trop-plein ne donnait plus. Après intervention sur le réseau, on avait vite constaté une rupture de canalisation au niveau de la source. Sans le savoir, Honoré était un précieux agent du service des eaux de la commune du Percy qui ne comptait par ailleurs que des bénévoles.





























