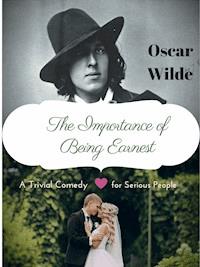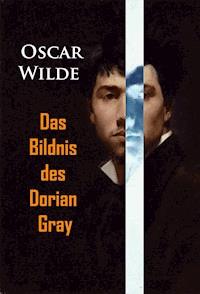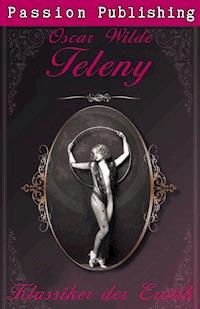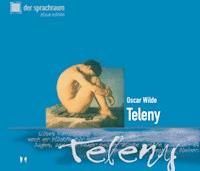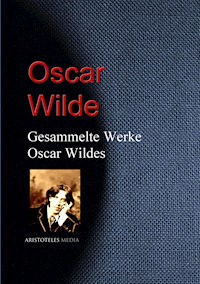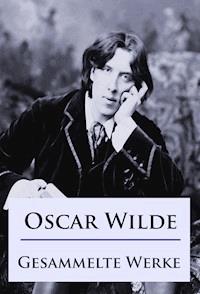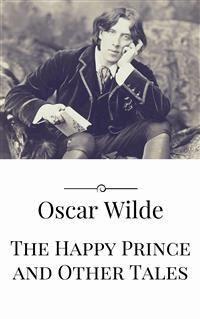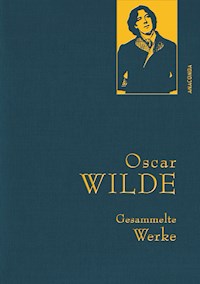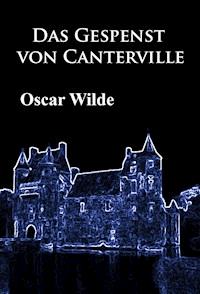Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Extrait : La plupart des romanciers russes regardent le roman historique comme un faux genre, comme une sorte de bal travesti littéraire, comme une simple représentation de marionnettes, et non comme une peinture vraie de la vie. Pourtant, l'histoire de la Russie abonde en scènes et en situations si extraordinaires que nous voyons sans surprise, en dépit des dogmes de l'école naturaliste, M. Stephen Coleridge prendre pour cadre de son étrange récit la Russie du seizième siècle.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 257
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Derniers Essais de Littérature et d'Esthétique : Août 1887-1890
Derniers Essais de Littérature et d'Esthétique : Août 1887-1890Un bon roman historique, Pall Mall Gazette, 8 août 1887M. ColeridgeRomans Nouveaux, Saturday Review, 20 août 1887Deux Biographies de Keats, Pall Mall Gazette, 27 septembre 1887Sermons en pierres à Bloomsbury, La nouvelle Salle de Sculpture du British Museum, Pall Mall Gazette, 15 octobre 1887.Un Écossais, à propos de la poésie écossaise, Pall Mall Gazette, 24 octobre 1887Le nouveau livre de M. Mahaffy, Pall Mall Gazette, 9 novembre 1887Fin de l'Odyssée de M. Morris, Pall Mall Gazette. 24 novembre 1887Le Virgile de Sir Charles Bowen, Pall Mall Gazette, 30 novembre 1887L'unité des arts, Conférence à un Five O'clock [Pall Mall Gazette, 12 décembre 1887]L'art chrétien primitif en Irlande, Pall Mall Gazette, 17 décembre 1887L'art aux Salons de Willis, Sunday Times, 26 décembre 1887Vénus ou Victoire ?, Pall Mall Gazette, 24 février 1888M. Caro, sur George Sand, Pall Mall Gazette, 14 avril 1888M. Morris, au sujet de la tapisserie, Pall Mall Gazette, 2 novembre 1888La Sculpture aux Arts et Métiers, Pall Mall Gazette, 9 novembre 1888Imprimerie et Imprimeurs, Pall Mall Gazette, 16 novembre 1888Les Beautés de la Reliure, Pall Mall Gazette, 23 novembre 1888La Clôture des Arts et Métiers, Pall Mall Gazette, 30 novembre 1888Poétesses Anglaises, Queen, 8 décembre 1888Le dernier volume de Sir Edwin Arnold, Pall Mall Gazette, 11 décembre 1888Poètes australiens, Pall Mall Gazette, 14 décembre 1888Les Modèles à Londres, English Illustrated Magazine, janvier 1889Poésie et Prison, Pall Mall Gazette, 3 janvier 1889L'Évangile selon Walt Whitman, Pall Mall Gazette, 25 janvier 1889, à propos des Brindilles de novembre.Le Nouveau Président, Pall Mall Gazette, 26 janvier 1889Une des Bibles du Monde, Pall Mall Gazette, 12 février 1889Le Socialisme poétique, Pall Mall Gazette, 15 février 1889Essais, par M. Brander Matthews, Pall Mall Gazette, 27 février 1889, à propos de Plume et encreLe dernier livre de M. William Morris, Pall Mall Gazette, 2 mars 1889Adam Lindsay Gordon, Pall Mall Gazette, 23 mars 1889Le Livre Bleu de M. Froude, Pall Mall Gazette, 13 avril 1889Le Nouveau roman de Ouida, Pall Mall Gazette, 17 mai 1889Un roman par un liseur de pensée, Pall Mall Gazette, 5 juin 1889Le dernier volume de M. Swinburne, Pall Mall Gazette, 27 juin 1889Trois poètes nouveaux, Pall Mall Gazette, 12 juillet 1889Un sage chinois Speaker, 8 février 1890Le dernier livre de M. Pater Speaker, 23 mars 1890Primavera Pall Mall Gazette, 24 mai 1890Page de copyrightDerniers Essais de Littérature et d'Esthétique : Août 1887-1890
Oscar Wilde
Un bon roman historique, Pall Mall Gazette, 8 août 1887
La plupart des romanciers russes regardent le roman historique comme un faux genre, comme une sorte de bal travesti littéraire, comme une simple représentation de marionnettes, et non comme une peinture vraie de la vie.
Pourtant, l'histoire de la Russie abonde en scènes et en situations si extraordinaires que nous voyons sans surprise, en dépit des dogmes de l'école naturaliste, M. Stephen Coleridge prendre pour cadre de son étrange récit la Russie du seizième siècle.
Sans doute on peut dire bien des choses en faveur de la préférence donnée à un sujet éloigné des événements actuels.
La passion, elle-même, gagne à être vue dans un milieu pittoresque. La distance dans le temps, à la différence de la distance dans l'espace, rend les objets plus grands et plus nets. Les choses ordinaires de la vie contemporaine sont enveloppées d'un brouillard de familiarité qui obscurcit souvent leur signification.
En outre, à certains moments, nous sentons qu'il y a fort peu de plaisir artistique à attendre de l'étude de l'école réaliste moderne.
Ses œuvres sont fortes, mais pénibles, et au bout d'un certain temps, nous nous lassons de leur âpreté, de leur violence et de leur crudité. Elles exagèrent l'importance des faits et méconnaissent l'importance de la fiction.
Tel est, en tout cas, l'état d'esprit—et la critique est-elle autre chose qu'un état d'esprit ?—qu'a produit en nous la lecture du Démétrius.
M. Coleridge
C'est l'histoire d'un tout jeune homme de naissance inconnue, qui est élevé dans la domesticité d'un noble polonais.
Cet adolescent de haute taille, de physionomie agréable, nommé Alexis, a dans le port, une fierté, dans les manières, une grâce, qui paraissent étranges dans une situation aussi infirme.
Tout à coup il est reconnu par un gentilhomme russe exilé, comme étant Démétrius, le fils d'Ivan le Terrible, qu'on croyait avoir été assassiné par l'usurpateur Boris. Son identité est confirmée par une singulière croix d'émeraudes qu'il porte au cou et par une indication, en langue grecque, dans son livre de prières, et qui révèle le secret de sa naissance et comment il a été sauvé.
Lui-même sent battre dans ses veines un sang royal et il fait appel à la noblesse de la Diète de Pologne pour qu'elle épouse sa cause. Sa parole passionnée la décide à le reconnaître pour le véritable Tsar et il envahit la Russie à la tête d'une armée nombreuse. Le peuple accourt de tous côtés autour de lui, et Marfa, la veuve d'Ivan le Terrible, s'échappe du couvent, où elle a été ensevelie vivante par Boris, pour venir au-devant de son fils.
D'abord elle semble ne point le reconnaître, mais par la douceur de sa voix, par l'éloquence de son langage, il la conquiert, et elle l'embrasse, en présence de l'armée et déclare qu'il est son fils. L'usurpateur, terrifié de ces nouvelles et abandonné par ses soldats, se suicide.
Alexis fait son entrée triomphale dans Moscou et il est couronné au Kremlin. Mais malgré tout, il n'est point le vrai Démétrius. Il a été trompé lui-même et il trompe les autres.
M. Coleridge a tracé son rôle avec une délicate subtilité, avec une vive pénétration, et la scène, dans laquelle Démétrius découvre qu'il n'est point le fils d'Ivan et n'a aucun droit au nom qu'il réclame, est extrêmement forte et dramatique. Il y a un point de ressemblance entre Alexis et le véritable Démétrius ; tous deux sont mis à mort, et c'est par la mort de son étrange héros que M. Coleridge termine son remarquable récit.
En somme, M. Coleridge a écrit un roman historique réellement bon, et on peut le féliciter de son succès. Le style est particulièrement intéressant et les parties narratives du livre méritent un grand éloge pour leur clarté, leur dignité, leur sobriété. Les discours et les dialogues ne sont point traités avec le même bonheur, car ils ont une tendance maladroite à tourner en mauvais vers blancs.
Voici par exemple un discours, imprimé par M. Coleridge comme de la prose, et dans lequel la véritable musique de la prose est sacrifiée à un faux parti-pris métrique qui est à la fois monotone et fatigant :
« But, Death, who brings us freedom from all falsehood, Who heals the heart, when the physician fails, Who comforts all whom life cannot console, Who stretches out in sleep the tired watchers ; He takes the King, and proves him but a beggar ! He speaks, and we, deaf to our Maker's voice, Hear and obey the call of our destroyer ! Then let us murmur not at anything ; For if our ills are curable, 'tis idle, and if they are past remedy, 'tis vain. The worst our strongest enemy can do Is take from us our life, and this indeed Is in the power of the weakest also. »
Mais la Mort, qui nous apporte l'affranchissement de tout mensonge qui guérit le cœur quand le médecin échoue, qui réconforte ceux que la vie ne saurait consoler, qui plonge dans le sommeil les gardiens fatigués s'empare du Roi, et prouve qu'il n'est qu'un mendiant, parle, et nous, sourds à la voix de notre créateur, nous écoutons l'appel de notre destructeur, et nous y obéissons. Ne murmurons point contre quoi que ce soit, car c'est chose superflue, si nos maux sont curables, et s'ils résistent à tout remède, c'est chose vaine. Le pis que puisse faire notre plus fort ennemi, c'est de nous ôter la vie, et vraiment c'est ce que peut faire aussi l'ennemi le plus faible.
Ce n'est point de la bonne prose, c'est simplement du vers blanc de qualité inférieure et nous espérons que, dans son prochain roman, M. Coleridge ne nous offrira pas de la poésie de second ordre au lieu de prose harmonieuse.
Certes, que M. Coleridge soit un jeune auteur de grand talent, et très cultivé, on ne saurait en douter, et véritablement, en dépit de l'erreur que nous avons signalée, Démétrius reste un des romans les plus attrayants, les plus agréables, qui aient paru cette saison.
Romans Nouveaux, Saturday Review, 20 août 1887
La fiction teutonique, en général, est un peu lourde et très sentimentale, mais Son Fils, de Werner, excellemment traduit par Miss Tyrrell, est vraiment un récit hors ligne.
On en ferait une pièce de premier ordre. Le vieux comte Steinrück a deux petits-fils, Raoul et Michel.
Ce dernier est élevé comme un fils de paysan, cruellement traité d'ailleurs par son grand-père, et par le paysan aux soins duquel il a été confié, sa mère, la comtesse Steinrück, ayant épousé un aventurier qui est joueur.
Il est le rude héros du récit, le Saint Michel de cette guerre contre le mal, qu'est la vie, tandis que Raoul, gâté par son grand-père et par sa mère, une Française, trahit son pays et ternit son nom.
A chaque pas dans le récit, ces deux jeunes gens entrent en collision. C'est une guerre entre caractères, un heurt entre individualités. Michel est fier, austère et noble ; Raoul est faible, charmant et mauvais. Michel a le monde contre lui et il triomphe ; Raoul a le monde de son côté et il succombe.
C'est un récit plein de mouvement et de vie, et la psychologie des personnages se manifeste par l'action, non par l'analyse, par des faits, non par la description. Bien qu'elle remplisse trois forts volumes, cette histoire ne nous fatigue pas.
Elle a de la vérité, de la passion, de la force, et on ne saurait demander mieux à la fiction.L'intérêt du Chenapan de M. Sale Lloyd est subordonné à un de ces malentendus qui composent le fond de magasins des romanciers de second ordre.
Le capitaine Egerton s'éprend de Miss Adela Thorndyke, un faible écho de quelqu'une des héroïnes de Miss Broughton, mais il ne veut point l'épouser parce qu'il l'a vue causer avec un jeune homme, qui habite dans le voisinage, et qui est un de ses plus anciens amis.
Nous disons, à regret, que Miss Thorndyke reste entièrement fidèle au capitaine Egerton et va jusqu'à refuser, à cause de lui, d'épouser le recteur de la paroisse, qui est un baronnet du cru, et un lord en chair et en os. Il y a là du caquet de five o'clock tea à n'en plus finir et bon nombre de personnages ennuyeux.
Il peut se faire que des romans comme le Chenapan s'écrivent avec plus de facilité qu'ils ne se lisent.
James Hepburn [Par Sophie Veitch.] appartient à une catégorie toute différente de livres. Ce n'est point un simple chaos de conversation, mais une forte histoire de la vie réelle, et qui placera, sans aucun doute, Miss Veitch à un rang éminent parmi les romanciers modernes. James Hepburn est le ministre de l'Église Libre de Mossgiel et dirige une congrégation d'agréables pécheurs et de graves hypocrites.
Deux personnes l'intéressent, Lady Ellinor Farquharson et un beau jeune vagabond nommé Robert Blackwood. Ce qu'il fait pour sauver Lady Ellinor de la honte et de la ruine a pour résultat qu'on l'accuse d'être son amant.Son intimité avec Robert Blackwood le fait soupçonner du meurtre d'une jeune fille commis dans sa maison.
Une réunion des Anciens et des dignitaires de l'Église est convoquée pour délibérer sur la démission du ministre, et là, au grand étonnement de tous, apparaît Robert Blackwood, qui avoue le crime dont Hepburn est accusé.
Tout le récit est d'une puissance extraordinaire, et il n'y est point fait un abus extravagant du dialecte écossais, ce qui est fort commode pour le lecteur.
La page de titre de Tiff nous apprend que ce livre a été écrit par l'auteur de Lucie ou une Grande Méprise, ce qui nous paraît une forme de l'anonymat, attendu que nous n'avons jamais ouï parler du roman en question.
Nous nous plaisons toutefois à croire qu'il valait mieux que Tiff, car Tiff est certainement ennuyeux. C'est l'histoire d'une belle jeune fille, qui a beaucoup d'amoureux et les perd, et d'une fille laide, qui n'a qu'un amoureux et le garde. C'est un récit assez embrouillé, et qui contient beaucoup de scènes d'amour.
Si la Collection «des Romans favoris» dans laquelle Tiff paraît, doit être continuée, nous conseillerons à l'éditeur de modifier le caractère et la reliure :
Le premier est beaucoup trop menu, et le second est fait d'une imitation de peau de crocodile ornée d'une araignée bleue et d'une gravure vulgaire, représentant l'héroïne dans les bras d'un jeune homme en tenue de soirée.
Si ennuyeux que soit Tiff—et il l'est à un degré remarquable—il ne mérite point une aussi détestable reliure.
Deux Biographies de Keats, Pall Mall Gazette, 27 septembre 1887
«Un poète, disait un jour Keats, est de toutes les créatures de Dieu la moins poétique».
Que cet aphorisme soit vrai ou non, c'est certainement l'impression que donnent les deux dernières biographies qui ont paru sur Keats lui-même [Keats par Sidney Colvin et Vie de John Keats par William Michael Rossetti.].
On ne saurait dire que M. Colvin ou M. William Rossetti [Keats par Sidney Colvin et Vie de John Keats par William Michael Rossetti.] nous fassent mieux aimer ou mieux comprendre Keats. Dans l'un et l'autre de ces livres, il y a beaucoup de choses qui sont comme «de la paille dans la bouche» et dans celui de M. Rossetti, il ne manque pas de ces choses qui ont «au palais l'acre saveur du cuivre».
De nos jours, cela est, jusqu'à un certain point, inévitable. On est toujours tenu de payer l'amende, quand on a regardé par des trous de serrure. Or, trou de serrure et escalier de service jouent un rôle essentiel dans la méthode des biographes modernes.
Toutefois, il n'est que juste de reconnaître, tout d'abord, que M. Colvin s'est acquitté de sa besogne beaucoup mieux que M. Rossetti. Ainsi le récit de la vie de Keats adolescent, tel que le donne M. Colvin, est très agréable. De même l'esquisse du cercle des amis de Keats. Leigh Hunt et Haydon, notamment, sont admirablement dessinés. Çà et là sont introduits de vulgaires détails de famille, sans beaucoup d'égard pour les proportions.
Les panégyriques posthumes d'amis dévoués n'ont réellement pas grande valeur pour nous aider à apprécier exactement le vrai caractère de Keats, quoiqu’en semble croire M. Colvin.
Nous sommes convaincus que lorsque Bailey écrivait à Lord Houghton que deux traits essentiels, le sens commun et la bienveillance, distinguaient Keats, le digne archidiacre avait les meilleures intentions du monde, mais nous préférons le véritable Keats, avec son emportement capricieux et volontaire, ses humeurs fantasques et sa belle légèreté. Ce qui fait une partie du charme de Keats comme homme, c'est qu'il était délicieusement incomplet.
Après tout, si M. Colvin ne nous a point donné un portrait bien ressemblant de Keats, il nous a certainement raconté sa vie dans un livre agréable et d'une lecture facile. Il n'écrit peut-être pas avec l'aisance et la grâce d'un homme de lettres, mais il n'est jamais prétentieux et n'est pas souvent pédant.
Le livre de M. Rossetti est absolument raté. Et, pour commencer, M. Rossetti commet la grave erreur de séparer l'homme de l'artiste. Les faits de la vie de Keats ne sont intéressants qu'à la condition de les montrer dans leur rapport avec son activité créatrice. Dès qu'ils sont isolés, ils perdent tout intérêt ou même deviennent pénibles.
M. Rossetti se plaint de ce que les débuts de la vie de Keats soient dépourvus d'incidents, de ce que la dernière période soit décourageante, mais la faute est imputable au biographe et non au sujet.
Le livre s'ouvre par un récit détaillé de la vie de Keats, où il ne nous fait grâce de rien, depuis ce qu'il appelle la «mésaventure sexuelle d'Oxford» jusqu'aux six semaines de dissipation après l'apparition de l'article du Blackwood et aux propos que tenait le mourant dans son délire loquace. A n'en pas douter, tout, ou presque tout ce que nous rapporte M. Rossetti, est vrai, mais il ne fait preuve ni de tact dans le choix des faits, ni de sympathie dans sa manière de les traiter.
Lorsque M. Rossetti parle de l'homme, il oublie le poète, et lorsqu'il juge le poète, il montre qu'il ne comprend point l'homme. Prenez par exemple sa critique de la merveilleuse Ode à un rossignol, d'une si étonnante magie d'harmonie, de couleur et de forme. Il commence par dire que «la première marque de faiblesse» dans la pièce est «l'abus des allusions mythologiques», assertion complètement fausse, car sur les huit stances qui composent la pièce, il n'y en a que trois qui contiennent des allusions mythologiques, et sur ce nombre, il n'en est aucune qui soit forcée ou éloignée.
Puis, lorsqu'il cite la seconde strophe :
Oh ! Une lampée de vin, qui aura été Pendant un long siècle dans la terre profondément fouillée, et qui aurait un parfum de Flore, de la danse sur le gazon de la campagne, et de la chanson provençale, et de la gaîté brunie au soleil, M. Rossetti, dans un bel accès de Ruban bleu [Insigne des membres de la Société de Tempérance qui se sont engagés à ne boire que de l'eau.], s'écrie avec enthousiasme : «Assurément personne n'a besoin de boire du vin pour se préparer à goûter la mélodie d'un rossignol, soit au sens propre, soit au sens figuré».
«Appeler le vin une sincère et rougissante Hippocrène» lui paraît à la fois «grandiloquent et désagréable». L'expression «chaînes de bulles qui clignotent sur le bord» est triviale, quoique pittoresque ; l'image «non point porté sur le chariot de Bacchus que traînent des panthères» est «bien pire».
Une expression comme celle-ci : «Dryade des arbres, à l'aile légère» est évidemment un pléonasme, car dryade signifie réellement «nymphe du chêne».
Et de cette superbe explosion de passion :
Tu n'es point né pour la mort, immortel oiseau, Ni pour que des générations affamées te foulent aux pieds. La voix que j'entendis au cours de cette nuit fut entendue aux temps passée par l'empereur, par le paysan.
M. Rossetti nous dit que cette invocation est un solécisme palpable, ou palpable (sic) de logique, «attendu que les hommes vivent plus longtemps que les rossignols».
Comme M. Colvin fait une critique fort analogue à celle-là, en parlant d'«une faute de logique qui est en même temps... un défaut poétique», il valait peut-être la peine de signaler à ces deux récents critiques de l'œuvre de Keats, que Keats a voulu exprimer l'idée du contraste entre la durée de la beauté et la condition changeante et la déchéance de la vie humaine, idée qui reçoit son expression la plus complète dans l'Ode à une urne grecque.
Les autres pièces ne sortent pas moins malmenées des mains de M. Rossetti.
La belle invocation, dans Isabella :
Portez vos plaintes vers elle, toutes, syllabes de gémissement, sortez des profondeurs de la gorge de la triste Melpomène Sortez en ordre tragique de la lyre de bronze Et faites vibrer en un mystère les cordes.
Cela lui paraît «une fadeur». La Bacchante indienne du quatrième livre d'Endymion est qualifiée de «buveuse sentimentale et tentatrice». Quant à Endymion, M. Rossetti déclare ne pouvoir comprendre comment «son organisme humain, avec des appareils respiratoire et digestif, continue à exister,» et il nous apprend comment Keats aurait dû, d'après lui, traiter le sujet.
Un jour, un éminent critique français s'écriait avec désespoir : «Je trouve des physiologistes partout», mais il était réservé à M. Rossetti de faire des considérations sur la digestion d'Endymion et nous lui concédons volontiers la supériorité que lui donne ce point de vue.
Même lorsque M. Rossetti loue, il gâte ce qu'il loue. Traiter Hypérion de «monument d'architecture cyclopéenne en vers» est assez mauvais, mais l'appeler un «Stonehenge de réverbération» est absolument détestable, et nous n'en savons guère plus long sur la Veille de la Saint Marc quand nous apprenons que la simplicité en est «pleine de sang et singulière».
Puis, que signifie cette assertion que les Notes de Keats sur Shakespeare sont «un peu tendues et bouffies ?»
N'y a-t-il rien de mieux à dire de Madeline dans la Veille de la Sainte Agnès, sinon qu'elle est présentée comme une figure très charmante, très aimable, «bien qu’elle ne fasse autre chose de bien particulier que de se dévêtir sans regarder derrière elle et de s'en aller furtivement».
Il n'est nullement nécessaire de suivre M. Rossetti plus loin, pour le voir barboter dans la vase qu'il a faite lui-même avec ses pieds. Un critique, capable de dire qu'«un nombre assez faible des poésies de Keats sont dignes d'une grande admiration», ne mérite pas d'être pris au sérieux.
M. Rossetti est un homme entreprenant, un écrivain laborieux, mais il manque entièrement du sens nécessaire pour l'interprétation de la poésie telle que l'a écrite John Keats. C'est avec un vrai plaisir qu'on revient ensuite à M. Colvin, dont les critiques sont toujours modestes et souvent pénétrantes.
Nous ne sommes point d'accord avec lui lorsqu'il accepte la théorie de M. Owen, au sujet d'un sens allégorique et mystique qui se cacherait sous Endymion.
Son jugement final sur Keats, qui «serait l'esprit le plus shakespearien qui ait paru depuis Shakespeare», n'est pas très heureux et nous sommes surpris de l'entendre insinuer, sur la foi d'une anecdote assez suspecte de Severn, que Sir Walter Scott avait sa part dans l'article du Blackwood.
Mais il n'y a rien qui soit âcre, irritant, maladroit dans l'appréciation qu'il donne sur l'œuvre du poète. Le vrai Marcellus de la poésie anglaise n'a pas encore trouvé son Virgile, mais M. Colvin fait un Stace passable.
Sermons en pierres à Bloomsbury, La nouvelle Salle de Sculpture du British Museum, Pall Mall Gazette, 15 octobre 1887.
Grâce aux efforts de Sir Charles Newton, auquel tous ceux qui s'intéressent à l'art classique doivent leur reconnaissance, quelques-uns des merveilleux trésors, si longtemps murés dans les sombres souterrains du British Museum, ont enfin apparu à la lumière, et la nouvelle Salle de Sculpture qui vient d'être ouverte au public, compensera amplement la peine d'une visite, même pour ceux aux yeux de qui l'art est une pierre d'achoppement et un écueil de scandale.
En effet, même sans parler de la simple beauté de forme, de contour et d'ensemble, de la grâce et du charme dans la conception, de la délicatesse dans l'exécution technique, nous voyons exposé, sous nos yeux, ce que les Grecs et les Romains pensaient, au sujet de la mort, et le philosophe, le prédicateur, l'homme du monde pratique, le Philistin lui-même, seront certainement touchés par ces «sermons en pierres» avec leur portée profonde, l'abondance d'idées qu'ils suggèrent et leur simple humanité.
Des pierres funéraires courantes, voilà ce qu'ils sont pour la plupart, œuvres non point d'artistes fameux, mais de simples artisans. Seulement elles ont été ouvrées, en un temps où tout métier était un art. Les plus beaux spécimens, au point de vue purement artistique, sont sans contredit les deux stèles trouvées à Athènes.
L'une et l'autre sont les pierres tombales de jeunes athlètes grecs. Dans l'une, l'athlète est représenté tendant sa strigile à son esclave ; dans l'autre, l'athlète est debout, seul, la strigile en main.
Elles n'appartiennent point à la plus grande période de l'Art grec. Elles n'ont point le grand style du siècle de Phidias, mais elles ont néanmoins leur beauté, et il est impossible de n'être point fasciné par leur grâce exquise, par la façon, dont elles sont traitées, si simple en ses moyens, si subtile en son effet. Toutes les pierres funéraires d'ailleurs sont pleines d'intérêt.
En voici une de deux dames de Smyrne, qui furent si remarquables en leur temps, que la cité leur vota des couronnes d'honneur ; voici un médecin grec examinant un bambin qui souffre d'indigestion ; voici le monument de Xanthippe, qui fut probablement un martyr de la goutte, car il tient à la main le moulage d'un pied destiné sans doute à être offert en ex-voto à quelque dieu.
Une jolie stèle de Rhodes nous présente un groupe familial. Le mari est à cheval et fait ses adieux à sa femme, qui a l'air de vouloir le suivre, mais qui est retenue par un petit enfant. L'émotion de la séparation, en quittant ceux que nous aimons, est le motif central de l'art funéraire grec.
Il est répété sous toutes les formes possibles, et chaque pierre muette semble murmurer : ?????. (Salut.)
L'art romain est différent. Il introduit le portrait vigoureux et réaliste et il traite la pure vie de famille beaucoup plus fréquemment que ne le fait l'art grec. Ils sont fort laids, ces Romains, à la physionomie dure, hommes et femmes, dont les portraits sont représentés sur leurs tombes, mais ils paraissent avoir été aimés et respectés de leurs enfants et de leurs serviteurs. Voici le monument d'Aphrodiscus et Atilia, un noble romain et sa femme, morts en terre britannique il y a bien des siècles, et dont la pierre tombale a été trouvée dans la Tamise.
Tout près se voyait une stèle venant de Rome, avec les bustes d'un vieux couple d'époux qui étaient certainement d'une étonnante laideur.
Le contraste entre la représentation abstraite par les Grecs de l'idée de la mort et la réalisation concrète, par les Romains, des individus défunts, est extrêmement curieux. Outre les pierres funéraires, la nouvelle salle de Sculpture contient de très charmants spécimens de l'art décoratif romain sous les Empereurs.
Le plus merveilleux de tous, et qui vaut à lui seul une excursion à Bloomsbury, est un bas-relief représentant une scène de mariage. Juno Pronuba unit les mains d'un beau et jeune noble et d'une dame fort imposante. Il y a dans ce marbre toute la grâce du Pérugin, et même la grâce de Raphaël. La date en est incertaine, mais la coupe soignée de la barbe du fiancé paraît indiquer l'époque de l'empereur Hadrien.
C'est manifestement l'œuvre d'artistes grecs, et c'est un des plus beaux bas-reliefs de tout le Musée. Il y a en lui je ne sais quoi qui rappelle l'harmonie et la douceur de la poésie de Properce. Puis, ce sont de délicieuses frises où sont figurés des enfants. L'une d'elles qui représente des enfants jouant d'instruments, aurait pu inspirer une bonne partie de l'art plastique florentin.
A vrai dire, quand nous passons en revue ces marbres, nous n'avons pas de peine à voir d'où sortit la Renaissance et à quoi nous devons les formes diverses de l'art de la Renaissance. La frise des Muses, dont chacune porte piquée dans sa chevelure une plume prise aux ailes des sirènes vaincues, est extrêmement belle. Sur un charmant petit bas-relief, deux amours se disputent le prix de la course en char et la frise des Amazones couchées a quelques splendides qualités de dessin.
Une frise d'enfants, qui jouent avec l'armure du Dieu Mars, mérite aussi d'être mentionnée. C'est plein de fantaisie et d'humour délicat. En somme, Sir Charles Newton et M. Murray méritent d'être chaudement félicités du succès de la nouvelle salle. Nous espérons toutefois que l'on cataloguera et qu'on exposera encore d'autres pièces du trésor caché. Actuellement, dans des sous-sols, il y a un bas-relief très remarquable qui représente le mariage de l'Amour et de Psyché, et un autre où l'on voit des pleureurs de profession se lamentant sur le corps d'un mort.
Le beau moulage du Lion de Chéronée devrait aussi en être retiré, ainsi que la stèle où se voit l'admirable portrait de l'esclave romain. L'économie est une excellente vertu publique, mais la parcimonie qui laisse séjourner de belles œuvres d'art dans l'atmosphère farouche et sombre d'une cave humide n'est guère moins qu'un détestable vice public.
Un Écossais, à propos de la poésie écossaise, Pall Mall Gazette, 24 octobre 1887
Un éminent critique, qui vit encore et qui est né au sud de la Tweed, confia un jour, tout bas, à un ami que les Écossais, à son avis, connaissaient réellement fort mal leur littérature nationale. Il admettait parfaitement qu'ils aimassent leur «Robbie Burns» et leur «Sir Walter» avec un enthousiasme patriotique, qui les rend extrêmement sévères envers le malheureux homme du sud qui se hasarde à louer l'un ou l'autre en leur présence.
Mais il soutenait que les œuvres des grands poètes nationaux, tels que Dunbar, Henryson, et Sir David Lyndsay sont des livres scellés pour la majorité des lecteurs à Edimbourg, à Aberdeen et à Glasgow et que fort peu d'Écossais se doutent de l'admirable explosion de poésie qui eut lieu dans leur pays pendant les quinzième et seizième siècles, alors qu'il n'existait, dans l'Angleterre de cette époque, qu'un faible développement intellectuel.
Cette terrible accusation est-elle fondée ou non, c'est ce qu'il est inutile de discuter présentement. Il est probable que l'archaïsme de la langue suffira toujours pour empêcher un poète comme Dunbar de devenir populaire, dans le sens ordinaire du mot. Toutefois le livre du Professeur Veitch [Le sentiment de la nature dans la poésie écossaise.] prouve qu'en tout cas, il y a «dans le pays des galettes» des gens capables d'admirer et d'apprécier ses merveilleux chanteurs d'autrefois.
Des gens que leur admiration pour le Lord des Îles, et pour l'Ode à une pâquerette de la montagne ne rend point aveugles aux beautés exquises du Testament de Cresseida, du Chardon et de la Rose, du Dialogue entre Expérience et un Courtisan. Le Professeur Veitch, prenant pour sujet de ses deux intéressants volumes le sentiment de la Nature dans la poésie écossaise, commence par une dissertation historique sur le développement du sentiment dans l'espèce humaine. L'état primitif lui apparaît comme se réduisant à une simple «sensation de plein air».
Les principales sources de plaisir sont la chaleur que donne le grand soleil, la fraîcheur de la brise, l'air général de fraîcheur de la terre et du ciel, sensation à laquelle s'associe la conscience de la vie et du plaisir sensitif, tandis que l'obscurité, l'orage et le froid sont regardés comme désagréables.
A cette époque succède l'époque pastorale, où nous trouvons l'amour des vertes prairies, de l'ombre donnée par les arbres, de tout ce qui rend la vie agréable et confortable. Vient à son tour l'époque de l'agriculture, ère de la guerre avec la terre, où les hommes prennent du plaisir dans le champ de blé et le jardin, mais voient d'un mauvais œil tout obstacle à la culture, comme la forêt, la roche, tout ce qui ne peut pas être réduit à l'utilité par la soumission, tels la montagne et la mer. Nous arrivons enfin au pur sentiment de la nature, au pur plaisir que donnent la seule contemplation du monde extérieur, la joie qu'on trouve dans les impressions sensibles, en dehors de tout ce qui a rapport à l'utilité ou à la bienfaisance de la Nature.
Mais là ne s'arrête pas le développement. Le Grec, dans son désir d'identifier la Nature et l'Humanité, peuplait le bosquet et les flancs des montagnes de belles formes fantaisistes, voyait le dieu tapi dans la futaie, la naïade suivant le fil de l'eau. Le moderne disciple de Wordsworth, visant à identifier l'homme avec la Nature, trouve dans les choses extérieures «les symboles de notre vie intérieure, les influences d'un esprit apparenté au nôtre». Il y a bien des idées suggestives dans ces premiers chapitres du livre du Professeur Veitch, mais nous ne saurions être de son avis sur l'attitude du primitif en face de la Nature. La sensation de plein-air, dont il parle, nous paraît comparativement moderne.
Les mythes naturalistes les plus antiques ne nous parlent non point du «plaisir sensuel» que la Nature donnerait à l’homme, mais de la terreur que la Nature inspire. Et de plus, les ténèbres et l'orage ne sont point regardés par l'homme primitif comme des choses «simplement répulsives».
Ce sont, pour lui, des êtres divins et surnaturels, pleins de merveille, dégageant une terreur mystérieuse. Il aurait fallu aussi dire quelques mots au sujet de l'influence des villes sur le développement du sentiment de la nature, car si paradoxale que la chose puisse paraître, il n'en est pas moins vrai que c'est en grande partie à la création des cités que nous devons le sentiment de la Nature.