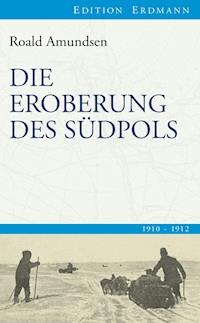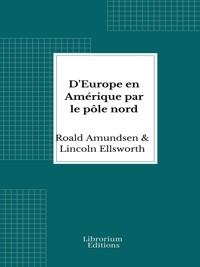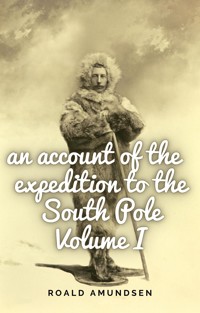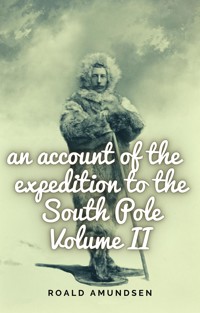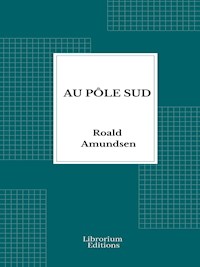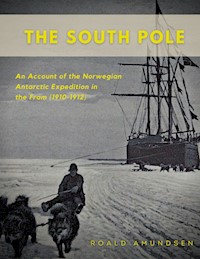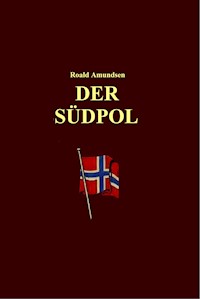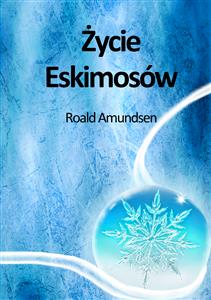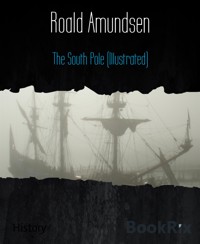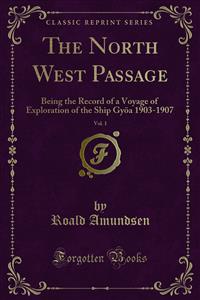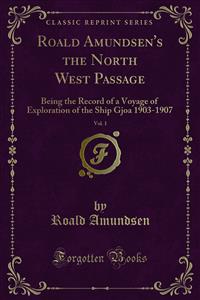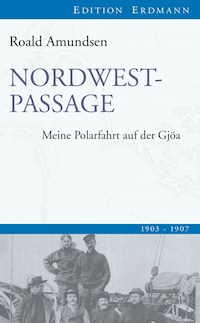2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Cervantes Digital
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Französisch
En Avion vers le Pôle Nord" vous entraîne dans une aventure aérienne palpitante vers l'un des endroits les plus mystérieux et inhospitaliers de la planète. C'est un récit captivant d'exploration et de courage, où les intrépides pionniers s'envolent vers l'inconnu, bravant des conditions extrêmes pour conquérir les vastes étendues glacées du pôle Nord.
Dans les pages de ce livre, vous ressentirez l'excitation de l'aviation pionnière, les défis de naviguer à travers des ciels hostiles et la fascination pour un monde recouvert de glace et de secrets. Les descriptions immersives vous transporteront à bord de ces avions emblématiques, tandis que vous suivez l'équipage dans cette quête audacieuse vers le sommet du monde.
"En Avion vers le Pôle Nord" est un hommage à l'esprit d'aventure et à la bravoure des hommes et des femmes qui ont osé repousser les frontières du possible. C'est un voyage palpitant qui vous fera rêver d'explorer les horizons lointains et de surmonter les défis les plus glaciaux pour atteindre de nouveaux sommets. Préparez-vous à décoller vers l'inconnu et à plonger dans une aventure inoubliable dans les cieux glacés du Pôle Nord.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Copyright 2023
Cervantes Digital
All rights reserved
ISBN: 978-1-312-11327-5

EXPÉDITION AMUNDSEN-ELLSWORTH
en avión vers le pôle nord
parRoald Amundsen
traduit du norvégien et adapté par Charles Rabot

AVANT-PROPOS
Comment Amundsen a-t-il été amené à entreprendre son vol audacieux au-dessus des banquises en direction du Pôle ?
Quels sont les aspects caractéristiques de ces embâcles glacés ? Quels sont les phénomènes redoutables dont ils sont le théâtre ? C’est ce qu’il importe d’expliquer pour la clarté du récit que nous offrons au public.
Après avoir conquis le Pôle Sud, le célèbre explorateur norvégien résolut de s’attaquer à l’autre pôle de la terre et pour cela d’entreprendre une dérive à travers le bassin arctique, le vaste océan situé au nord des continents, au milieu duquel passe le sommet boréal de l’axe de rotation du globe. Cette étendue océanique est presque entièrement recouverte d’énormes trains de glaçons, serrés, pressés les uns contre les autres, formant un obstacle insurmontable à la marche des navires. Ces masses flottantes ne demeurent pas immobiles ; dans l’immense secteur compris entre le détroit de Bering et le Groenland en passant par le Spitzberg, sous la poussée d’un courant marin, elles glissent lentement vers le nord-ouest, en direction du Pôle, puis, après être parvenues dans les parages de ce point mathématique, descendent vers le sud-ouest, le long de la côte orientale du Groenland, pour venir finalement fondre dans l’Atlantique autour de Terre-Neuve.
Ce sera l’éternel honneur de Nansen d’avoir eu l’intuition géniale d’utiliser ce remarquable déplacement des eaux pour pénétrer au cœur du bassin arctique. Monté sur le fameux Farm, il se fit prendre, à l’ouest des îles de la Nouvelle Sibérie, dans la grande banquise polaire ; entraîné ensuite par le courant avec ces glaces, il arriva à 421 kilomètres du Pôle, un record sensationnel pour l’époque.
Afin de parvenir plus au nord que son illustre compatriote, Amundsen reprit son programme, mais en le modifiant considérablement. Si, pensait-il, son devancier n’avait pas touché le but suprême, c’est qu’il avait dérivé avec la partie périphérique de la banquise, laquelle de toute évidence doit en passer fort loin. En conséquence le vainqueur du Pôle austral décida d’entrer dans les glaces au nord du détroit de Bering, c’est-à-dire plus à l’est que ne l’avait fait Nansen, afin d’atteindre la zone médiane du courant propulseur. Par cette manœuvre il espérait arriver à proximité du Pôle Nord.
Donc, au début de l’été 1918 Amundsen appareillait à destination du détroit de Bering sur un bateau construit en vue de résister aux plus rudes épreuves de la navigation arctique, le Maud. A celle époque, quoique en décroissance, la guerre sous-marine était encore redoutable ; dans la pensée de soustraire son expédition aux dangers d’une attaque, l’explorateur norvégien décida de gagner le futur théâtre de ses opérations à l’extrémité nord-est de l’Asie, en longeant la côte septentrionale de l’ancien monde, à travers l’océan polaire de Sibérie.
Cette navigation ne fut pour Amundsen qu’une longue suite de cruels mécomptes. Deux mois seulement après son départ, il est bloqué par les glaces et obligé d’hiverner dans une baie voisine du cap Tchéliouskine, la pointe suprême du continent asiatique vers le nord. L’année suivante, en 1919, les banquises sont encore plus épaisses que pendant la campagne précédente, et, après quelques jours seulement de navigation, les Norvégiens sont contraints à un nouvel hivernage dans une île de la côte sibérienne. Depuis deux ans ils luttent contre l’âpre nature arctique, sans avoir réussi à atteindre le point de départ de la dérive projetée, mais leur chef n’en demeure pas moins inébranlable dans sa résolution. Au commencement de l’été 1920, à peine est-il libéré de sa prison de glace, qu’il va se ravitailler à Nome, sur la côte de l’Alaska, puis reprend aussitôt la route du nord pour essayer de parvenir dans la zone du courant portant vers le Pôle. Vain espoir ! Cette troisième tentative échoue comme les précédentes. Amundsen se trouve arrêté par la banquise sur la côte de Sibérie, et cela avant d’avoir pu sortir complètement du détroit de Bering ; de nouveau le voici condamné à un long et pénible hivernage.
La fortune semble vouloir faire expier au grand explorateur les faveurs dont elle l’avait comblé jusque-là. Mais aucun coup du sort ne peut vaincre sa volonté. Dès qu’en 1921 les glaces lui rendent la liberté de manœuvre, Amundsen gagne Seattle, le grand port américain de la côte du Pacifique, pour réparer son navire avarié et l’année suivante il repart pour un quatrième assaut.
Cette fois l’explorateur a conçu une manœuvre à double action. Tandis que son bateau cherchera à entrer au nord-ouest du détroit de Bering dans la banquise mouvante, il s’installera, lui, sur la côte nord de l’Alaska, avec un avion et un pilote, pour de là essayer de gagner le Pôle par la voie des airs. La première partie de son programme réussit : son navire commence sa dérive si longtemps attendue ; par contre, son audacieuse tentative aérienne échoue. Amundsen n’abandonne pas la partie pour cela ; il rentre en Europe pour organiser une nouvelle campagne d’aviation vers l’extrême nord, en prenant le Spitzberg comme point de départ.
En juin 1924 l’expédition est complètement montée, les appareils prêts à prendre leur vol, mais avant de les laisser s’envoler, le constructeur exige leur paiement comptant. Or, la caisse de la mission, privée de concours qui lui avaient été promis, est vide. Pour la cinquième fois les événements tournent contre le célèbre Norvégien. A la réalisation de son rêve, il a sacrifié tout son avoir ; pour payer les dettes de son expédition, il est forcé de demander la liquidation judiciaire de ses biens, il est vaincu, il est ruiné. Néanmoins il garde sa foi dans le succès final, et, soutenu par son énergie inflexible, qu’aucun revers ne peut entamer, à la fin de 1924 il part pour les Etats-Unis, dans la pensée d’y trouver des subsides pour une nouvelle campagne. Le hasard, le dieu des voyageurs, le servit en le mettant en relation avec un jeune Américain, Mr Lincoln Ellsworth, épris d’aventures. Grâce à son concours, et à celui de la Société de Navigation aérienne de Norvège, les fonds nécessaires à un nouveau voyage furent réunis ; après sept longues années de défaites répétées, le succès revenait enfin à Amundsen. Sa volonté avait fait plier l’adversité. Tel est le héros de l’aventure racontée dans ce livre.
Sur quel terrain s’est déroulé son voyage extraordinaire, il est nécessaire de l’indiquer dès à présent pour permettre au lecteur de se rendre compte des péripéties émouvantes de ce nouveau drame polaire.
Personne n’ignore que, tandis que le Pôle Sud est situé sur un immense continent glacé, le Pôle Nord se rencontre au milieu d’un vaste océan rempli d’épaisses banquises, occupant toute la calotte arctique du globe. Loin de former une nappe d’un seul tenant et parfaitement unie comme la glace qui recouvre en hiver les lacs, ces banquises sont, au contraire, morcelées et accidentées d’innombrables saillies. Leurs fragments, les « champs », pour employer l’expression technique, possèdent des dimensions fort variables ; tantôt ils atteignent une étendue de plusieurs kilomètres, tantôt ils ne dépassent pas plusieurs centaines de mètres, et même souvent beaucoup moins. Sous l’impulsion des courants marins, des marées, des vents, ces radeaux de glace sont animés d’un mouvement de dérive constant. Une tempête vient-elle à s’élever, ils se pressent et se heurtent avec une violence indescriptible. Dans des collisions terrifiantes, les glaçons chevauchent les uns par-dessus les autres, se brisent, en même temps soulevés par des poussées formidables, leurs débris s’empilent en crêtes et en monticules[1]. Ces reliefs peuvent atteindre une hauteur de 8 à 10 mètres et se suivent en longues chaînes rapprochées[2]. La banquise de l’extrême Nord devient ainsi un chaos de saillies de glace ; représentez-vous une mer folle, gonflée d’énormes vagues qu’un froid intense aurait subitement solidifiée. Cette surface frigide, jamais elle ne demeure calme. Quand les « champs » ne se dressent pas les uns contre les autres, ils se disloquent brutalement. Le grand désert blanc semble-t-il figé dans l’immobilité, tout à coup un fracas rompt le silence qui l’emplit. Une crevasse s’ouvre au milieu d’un champ de glace ; à vue d’œil, ses lèvres s’écartent, mues par des forces mystérieuses ; bientôt un canal se forme ; à son tour il s’agrandit et, à la place de l’amas de blocs préexistants, naît une nappe d’eau, large de centaines de mètres et longue de plusieurs kilomètres. Puis, un beau jour, sans cause apparente, ses rives mobiles se rapprochent et finalement se rejoignent en s’écrasant. Aussi brusquement qu’il est né, le lac disparaît.
[1] Dans le vocabulaire arctique ces accumulations de glaçons portent le nom de Toross, un vocable russe. L’emploi de ce terme technique, peu familier, nous paraissant devoir nuire à la clarté du récit, nous l’avons remplacé par l’expression plus descriptive de crête ou de chaîne de monticules.
[2] La région survolée par Amundsen ne renferme pas d’icebergs, c’est-à-dire de montagnes de glace pouvant atteindre 50, 60 et même parfois 100 mètres au-dessus de la mer. Ces énormes blocs, détachés du front de très vastes glaciers, ne se rencontrent dans l’hémisphère nord, en abondance et avec de grandes dimensions, qu’autour du Groenland, d’où ils descendent au sud, pour terminer leur carrière sur les bancs de Terre-Neuve. Près la côte nord-est du Spitzberg et aux approches de la terre Nicolas II, dans l’océan Glacial de Sibérie, on trouve également parfois des icebergs, mais en nombre restreint et de petite taille. Dans tout le reste du bassin arctique les glaçons de cette catégorie font défaut.
Que sur une surface aussi accidentée et aussi traîtresse des aviateurs aient réussi à prendre leur envol, cela dépasse l’imagination.
Aussi bien, le récit de leur exploit présente-t-il l’intérêt d’un roman d’aventures vécu, en même temps qu’une leçon d’énergie attachante par sa simplicité et son absence de rhétorique.
Ces braves ont écrit comme ils ont agi.
Charles Rabot.
La Halinière en Martigné-Ferchaud, le 29 septembre 1925.
AMESDAMESKIRSTEN RIISER-LARSENET GUNVOR DIETRICHSONCES DEUX NOBLES REPRÉSENTANTESDES VERTUS DE LA FEMME NORVÉGIENNECE LIVREEST RESPECTUEUSEMENT DÉDIÉ.
ROALD AMUNDSEN.

Itinéraire de l’expédition Amundsen dans son voyage vers le Pôle et au retour
PREMIÈRE PARTIE
A travers les airs du Spitzberg aux approches du pôle
L’Odyssée du N-25. — La lutte pour la vie sur la banquise. — Le retour au Spitzberg.
PAR
Roald AMUNDSEN
CHAPITRE PREMIER: Comment je devins aviateur.
Une première expérience mouvementée. — Le début de l’aviation dans le domaine polaire. — J.-Lincoln Ellsworth, mécène de l’expédition. — La campagne de 1925. — Mes collaborateurs. — Mon programme d’exploration pour 1926.
Le jour où les frères Wright accomplirent leur premier vol inaugure une ère nouvelle dans l’histoire de la civilisation. Dès lors, des possibilités d’un intérêt considérable s’ouvraient à l’homme ; des temps nouveaux s’annonçaient dans tous les domaines, même dans celui si particulier de l’exploration polaire.
Jusque-là, pour pénétrer à travers les banquises de l’océan Arctique en direction du Pôle, deux moyens de locomotion avaient été employés, le navire et le traîneau tiré par des chiens. L’un et l’autre étaient demeurés impuissants devant les obstacles accumulés sur leurs routes. La plupart des bateaux engagés dans la lutte avaient été broyés par les glaces, tandis que les audacieux qui s’étaient aventurés à pied avec des traîneaux chargés de vivres, sur le plancher mouvant de la banquise, avaient toujours dû s’arrêter loin du but, vaincus par les privations et par le froid. Dans ces luttes contre les éléments, quel courage, quelle endurance ces vaillants pionniers ont déployés ! Sans contredit, il n’est pas de plus bel exemple d’abnégation et d’esprit de sacrifice que celui donné par les assaillants du Pôle Nord. Et voici tout à coup qu’une invention merveilleuse semble devoir fournir le moyen de triompher de tous les obstacles qui, jusqu’ici, ont arrêté l’homme dans cette marche à l’Etoile. Un vol de quelques heures et la victoire sera acquise.
L’exploit de Blériot fut pour moi le trait de lumière. Immédiatement, je compris que le temps était proche où l’air deviendrait la voie de pénétration dans le monde polaire ; en imagination, j’entrevis l’avion franchissant avec aisance les immensités blanches qui, jusque-là, avaient arrêté navires et traîneaux. Dans mon rêve, j’envisageais l’océan glacé au milieu duquel se rencontre le Pôle Nord et qu’enveloppe encore presque entièrement un voile de mystère. Si Nansen, le duc des Abruzzes, Peary ont accompli des trouées dans cette vaste solitude frigide, combien immense cependant demeure le domaine de l’inconnu. En poursuivre l’exploration avec les moyens employés jusqu’ici exigerait des années et des années, peut-être sans arriver à un résultat complet. Au contraire, avec un avion… Dès lors, cette idée s’imposa à mon esprit et sa réalisation devint ma grande préoccupation.
Dès 1909, lorsque je me préparais à entreprendre une dérive à travers le bassin arctique, dans le genre de celle effectuée par Nansen en 1893-1896, j’eus, avec un des meilleurs pilotes de l’époque, un entretien sur les possibilités d’emploi de l’aéroplane dans la zone polaire. Mon interlocuteur se déclara prêt à tenter la chance avec moi. Seules des raisons financières me forcèrent à renoncer à ce concours. Je ne le regrette ni pour l’un ni pour l’autre, étant donné l’état de l’aviation à cette époque. Si je rappelle ici cette conversation, c’est uniquement pour prouver que mon projet de survoler l’océan Glacial est ancien, que, par suite, je ne me suis pas approprié les idées des autres, ainsi que j’en ai été accusé. Un grief aussi enfantin, je ne l’aurais certes pas relevé, si souvent la médisance ne trouvait un trop facile accueil.
En 1914, j’achetai mon premier aéroplane, un Farman monté sur ski, dans le dessein de m’en servir pour des reconnaissances autour de mon navire pendant sa dérive à travers le bassin arctique. Dans ma pensée, cet appareil rendrait des services considérables en me permettant d’embrasser d’un seul coup d’œil de très vastes espaces. Me fiant à mon expérience des régions polaires, je ne mettais pas alors en doute la possibilité de rencontrer au milieu de la banquise des espaces suffisamment plans pour les envols et les atterrissages.
Depuis, j’ai appris que sur l’état du terrain explorateurs et aviateurs ont des opinions complètement différentes, qu’un champ de glace que les premiers considèrent comme remarquablement uni est jugé hérissé de saillies par les seconds. Ce premier appareil je n’eus pas l’occasion de l’employer.
Sur ces entrefaites, la déclaration de guerre entraîna la remise de mon expédition. Dans cette circonstance comme dans plusieurs autres, l’obstacle qui me contraignit à m’arrêter devint plus tard la source du succès. Pendant les quatre années que dura la conflagration mondiale, l’aviation réalisa d’énormes progrès. Durant cette période, l’enfant né en 1908 grandit rapidement et apprit à marcher seul.
En 1921, en Amérique, le record de la durée du vol fut porté à vingt-sept heures. L’appareil employé était un monoplan Junker. Fabriqué entièrement en duralumin, ni le froid, ni la chaleur, ni la neige, ni la pluie ne pouvaient lui causer de dommages. Il répondait donc complètement aux exigences de l’exploration polaire. Je me trouvais alors à Seattle, sur les bords du Pacifique, occupé à remettre en état mon navire, le Maud, en vue d’une nouvelle campagne dans l’Arctique. Dès que je connus l’exploit accompli par le Junker, ma résolution fut prise ; à n’importe quel prix, je devais m’en procurer un. Avec cet appareil l’impossible pouvait devenir une réalité ; la porte sur le grand inconnu blanc allait s’ouvrir d’un coup, me semblait-il. Hélas ! encore une fois mes espoirs furent déçus : pendant quelques années encore la porte devait demeurer close.

SPITZBERG. — A la baie du Roi, les membres de l’expédition étudient sur la carte le trajet éventuel des hydravions au dessus de la banquise (au centre, assis, Roald Amundsen, debout de gauche à droite Feucht, Ellsworth, Horgen, Riiser-Larsen, Dietrichson, Omdal).(Cliché Illustration)
Donc, j’acquis un Junker, et, pour le piloter, fis choix du lieutenant de vaisseau Omdal, de la marine norvégienne. Afin d’apprendre à connaître notre appareil, nous décidâmes d’effectuer, par la voie des airs, le trajet de New-York, où sont installés les établissements Junker, à Seattle, en d’autres termes de traverser les Etats-Unis dans toute leur largeur. Le voyage faillit avoir une issue tragique. Au-dessus de la ville de Marion, en Pensylvanie, une panne de moteur nous obligea à une descente piquée. De l’aventure nous sortîmes indemnes, mais l’appareil fut brisé. L’usine m’en ayant expédié un second par chemin de fer, je pus l’embarquer sur le Maud, ainsi qu’un petit avion de reconnaissance que m’avait remis la célèbre firme américaine Curtiss.
Une fois arrivée sur la côte nord de l’Alaska, l’expédition se partagea en deux groupes. Le Maud fit route dans le nord-ouest pour commencer sa dérive à travers le bassin arctique ; il emmenait le Curtiss destiné à effectuer des raids de rayon limité autour du bateau.
Le Maud se trouvait ainsi outillé à la fois pour l’exploration de l’océan et pour celle de l’atmosphère. Le second groupe, comprenant le lieutenant Omdal et moi, avec le Junker, s’installa sur les bords de la baie Wainwright. De là nous projetions de survoler aussi loin que possible la région inconnue s’étendant en direction du Pôle, au nord de l’Alaska.
Le mauvais temps nous ayant empêché d’accomplir ce programme pendant l’été 1922, nous hivernâmes sur cette côte, et, en mai 1923, nous nous préparâmes à partir. Le premier essai de l’appareil amena un désastre. En touchant le sol au retour, le train d’atterrissage se brisa complètement ; ne possédant aucun moyen de le réparer, nous fûmes contraints à la retraite. Telle fut l’issue de ma première tentative d’exploration aérienne.
Un sort semblable attendait le Curtiss. Il fut détruit à son second atterrissage sur la banquise, ainsi qu’un radio lancé par le Maud nous l’apprit. Les deux reconnaissances qu’il a effectuées paraissent avoir été fort brèves et n’avoir pas permis d’examiner des régions étendues. Quoi qu’il en soit, ce sont les deux premiers vols qui aient été effectués au-dessus des glaces polaires et en même temps les premières expériences révélant les énormes difficultés que présente l’emploi de l’avion dans l’Arctique. Le message relatant les sorties du Curtiss signale notamment l’impossibilité pour le pilote, quand il vole à une certaine hauteur, de se rendre compte de l’état du terrain en vue de l’atterrissage ; alors même qu’il se trouve à une faible altitude, la glace lui paraît unie, alors qu’en réalité elle est hérissée de monticules.
Après ces deux échecs, l’avenir ne me paraissait pas précisément souriant. Revenu à Seattle après ma campagne infructueuse en Alaska, je me trouvai démuni de tout ; mon avoir consistait uniquement en un aéroplane avarié dont personne ne voulait. Je ne perdis pas courage pour cela, et, sans désemparer, travaillai à me procurer un nouvel équipement. La majeure partie de 1924 s’écoula sans obtenir aucun résultat. C’est alors qu’en septembre de cette même année j’offris à la Société norvégienne de Navigation aérienne de collaborer à la mise sur pied de mon projet. Ma proposition ayant reçu un accueil enthousiaste, je convins avec cette association que, pendant qu’elle s’occuperait de recueillir des fonds en Norvège, j’irais en Amérique essayer d’en trouver de mon côté. Après avoir fait des conférences dans plusieurs villes des Etats-Unis, un matin j’étais occupé à calculer combien de temps encore je devrais me livrer à cet exercice oratoire pour réunir les capitaux nécessaires à désintéresser mes créanciers et à monter une nouvelle expédition. Pas précisément encourageant, le résultat : seulement, dans cinquante-huit ans, alors que j’aurai 110 ans, je disposerai d’une somme suffisante. L’imprévu me sauva. A la suite de mes opérations arithmétiques, j’étais plongé dans des réflexions assez tristes, lorsque, soudain, retentit un appel du téléphone. Je prends l’écouteur :
— C’est bien au capitaine Roald Amundsen que j’ai l’avantage de parler ?
— Oui.
— Ici, Lincoln Ellsworth.
C’est ainsi que j’entrai en rapport avec l’homme auquel je dois d’avoir pu mettre à exécution mon programme.
En exprimant ma gratitude à mon collaborateur et ami américain, je ne crois pas diminuer le rôle de la Société norvégienne de Navigation aérienne dans la préparation de mon entreprise ; à elle aussi toute ma reconnaissance demeure acquise pour son concours si utile. A son président, le Dr Rolf Thommesen, et à deux membres de son comité directeur, le Dr Arnold Ræstad[3] et le major Sverre[4], je dois des obligations toutes particulières. Grâce à leurs efforts énergiques, grâce également à l’appui du gouvernement norvégien, ils réussirent à assurer l’organisation matérielle de l’expédition pendant mon séjour aux Etats-Unis qui se prolongea durant tout l’hiver 1924-1925.
[3] Ancien ministre des Affaires étrangères de Norvège.
[4] Ancien attaché militaire à la Légation de Norvège à Paris.
Je confiai au lieutenant de vaisseau Riiser-Larsen, de la marine nationale norvégienne, la direction des services techniques. Ayant été mon collaborateur dévoué en 1924, il était au courant de cette lourde tâche. Avec quelle satisfaction et quelle confiance en lui je lui câblais que je disposais de 85.000 dollars, subvention personnelle de James W. Ellsworth[5], et que je le priais en conséquence de commander deux aéroplanes[6].
[5] Père de M. Lincoln Ellsworth.
[6] M. James W. Ellsworth, père de M. Lincoln Ellsworth, est mort pendant le cours de l’expédition, sans avoir pu jouir du triomphe de son fils.
La réputation de Riiser-Larsen comme aviateur est si bien établie dans notre pays qu’il est oiseux de faire l’éloge de sa maîtrise. Outre ses qualités professionnelles, il en possède une bonne douzaine d’autres non moins précieuses qui le rendaient tout à fait digne du poste que je lui assignai. Pour un chef, c’est une singulière bonne fortune de pouvoir se reposer sur un tel second ; un pareil collaborateur aplanit toutes les difficultés, quelques nombreuses qu’elles soient.
Mes deux autres auxiliaires de premier plan ont été le lieutenant de vaisseau Leif Dietrichson, également de la marine nationale norvégienne, et le lieutenant-aviateur Omdal, déjà nommé. Tous deux, ayant également participé aux préparatifs de l’expédition avortée de l’an dernier, connaissaient, comme Riiser-Larsen, la besogne leur incombant. Dietrichson est, lui aussi, un pilote aussi habile qu’expérimenté ; le récit du voyage mettra en relief son courage et son esprit de décision ; donc inutile d’en dire plus long à son sujet. Omdal se distingue par une rare volonté et une énergie indomptables. Indifférent à la mauvaise fortune, il ne se courbe devant aucun échec. Après avoir été mon compagnon d’infortune dans mes deux tentatives de 1923 et 1924, on aurait pu croire qu’il eût été peu désireux de continuer à me prêter son concours. Pas du tout. Omdal ne cède jamais : « Tant que vous n’aurez pas triomphé, je resterai à vos côtés », me répondit-il un jour où je lui parlais de mes déceptions. Avec trois hommes de cette trempe, la préparation technique était en bonnes mains.
Maintenant, deux mots sur notre programme. Je me proposais de pénétrer aussi loin que possible dans la zone arctique, entre le Spitzberg et l’Alaska. Que renferme cet immense espace ? Les explorations de Nansen, du duc des Abruzzes, de Peary autorisent à penser qu’il est occupé par un océan couvert de banquises en dérive. A cet égard, toutefois, aucune certitude ; or, la science actuelle en exige ; un vol de quelques heures au-dessus de cette région aurait précisément pour résultat de fournir les précisions nécessaires. Nous n’envisagions guère la possibilité de parvenir jusqu’au Pôle même, le rayon d’action de nos appareils étant trop faible pour un aussi long voyage. D’ailleurs, je n’attachais qu’un médiocre intérêt à atteindre le sommet boréal de l’axe de rotation du globe, ayant toujours été persuadé que Peary y était déjà parvenu.
D’autre part, j’espérais, au cours du vol envisagé, exécuter des observations météorologiques intéressantes.
Enfin, l’expédition devait me permettre d’acquérir une expérience très utile au cas où j’entreprendrais plus tard le raid que je projette depuis longtemps entre le Spitzberg et l’Alaska, ou si d’autres tentaient cette aventure. Je le déclare hautement ; je souhaite ardemment que notre campagne de cette année puisse servir à des confrères. Je ne suis pas de ces explorateurs qui considèrent l’océan Glacial comme un terrain de chasse réservé à leur usage exclusif. Mon sentiment est tout différent. Dans mon opinion, plus nombreux sont les pionniers partant à la conquête de l’inconnu, plus importants seront les résultats, surtout si les attaques sont simultanées et dirigées vers le même point. La concurrence est la source du progrès. Un exemple : un aviateur fait connaître son intention de survoler de part en part le bassin arctique, en raison d’incidents imprévus, il ne peut accomplir son programme. Est-ce que, tant qu’il vivra, d’autres n’auront pas le droit d’essayer de le réaliser ? Pareille prétention me paraît absurde en même temps que peu conforme à l’esprit sportif qui doit régner en pareille matière. « Qui arrive le premier au moulin moud le premier », dit un vieux proverbe norvégien.
Pendant l’été 1926, je me propose de traverser le bassin arctique, du Spitzberg à l’Alaska, par la voie des airs. Ce projet, je l’annonce, non pas pour me réserver l’exclusivité de son exécution, mais, au contraire, dans l’espoir que d’autres seront tentés de suivre mon exemple. Les enseignements que j’ai recueillis en 1925, je les mets avec plaisir à leur disposition. Dans un radio expédié en septembre 1924 par le Maud, captif dans la banquise, le Dr Sverdrup explique que, d’après les observations de marée très nombreuses qu’il a effectuées pendant ses campagnes dans l’océan Glacial de Sibérie, il ne croit guère à l’existence d’une terre au nord de l’Alaska. Ma confiance en ce collaborateur est très grande ; je le considère comme un excellent observateur et un esprit critique fort avisé. Il n’en reste pas moins que son opinion repose uniquement sur des raisonnements. Or, en géographie, seule la vision d’un pays donne la certitude.
Le nouveau raid que je prépare ne sera donc pas dépourvu d’intérêt scientifique[7].
[7] Ce voyage sera exécuté non plus en avion, mais en dirigeable. A cet effet, Amundsen a acquis un semi-rigide en service dans la marine italienne. Le départ sera pris au Spitzberg, sur les bords de la baie du Roi, où un hangar va être construit pour permettre à l’aéronef d’attendre en sécurité des circonstances atmosphériques favorables. (Note du traducteur.)