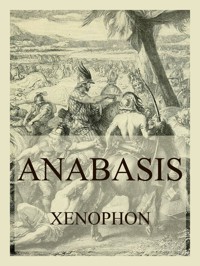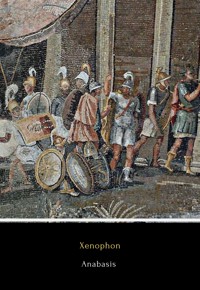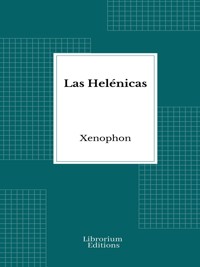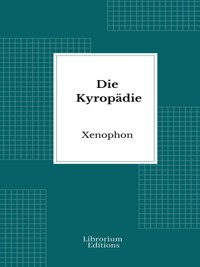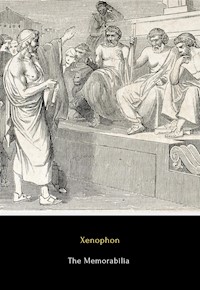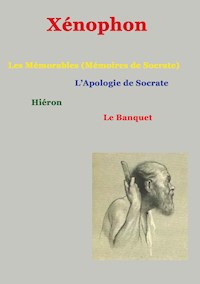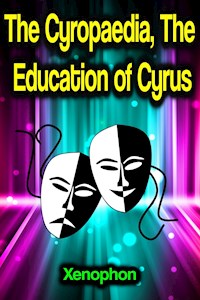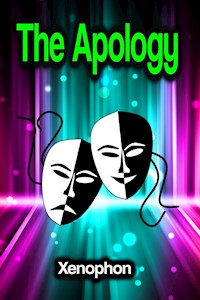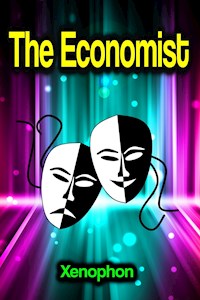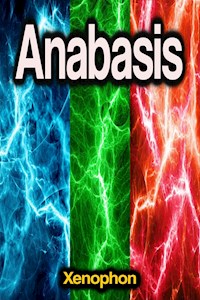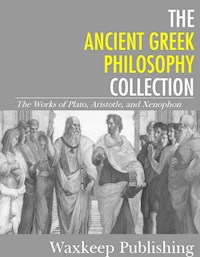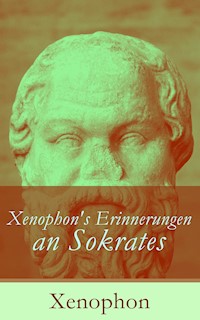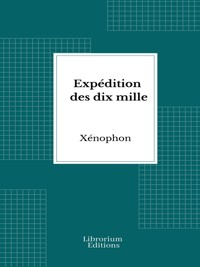
1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Librorium Editions
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Darius et Parysatis eurent deux fils : l’aîné, Artaxercès, le plus jeune, Cyrus. Darius étant tombé malade et sentant sa fin approcher, voulut avoir près de lui ses deux fils. L’aîné se trouvait là ; Cyrus fut mandé par son père des gouvernements dont il l’avait fait satrape, en le nommant aussi général de toutes les troupes campées dans la plaine du Castole. Cyrus vint donc, accompagné de Tissapherne, qu’il croyait son ami, et suivi de trois cents hoplites grecs que commandait Xénias de Parrhasie.
Darius meurt : Artaxercès lui succède. Alors Tissapherne accuse Cyrus auprès de son frère de tramer contre lui. Artaxercès le croit, et fait arrêter Cyrus, pour le mettre à mort. Leur mère, à force d’instances, fléchit le roi, et obtient que Cyrus soit renvoyé dans son gouvernement. Cyrus, tout ému du danger et de l’affront, s’en va et songe aux moyens de ne plus dépendre de son frère, mais, s’il peut, de régner à sa place. Parysatis, leur mère, favorisait Cyrus, qu’elle chérissait plus que le roi régnant Artaxercès. D’ailleurs, quiconque venait de chez le roi auprès de Cyrus, il le changeait si bien, qu’au départ on avait plus d’amitié pour lui que pour le roi ; et il mettait tous ses soins à ce que les Barbares qui étaient à son service devinssent de bons soldats et dévoués à sa personne.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
XÉNOPHON
EXPÉDITION DES DIX MILLE
1872
© 2023 Librorium Editions
ISBN : 9782385741419
AVERTISSEMENT
Xénophon a inscrit en tête de son livre le mot grec Anabasis, qui veut dire marche ascendante, marche en avant ; c’est précisément l’opposé de cet autre titre adopté généralement par les modernes : Retraite des Dix mille. En proposant d’y substituer celui d’Expédition des Dix mille, nous faisons œuvre de conciliation, puisque la marche en avant et la marche en retraite s’y trouvent également comprises. Il est vrai qu’on pourrait nous chercher chicane sur ce que le corps expéditionnaire était d’environ treize mille hommes au départ ; mais comme il n’était plus guère que de huit mille cinq cents au retour, à Cérasonte, et qu’il diminua encore depuis cet endroit-là, il nous semble que le chiffre de dix mille est une bonne moyenne.
Quoi qu’il en soit, et sous quelque titre qu’il se produise, le livre de Xénophon est justement compté parmi les classiques de la guerre ; il en est le premier dans l’ordre des temps, et peut-être à tous les points de vue. L’auteur de l’Anabase est un maître dans l’art de conduire les soldats.
Xénophon était Athénien, du bourg d’Erchios ; on ne connaît pas bien la date de sa naissance, mais on la rapporte aux environs de l’année 445 avant notre ère. Il reçut la forte éducation, physique et intellectuelle, qu’on donnait à la jeunesse de son pays et de son temps. Il suivit des cours d’art militaire, comme il s’en faisait alors dans les principales villes de la Grèce. Enfin, pour achever le développement de ses facultés morales, il eut le bonheur de rencontrer Socrate.
Vers l’âge de dix-huit ans, il commença de servir dans la milice des péripoles, qui étaient chargés de garder les environs d’Athènes. Deux ans plus tard, on le trouve dans l’armée active. Blessé au combat de Délium où les Athéniens furent battus par les troupes de Thèbes, il fut sauvé par Socrate, qui le prit sur ses épaules et l’emporta loin du champ de bataille.
La guerre du Péloponèse ayant pris fin, et Athènes ayant succombé sous les coups de Sparte, Xénophon se laissa persuader par un ami, le Béotien Proxène, d’aller chercher fortune auprès du second fils de Darius II, Cyrus le jeune, qui gouvernait la plus grande partie de l’Asie Mineure. Après la mort de Darius et l’avénement de son fils aîné, Artaxercès Mnémon, au trône de Perse, Cyrus résolut de disputer la couronne à son frère ; il leva des troupes, appela des auxiliaires grecs, et partit. Alors commença, en 401, cette expédition des Dix mille où Xénophon, d’abord simple volontaire, s’éleva bientôt au premier rang, et dont il a écrit l’histoire.
Quand il revint à Athènes, Socrate était mort ; une démocratie jalouse, inquiète, poursuivait de ses soupçons les meilleurs citoyens. Xénophon fut accusé de laconisme, c’est-à-dire de sympathie pour Sparte et d’inclination vers un gouvernement aristocratique, comme celui que Lycurgue avait fondé en Laconie ; il fut condamné à l’exil. Agésilas lui donna une généreuse hospitalité ; les liens d’une amitié solide unirent ces deux fameux hommes de guerre. Enfin, Xénophon se retira dans l’Élide, auprès d’Olympie, à Scillonte, où se termina, après quelques autres vicissitudes, sa longue carrière ; il avait plus de quatre-vingt-dix ans quand il mourut, en 354.
Xénophon a beaucoup écrit et sur beaucoup de sujets. Les Mémoires sur Socrate et l’Apologie de Socrate sont des monuments incomparables pour l’histoire du grand réformateur de la philosophie. Le Gouvernement des Lacédémoniens et le Gouvernement des Athéniens nous font bien connaître le caractère politique des deux peuples et l’antagonisme de leurs institutions. Le Commandant de la cavalerie et le traité de l’Équitation nous ramènent vers l’art militaire qui tient une si grande place dans les ouvrages historiques de Xénophon : les Helléniques ou Histoire Grecque, suite donnée par lui au chef-d’œuvre inachevé de Thucydide, l’Anabase, la Vie d’Agésilas, et jusque dans cette Cyropédie ou Éducation de Cyrus, qui est cependant, comme on l’a justement remarqué, bien plutôt une œuvre d’imagination qu’une histoire.
Nous n’avons nommé que les principaux écrits de Xénophon ; le premier de tous, le plus achevé, le plus populaire, et nous ne saurions trop le redire, le plus digne de l’être, c’est l’Expédition des Dix mille.
La traduction qu’on va lire est due à la plume exercée de M. Eugène Talbot. Vers la fin du dernier siècle, un officier général, le comte de La Luzerne, qui fut ministre de la marine sous Louis XVI, avait consacré à l’étude du livre de Xénophon la passion d’un ami des lettres anciennes et l’intelligence d’un homme du métier. M. Talbot a profité utilement de son précieux travail.
En s’appliquant à faire connaître à leurs contemporains les principales œuvres de l’antiquité Grecque et Romaine, les traducteurs du XVIIe et du XVIIIe siècle se préoccupaient plus d’être compris que d’être exacts. C’est ainsi que, pour les magistratures, les fonctions civiles et militaires chez les anciens, ils cherchaient des équivalents chez les modernes ; il paraît que des termes tels que ceux de colonel, de mestre de camp, et d’autres de même sorte, attribués aux chefs militaires d’Athènes où de Rome, ne choquaient pas alors les lecteurs. De notre temps on est plus difficile ; mais on risque de tomber dans l’excès contraire. Comme on se défie des équivalents qui ne peuvent jamais être en effet d’une exactitude parfaite, on introduit simplement dans la traduction les dénominations grecques où latines, en leur donnant tout au plus une désinence française : hoplites, peltastes, gymnètes, etc. Cela demande cependant quelque explication. Le plus souvent, pas toujours, on fait une note ; mais l’inconvénient des notes est qu’une fois données, on ne les reproduit plus d’ordinaire, tandis que les termes qui intriguent le lecteur se représentent au contraire assez fréquemment et le forcent à rechercher, non sans peine, feuillet par feuillet, l’explication unique à laquelle il a plus d’une fois besoin de recourir.
Au lieu de notes, nous avons cru devoir placer, dans cet Avertissement même, quelques éclaircissements sur un certain nombre de termes grecs laissés, par principe d’exactitude, dans cette traduction.
L’hoplite, chez les Grecs, était le fantassin armé de toutes pièces, casque, cuirasse, cnémides ou jambières, grand bouclier qui couvrait tout le corps, depuis le cou jusqu’aux pieds, longue pique ou sarisse, épée. Les hoplites composaient le fonds de l’infanterie grecque, quelque chose comme notre infanterie de ligne.
Le peltaste, ainsi nommé de son bouclier, ou pelte, beaucoup moins grand que celui de l’hoplite, était armé plus légèrement ; au lieu de cuirasse, il avait seulement une lame d’une certaine largeur, en fer ou en cuivre, autour de la taille ; point de cnémides ; au lieu de la sarisse, un javelot ou tout au plus une demi-pique. Les peltastes étaient de l’infanterie légère.
Sous les termes de psiles, de gymnètes, il faut entendre une infanterie encore plus légère, sans armure défensive, sans bouclier même, prompte à la course, faite pour escarmoucher, en un mot des tirailleurs. Les frondeurs, les archers, ce qu’on nommait en général les gens de trait, appartenaient à cette catégorie.
Les skeuophores étaient les porteurs ou conducteurs de bagages.
La formation des troupes, du moins au temps de Xénophon, se faisait d’après l’ordonnance lacédémonienne, parce que alors Lacédémone, étant victorieuse, donnait le ton militaire au reste de la Grèce. Cette ordonnance différait beaucoup de l’ordonnance macédonienne qui lui succéda, et quoiqu’on trouve les mêmes termes dans l’une et dans l’autre, on doit les entendre dans des sens différents.
Ainsi, dans l’ordonnance macédonienne, le lochos ou loche n’est qu’une file de la phalange, de huit à seize hommes au plus : dans l’ordonnance lacédémonienne, le loche est un corps de cent hommes, quelque chose comme une de nos compagnies d’infanterie ; de sorte que le lochage, ou chef de loche, qui, chez les Macédoniens, ne se trouvait être qu’un sous-officier, nous dirions volontiers un sergent, était, chez les Spartiates, comme un capitaine chez nous. On verra dans l’Expédition des Dix mille, les lochages jouer un rôle considérable.
Les hypolochages peuvent être considérés comme des lieutenants.
Le loche se partageait en deux pentécosties, ou sections de cinquante hommes, commandées par des pentécontarques, et la pentécostie, en deux énomoties, de vingt-cinq hommes chacune, sous les ordres d’un énomotarque.
Quatre loches, et quelquefois davantage, étaient réunis sous le commandement d’un stratége qui était comme un colonel. Le taxiarque était un stratége, sous un nom différent. L’hypostratége était en quelque sorte un lieutenant-colonel.
En allant au combat, les troupes grecques entonnaient le péan, qui était un chant militaire et religieux, et invoquaient Ényalius, c’est-à-dire Mars, dieu de la guerre, sous un de ses surnoms.
Dans l’armée d’Artaxercès, on voit figurer les doryphores ou porte-lances, qui formaient la garde du Grand Roi — c’était ainsi qu’on appelait le roi de Perse, — et les gerrophores qui prenaient leur nom du bouclier tressé en osier, ou gerre, qu’ils portaient.
Dans la marine, les triérites étaient les rameurs ou matelots d’une trirème, galère à trois rangs de rames, commandée par un triérarque.
Les navires à cinquante rames s’appelaient des pentécontores ; à trente rames, des triacontores.
Le terme d’épibates désignait les matelots en général.
Dans les villes auxquelles Sparte avait enlevé leur autonomie, elle envoyait un harmoste ou gouverneur, revêtu de tous les pouvoirs civils et militaires.
Un comarque était un chef de village, une sorte de maire rural.
Il y aurait peut-être quelques autres explications à donner encore, mais nous nous bornons à celles-ci, ne voulant pas fatiguer le lecteur, sous prétexte de lui être utile.
C. R.
XÉNOPHON
EXPÉDITION DES DIX MILLE.
LIVRE PREMIER
CHAPITRE PREMIER
Des causes de la guerre entre Cyrus le jeune et Artaxercès. Cyrus se prépare à la lutte.
Darius et Parysatis eurent deux fils : l’aîné, Artaxercès, le plus jeune, Cyrus. Darius étant tombé malade et sentant sa fin approcher, voulut avoir près de lui ses deux fils. L’aîné se trouvait là ; Cyrus fut mandé par son père des gouvernements dont il l’avait fait satrape, en le nommant aussi général de toutes les troupes campées dans la plaine du Castole. Cyrus vint donc, accompagné de Tissapherne, qu’il croyait son ami, et suivi de trois cents hoplites grecs que commandait Xénias de Parrhasie.
Darius meurt : Artaxercès lui succède. Alors Tissapherne accuse Cyrus auprès de son frère de tramer contre lui. Artaxercès le croit, et fait arrêter Cyrus, pour le mettre à mort. Leur mère, à force d’instances, fléchit le roi, et obtient que Cyrus soit renvoyé dans son gouvernement. Cyrus, tout ému du danger et de l’affront, s’en va et songe aux moyens de ne plus dépendre de son frère, mais, s’il peut, de régner à sa place. Parysatis, leur mère, favorisait Cyrus, qu’elle chérissait plus que le roi régnant Artaxercès. D’ailleurs, quiconque venait de chez le roi auprès de Cyrus, il le changeait si bien, qu’au départ on avait plus d’amitié pour lui que pour le roi ; et il mettait tous ses soins à ce que les Barbares qui étaient à son service devinssent de bons soldats et dévoués à sa personne.
En même temps, il lève des troupes grecques le plus secrètement possible, afin de prendre le roi tout à fait au dépourvu. Voici comment eut lieu cette levée. Dans toutes les villes où il entretenait garnison, il ordonna aux commandants d’enrôler le plus grand nombre possible des meilleurs soldats du Péloponèse, sous prétexte que Tissapherne en voulait à ses places. En effet, les villes ioniennes avaient été jadis à Tissapherne, le roi lui en ayant fait présent ; mais toutes, sauf Milet, s’étaient rangées du parti de Cyrus. Or, à Milet, Tissapherne, pressentant que les habitants avaient également l’intention de passer à Cyrus, fit mourir les uns et bannir les autres. Cyrus accueille les bannis, assemble une armée, assiége Milet par terre et par mer, et tâche d’y faire rentrer ceux qui en avaient été exilés. C’était pour lui un nouveau prétexte de lever des troupes. Puis il envoie prier le roi de lui donner ces places, à lui, son frère, plutôt qu’à Tissapherne. Leur mère appuie cette demande, en sorte qu’Artaxercès, loin de soupçonner le piége qu’on lui tend, se figure que Cyrus ne fait tous ces armements dispendieux que contre Tissapherne. Il n’est pas même fâché de les voir en guerre, Cyrus lui envoyant les tributs prélevés sur les villes que Tissapherne avait eues en son pouvoir.
Une autre armée se levait pour Cyrus dans la Chersonèse, vis-à-vis d’Abydos ; et voici comment. Cléarque était un réfugié lacédémonien. Cyrus, s’étant mis en rapport avec lui, le prit en affection, et lui donna dix mille dariques[1]. Cléarque emploie cette somme à lever des troupes, se met en campagne, sort de la Chersonèse, marche contre les Thraces qui habitent au-dessus de l’Hellespont, et rend de si grands services aux Grecs, que les villes de l’Hellespont se cotisent afin de lui envoyer des vivres pour ses armées. C’était là un second corps de troupes entretenues secrètement pour le service de Cyrus.
[1] Environ 180,500 francs.
Aristippe de Thessalie était son hôte. Persécuté dans sa patrie par les gens du parti opposé, il vient trouver Cyrus, lui demande environ deux mille mercenaires, avec trois mois de paye, pour être en état de triompher de ses adversaires politiques. Cyrus lui donne jusqu’à quatre mille hommes, avec une paye de six mois, et le prie de ne point s’accommoder avec ses adversaires, qu’ils n’en aient conféré tous deux. Ce fut un troisième corps entretenu secrètement en Thessalie.
Proxène de Béotie, son ami, reçut ordre de lui d’arriver avec le plus d’hommes possible, sous prétexte de marcher contre les Pisidiens, vu que ces Pisidiens infestaient son territoire. Sophénète de Stymphale et Socrate d’Achaïe, ses hôtes, reçoivent également l’ordre d’arriver avec le plus d’hommes possible, comme pour faire la guerre à Tissapherne avec les bannis de Milet. Tous exécutent ce qu’il a prescrit.
CHAPITRE II
Marche de Cyrus. — Tissapherne découvre au roi les projets de son frère. — Entrevue de la reine Épyaxa et de Cyrus. — Grande revue. — Suite de la marche. — Arrivée à Tarse. — Conférence de Syennésis, roi de Cilicie, et de Cyrus.
Quand il croit le moment venu de s’avancer vers les hauts pays, il prétexte qu’il veut chasser complétement les Pisidiens de son territoire ; et il rassemble, en vue de ce faux projet, toutes les troupes grecques et barbares de la contrée. Il ordonne à Cléarque de venir avec toutes ses forces ; à Aristippe, de s’arranger avec ceux de sa patrie et de renvoyer l’armée qu’il a ; à l’Arcadien Xénias, qui dans les garnisons commandait les troupes étrangères, de venir le joindre avec tous ses hommes, sauf ceux qui seraient nécessaires pour la garde des citadelles. Il rappelle de devant Milet les troupes de siége, et ordonne aux bannis de se joindre à elles, leur promettant que, s’il réussit dans l’expédition qu’il médite, il ne désarmera point qu’il ne les ait rétablis dans leur patrie. Ils obéissent avec plaisir, car ils avaient confiance en lui, prennent les armes et le joignent à Sardes. Xénias, après avoir fait sa levée dans les villes, arrive à Sardes avec près de quatre mille hoplites ; Proxène entre, suivi de quinze cents hoplites et de cinq cents gymnètes ; Sophénète de Stymphale amène mille hoplites, et Socrate d’Achaïe, cinq cents ; Pasion de Mégare, sept cents hoplites et autant de peltastes. Pasion et Socrate venaient du siége de Milet. Telles sont les troupes qui joignent Cyrus à Sardes.
Tissapherne observant cela, et jugeant ces préparatifs trop considérables pour une expédition contre les Pisidiens, va trouver le roi le plus vite possible, suivi de cinq cents cavaliers. Le roi, instruit par Tissapherne de l’armement de Cyrus, se met en état de défense.
Cependant Cyrus, à la tête des troupes que j’ai dites, part de Sardes, traverse la Lydie, fait, en trois étapes, vingt-deux parasanges[2], et arrive au fleuve Méandre. La largeur de ce cours d’eau est de deux plèthres[3] ; il était traversé par un pont de sept bateaux. Cyrus le passe, fait une étape de huit parasanges à travers la Phrygie, et arrive à Colosses, ville peuplée, riche et grande. Il y reste sept jours. Ménon, le Thessalien, l’y joint avec mille hoplites et cinq cents peltastes, Dolopes, Éniens et Olynthiens. De là, il fait en trois étapes vingt parasanges, et arrive à Célènes, ville de Phrygie, peuplée, grande et riche. Cyrus y avait un palais et un grand parc, rempli de bêtes sauvages qu’il chassait à cheval, quand il voulait s’exercer, lui et ses chevaux. Au travers du parc coule le Méandre, dont les sources se trouvent dans le palais même : il coule ensuite à travers la ville de Célènes. Il existe encore à Célènes un autre palais fortifié du grand roi, aux sources mêmes du Marsyas, sous la citadelle. Le Marsyas traverse aussi la ville et se jette dans le Méandre : sa largeur est de vingt-cinq pieds. C’est là, dit-on, qu’Apollon, vainqueur de Marsyas, qui était entré en concurrence de talent avec lui, l’écorcha vif et suspendit sa peau dans l’antre d’où sortent les sources. Voilà pourquoi le fleuve s’appelle Marsyas. Xerxès à son retour de Grèce, après sa défaite et sa fuite du combat, fit, dit-on, bâtir le palais et la citadelle de Célènes. Cyrus y séjourne trente jours. Cléarque, banni de Lacédémone, s’y rend avec mille hoplites, huit cents peltastes thraces et deux cents archers crétois. En même temps Sosias de Syracuse et Sophénite d’Arcadie arrivent, l’un avec trois cents, l’autre avec mille hoplites. Cyrus fait dans son parc la revue et le dénombrement des Grecs ; ils montaient en tout à onze mille hoplites et environ deux mille peltastes.
[2] La parasange correspond à la lieue ancienne, c’est-à-dire à quatre kilomètres.
[3] Plus de 62 mètres. Le plèthre est de plus de 30 mètres.
Reprenant sa marche, il fait en deux étapes dix parasanges, et arrive à Peltes, ville populeuse ; il y séjourne trois jours, pendant lesquels Xénias, d’Arcadie, célèbre les Lycées[4] par des sacrifices et des jeux : les prix étaient des étrilles d’or[5]. Cyrus, en personne, assiste à ces jeux. De là, en deux étapes il fait douze parasanges, jusqu’à l’Agora des Céraniens, ville bien peuplée, la dernière du territoire de la Mysie. Puis il fait trente parasanges en trois étapes, et arrive à Caystropédium, ville peuplée, où il demeure cinq jours. Il était dû plus de trois mois de paye aux soldats, qui venaient souvent réclamer à la porte de Cyrus. Celui-ci les renvoyait avec des espérances, et il était évidemment chagrin ; car il n’était pas dans sa nature de ne pas payer quand il avait de quoi. Sur ces entrefaites, Épyaxa, femme de Syennésis, roi de Cilicie, vient trouver Cyrus et lui fait, dit-on, présent de fortes sommes. Cyrus fait aussitôt payer à son armée la solde de quatre mois. Cette reine avait une garde de Ciliciens et d’Aspendiens : le bruit courut que Cyrus avait obtenu ses faveurs.
[4] Autrement les Lupercales, fêtes de Pan.
[5] C’était un meuble de bain.
Il fait ensuite en deux étapes dix parasanges, et arrive à Thymbrium, ville peuplée. On y voit une fontaine, portant le nom de Midas, roi de Phrygie, et dans laquelle on dit que Midas saisit le satyre, en y mêlant du vin[6]. De là, il fait dix parasanges en deux étapes, et arrive à Tyriéum, ville peuplée, où il demeure trois jours. On dit qu’en cet endroit la reine de Cilicie pria Cyrus de lui montrer son armée en bataille. Il y consent, et passe dans la plaine une revue des Grecs et des Barbares. Il ordonne aux Grecs de se ranger et de se tenir en bataille, selon leur usage, et aux chefs d’ordonner chacun leur troupe. On les range sur quatre de hauteur. Ménon occupe l’aile droite avec les siennes ; Cléarque, la gauche avec ses soldats ; les autres généraux, le centre. Cyrus voit d’abord défiler les Barbares, qui passent sous ses yeux par escadrons et par bataillons ; puis il passe devant la ligne des Grecs, monté sur un char, et la reine de Cilicie dans une litière. Les soldats grecs avaient tous des casques d’airain, des tuniques de pourpre, des cnémides et des boucliers bien luisants.
[6] Cette fable d’un satyre, ou de Silène même, enivré et surpris par Midas, se trouve dans Pausanias et Maxime de Tyr.
Quand Cyrus a passé devant toute la ligne, il arrête son char devant le centre de la phalange, envoie Pigrès, son interprète, auprès des généraux grecs, et leur ordonne de porter les piques en avant et de faire avancer toute la colonne. Cet ordre est transmis aux soldats. Au signal de la trompette, les piques sont portées en avant et la colonne se met en marche ; puis le pas s’accélère avec des cris, et les soldats, par un mouvement spontané, se mettent à courir vers leurs tentes. Bon nombre de Barbares sont effrayés, notamment la reine de Cilicie, qui saute à bas de sa litière ; et les vivandières, laissant là leurs denrées, prennent la fuite, tandis que les Grecs rentrent en riant dans leurs tentes. La Cilicienne, voyant la belle tenue et la discipline de l’armée, est ravie, et Cyrus enchanté de l’effroi que les troupes grecques ont causé aux Barbares.
Il fait ensuite vingt parasanges en trois étapes, et arrive à Iconium, dernière ville de la Phrygie. Il y reste trois jours. De là, il traverse la Lycaonie, parcourant trente parasanges en cinq étapes. Il permet aux Grecs de piller cette contrée, comme étant pays ennemi. Il renvoie ensuite Épyaxa en Cilicie par le chemin le plus court, lui donnant pour escorte les troupes de Ménon de Thessalie, commandées par Ménon lui-même. Cyrus, avec le reste de ses forces, traverse la Cappadoce, fait vingt-cinq parasanges en quatre étapes, et arrive à Dana, ville peuplée, grande et riche. Il y séjourne trois jours.
Là, Cyrus fait mettre à mort un Perse, Mégapherne, porte-enseigne royal, et un autre officier subalterne, accusés par lui de haute trahison. On essaye ensuite de pénétrer en Cilicie. Le chemin qui y conduit, quoique accessible aux charrois, est roide, impraticable à une armée qui trouve la moindre résistance. On disait même que Syennésis était sur les hauteurs, pour défendre le passage. Cyrus reste donc un jour dans la plaine. Le lendemain, un messager vient lui dire que Syennésis a quitté les hauteurs à la nouvelle que le corps de Ménon était entré en Cilicie après avoir passé les montagnes, et sur le bruit que des trirèmes longeaient la côte d’Ionie pour se rendre en Cilicie, sous la conduite de Tamos, chef de la flotte unie des Lacédémoniens et de Cyrus. Cyrus donc monte sur les hauteurs sans obstacle, et s’empare des tentes sous lesquelles campaient les Ciliciens. De là, il descend dans une plaine, grande, belle, bien arrosée, pleine d’arbres de toute espèce et de vignes ; elle produit beaucoup de sésame, de méline, de millet, de froment et d’orge. Elle est fortifiée par une ceinture de montagnes élevées, qui s’étendent de la mer à la mer.
CHAPITRE III
Mutinerie des soldats de Cyrus. — Discours de Cléarque. — Cyrus augmente la paye.
Cyrus descend, traverse cette plaine, fait en quatre étapes vingt-cinq parasanges, et arrive à Tarse, ville de Cilicie, grande et riche. Là se trouvait le palais de Syennésis, roi des Ciliciens. Au travers de la ville coule un fleuve, nommé Cydnus, large de deux plèthres. Les habitants de la ville s’enfuient avec Syennésis, dans un lieu fortifié, sur les montagnes, excepté les hôteliers. Il reste aussi les gens de la côte, habitants de Soli et d’Issus. Épyaxa, femme de Syennésis, était arrivée à Tarse, cinq jours avant Cyrus. Dans le trajet des montagnes qui conduisent à la plaine, deux des loches de Ménon avaient péri. Les uns disaient que, s’étant mis à piller, ils furent taillés en pièces par les Ciliciens ; et d’autres que, restés en arrière et ne pouvant retrouver ni le corps d’armée, ni les routes, ils s’étaient égarés et avaient péri. Ces loches étaient de cent hoplites. Les autres, arrivés à Tarse, pillèrent la ville, furieux de la perte de leurs compagnons, et n’épargnèrent point le palais. Cyrus, à peine entré dans la ville, mande à lui Syennésis. Celui-ci répond qu’il ne s’est jamais remis entre les mains de plus fort que lui, et il ne consent à se rendre auprès de Cyrus que sur les instances de sa femme et après avoir reçu des sûretés. Après quoi, les deux princes étant entrés en conférence, Syennésis fournit à Cyrus de grandes sommes d’argent pour ses troupes, et Cyrus lui fait les présents d’honneur qu’offrent les rois de Perse : un cheval ayant un frein d’or, un collier, des bracelets de même métal, un cimeterre à poignée d’or et une robe perse. Il lui promet aussi que son pays ne sera plus pillé, et lui permet de reprendre, où qu’ils se rencontrent, les esclaves qu’on lui a enlevés.
Cyrus et son armée restent là vingt jours ; les soldats refusent d’aller plus loin. Ils commençaient, en effet, à soupçonner qu’on les menait contre le roi, et déclaraient qu’ils ne s’étaient point engagés pour cela. Cléarque, le premier, veut contraindre ses soldats à marcher en avant ; mais ils lui jettent des pierres, à lui et à ses équipages, au moment où il se met en marche. Cléarque courut alors grand risque d’être lapidé. Peu de temps après, voyant qu’il est impossible d’agir de force, il convoque ses troupes ; et d’abord, fondant en larmes, il demeure quelque temps silencieux ; tous le regardent étonnés et sans mot dire. Alors il leur parle en ces termes : « Soldats, ne soyez pas surpris que je sois peiné des circonstances présentes. Cyrus était mon hôte. Banni de ma patrie, j’ai trouvé chez lui un accueil honorable, et, de plus, il m’a donné dix mille dariques. Cette somme, je ne l’ai point gardée pour mon usage particulier, ni employée à mes plaisirs ; je l’ai dépensée pour vous. Et d’abord, j’ai fait la guerre aux Thraces, et avec vous j’ai vengé la Grèce, en les chassant de la Chersonèse, quand ils voulaient arracher cette contrée aux colons grecs. Cyrus m’ayant mandé, je vous prends avec moi, je pars, pour lui venir en aide au besoin, et reconnaître ses services. Puisque vous ne voulez plus me suivre, il faut : ou que, vous trahissant, je reste l’ami de Cyrus, ou que, mentant à Cyrus, je demeure avec vous. M’arrêté-je au parti le plus juste, je ne sais ; mais j’opte pour vous ; et avec vous, quoi qu’il advienne, je suis prêt à le subir. Non ; personne ne dira qu’ayant conduit des Grecs chez des Barbares, j’ai trahi les Grecs et leur ai préféré l’amitié des étrangers. Ainsi, puisque vous refusez de m’obéir et de me suivre, c’est moi qui vous suivrai, et, quoi qu’il arrive, je le supporterai ; car je vous considère comme ma patrie, mes amis, mes compagnons d’armes. Avec vous, je serai respecté partout où j’irai ; séparé de vous, je suis incapable, je le sens, ou d’aider un ami ou de repousser un ennemi. J’irai donc partout où vous irez, soyez-en convaincus. »
Ainsi parle Cléarque ; tous les soldats, les siens et les autres, lui entendant dire qu’il ne veut point marcher contre le roi, le couvrent d’applaudissements. Plus de deux mille de ceux de Xénias et de Pasion, prenant armes et bagages, passent dans le camp de Cléarque. Cyrus, inquiet et peiné de cet incident, fait mander Cléarque. Celui-ci refuse d’aller le trouver, mais, à l’insu des soldats, il envoie un messager lui dire de se rassurer et que tout finirait pour le mieux : il le prie, en même temps, de l’envoyer chercher une seconde fois, et il refuse encore d’y aller. Après quoi, il convoque ses soldats, ceux qui venaient de se joindre à lui et qui veut l’entendre, puis il leur dit : « Soldats, Cyrus en est évidemment avec nous au point où nous en sommes avec lui ; nous ne sommes plus ses soldats puisque nous ne le suivons pas, et il ne nous fournit plus de paye. Il se croit lésé par nous, je le sais ; aussi, lorsqu’il me mande, je ne veux point y aller ; surtout à cause de la honte que je sens au fond de ma conscience de l’avoir entièrement trompé. En second lieu, je crains qu’il ne me fasse arrêter et qu’il ne me punisse des torts qu’il croit avoir à me reprocher. Ce n’est donc pas le moment de nous endormir et de nous abandonner, mais de délibérer sur ce qu’il convient de faire en ces conjonctures. Si nous restons ici, il faut aviser, selon moi, aux moyens d’y demeurer en toute sûreté ; s’il nous plaît de partir, il faut voir à nous retirer en toute sûreté et à nous procurer des vivres : car, sans vivres, le général et le simple soldat ne sont bons à rien. Cyrus est un homme précieux quand on est son ami, et un rude ennemi quand on l’a pour adversaire. D’ailleurs il a de l’infanterie, une cavalerie, une flotte, que nous voyons, que nous connaissons tous, puisque nous sommes établis auprès de lui. Il est donc temps de dire ce que chacun croira le meilleur. » Cela dit, il se tut.
Sur ce point, plusieurs se levèrent, les uns spontanément, pour dire ce qu’ils pensaient ; les autres, stylés par Cléarque, pour démontrer quelle difficulté il y aurait à rester ou à s’en aller sans l’agrément de Cyrus. Un d’entre eux, feignant d’être fort pressé de se rendre en Grèce, dit que, si Cléarque refusait de les ramener, il fallait au plus tôt élire d’autres chefs, acheter des vivres, puisqu’il y avait un marché dans le camp des Barbares, et plier bagage ; qu’ensuite on irait demander des vaisseaux à Cyrus, ou, en cas de refus, un guide qui conduisît les Grecs par des pays amis. « S’il ne nous donne pas même de guide, mettons-nous aussitôt en ordre de bataille, envoyons un détachement qui s’empare des hauteurs, et ne nous laissons prévenir ni par Cyrus, ni par les Ciliciens, sur lesquels nous avons fait bon nombre de prisonniers, et dont nous avons pillé les effets. » Ainsi parla ce soldat ; Cléarque dit ce peu de mots : « Quant à me mettre à la tête d’une semblable expédition, qu’aucun de vous ne m’en parle : je vois maintes raisons de n’en rien faire ; mais l’homme que vous aurez choisi pour chef, je lui obéirai de tout cœur. Vous savez que je sais me soumettre aussi bien que personne. »
Alors un autre se lève, fait remarquer la simplicité de celui qui conseille de demander des vaisseaux à Cyrus, comme si celui-ci n’en avait pas besoin pour son retour, et fait observer combien il serait naïf de demander un guide à celui « dont nous ruinons, dit-il, l’entreprise. Si nous nous fions à un guide que nous aura donné Cyrus, qui nous empêche de prier Cyrus de s’emparer pour nous des hauteurs ? Pour ma part, j’hésiterais à monter sur les vaisseaux qu’il fournirait, de peur qu’il ne voulût nous couler avec ses trirèmes. Je craindrais de suivre le guide qu’il nous donnerait, de peur qu’il ne nous engageât dans quelque pas d’où il nous fût impossible de sortir. Je voudrais, si je pars contre le gré de Cyrus, m’en aller à son insu, ce qui n’est pas possible. Je dis donc que tout cela n’est que folies. Je suis d’avis qu’on envoie des hommes à Cyrus, des gens capables, avec Cléarque, pour lui demander ce qu’il veut faire de nous. S’il s’agit d’une expédition du genre de celle où il a déjà employé des troupes étrangères, suivons-le et ne nous montrons pas plus lâches que celles qui sont allées avec lui dans les hauts pays. Si c’est une entreprise plus considérable, plus pénible, plus périlleuse, il faut ou qu’il nous détermine à le suivre, ou que, convaincu par nous, il consente d’amitié à nous laisser partir. Par là, si nous le suivons, il trouvera en nous des amis, des gens de cœur ; si nous partons, notre retraite ne sera point inquiétée. Quoi qu’il réponde à cette proposition, qu’on le redise ici ; après l’avoir entendu, nous délibérerons. »
Cet avis prévalut. On choisit des hommes qu’on lui envoie avec Cléarque, et qui demandent à Cyrus ses projets d’expédition. Il répond qu’il a appris qu’Abrocomas, son ennemi, est à la distance de douze étapes aux bords de l’Euphrate ; qu’il veut donc les mener contre lui, et le punir s’il l’y rencontre ; mais s’il a fui, « nous délibérerons alors sur ce qu’il faudra faire. » Ces mots entendus, les envoyés les rapportent aux soldats : ceux-ci soupçonnent qu’on les conduit contre le roi : cependant ils se décident à suivre. Comme ils demandent une paye plus forte, Cyrus leur promet de leur donner à tous une moitié en sus, et de leur compter à chacun par mois trois demi-dariques au lieu d’une darique.
Marchait-il réellement contre le roi ? Personne jusque-là ne l’avait entendu dire nettement.
CHAPITRE IV
Arrivée à Issus ; jonction de la flotte. — Passage des Pyles ciliciennes. — Entrée en Syrie. — Départ de Xénias et de Pasion. — Discours de Cyrus. — Continuation de la marche. — Discours de Cyrus. — Arrivée sur les bords de l’Araxe.
De là Cyrus fait dix parasanges en deux étapes et arrive au fleuve Psarus, large de trois plèthres. Ensuite, après une marche de cinq parasanges, on arrive au bord du Pyramus, large d’un stade. De là, on fait quinze parasanges en deux étapes et l’on arrive à Issus, dernière ville de la Cilicie sur la mer, peuplée, grande et riche. On y séjourne trois jours, pendant lesquels se joignent à Cyrus, en arrivant du Péloponèse, trente-cinq vaisseaux commandés par Pythagore de Lacédémone. Tamos d’Égypte les conduisait depuis Éphèse, ayant avec lui vingt-cinq autres vaisseaux de Cyrus, avec lesquels il avait assiégé Milet, ville amie de Tissapherne, et servi Cyrus contre ce dernier. Chirisophe de Lacédémone se trouvait également sur ces vaisseaux, mandé par Cyrus et suivi de sept cents hoplites avec lesquels il servit dans l’armée. Les vaisseaux vinrent mouiller près de la tente de Cyrus. Là des mercenaires grecs quittent Abrocomas pour passer à Cyrus ; ils étaient quatre cents hoplites qui s’unissent à lui pour marcher contre le roi.
D’Issus il arrive en une étape de cinq parasanges aux Pyles de Cilicie et de Syrie[7]. Ce sont deux murailles : celle qui est située en deçà, en avant de la Cilicie, était gardée par Syennésis et un corps de Ciliciens ; celle qui est située au delà et du côté de la Syrie, était, dit-on, gardée par le roi en personne. Entre les deux coule un fleuve nommé Karsus, large d’un plèthre. L’espace entier qui est entre les deux murailles est de trois stades. Il n’est pas facile de le forcer. Le passage est étroit ; les murailles descendent jusqu’à la mer, et elles sont couronnées de rochers à pic. C’est dans chacune de ces murailles que s’ouvrent les Pyles. Pour se frayer un passage, Cyrus fait venir sa flotte, afin de débarquer les hoplites en deçà et au delà des Pyles, et de passer en dépit des ennemis qui pouvaient garder les Pyles syriennes. Cyrus s’attendait à la résistance d’Abrocomas, qui avait un corps nombreux ; mais Abrocomas n’en fit rien. Dès qu’il sut que Cyrus était en Cilicie, il se retira de la Phénicie, et marcha vers le roi avec une armée qu’on évaluait à trente myriades[8].
[7] Il y a deux défilés qui séparent la Cilicie de la Syrie ; le premier, plus éloigné de la mer, avait le nom de Pyles (portes) Amaniques ; le second s’appelait Pyles de la Cilicie.
[8] Trois cent mille hommes.
De là Cyrus fait une marche de cinq parasanges, et l’on arrive à Myriandre, ville habitée par les Phéniciens, près de la mer : c’est un lieu de commerce et de mouillage pour un grand nombre de vaisseaux. On s’y arrête sept jours, pendant lesquels Xénias d’Arcadie et Pasion de Mégare s’embarquent avec ce qu’ils avaient de plus précieux, et se retirent piqués, suivant l’opinion la plus commune, de ce que Cyrus laissait à Cléarque ceux de leurs soldats qui s’étaient joints à lui pour retourner en Grèce et ne point marcher contre le roi. Aussitôt qu’ils eurent disparu, le bruit courut que Cyrus les faisait poursuivre par des trirèmes : quelques-uns souhaitaient qu’on les arrêtât comme traîtres ; d’autres en avaient pitié, s’ils étaient pris.
Cyrus convoque les généraux et dit : « Xénias et Pasion nous ont abandonnés : mais qu’ils sachent qu’ils ne se sont point sauvés comme des esclaves fugitifs. Je sais où ils vont, et ils ne m’ont point échappé. J’ai des trirèmes et je puis prendre leur bâtiment ; mais, j’en atteste les dieux, je ne les poursuivrai point. Il ne sera pas dit que, quand un homme est avec moi, j’en use, et que, quand il veut s’en aller, je le prends, le maltraite et pille son avoir. Qu’ils s’en aillent donc, mais qu’ils n’ignorent pas qu’ils se conduisent plus mal envers nous que nous envers eux. Il y a mieux : j’ai en mon pouvoir leurs enfants et leurs femmes qu’on garde à Tralles ; mais je ne les en priverai point ; ils les recevront comme prix des bons services qu’ils m’ont jadis rendus. » Ainsi parla Cyrus ; et les Grecs qui n’avaient pas beaucoup de cœur pour l’expédition, en apprenant la belle action de Cyrus, le suivirent avec plus de plaisir et de cœur.
Cyrus fait ensuite vingt parasanges en quatre étapes, et arrive au fleuve Chalus, large d’un plèthre et rempli de grands poissons privés ; les Syriens les regardent comme des dieux et ne permettent point qu’on leur fasse du mal, non plus qu’aux colombes. Les villages où l’on dressa les tentes étaient à Parysatis : c’était un don pour sa ceinture[9]. De là, il fait trente parasanges en cinq étapes jusqu’aux sources du fleuve Dardès, large d’un plèthre. Là était le palais de Bélésis, gouverneur de la Syrie, avec un parc très-grand, très-beau, et produisant tout ce que donne chaque saison. Cyrus fait raser le parc et fait brûler le palais. Il fait ensuite quinze parasanges en trois étapes et arrive aux bords de l’Euphrate, large de quatre stades. En cet endroit est bâtie une ville grande et riche nommée Thapsaque. On y demeure cinq jours. Cyrus, ayant mandé les généraux grecs, leur dit qu’il marche contre le grand roi sur Babylone, et les prie de l’annoncer à leurs soldats, en les engageant à le suivre. Les généraux convoquent une assemblée et annoncent cette nouvelle. Les soldats s’emportent contre leurs chefs, et prétendent que, sachant depuis longtemps ce projet, ils l’ont tenu caché. Ils refusent de marcher en avant, si on ne leur donne pas autant qu’aux Grecs qui ont jadis accompagné Cyrus dans son voyage auprès de son père ; et cela, quand il ne s’agissait pas de se battre, mais d’escorter Cyrus que son père avait appelé. Les généraux font leur rapport à Cyrus : celui-ci promet de donner à chaque homme cinq mines d’argent à leur arrivée à Babylone, et de leur payer la solde entière jusqu’à ce qu’ils soient de retour en Ionie. Ces promesses gagnent presque tous les Grecs ; mais Ménon, avant qu’on fût certain de ce que feraient les autres soldats, s’ils suivraient Cyrus ou non, convoque séparément les siens et dit : « Soldats, si vous m’en croyez, sans péril, sans fatigue, vous vous ferez mieux venir de Cyrus que tous les autres soldats. Que vous ordonné-je de faire ? Cyrus prie les Grecs de le suivre contre le roi. Moi, je vous dis donc qu’il nous faut passer l’Euphrate, avant qu’on sache au juste ce que les autres Grecs répondront à Cyrus. S’ils se décident à le suivre, on vous regardera comme les instigateurs, étant passés les premiers ; Cyrus vous saura gré de votre zèle, il vous payera, et il sait payer mieux que personne : si les autres ne se décident point, nous reviendrons tous sur nos pas ; et vous, étant les seuls qui ayez obéi, il vous emploiera, comme des gens dévoués, à la tête des garnisons et des loches. De quoi que ce soit que vous le priez, j’en suis sûr, vous trouverez un ami dans Cyrus. »
[9] « Cicéron contre Verrès, liv. III, chap. XXXIII, dit que les rois des Perses et des Syriens sont dans l’usage d’avoir plusieurs femmes, et que des villes sont attribuées à ces princesses pour fournir, les unes, leur ceinture, redimiculum, d’autres leur voile, d’autres leurs colliers, d’autres les ornements de leur tête. Hérodote, Euterpe, chap. XCVIII, parle d’une ville d’Égypte donnée à perpétuité aux reines de ce pays pour leur chaussure. Il ajoute que cet ouvrage subsiste depuis la conquête de l’Égypte par les Perses. Athénée, liv. I, chap. XXV, cite la même ville comme donnée successivement par tous les souverains de ce pays, soit Perses, soit Égyptiens, aux reines d’Égypte. Plusieurs autres nous apprennent que Xerxès fit don à Thémistocle, lorsqu’il se réfugia en Asie, de trois villes dont l’une devait fournir le pain, une autre le vin et la troisième les mets de sa table. Mais le passage de Platon, Alcibiade Ier, p. 123, confirme encore plus positivement la conjecture de Muret et de Lengerman. Platon assure que l’on tenait d’un homme digne de foi, qui avait été à la cour de Perse, qu’il avait employé un jour presque entier à traverser un pays vaste et fertile, que les habitants appelaient la ceinture de la reine (c’est probablement celui dont parle ici Xénophon, car il se trouve sur la route d’un Grec allant à Babylone) ; qu’un autre territoire s’appelait le voile de la reine, et qu’enfin différents lieu, beaux et d’un grand revenu, portaient chacun le nom de divers ornements de cette princesse, auxquels ils étaient affectés. Tel était l’usage des Perses. » De La Luzerne.
Ces mots entendus, ils obéissent et traversent, avant la réponse des autres corps. Cyrus les voyant passés en est ravi, et leur fait dire par Glos : « J’avais déjà lieu, soldats, de me louer de vous ; mais vous aurez aussi à vous louer de moi, je l’ai à cœur, ou bien croyez que je ne suis plus Cyrus. » A ces mots, les soldats, remplis de grandes espérances, lui souhaitent un plein succès. Ménon même, dit-on, reçoit de lui de magnifiques présents. Cela fait, Cyrus traverse le fleuve, suivi de tout le reste de l’armée. Dans ce passage du fleuve, personne ne fut mouillé plus haut que la poitrine. Les habitants de Thapsaque disaient que jamais ce fleuve n’avait été guéable avant ce jour, sans bateau. Or, Abrocomas, qui avait précédé Cyrus, avait brûlé les bateaux pour empêcher le passage. On crut donc qu’il y avait là quelque chose de divin, et qu’évidemment le fleuve s’était retiré devant Cyrus, comme devant son futur roi.
On fait ensuite à travers la Syrie cinquante parasanges en neuf étapes, et l’on arrive sur les bords de l’Araxe. Il y avait en cet endroit de nombreux villages remplis de blé et de vin. On y demeure trois jours et l’on y fait des provisions.