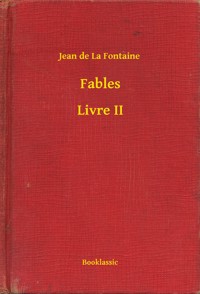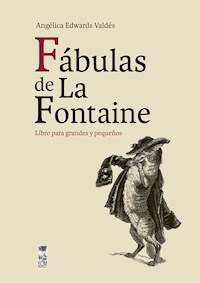3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Französisch
Le renard flatte le corbeau, qui tient un fromage dans son bec, si bien que celui-ci est obligé de lâcher son bien. Une grenouille veut gonfler pour ressembler au boeuf et finit par exploser. En effet, le mulet portant l'argent est fier, mais c'est sur lui que les voleurs vont attaquer et non sur le mut.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Fables Livres V à VIII
Fables Livres V à VIIILivre cinquièmeLivre sixièmeLivre septièmeLivre huitièmePage de copyrightFables Livres V à VIII
Jean de La Fontaine
Livre cinquième
La Bûcheron et Mercure
À M. le C.D.B.
Votre goût a servi de règle à mon ouvrage.
J’ai tenté les moyens d’acquérir son suffrage.
Vous voulez qu’on évite un soin trop curieux,
Et des vains ornements l’effort ambitieux ;
Je le veux comme vous : cet effort ne peut plaire.
Un auteur gâte tout quand il veut trop bien faire.
Non qu’il faille bannir certains traits délicats :
Vous les aimez, ces traits, et je ne les hais pas.
Quant au principal but qu’Ésope se propose,
J’y tombe au moins mal que je puis.
Enfin, si dans ces vers, je ne plais et n’instruis,
Il ne tient pas à moi ; c’est toujours quelque chose.
Comme la force est un point
Dont je ne me pique point,
Je tâche d’y tourner le vice en ridicule,
Ne pouvant l’attaquer avec des bras d’Hercule.
C’est là tout mon talent ; je ne sais s’il suffit.
Tantôt je peins en un récit
La sotte vanité jointe avecque l’envie,
Deux pivots sur qui roule aujourd’hui notre vie :
Tel est ce chétif animal
Qui voulut en grosseur au bœuf se rendre égal.
J’oppose quelquefois, par une double image,
Le vice à la vertu, la sottise au bon sens,
Les agneaux aux loups ravissants,
La mouche à la fourmi, faisant de cet ouvrage
Une ample comédie à cent actes divers,
Et dont la scène est l’Univers.
Hommes, dieux, animaux, tout y fait quelque rôle,
Jupiter comme un autre. Introduisons celui
Qui porte de sa part aux belles la parole :
Ce n’est pas de cela qu’il s’agit aujourd’hui.
Un bûcheron perdit son gagne-pain,
C’est sa cognée ; et la cherchant en vain,
Ce fut pitié là-dessus de l’entendre.
Il n’avait pas des outils à revendre :
Sur celui-ci roulait tout son avoir.
Ne sachant donc où mettre son espoir,
Sa face était de pleurs toute baignée :
« Ô ma cognée ! ô ma pauvre cognée !
S’écriait-il, Jupiter, rends-la-moi ;
Je tiendrai l’être encore un coup de toi. »
Sa plainte fut de l’Olympe entendue.
Mercure vient. « Elle n’est pas perdue,
Lui dit ce dieu, la connaîtrais-tu bien ?
Je crois l’avoir près d’ici rencontrée. »
Lors une d’or à l’homme étant montrée,
Il répondit : « Je n’y demande rien. »
Une d’argent succède à la première,
Il la refuse. Enfin une de bois :
« Voilà, dit-il, la mienne cette fois ;
Je suis content si j’ai cette dernière.
– Tu les auras, dit le Dieu, toutes trois.
Ta bonne foi sera récompensée.
– En ce cas-là je les prendrai », dit-il.
L’histoire en est aussitôt dispersée ;
Et boquillons de perdre leur outil,
Et de crier pour se le faire rendre.
Le roi des Dieux ne sait auquel entendre.
Son fils Mercure aux criards vient encore ;
À chacun d’eux il en montre une d’or.
Chacun eût cru passer pour une bête
De ne pas dire aussitôt : « La voilà ! »
Mercure, au lieu de donner celle-là,
Leur en décharge un grand coup sur la tête.
Ne point mentir, être content du sien,
C’est le plus sûr : cependant on s’occupe
À dire faux pour attraper du bien.
Que sert cela ? Jupiter n’est pas dupe.
Le Pot de terre et le Pot de fer
Le Pot de fer proposa
Au Pot de terre un voyage.
Celui-ci s’en excusa,
Disant qu’il ferait que sage
De garder le coin du feu :
Car il lui fallait si peu,
Si peu, que la moindre chose
De son débris serait cause :
Il n’en reviendrait morceau.
« Pour vous, dit-il, dont la peau
Est plus dure que la mienne,
Je ne vois rien qui vous tienne.
– Nous vous mettrons à couvert,
Repartit le Pot de fer :
Si quelque matière dure
Vous menace, d’aventure,
Entre deux je passerai,
Et du coup vous sauverai. »
Cette offre le persuade.
Pot de fer son camarade
Se met droit à ses côtés.
Mes gens s’en vont à trois pieds,
Clopin-clopant, comme ils peuvent,
L’un contre l’autre jetés
Au moindre hoquet qu’ils trouvent.
Le Pot de terre en souffre ; il n’eut pas fait cent pas
Que par son compagnon il fut mis en éclats,
Sans qu’il eût lieu de se plaindre.
Ne nous associons qu’avecque nos égaux ;
Ou bien il nous faudra craindre
Le destin d’un de ces pots.
Le petit Poisson et le Pêcheur
Petit poisson deviendra grand,
Pourvu que Dieu lui prête vie ;
Mais le lâcher en attendant,
Je tiens pour moi que c’est folie :
Car de le rattraper il n’est pas trop certain.
Un Carpeau qui n’était encore que fretin
Fut pris par un Pêcheur au bord d’une rivière.
« Tout fait nombre, dit l’homme en voyant son butin ;
Voilà commencement de chère et de festin :
Mettons-le en notre gibecière. »
Le pauvre Carpillon lui dit en sa manière :
« Que ferez-vous de moi ? je ne saurais fournir
Au plus qu’une demi-bouchée ;
Laissez-moi Carpe devenir :
Je serai par vous repêchée ;
Quelque gros partisan m’achètera bien cher :
Au lieu qu’il vous en faut chercher
Peut-être encore cent de ma taille
Pour faire un plat : quel plat ? croyez-moi, rien qui vaille.
– Rien qui vaille ? eh bien ! soit, repartit le Pêcheur :
Poisson, mon bel ami, qui faites le prêcheur,
Vous irez dans la poêle, et vous avez beau dire,
Dès ce soir on vous fera frire. »
Un Tiens vaut, ce dit-on, mieux que deux Tu l’auras :
L’un est sûr, l’autre ne l’est pas.
Les oreilles du Lièvre
Un animal cornu blessa de quelques coups
Le Lion, qui plein de courroux,
Pour ne plus tomber en la peine,
Bannit des lieux de son domaine
Toute bête portant des cornes à son front.
Chèvres, béliers, taureaux, aussitôt délogèrent ;
Daims et cerfs de climat changèrent :
Chacun à s’en aller fut prompt.
Un lièvre, apercevant l’ombre de ses oreilles,
Craignit que quelque inquisiteur
N’allât interpréter à cornes leur longueur,
Ne les soutînt en tout à des cornes pareilles.
« Adieu, voisin Grillon, dit-il ; je pars d’ici :
Mes oreilles enfin seraient cornes aussi,
Et quand je les aurais plus courtes qu’une autruche,
Je craindrais même encore. Le Grillon repartit :
« Cornes cela ? Vous me prenez pour cruche ;
Ce sont oreilles que Dieu fit.
– On les fera passer pour cornes,
Dit l’animal craintif, et cornes de licornes.
J’aurai beau protester ; mon dire et mes raisons
Iront aux Petites-Maisons. »
Le Renard ayant la queue coupée
Un vieux Renard, mais des plus fins,
Grand croqueur de poulets, grand preneur de lapins,
Sentant son renard d’une lieue,
Fut enfin au piège attrapé.
Par grand hasard en étant échappé,
Non pas franc, car pour gage il y laissa sa queue ;
S’étant, dis-je, sauvé, sans queue et tout honteux,
Pour avoir des pareils (comme il était habile),
Un jour que les Renards tenaient conseil entre eux :
« Que faisons-nous, dit-il, de ce poids inutile,
Et qui va balayant tous les sentiers fangeux ?
Que nous sert cette queue ? Il faut qu’on se la coupe :
Si l’on me croit, chacun s’y résoudra.
– Votre avis est fort bon, dit quelqu’un de la troupe :
Mais tournez-vous, de grâce, et l’on vous répondra. »
À ces mots il se fit une telle huée,
Que le pauvre écourté ne put être entendu.
Prétendre ôter la queue eût été temps perdu :
La mode en fut continuée.
La Vieille et les deux Servantes
Il était une Vieille ayant deux chambrières :
Elles filaient si bien que les sœurs filandières
Ne faisaient que brouiller au prix de celles-ci.
La Vieille n’avait point de plus pressant souci
Que de distribuer aux Servantes leur tâche.
Dès que Téthys chassait Phébus aux crins dorés,
Tourets entraient en jeu, fuseaux étaient tirés ;
Deçà, delà, vous en aurez ;
Point de cesse, point de relâche.
Dès que l’Aurore, dis-je, en son char remontait,
Un misérable Coq à point nommé chantait ;
Aussitôt notre Vieille, encore plus misérable,
S’affublait d’un jupon crasseux et détestable,
Allumait une lampe, et courait droit au lit
Où, de tout leur pouvoir, de tout leur appétit,
Dormaient les deux pauvres Servantes.
L’une entrouvrait un œil, l’autre étendait un bras ;
Et toutes deux, très mal contentes,
Disaient entre leurs dents : « Maudit Coq, tu mourras ! »
Comme elles l’avaient dit, la bête fut grippée :
Le réveille-matin eut la gorge coupée.
Ce meurtre n’amenda nullement leur marché :
Notre couple, au contraire, à peine était couché,
Que la Vieille, craignant de laisser passer l’heure,
Courait comme un lutin par toute sa demeure.
C’est ainsi que, le plus souvent,
Quand on pense sortir d’une mauvaise affaire,
On s’enfonce encore plus avant :
Témoin ce couple et son salaire,
La Vieille, au lieu du Coq, les fit tomber par là
De Charybde en Scylla.
Le Satyre et le Passant
Au fond d’un antre sauvage,
Un Satyre et ses enfants
Allaient manger leur potage
Et prendre l’écuelle aux dents.
On les eût vus sur la mousse
Lui, sa femme, et maint petit :
Ils n’avaient tapis ni housse,
Mais tous fort bon appétit.
Pour se sauver de la pluie,
Entre un Passant morfondu.
Au brouet on le convie :
Il n’était pas attendu.
Son hôte n’eut pas la peine
De le semondre deux fois.
D’abord avec son haleine
Il se réchauffe les doigts ;
Puis sur le mets qu’on lui donne,
Délicat, il souffle aussi.
Le Satyre s’en étonne :
« Notre hôte, à quoi bon ceci ?
– L’un refroidit mon potage ;
L’autre réchauffe ma main.
– Vous pouvez, dit le Sauvage,
Reprendre votre chemin.
Ne plaise aux Dieux que je couche
Avec vous sous même toit !
Arrière ceux dont la bouche
Souffle le chaud et le froid !
Le Cheval et le Loup
Un certain Loup, dans la saison
Que les tièdes zéphyrs ont l’herbe rajeunie,
Et que les animaux quittent tous la maison
Pour s’en aller chercher leur vie ;
Un Loup, dis-je, au sortir des rigueurs de l’hiver,
Aperçut un Cheval qu’on avait mis au vert.
Je laisse à penser quelle joie.
« Bonne chasse, dit-il, qui l’aurait à son croc.
Eh ! que n’es-tu mouton ? car tu me serais hoc ;
Au lieu qu’il faut ruser pour avoir cette proie.
Rusons donc. » Ainsi dit, il vient à pas comptés ;
Se dit écolier d’Hippocrate ;
Qu’il connaît les vertus et les propriétés
De tous les simples de ces prés ?
Qu’il sait guérir, sans qu’il se flatte.
Toutes sortes de maux. Si dom Coursier voulait
Ne point celer sa maladie,
Lui Loup, gratis, le guérirait ;
Car le voir en cette prairie
Paître ainsi, sans être lié,
Témoignait quelque mal, selon la médecine.
« J’ai, dit la bête chevaline,
Une apostume sous le pied.
– Mon fils, dit le docteur ; il n’est point de partie
Susceptible de tant de maux.
J’ai l’honneur de servir nos seigneurs les Chevaux,
Et fais aussi la Chirurgie. »
Mon galant ne songeait qu’à bien prendre son temps,
Afin de happer son malade.
L’autre, qui s’en doutait, lui lâche une ruade,
Qui vous lui met en marmelade
Les mandibules et les dents.
« C’est bien fait, dit le Loup en soi-même fort triste ;
Chacun à son métier doit toujours s’attacher.
Tu veux faire ici l’herboriste,
Et ne fus jamais que boucher. »
Le Laboureur et ses Enfants
Travaillez, prenez de la peine :
C’est le fonds qui manque le moins.
Un riche Laboureur, sentant sa mort prochaine,
Fit venir ses enfants, leur parla sans témoins.
« Gardez-vous, leur dit-il, de vendre l’héritage
Que nous ont laissé nos parents :
Un trésor est caché dedans.