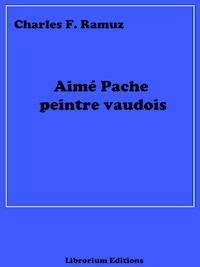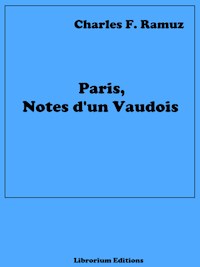Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editions Plaisir de Lire
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Le récit biographique passionnant d’un faux-monnayeur dans le Valais du XIXe siècle.
Joseph-Samuel Farinet a bel et bien existé. Né en 1845 et mort en 1880, ce faux-monnayeur est vite devenu un héros fabuleux. Ce n’est ni le héros de légende, ni le mythe folklorique valaisan, ni même le fait divers en soi, aux allures de roman policier, qui intéressent Charles-Ferdinand Ramuz. Farinet incarne cette liberté que veut célébrer le poète !
Au-dessus du village de Mièges en Valais, Maurice Farinet, fils de contrebandier, fabrique imperturbablement de la fausse monnaie avec de l’or qu’il recueille au sein de la plus haute montagne surplombant son village. Il écoule ses pièces d’or sans peine auprès des gens du pays, tous acquis à sa cause. N’est-ce pas de l’or pur officiellement attesté? Et cette monnaie n’est-elle pas plus fiable que celle du gouvernement? Arrêté à Aoste et condamné à six ans de réclusion, Farinet s’échappe de prison par deux fois et se réfugie toujours plus haut dans ses montagnes où il se croit invincible. Pourtant, malgré la solidarité villageoise, la proposition d’un compromis qui le fera renoncer à son or et l’amour entrevu dans le regard d’une jeune fille, le destin de cet esprit rebelle à toutes les lois humaines semble joué.
Postface de Philippe Renaud du centre de recherches sur les lettres romandes à Lausanne (CRLR).
L’histoire de Farinet, cet hymne à la liberté, est racontée par l'auteur dans une langue rude, simple, à la respiration haletante, reflétant bien le caractère et la vie des montagnards.
EXTRAIT
– Oui, a continué Fontana, parce que je dis, moi, que son or est meilleur que celui du gouvernement. Et je dis qu’il a le droit de faire de la fausse monnaie, si elle est plus vraie que la vraie. Est-ce que, ce qui fait la valeur des pièces, c’est les images qui sont dessus, ou quoi ? ces demoiselles, ces femmes nues ou pas nues, les couronnes, les écussons ? Ou bien les inscriptions peut-être ? Ou bien leurs chiffres, disait-il, les chiffres qu’y met le gouvernement ? Les inscriptions, on s’en fout, pas vrai ? et les chiffres aussi, on s’en fout. Ça ne serait pas la première fois que le gouvernement vous tromperait sur la valeur et sur le poids, tout aussi bien qu’un particulier. Demandez seulement à ceux qui s’y connaissent. Le gouvernement vous dit : «Cette pièce valait tant ; eh bien, maintenant elle vaudra tant...» Ça s’est vu, ça peut se revoir. C’est moins honnête que Farinet, les gouvernements, parce qu’à lui, ce qu’on lui paie, c’est en quoi ses pièces sont faites et, à eux, c’est ce qui est dessus...
À PROPOS DE L'AUTEUR
Charles-Ferdinand Ramuz est né à Lausanne le 24 septembre 1878. Il a fait des études de Lettres à l’université de Lausanne et y a obtenu sa licence en 1901. Il a exercé la profession de maître d’études au Collège d’Aubonne avant de comprendre rapidement qu’il n’était pas fait pour l’enseignement. Il s’est alors rendu à Paris et a étudié à la Sorbonne où il a préparé une thèse sur Maurice de Guérin. Il y a vécu entre 1904 et 1914 et y a écrit
Aline (1905),
Jean-Luc persécuté (1909) ou encore
Vie de Samuel Belet (1913) Il a aussi écrit des nouvelles, des chroniques et des poèmes (dont le recueil
Le Petit Village en 1903). Les thèmes spécifiques ramuziens, tels que la solitude de l’homme face à la nature ou la poésie des terres, des vignes et du lac y étaient déjà présents. À Paris il a fréquenté des artistes et écrivains suisses et français tels que Charles-Albert Cingria, André Gide ou encore le peintre René Auberjonois.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 255
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
I
Et le père Fontana a continué à dire des choses à voix basse aux deux hommes qui étaient avec lui dans le café Crittin à Mièges :
– Oui…
Il hochait lentement la tête.
C’étaient les nommés Ardèvaz et Charrat.
– Oui, a continué Fontana, parce que je dis, moi, que son or est meilleur que celui du gouvernement. Et je dis qu’il a le droit de faire de la fausse monnaie, si elle est plus vraie que la vraie. Est-ce que, ce qui fait la valeur des pièces, c’est les images qui sont dessus, ou quoi ? ces demoiselles, ces femmes nues ou pas nues, les couronnes, les écussons ? Ou bien les inscriptions peut-être ? Ou bien leurs chiffres, disait-il, les chiffres qu’y met le gouvernement ? Les inscriptions, on s’en fout, pas vrai ? et les chiffres aussi, on s’en fout. Ça ne serait pas la première fois que le gouvernement vous tromperait sur la valeur et sur le poids, tout aussi bien qu’un particulier. Demandez seulement à ceux qui s’y connaissent. Le gouvernement vous dit : « Cette pièce valait tant ; eh bien, maintenant elle vaudra tant… » Ça s’est vu, ça peut se revoir. C’est moins honnête que Farinet, les gouvernements, parce qu’à lui, ce qu’on lui paie, c’est en quoi ses pièces sont faites et, à eux, c’est ce qui est dessus…
Il s’était mis à parler de plus en plus fort sans s’en douter ; puis s’est tu brusquement, jetant un regard par-dessus son épaule gauche du côté de la porte.
Il avait eu peur sans doute qu’on ne fût entré sans qu’il y eût pris garde, pendant qu’il tenait son discours, mais il a vu que non, dans la fumée ; il est vrai qu’il n’était encore que cinq heures et que ce n’est pas l’heure où les clients abondent (à cause qu’ils sont plutôt dans leurs vignes, dans leurs champs ou dans leurs jardins) ; si bien que la salle à boire restait vide, avec ses deux rangées de tables qui allaient jusqu’à la fenêtre dans une espèce de brouillard où on ne les distinguait qu’assez mal ; – et, rassuré, Fontana tira sur sa pipe par deux fois en creusant les joues.
Il a pris son verre, puis a trinqué.
Les deux autres n’avaient rien dit. Ils tiraient aussi sur leurs pipes à couvercle de laiton ; de temps en temps ils hochaient la tête.
Ils avaient les coudes sur la table ; ils se taisaient. Sans doute qu’ils attendaient la suite du discours de Fontana, lequel en effet n’était pas fini, c’est bien ce que Fontana a vu ; alors il a regardé prudemment encore une fois par-dessus son épaule, ayant en face de lui le mur, et à sa droite également le mur ; puis, baissant la voix tout de même par un surcroît de précautions (et bien qu’il sût que le patron était un homme sûr et dévoué à Farinet, si par hasard le patron, lui, pouvait entendre) :
– Et si vous dites que Farinet, c’est du jeunet, moi je veux bien, mais de qui est-ce qu’il tient son secret, qui est-ce qui lui a montré les cachettes ? Le père Sage avait des papiers et même il me les a montrés, et je les ai vus. Ça venait de Paris, oui de Paris, et de Genève. Des certificats, ça s’appelle. Il avait envoyé là-bas de sa poudre pour l’expertiser ; eh bien, ce qu’il y avait sur ses papiers, c’est que…
Il s’arrête ; puis il prononce les trois mots bien séparément :
– Ça… en… était.
Il s’arrête.
– C’était sur ces papiers, et c’est des messieurs, vous comprenez, c’est du monde qui s’y entend quand même mieux que nous, c’est des gens du métier, des savants, des auteurs de livres, des philosophes.
Ils ont dit : « C’est pur or, et rien que pur or. » Ils l’ont écrit. C’est sur ces certificats. Et, vous comprenez, ces certificats, c’est Farinet qui les a maintenant… La seule différence, c’est que Sage gardait son or en poudre et que, lui, en a fait des pièces, mais ça le regarde. Si elles ne sont pas toujours bien faites, c’est qu’il n’a pas tous les outils qu’il faudrait. Mais la matière y est. Et je vous dis que c’est une chose qu’il fait bon avoir sous sa paillasse ou sous une pierre dans son jardin pour l’occasion. Une chose qui ne vieillit pas, qui ne pourrit, ni ne se gâte, qui ne change pas de couleur, qui ne change pas de poids, une chose fixe, quoi, quand toutes les autres ne sont pas fixes ; une chose pas seulement d’aujourd’hui, ni d’hier ou de demain, mais de toujours, vieille comme le monde et qui durera autant que le monde… Et alors on aurait de l’or dans la commune et on le laisserait où il est, sans l’utiliser !
Est-ce raisonnable ?… D’abord, moi, j’en ai ; je ne le cache pas. J’en ai pour cent francs. Et toi, Ardèvaz ?
Ardèvaz a fait signe de la tête qu’il en avait.
– Tu vois bien. Et toi, Charrat ?
Charrat a souri.
– Oh ! tout le monde en a ; c’est une chose en règle.
– Alors, est-ce juste qu’il soit en prison et qu’on l’y laisse ? a dit Fontana. C’est les voleurs qu’on met en prison. Lui, c’est le contraire d’un voleur. Demande seulement au patron…
Il appelle :
– Hé ! patron !
Il disait :
– On va lui demander s’il n’en a pas, lui aussi, et pour combien ? Car c’est lui qui en a le plus. Depuis le temps que Farinet lui paie ses consommations avec ses pièces… Crittin en a pour au moins mille francs… On va lui demander. On est ici entre amis, rien qu’entre amis et gens de confiance… Hé, patron ! Pourquoi est-ce qu’il ne vient pas ?
On s’étonnait, en effet, que Crittin ne fût pas encore venu, comme il faisait d’ordinaire, boire un verre avec nous ; et Ardèvaz se lève.
Ardèvaz ouvre la porte qui donnait sur le corridor.
Mais, à ce même moment, la porte qui donnait sur la rue, à l’autre bout du corridor, s’était ouverte ; et une femme était entrée, plus très jeune autant qu’on en pouvait juger, un chapeau sur la tête, une valise à la main, tout habillée de noir, mais blanche de poussière jusqu’aux genoux ; qui, voyant Ardèvaz, s’arrête…
Ce jour-là, à Mièges, dans le pied des rochers, un peu au-dessus de la plaine du Rhône, derrière les murs de Mièges qui brillaient au soleil, – dans ce corridor, une femme qui entre, et voit Ardèvaz, mais voilà que Crittin en même temps était sorti de sa cuisine.
– Ah ! c’est vous… Je vous attendais…
Pendant qu’il s’était approché d’elle, puis, apercevant Ardèvaz :
– Ne t’en va pas… C’est Joséphine… Tu ne te rappelles pas ?… Elle a été en service ici, il y a deux ans.
Il disait à Joséphine :
– Entrez un moment dans la salle à boire… Il y a des clients que vous connaissez bien…
Et, l’ayant fait entrer :
– Eh bien, Fontana, vous vous remettez ? Et toi, Charrat, tu te remets ?… Joséphine…
– Ah ! dit Fontana, bien sûr.
Et, lui tendant la main :
– Comment ça va ?… Alors on vient de loin, comme ça… Ah ! de Sion… Ah ! a-t-il dit. Et comment ça va-t-il, à Sion ?…
Elle a dit :
– Ça va bien.
C’est même la seule chose qu’elle ait dite, parce qu’alors Crittin lui avait demandé si elle ne voulait pas monter dans sa chambre.
Il l’a accompagnée jusque dans sa chambre, puis est revenu dans la salle à boire ; et, là, il disait drôlement :
– Oui, je l’ai reprise… Parce que je crois qu’il va se passer quelque chose. Et bientôt, dit-il, mais n’en parlez pas…
Et Fontana :
– C’est Farinet… Justement on parlait de lui…
Mais Crittin a cligné de l’œil.
II
Or, cette même nuit, en effet, peu après que l’horloge de la cathédrale eut sonné ses douze coups, Farinet n’avait point fait de bruit, mais il avait quitté le cadre en bois de chêne scellé au mur où il couchait sur une paillasse.
Le gardien-chef, qui avait fait sa tournée, un moment avant, ayant rabattu le guichet grillagé qui ouvrait à l’extérieur dans la porte doublée de fer, l’avait encore vu étendu bien sagement sous sa couverture ; il avait été dormir, lui aussi.
C’était peu après les douze coups de minuit ; – Farinet s’était mis assis sur sa paillasse.
Il n’avait pas bougé d’un long moment. Il a été prudent et calculateur (comme il l’était en toute chose). Longtemps, il était resté immobile, ayant à s’assurer d’abord que tout était tranquille dans le bâtiment des galères (qui est le nom qu’on donne dans le pays à la prison).
Il n’avait rien entendu. Il n’avait eu qu’à écarter ses couvertures.
Peu après minuit, il se lève ; il va pieds nus à la meurtrière qui était percée dans le mur ; il se hisse jusqu’à elle à la force des bras, ayant empoigné un des barreaux ; puis, arc-bouté dans l’épaisseur de la pierre, comme un ramoneur dans sa cheminée, il s’était remis à son travail.
On n’a jamais bien su comment il s’était procuré cette lime à métaux, mais il était facile de voir qu’il s’en était déjà servi, les barreaux étant sciés aux trois quarts. Et sa lime s’était remise à tousser ou faisait un bruit de respiration comme quand quelqu’un a de l’asthme ; de temps en temps elle s’arrêtait, mais tout continuait à être tranquille dans les galères, alors la lime repartait.
C’est ainsi que le premier barreau avait été bientôt complètement scié, puis le second. Ils étaient pourtant robustes tous deux, parce que forgés au marteau sur l’enclume dans le vieux temps (quand on savait encore ce que c’était que forger) : n’empêche qu’ils étaient maintenant coupés à leur sommet et à ras de la pierre, l’un et l’autre ; car Farinet avait décidé de leur laisser le plus de longueur possible, de manière à avoir du jeu pour les ployer. Il est resté encore un instant sans plus faire aucun mouvement, ayant dû d’abord laisser taire le bruit de son cœur. Il buvait sa sueur salée avec la langue au coin de ses lèvres ; et, coulant le long de sa nuque, elle lui collait sa chemise sur la peau. Il était maintenant coupé par la lumière de la lune, à la hauteur de la ceinture ; c’était le bas de sa personne qui était éclairé par elle ; le bas de sa personne était comme de la glace, tandis que ses mains et sa tête étaient comme du feu. Ça ne fait rien, on va leur montrer qui on est ! Il a attendu tant qu’il fallu avec patience, guettant d’une oreille les bruits qui auraient pu se faire entendre à l’intérieur de la prison, de l’autre oreille ceux du dehors ou qui auraient pu s’y produire ; mais c’était seulement un cheval qui toussait là-bas, de l’autre côté du mur de la cour ; puis l’horloge de la cathédrale qui avait sonné une heure du matin. Il se suspend à l’un des barreaux des deux mains ; il se laisse retomber...
Ah ! ils ont cru m’avoir ! La barre cédait sous son poids ; ah ! ils ont cru qu’ils allaient me garder encore six mois dans leurs galères, ils ne savaient pas qui je suis. Le roi d’Italie non plus, Humbert Ier, ne le savait pas : il l’a su. Déjà Farinet passait au second barreau, ne sentant même point que le sang lui coulait le long du bras jusqu’à l’aisselle ; le second barreau venait de céder également. L’un et l’autre faisaient maintenant une sorte de crochet à la courbure inclinée vers le sol, laissant tout juste au-dessus d’eux la place qu’il fallait pour passer ; une place réduite, il est vrai, et même réduite à l’extrême, où on ne pouvait engager le corps que dans le sens de la longueur, mais ça le connaissait un peu ! On n’a pas couru la montagne depuis tout petit sans avoir appris comment faire, puis la liberté l’attendait là tout près et entrait jusqu’à lui avec la lumière de la lune, lui disant : « Tu y es presque, Farinet, encore un petit effort, c’est ça... » Elle lui disait : « A présent, tu n’as plus qu’à nouer la corde... C’est ça... Tu fais deux nœuds. N’aie pas peur. »
Il n’avait pas peur. Car c’était vrai qu’on l’aimait bien et les choses aussi l’aimaient bien. Il n’avait pas eu besoin, comme tant de prisonniers dont on lit l’histoire dans les livres, de découper en bandes la toile de sa paillasse ; il avait une corde, une vraie, une corde faite de bon chanvre, qui était juste de la longueur qu’il fallait, c’est-à-dire huit mètres environ. On l’aimait bien, on s’occupait de lui. Et il voyait que même les choses avaient de l’affection pour lui, parce que, ayant donc fixé la corde par un double nœud à l’un des barreaux, c’est juste à ce moment qu’un nuage avait passé devant la lune. Les galères sont dans le haut de la ville où elles dressent leurs grands murs nus ; et ainsi sa personne aurait pu être facilement aperçue, se démenant en sombre sur la façade claire, s’il y avait eu de la lune, mais il n’y en a point eu. Elle avait dit : « Je ne veux pas te gêner », en même temps elle se retirait derrière un gros nuage noir. Il s’est laissé descendre le long du mur dans une nuit profonde sans pouvoir être distingué d’elle. Il n’a eu qu’à se confier à la corde jusqu’à son extrémité pour toucher terre. Il ne pensait plus à rien, tout s’est passé avec une grande rapidité. Les mouvements qu’il faisait, c’est comme si quelqu’un les faisait pour lui ; ils se succédaient si rapidement qu’il n’avait même plus le temps de s’en rendre compte. Arrivé ensuite au bas de la corde, ses pas ont été parfaitement silencieux. Il a été comme dans le fond d’un puits, et c’était le chemin de ronde, pas large : quatre ou cinq pas à faire tout au plus ; il les a faits en silence, dans la plus grande obscurité. La lune, au-dessus de tous les clochers de Sion et de l’Evêché, disait : « Je me cache » ; lui, se porte avec ses pieds silencieux dans le pied du mur d’enceinte, qui est haut de cinq ou six mètres, mais ça le connaît. C’est tout à fait comme quand on allait chercher l’or, comme quand on allait chasser le chamois et on arrivait dans le bout d’une vire ; – alors pas moyen de s’en retourner, pas moyen de continuer, pas moyen non plus de descendre : sur ces corniches larges comme les deux mains où on s’engage, puis elles viennent à rien tout à coup dans le vide avec des vaches pas plus grosses que des bêtes à bon Dieu qu’on a entre les jambes, à quatre cents mètres plus bas. Ici (il riait en lui-même), ah ! ils croient m’arrêter peut-être avec leur pauvre maçonnerie, quand le Grand Maçon lui-même n’y a rien pu. Et allez demander également au roi d’Italie, le roi Humbert Ier, vous savez bien, quand il voulait me garder chez lui. Il avait des murs, lui aussi, à quoi est-ce que ça lui a servi ? Avec le bout des doigts de ses mains, il a trouvé au-dessus de sa tête une fissure ; avec le bout de ses doigts de pied il a trouvé une autre fissure dans le mur du gouvernement. Il se colle à la pierre le plus étroitement qu’il peut, le bras levé. L’autre bras alors va chercher plus haut, se fixe à son tour, est rejoint par le premier ; et il tire sur eux, en s’aidant du genou. Ainsi il est arrivé sur le faîte du mur pendant que Sion dormait ; il a jeté par-dessus le mur le bras gauche, il s’y est couché à plat ventre. Ça y est ! Le roi d’Italie... Deux ou trois mots, toujours les mêmes, lui chantaient dans la tête, pendant qu’un fleuve chaud allait de ses tempes à ses oreilles où il faisait une grande rumeur, mais agréable, maintenant ; c’était comme si on criait bravo. Le roi d’Italie... le roi d’Italie...
De nouveau, le cheval avait toussé.
L’horloge ensuite sonne de nouveau un coup.
C’était cette fois sur la cloche claire, parce que la plus sourde sert à sonner les coups de l’heure et la claire ceux de la demie : alors Farinet s’était rappelé que son ouvrage n’était pas encore tout à fait fini.
Il était monté à travers les vignes, puis il s’était laissé tomber dans l’herbe sous un pommier.
Il respirait l’air de la liberté avec toute sa poitrine. Il tend la main, il sent sous sa main et à travers l’étoffe de son pantalon l’herbe mouillée ; levant alors la tête, il a réaperçu les étoiles, pouvant voir maintenant le ciel dans toute son étendue, et c’est bon et c’est beau.
Il avait d’abord marché très vite et plutôt couru que marché, grimpant à la côte pierreuse, entre les souches couvertes de pousses qu’on venait d’arracher, ou dans le fond des fossés qu’on creuse pour les provignages, lesquels lui avaient fourni ainsi d’abord d’heureux couverts ; il n’avait pas eu le temps de penser à rien dans son pantalon de forçat, étant seulement préoccupé que ce pantalon ne fût pas vu et économisant son souffle ; mais, à présent, une branche de pommier est au-dessus de lui et il y en a une autre qui pend devant lui et le cache.
Il regarde. Il voyait que la pente raide commençait juste sous sa personne, tombant là brusquement avec ses vignes culbutées ; alors il y avait dans le bas le large fond plat de la vallée, où un peu plus loin est le Rhône, tandis que tout Sion était entre le Rhône et lui.
L’ensemble se présentait peu à peu, à mesure que ses yeux s’y habituaient, dans l’absence de toute lumière (ce qui le rassurait aussi), comme taillé à coups de ciseau dans de la pierre noire, y compris les hauteurs de Valère et de Tourbillon, mais moins hautes qu’il n’était lui-même. L’église, qui est au sommet de celle-là, et le château, qui est au sommet de celle-ci, étaient tous deux au-dessous de lui, tellement il était déjà monté. A présent il commençait à rire, et, s’étant assis, admirait comment toute une ville, avec un évêque, un gouvernement, un château, deux châteaux, des tours, sept ou huit églises, un tribunal, des juges, un jugement rendu, des gendarmes et des geôliers, n’avaient pas pu le retenir, toutes ces choses et ces personnes mises ensemble, tandis que lui était tout seul contre elles toutes. Il était seul, eux quatre ou cinq mille. Mais c’est que leur justice ne vaut rien, leur justice est de l’injustice. Eux, vivent petit là-dessous, ils vivent étroit, ils vivent faux (pendant qu’il regardait toujours de haut en bas), ils vivent couchés dans des lits, pendant qu’il sentait sous sa main l’herbe devenir toute mouillée, et elle était pleine de fleurs qui recommençaient à sentir bon. Adieu ! alors, vous autres, vous d’en bas. Chacun sa vie. Ils sont morts pour deux heures encore et j’ai tout le temps pendant qu’ils sont morts. Ils ont voulu m’empêcher de vivre parce que j’ai ma vie, à moi...
Hardi ! crie-t-il dans son cœur, hardi ! et à bientôt la suite ; – mais pour l’instant repos, parce que tout va bien, mais c’est qu’on a bien calculé.
Il tâte son corps dans l’herbe haute : touche ses pieds nus, ses genoux, le gros pantalon d’uniforme à rayures, la toile de chanvre pleine d’écorces de sa chemise d’uniforme, – mais dessous il y a moi et c’est moi qu’il y a dessous.
Il se laisse aller en arrière. Il se laisse aller en arrière de tout son corps contre la bonne terre, il la touche de partout. Il s’applique à elle avec tout lui-même, le derrière du crâne, l’os de la nuque, les deux épaules, les cuisses, le mollet, le talon.
Il voit que rien n’a encore bougé dans les galères.
Il voit aussi que les étoiles commencent à pâlir entre les branches du pommier, et plus en avant dans le ciel dont la courbure commence à se défaire ; et, dessous, il y a les montagnes dont le nombre croît, au contraire, à mesure que la nuit s’en va.
Il s’est assis. Il cherche à les compter. Elles percent partout comme des dents dans la gencive, avec leurs pointes qui sont blanches, toujours plus blanches, toujours plus nombreuses, les unes devant les autres en demi-cercle ; – en voilà une, en voilà une autre, ça en fait vingt, trente, cent, cinq cents, combien ? et la tête lui tourne, mais il rit: « C’est à moi, c’est à moi de nouveau... » Il regarde les choses de la terre qui renaissent à la bonne vie, ici, là-bas, plus loin, à droite et à gauche, partout: les brins d’herbe qu’on voit à peu près, les toits qui se séparent les uns des autres ; un clocher, trois, quatre, cinq, le Rhône, la route dans la plaine : c’est à moi. Et puis toutes les montagnes au-dessus de lui, tandis que les étoiles une à une s’éteignent. Alors le coq chante, pendant que dans le haut de la vallée, au-dessus des montagnes blanches, une sorte de brume pâle montait dans le ciel.
Il s’était mis debout.
Il allait vite. Il ne sentait pas les pierres, il ne sentait pas le piquant des chaumes, ni les épines des buissons. Il pensait seulement: « Attention », parce qu’il regardait aussi les trous par où sortaient ses genoux, il regardait son pantalon et sa couleur, car il avait maintenant une couleur, et on voyait qu’il était jaune avec une large bande noire. Mais les villages sont rares sur ces pentes trop raides, dans ce pays à la terre pauvre et trop penché que des torrents, qui tombent du haut de la chaîne, coupent encore de leurs gorges. Il en connaissait tous les sentiers, toutes les cachettes ; il en connaissait une à une toutes les maisons, un à un tous les fenils ; tous les espaces bâtis et pas bâtis, cultivés et, pas cultivés. D’ailleurs, il n’était plus très loin déjà d’être arrivé.
Un dernier ravin se présente ; il a seulement évité de s’engager sur le chemin qui le franchissait au moyen d’un pont. Il a pris un peu plus en amont, ayant grimpé à un talus qu’une haie bordait dans le haut ; – il s’est avancé jusque derrière la haie.
A cent mètres devant lui, il y avait une maison.
Le soleil venait d’en frapper le toit dont les plaques d’ardoise s’étaient mises à briller.
En même temps, une petite fumée bleue est sortie par l’ouverture de la large cheminée à couvercle levé, montant dans le doré de l’air joyeusement, pendant qu’un chien courant était attaché devant la porte à une chaîne beaucoup trop grosse pour lui.
De derrière la haie, Farinet siffle à trois reprises entre ses doigts. Il siffle d’une certaine façon à trois reprises derrière sa haie et l’homme, qui s’était montré dans l’encadrement de la porte, pose tout à coup par terre son seau de bois, tournant la tête dans la direction d’où les coups de sifflet étaient venus, puis s’avance dans cette direction, ayant fait taire le chien qui pleurait pour le suivre.
III
Quelques mois auparavant, les journaux du pays avaient été pleins de lui et de son histoire (il n’y en avait, d’ailleurs, que deux ou trois et ils ne paraissaient qu’une fois par semaine).
C’était à l’occasion de sa mise en jugement pour fabrication de fausse monnaie.
On avait donné dans les journaux la date de sa naissance ; il avait vingt-huit ans. Il était né à Bourg-Saint-Pierre, qui est un village situé dans le fond d’une des vallées qui viennent se brancher sur celle du Rhône à main gauche, s’enfonçant ensuite profondément dans la montagne vers le midi. Il était l’aîné de deux garçons et de deux filles. On racontait dans les journaux que tout petit encore (il n’avait pas plus de quatorze ans) son père le prenait avec lui pour aller courir la montagne, étant connu au loin comme contrebandier (on n’est pas à plus d’une lieue de la frontière), – et il chargeait le petit Maurice d’un sac, lui-même ayant sur le dos une hotte pleine de tabac. Ainsi, à ce qu’on racontait, Maurice Farinet avait été dressé à narguer de bonne heure les lois et le gouvernement ; à seize ans, disait-on, il avait déjà son fusil à lui. Et il s’en servait, et sans permis. Car Farinet le père ne faisait pas que de la contrebande. Il disait: « De quel droit le gouvernement nous obligerait-il à payer pour tuer des bêtes qui sont sur le territoire de la commune et par conséquent à nous ? » Il lui arrivait souvent de boire un peu trop, au retour de ses expéditions, dans l’un ou l’autre des cafés qui se trouvaient sur son passage ; là, assis devant un litre de fendant et plein de la force qui est dans le vin : « De quel droit ? C’est pourquoi je n’ai jamais rien payé, moi... » Il disait à son fils : « Toi non plus, tu ne paieras rien. Jamais. Jure-le. » Et Maurice le jurait volontiers, parce qu’il était de l’avis de son père.
Seulement voilà que, deux ou trois ans plus tard, on avait trouvé le père Farinet du côté de la Tour Penchée, au pied d’une paroi de rochers. Il était couvert de sang, la tête et le corps fracassés, ayant fait une chute de plus de cent mètres. On n’a jamais pu savoir si on lui avait tiré dessus (car il avait des ennemis), ou bien s’il n’avait pas simplement glissé dans les pierres, bien qu’il eût bon œil et bon pied et qu’il connût comme personne dans leurs moindres recoins toutes les montagnes du pays. Il était parti seul, cette fois-là, et ils ont dit depuis (des hommes qui travaillaient un peu plus bas dans la forêt) qu’ils avaient entendu plusieurs coups de feu au cours de la journée, mais peut-être bien était-ce le père Farinet qui les avait tirés lui-même. On n’a jamais su. Il n’en laissait pas moins une femme et cinq enfants.
En sorte qu’il avait fallu que Maurice, qui était l’aîné, allât gagner sa vie.
Il se louait pour la saison. Il allait faire des coupes de bois, l’hiver, dans la forêt ; ou bien, l’automne, la vendange à la plaine. A cette occasion, en effet, beaucoup d’hommes de la montagne descendent pour un mois ou deux et sont brantards ou pressureurs, ce qui leur fait un peu d’argent. C’est ainsi que, vers sa vingtième année, Maurice avait été engagé par un nommé Romailler qui était un des quatre municipaux de Mièges.
C’est ce qu’on disait dans les journaux, entre autres choses ; ce qu’on ne disait pas dans les journaux, c’étaient les raisons que Farinet avait eues de ne pas remonter chez lui, une fois les vendanges faites (et il n’y était jamais remonté). Son père n’avait point laissé d’argent et peu de bien, de quoi devaient vivre sa mère et quatre enfants, outre lui-même ; et là-haut c’était ou bien le travail ou tantôt l’argent qui manquait. Ses frères étaient devenus grands, on n’avait plus besoin de lui. Et il s’était trouvé qu’il avait fait à Mièges la connaissance d’un vieil homme, nommé Sage, qui s’occupait d’aller cueillir dans la montagne toute espèce d’herbes et de plantes qu’il vendait aux pharmaciens. Le vieux Sage avait plus de soixante-dix ans ; il avait besoin d’un aide.
Le père Sage habitait une petite maison construite sur l’emplacement des anciens remparts, à quelque distance du village ; il y vivait seul depuis longtemps, parce qu’il passait pour un peu sourcier, et aussi sorcier, et qu’outre ses plantes, il cherchait de l’or. On assurait même qu’il en avait trouvé. Il y avait, paraît-il, dans le sommet de la chaîne qui domine Mièges du côté du nord, à plus de deux mille cinq cents mètres, une veine que le vieux Sage avait découverte ; et il avait fini par la montrer à Farinet. Le temps avait passé ; le vieux Sage n’ayant ni enfant, ni famille s’était dit: « Il me servira de fils. Je lui léguerai ma maison et puis où je trouve ma poudre. » Et Farinet, lui aussi, s’était mis à récolter de la poudre ; seulement, tandis que le vieux Sage se contentait de collectionner son or, ce qui faisait beaucoup de petits cailloux jaunes et de paillettes qu’il enfermait tels quels dans une cassette, Farinet, lui, plus inventif, avait eu l’idée de confectionner des moules de plâtre et d’acheter un chalumeau. Et, à la mort du vieux, il avait commencé à faire circuler ses pièces. Il y avait tout près de là, dans la gorge de la Salenche, une belle grotte bien sèche, laquelle communiquait avec la cave de la maison ; c’est là qu’il avait installé son atelier pour être à l’abri de toute surprise. Il était bien vu des gens, parce qu’on croyait à son or et parce qu’il était généreux.
Le malheur avait été seulement qu’une fois il avait passé la frontière, ayant beaucoup de pièces à écouler ; le malheur avait été qu’il avait cru qu’il lui serait plus facile, car il en avait pour une assez grosse somme, d’aller changer ses pièces à Aoste, qui est sur territoire italien, de l’autre côté du Grand-Saint-Bernard.
C’était à Aoste qu’il s’était fait prendre.
La gendarmerie n’avait pas eu de ménagements pour lui, la justice moins encore. Il avait été condamné à six ans de maison de force : dont il avait fait plus de deux avant de réussir à s’évader.