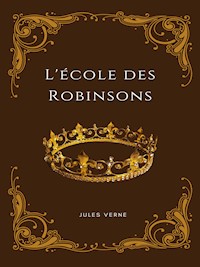
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Le jeune Godfrey mène une vie de privilégié chez son oncle William W. Kolderup, l'homme d'affaires le plus riche de San Francisco. Bien qu'il aime la belle Phina, il s'entête à vouloir parcourir le monde sans elle avant de l'épouser.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 269
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
L'école des Robinsons
L'école des RobinsonsIIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIXIIIXIVXVXVIXVIIXVIIIXIXXXXXIXXIIPage de copyrightL'école des Robinsons
Jules Verne
I
Où le lecteur trouvera, s’il le veut, l’occasion d’acheter une île de l’océan Pacifique
« Île à vendre, au comptant, frais en sus, au plus offrant et dernier enchérisseur ! » redisait coup sur coup, sans reprendre haleine, Dean Felporg, commissaire priseur de l’« auction », où se débattaient les conditions de cette vente singulière.
« Île à vendre ! île à vendre ! » répétait d’une voix plus éclatante encore le crieur Gingrass, qui allait et venait au milieu d’une foule véritablement très excitée.
Foule, en effet, qui se pressait dans la vaste salle de l’hôtel des ventes, au numéro 10 de la rue Sacramento. Il y avait là, non seulement un certain nombre d’Américains des États de Californie, de l’Oregon, de l’Utah, mais aussi quelques-uns de ces Français qui forment un bon sixième de la population, des Mexicains enveloppés de leur sarape, des Chinois avec leur tunique à larges manches, leurs souliers pointus, leur bonnet en cône, des Canaques de l’Océanie, même quelques Pieds-Noirs, Gros-Ventres ou Têtes-Plates, accourus des bords de la rivière Trinité.
Hâtons-nous d’ajouter que la scène se passait dans la capitale de l’État californien, à San Francisco, mais non à cette époque où l’exploitation des nouveaux placers attirait les chercheurs d’or des deux mondes, – de 1849 à 1852. San Francisco n’était plus ce qu’elle avait été au début, un caravansérail, un débarcadère, une auberge, où couchaient pour une nuit les affairés qui se hâtaient vers les terrains aurifères du versant occidental de la Sierra Nevada. Non, depuis quelque vingt ans, l’ancienne et inconnue Yerba-Buena avait fait place à une ville unique en son genre, riche de cent mille habitants, bâtie au revers de deux collines, la place lui ayant manqué sur la plage du littoral, mais toute disposée à s’étendre jusqu’aux dernières hauteurs de l’arrière-plan, – une cité, enfin, qui a détrôné Lima, Santiago, Valparaiso, toutes ses autres rivales de l’ouest, dont les Américains ont fait la reine du Pacifique, la « gloire de la côte occidentale » !
Ce jour-là – 15 mai –, il faisait encore froid. En ce pays, soumis directement à l’action des courants polaires, les premières semaines de ce mois rappellent plutôt les dernières semaines de mars dans l’Europe moyenne. Pourtant on ne s’en serait pas aperçu, au fond de cette salle d’encans publics. La cloche, avec son branle incessant, y avait appelé un grand concours de populaire, et une température estivale faisait perler au front de chacun des gouttes de sueur que le froid du dehors eût vite solidifiées.
Ne pensez pas que tous ces empressés fussent venus à la salle des « auctions » dans l’intention d’acquérir. Je dirai même qu’il n’y avait là que des curieux. Qui aurait été assez fou, s’il eût été assez riche, pour acheter une île du Pacifique, que le gouvernement avait la bizarre idée de mettre en vente ? On se disait donc que la mise à prix ne serait pas couverte, qu’aucun amateur ne se laisserait entraîner au feu des enchères. Cependant ce n’était pas la faute au crieur public, qui tentait d’allumer les chalands par ses exclamations, ses gestes et le débit de ses boniments enguirlandés des plus séduisantes métaphores.
On riait, mais on ne poussait pas.
« Une île ! une île à vendre ! répéta Gingrass.
— Mais pas à acheter, répondit un Irlandais, dont la poche n’eût pas fourni de quoi en payer un seul galet.
— Une île qui, sur la mise à prix, ne reviendrait pas à six dollars l’acre ! cria le commissaire Dean Felporg.
— Et qui ne rapporterait pas un demi-quart pour cent ! riposta un gros fermier, très connaisseur en fait d’exploitations agricoles.
— Une île qui ne mesure pas moins de soixante-quatre milles de tour et deux cent vingt-cinq mille acres de surface !
— Est-elle au moins solide sur son fond ? demanda un Mexicain, vieil habitué des bars, et dont la solidité personnelle semblait être fort contestable en ce moment.
— Une île avec forêts encore vierges, répéta le crieur, avec prairies, collines, cours d’eau…
— Garantis ? s’écria un Français, qui paraissait peu disposé à se laisser prendre à l’amorce.
— Oui ! garantis ! répondait le commissaire Felporg, trop vieux dans le métier pour s’émouvoir des plaisanteries du public.
— Deux ans ?
— Jusqu’à la fin du monde.
— Et même au-delà !
— Une île en toute propriété ! reprit le crieur. Une île sans un seul animal malfaisant, ni fauves, ni reptiles !…
— Ni oiseaux ? ajouta un loustic.
— Ni insectes ? s’écria un autre.
— Une île au plus offrant ! reprit de plus belle Dean Felporg. Allons, citoyens ! Un peu de courage à la poche ! Qui veut d’une île en bon état, n’ayant presque pas servi, une île du Pacifique, de cet océan des océans ? Sa mise à prix est pour rien ! Onze cent mille dollars ! À onze cent mille dollars, y a-t-il marchand ?… Qui parle ?… Est-ce vous, monsieur ? Est-ce vous là-bas… vous qui remuez la tête comme un mandarin de porcelaine ?… J’ai une île !… Voilà une île !… Qui veut d’une île ?
— Passez l’objet ! » dit une voix, comme s’il se fût agi d’un tableau ou d’une potiche.
Et toute la salle d’éclater de rire, mais sans que la mise à prix fût couverte même d’un demi-dollar.
Cependant, si l’objet en question ne pouvait passer de main en main, le plan de l’île avait été tenu à la disposition du public. Les amateurs devaient savoir à quoi s’en tenir sur ce morceau du globe mis en adjudication. Aucune surprise n’était à craindre, aucune déconvenue. Situation, orientation, disposition des terrains, relief du sol, réseau hydrographique, climatologie, liens de communication, tout était facile à vérifier d’avance. On n’achèterait pas chat en poche, et l’on me croira si j’affirme qu’il ne pouvait y avoir de tromperie sur la nature de la marchandise vendue. D’ailleurs, les innombrables journaux des États-Unis, aussi bien ceux de Californie que les feuilles quotidiennes, bi-hebdomadaires, hebdomadaires, bi-mensuelles ou mensuelles, revues, magazines, bulletins, etc., ne cessaient depuis quelques mois d’attirer l’attention publique sur cette île, dont la licitation avait été autorisée par un vote du Congrès.
Cette île était l’île Spencer, qui se trouve située dans l’ouest-sud-ouest de la baie de San Francisco, à quatre cent soixante milles environ du littoral californien, par 32° 15’ de latitude nord, et 142° 18’ de longitude à l’ouest du méridien de Greenwich.
Impossible, d’ailleurs, d’imaginer une position plus isolée, en dehors de tout mouvement maritime ou commercial, bien que l’île Spencer fût à une distance relativement courte et se trouvât pour ainsi dire dans les eaux américaines. Mais là, les courants réguliers, obliquant au nord ou au sud, ont ménagé une sorte de lac aux eaux tranquilles, qui est quelquefois désigné sous le nom de « Tournant de Fleurieu ».
C’est au centre de cet énorme remous, sans direction appréciable, que gît l’île Spencer. Aussi, peu de navires passent-ils en vue. Les grandes routes du Pacifique, qui relient le nouveau continent à l’ancien, qu’elles conduisent soit au Japon soit à la Chine, se déroulent toutes dans une zone plus méridionale. Les bâtiments à voile trouveraient des calmes sans fin à la surface de ce Tournant de Fleurieu, et les steamers, qui coupent au plus court, ne pourraient avoir aucun avantage à le traverser. Donc, ni les uns ni les autres ne viennent prendre connaissance de l’île Spencer, qui se dresse là comme le sommet isolé de l’une des montagnes sous-marines du Pacifique. Vraiment, pour un homme voulant fuir les bruits du monde, cherchant la tranquillité dans la solitude, quoi de mieux que cette Islande perdue à quelques centaines de lieues du littoral ! Pour un Robinson volontaire, c’eût été l’idéal du genre ! Seulement, il fallait y mettre le prix.
Et maintenant, pourquoi les États-Unis voulaient-ils se défaire de cette île ? Était-ce une fantaisie ? Non. Une grande nation ne peut agir par caprice comme un simple particulier. La vérité, la voici : Dans la situation qu’elle occupait, l’île Spencer avait depuis longtemps paru une station absolument inutile. La coloniser eût été sans résultat pratique. Au point de vue militaire, elle n’offrait aucun intérêt, puisqu’elle n’aurait commandé qu’une portion absolument déserte du Pacifique. Au point de vue commercial, même insuffisance, puisque ses produits n’auraient pas payé la valeur du fret, ni à l’aller ni au retour. Y établir une colonie pénitentiaire, elle eût été trop rapprochée du littoral. Enfin l’occuper dans un intérêt quelconque, besogne beaucoup trop dispendieuse. Aussi demeurait-elle déserte depuis un temps immémorial, et le Congrès, composé d’hommes « éminemment pratiques », avait-il résolu de mettre cette île Spencer en adjudication, – à une condition, toutefois, c’est que l’adjudicataire fût un citoyen de la libre Amérique.
Seulement, cette île, on ne voulait pas la donner pour rien. Aussi la mise à prix avait-elle été fixée à onze cent mille dollars. Cette somme, pour une société financière qui eût mis en actions l’achat et l’exploitation de cette propriété, n’aurait été qu’une bagatelle, si l’affaire eût offert quelques avantages ; mais, on ne saurait trop le répéter, elle n’en offrait aucun ; les hommes compétents ne faisaient pas plus cas de ce morceau détaché des États-Unis que d’un îlot perdu dans les glaces du pôle. Toutefois, pour un particulier, la somme ne laissait pas d’être considérable. Il fallait donc être riche, pour se payer cette fantaisie, qui, en aucun cas, ne pouvait rapporter un centième pour cent ! Il fallait même être immensément riche, car l’affaire ne devait se traiter qu’au comptant, « cash », suivant l’expression américaine, et il est certain que, même aux États-Unis, ils sont encore rares les citoyens qui ont onze cent mille dollars, comme argent de poche, à jeter à l’eau sans espoir de retour.
Et pourtant le Congrès était bien décidé à ne pas vendre au-dessous de ce prix. Onze cent mille dollars ! Pas un cent de moins, ou l’île Spencer resterait la propriété de l’Union.
On devait donc supposer qu’aucun acquéreur ne serait assez fou pour y mettre un tel prix.
Il était, d’ailleurs, expressément réservé que le propriétaire, s’il s’en présentait jamais un, ne serait pas roi de l’île Spencer, mais président de république. Il n’aurait aucunement le droit d’avoir des sujets, mais seulement des concitoyens, qui le nommeraient pour un temps déterminé, quitte à le réélire indéfiniment.
En tout cas, il lui serait interdit de faire souche de monarques. Jamais l’Union n’eût toléré la fondation d’un royaume, si petit qu’il fût, dans les eaux américaines.
Cette réserve était peut-être de nature à éloigner quelque millionnaire ambitieux, quelque nabab déchu, qui aurait voulu rivaliser avec les rois sauvages des Sandwich, des Marquises, des Pomotou ou autres archipels de l’océan Pacifique.
Bref, pour une raison ou pour une autre, personne ne se présentait. L’heure s’avançait, le crieur s’essoufflait à provoquer les enchères, le commissaire priseur usait son organe, sans obtenir un seul de ces signes de tête que ces estimables agents sont si perspicaces à découvrir, et la mise à prix n’était pas même en discussion.
Il faut dire, cependant, que, si le marteau ne se lassait pas de se lever au-dessus du bureau, la foule ne se lassait pas d’attendre. Les plaisanteries continuaient à se croiser, les quolibets ne cessaient de circuler à la ronde. Ceux-ci offraient deux dollars de l’île, frais compris. Ceux-là demandaient du retour pour s’en rendre acquéreurs.
Et toujours les vociférations du crieur : « Île à vendre ! île à vendre ! »
Et personne pour acheter.
« Garantissez-vous qu’il s’y trouve des « flats ? » demanda l’épicier Stumpy, de Merchant-Street.
— Non, répondit le commissaire priseur, mais il n’est pas impossible qu’il y en ait, et l’État abandonne à l’acquéreur tous ses droits sur ces terrains aurifères.
— Y a-t-il au moins un volcan ? demanda Oakhurst, le cabaretier de la rue Montgomery.
— Non, pas de volcan, répliqua Dean Felporg ; sans cela, ce serait plus cher ! »
Un immense éclat de rire suivit cette réponse.
« Île à vendre ! île à vendre ! » hurlait Gingrass, dont les poumons se fatiguaient en pure perte.
« Rien qu’un dollar, rien qu’un demi-dollar, rien qu’un cent au-dessus de la mise à prix, dit une dernière fois le commissaire priseur, et j’adjuge ! Une fois !… Deux fois !… »
Silence complet.
« Si personne ne dit mot, l’adjudication va être retirée !… Une fois !… Deux fois !…
— Douze cent mille dollars ! »
Ces quatre mots retentirent, au milieu de la salle, comme les quatre coups d’un revolver.
Toute l’assemblée, muette un instant, se retourna vers l’audacieux, qui avait osé jeter ce chiffre…
C’était William W. Kolderup, de San Francisco.
II
Comment William W. Kolderup de San Francisco fut aux prises avec J.-R. Taskinar, de Stockton
Il était une fois un homme extraordinairement riche, qui comptait par millions de dollars comme d’autres comptent par milliers. C’était William W. Kolderup.
On le disait plus riche que le duc de Westminster, dont le revenu s’élève à huit cent mille livres, et qui peut dépenser cinquante mille francs par jour, soit trente-six francs par minute – plus riche que le sénateur Jones, de Nevada, qui possède trente-cinq millions de rentes –, plus riche que M. Mackay lui-même, auquel ses deux millions sept cent cinquante mille livres de rente annuelle assurent sept mille huit cents francs par heure, ou deux francs et quelques centimes par seconde.
Je ne parle pas de ces petits millionnaires, les Rothschild, les Van Der Bilt, les ducs de Northumberland, les Stewart ; ni des directeurs de la puissante banque de Californie et autres personnages bien rentés de l’ancien et du nouveau monde, auxquels William W. Kolderup eût été en situation de pouvoir faire l’aumône. Il aurait, sans se gêner, donné un million, comme vous ou moi nous donnerions cent sous.
C’était dans l’exploitation des premiers placers de la Californie que cet honorable spéculateur avait jeté les solides fondements de son incalculable fortune. Il fut le principal associé du capitaine suisse Sutter, sur les terrains duquel, en 1848, fut découvert le premier filon. Depuis cette époque, chance et intelligence aidant, on le trouve intéressé dans toutes les grandes exploitations des deux mondes. Il se jeta alors hardiment à travers les spéculations du commerce et de l’industrie. Ses fonds inépuisables alimentèrent des centaines d’usines, ses navires en exportèrent les produits dans l’univers entier.
Sa richesse s’accrut donc dans une progression non seulement arithmétique, mais géométrique. On disait de lui ce que l’on dit généralement de ces « milliardaires », qu’il ne connaissait pas sa fortune. En réalité, il la connaissait à un dollar près, mais il ne s’en vantait guère.
Au moment où nous le présentons à nos lecteurs avec tous les égards que mérite un homme de « tant de surface », William W. Kolderup comptait deux mille comptoirs, répartis sur tous les points du globe ; quatre-vingt mille employés dans ses divers bureaux d’Amérique, d’Europe et d’Australie ; trois cent mille correspondants ; une flotte de cinq cents navires qui couraient incessamment les mers à son profit, et il ne dépensait pas moins d’un million par an rien qu’en timbres d’effets et ports de lettres. Enfin c’était l’honneur et la gloire de l’opulente Frisco, – petit nom d’amitié que les Américains donnent familièrement à la capitale de la Californie.
Une enchère, jetée par William W. Kolderup, ne pouvait donc être qu’une enchère des plus sérieuses. Aussi, lorsque les spectateurs de l’« auction » eurent reconnu celui qui venait de couvrir, avec cent mille dollars, la mise à prix de l’île Spencer, il se fit un mouvement irrésistible, les plaisanteries cessèrent à l’instant, les quolibets firent place à des interjections admiratives, des hurrahs éclatèrent dans la salle de vente.
Puis un grand silence succéda à ce brouhaha. Les yeux s’agrandirent, les oreilles se dressèrent. Pour notre part, si nous avions été là, notre souffle se serait arrêté, afin de ne rien perdre de l’émouvante scène qui allait se dérouler, si quelque autre amateur osait entrer en lutte avec William W. Kolderup. Mais était-ce probable ? Était-ce même possible ?
Non ! Et tout d’abord, il suffisait de regarder William W. Kolderup pour se faire cette conviction, qu’il ne céderait jamais dans une question où sa valeur financière serait en jeu.
C’était un homme grand, fort, tête volumineuse, épaules larges, membres bien attachés, charpente de fer, solidement boulonnée. Son regard bon, mais résolu, ne se baissait pas volontiers. Sa chevelure grisonnante « touffait » autour de son crâne, abondante comme au premier âge. Les lignes droites de son nez formaient un triangle rectangle géométriquement dessiné. Pas de moustaches. Une barbe taillée à l’américaine, rudement fournie au menton, dont les deux pointes supérieures se raccordaient à la commissure des lèvres, et qui remontait aux tempes en favoris poivre et sel. Des dents blanches, rangées symétriquement sur les bords d’une bouche fine et serrée. Une de ces vraies têtes de commodore, qui se redressent dans la tempête et font face à l’orage. Aucun ouragan ne l’eût courbée, tant elle était solide sur le cou puissant qui lui servait de pivot. Dans cette bataille de surenchères, chaque mouvement qu’elle ferait de haut en bas signifierait cent mille dollars de plus.
Il n’y avait pas à lutter.
« Douze cent mille dollars, douze cent mille ! dit le commissaire priseur, avec l’accent particulier d’un agent qui voit enfin que sa vacation lui sera profitable.
— À douze cent mille dollars, il y a marchand ! répéta le crieur Gingrass.
— Oh ! on peut surenchérir sans crainte ! murmura le cabaretier Oakhurst, William Kolderup, ne cédera pas !
— Il sait bien que personne ne s’y hasardera ! » répondit l’épicier de Merchant-Street.
Des « chut ! » répétés invitèrent les deux honorables commerçants à garder un complet silence. On voulait entendre. Les cœurs palpitaient. Une voix oserait-elle s’élever, qui répondrait à la voix de William W. Kolderup ? Lui, superbe à voir, ne bougeait pas. Il restait là, aussi calme que si l’affaire ne l’eût pas intéressé. Mais – ce que ses voisins pouvaient observer – ses deux yeux étaient comme deux pistolets, chargés de dollars, prêts à faire feu.
« Personne ne dit mot ? » demanda Dean Felporg.
Personne ne dit mot.
« Une fois ! deux fois !…
— Une fois ! deux fois !… répéta Gingrass, très habitué à ce petit dialogue avec le commissaire.
— Je vais adjuger !
— Nous allons adjuger !
— À douze cent mille dollars l’île Spencer, telle qu’elle se poursuit et comporte !
— À douze cent mille dollars !
— C’est bien vu ?… bien entendu ?
— Il n’y a pas de regret ?
— À douze cent mille dollars l’île Spencer !… »
Les poitrines oppressées se soulevaient et s’abaissaient convulsivement. À la dernière seconde, une surenchère allait-elle enfin se produire ?
Le commissaire Felporg, la main droite tendue au-dessus de sa table, agitait le marteau d’ivoire… Un coup, un seul coup, et l’adjudication serait définitive !
Le public n’eût pas été plus impressionné devant une application sommaire de la loi de Lynch !
Le marteau s’abaissa lentement, toucha presque la table, se releva, tremblota un instant, comme une épée qui s’engage au moment où le tireur va se fendre à fond ; puis il s’abattit rapidement…
Mais, avant que le coup sec n’eût été porté, une voix avait fait entendre ces quatre mots :
« Treize cent mille dollars ! »
Il y eut un premier « ah ! » général de stupéfaction, et un second « ah ! » non moins général, de satisfaction. Un surenchérisseur s’était présenté. Donc il y aurait bataille.
Mais quel était ce téméraire qui osait venir lutter à coups de dollars contre William W. Kolderup, de San Francisco ?
C’était J.-R. Taskinar, de Stockton.
J.-R. Taskinar était riche, mais il était encore plus gros. Il pesait quatre cent quatre-vingt-dix-livres. S’il n’était arrivé que « second » au dernier concours des hommes gras de Chicago, c’est qu’on ne lui avait pas laissé le temps d’achever son dîner, et il avait perdu une dizaine de livres.
Ce colosse, auquel il fallait des sièges spéciaux pour qu’il pût y asseoir son énorme personne, habitait Stockton, sur le San Joachim. C’est là une des plus importantes villes de la Californie, l’un des centres d’entrepôts pour les mines du sud, une rivale de Sacramento, où se concentrent les produits des mines du nord. Là, aussi, les navires embarquent la plus grande quantité du blé californien.
Non seulement l’exploitation des mines et le commerce des céréales avaient fourni à J.-R. Taskinar l’occasion de gagner une fortune énorme, mais le pétrole avait coulé comme un autre Pactole à travers sa caisse. De plus, il était grand joueur, joueur heureux, et le « poker », la roulette de l’Ouest-Amérique, s’était toujours montré prodigue envers lui de ses numéros pleins.
Mais, si riche qu’il fût, c’était un vilain homme, au nom duquel on n’accolait pas volontiers l’épithète d’« honorable », si communément en usage dans le pays. Après tout, comme on dit, c’était un bon cheval de bataille, et peut-être lui en mettait-on sur le dos plus qu’il ne convenait. Ce qui est certain, c’est qu’en mainte occasion il ne se gênait pas pour user du « derringer », qui est le revolver californien.
Quoi qu’il en soit, J.-R. Taskinar haïssait tout particulièrement William W. Kolderup. Il le jalousait pour sa fortune, pour sa situation, pour son honorabilité. Il le méprisait comme un homme gras méprise un homme qu’il a le droit de trouver maigre. Ce n’était pas la première fois que le commerçant de Stockton cherchait à enlever au commerçant de San Francisco une affaire, bonne ou mauvaise, par pur esprit de rivalité. William W. Kolderup le connaissait à fond, et lui témoignait en toute rencontre un dédain bien fait pour l’exaspérer.
Un dernier succès que J.-R. Taskinar ne pardonnait pas à son adversaire, c’est que ce dernier l’avait proprement battu aux dernières élections de l’État. Malgré ses efforts, ses menaces, ses diffamations – sans compter les milliers de dollars vainement prodigués par ses courtiers électoraux –, c’était William W. Kolderup qui siégeait à sa place au Conseil législatif de Sacramento.
Or, J.-R. Taskinar avait appris – comment ? je ne pourrais le dire –, que l’intention de William Kolderup était de se porter acquéreur de l’île Spencer. Cette île, sans doute, lui serait aussi inutile qu’elle le serait à son rival. Peu importait. il y avait là une nouvelle occasion d’entrer en lutte, de combattre, de vaincre peut-être : J.-R. Taskinar ne pouvait la laisser échapper.
Et voilà pourquoi J.-R. Taskinar était venu à la salle de l’« auction », au milieu de cette foule de curieux, qui ne pouvait pressentir ses desseins ; pourquoi, à tout le moins, il avait préparé ses batteries ; pourquoi, avant d’agir, il avait attendu que son adversaire eût couvert la mise à prix, si haute qu’elle fût.
Enfin William W. Kolderup avait lancé cette surenchère :
« Douze cent mille dollars ! »
Et J.-R. Taskinar, au moment où William W. Kolderup pouvait se croire définitivement adjudicataire de l’île, s’était révélé par ces mots jetés d’une voix de stentor :
« Treize cent mille dollars ! »
Tout le monde, on l’a vu, s’était retourné.
« Le gros Taskinar ! »
Ce fut le nom qui passa de bouche en bouche. Oui ! le gros Taskinar ! Il était bien connu ! Sa corpulence avait fourni le sujet de plus d’un article dans les journaux de l’Union. Je ne sais quel mathématicien avait même démontré, par de transcendants calculs, que sa masse était assez considérable pour influencer celle de notre satellite, et troubler, dans une proportion appréciable, les éléments de l’orbite lunaire.
Mais la composition physique de J.-R. Taskinar n’était pas en ce moment pour intéresser les spectateurs de la salle. Ce qui allait être bien autrement émouvant, c’est qu’il entrait en rivalité directe et publique avec William W. Kolderup. C’est qu’un combat héroïque, à coups de dollars, menaçait de s’engager, et je ne sais trop pour lequel de ces deux coffres-forts les parieurs auraient montré le plus d’entrain.
Énormément riches tous les deux, ces mortels ennemis ! Ce ne serait donc plus qu’une question d’amour-propre.
Après le premier mouvement d’agitation, rapidement comprimé, un nouveau silence s’était fait dans toute l’assemblée. On aurait entendu une araignée tisser sa toile.
Ce fut la voix du commissaire priseur Dean Felporg, qui rompit ce pesant silence.
« À treize cent mille dollars l’île Spencer ! » cria-t-il, en se levant, afin de mieux suivre la série des enchères.
William W. Kolderup s’était tourné du côté de J.-R. Taskinar. Les assistants venaient de s’écarter pour faire place aux deux adversaires. L’homme de Stockton et l’homme de San Francisco pouvaient se voir en face, se dévisager à leur aise. La vérité nous oblige à dire qu’ils ne s’en faisaient pas faute. Jamais le regard de l’un n’eût consenti à se baisser devant le regard de l’autre.
« Quatorze cent mille dollars, dit William W. Kolderup.
— Quinze cent mille ! répondit J.-R. Taskinar.
— Seize cent mille !
— Dix-sept cent mille ! »
Cela ne vous rappelle-t-il pas l’histoire de ces deux industriels de Glasgow, luttant à qui élèverait l’un plus haut que l’autre la cheminée de son usine, au risque d’une catastrophe ? Seulement, là, c’étaient des cheminées en lingots d’or.
Toutefois, après les surenchères de J.-R. Taskinar, William W. Kolderup mettait un certain temps à réfléchir avant de s’engager à nouveau. Au contraire, lui, Taskinar, partait comme une bombe et semblait ne pas vouloir prendre une seconde de réflexion.
« Dix-sept cent mille dollars ! répéta le commissaire priseur. Allons, messieurs, c’est pour rien !… C’est donné ! »
Et on eût pu croire qu’emporté par les habitudes de la profession, il allait ajouter, ce digne Felporg : « Le cadre vaut mieux que cela ! »
« Dix-sept cent mille dollars ! hurla le crieur Gingrass.
— Dix-huit cent mille, répondit William W. Kolderup.
— Dix-neuf cent mille ! répliqua J .-R. Taskinar.
— Deux millions ! » répliqua aussitôt William W. Kolderup, sans attendre cette fois. Son visage avait un peu pâli lorsque ces derniers mots s’échappèrent de sa bouche, mais toute son attitude fut celle d’un homme qui ne veut point abandonner la lutte.
J.-R. Taskinar était enflammé, lui. Son énorme figure ressemblait à ces disques de chemin de fer dont la face, tournée au rouge, commande l’arrêt d’un train. Mais, très probablement, son rival ne tiendrait pas compte des signaux et forcerait sa vapeur.
J.-R. Taskinar sentait cela. Le sang montait à son visage, apoplectiquement congestionné. Il tortillait de ses gros doigts, chargés de brillants de grand prix, l’énorme chaîne d’or qui se rattachait à sa montre. Il regardait son adversaire, puis fermait un instant les yeux, pour les rouvrir plus haineux que jamais.
« Deux millions cinq cent mille dollars ! dit-il enfin, espérant dérouter toute surenchère par ce bond prodigieux.
— Deux millions sept cent mille ! répondit d’une voix très calme William W. Kolderup.
— Deux millions neuf cent mille !
— Trois millions. »
Oui ! William W. Kolderup, de San Francisco, avait dit trois millions de dollars !
Les applaudissements allaient éclater. Ils se continrent, cependant, à la voix du commissaire priseur, qui répétait l’enchère, et dont le marteau levé menaçait de s’abaisser par un involontaire mouvement des muscles. On eût dit que Dean Felporg, si blasé qu’il fût devant les surprises d’une vente publique, était incapable de se contenir plus longtemps.
Tous les regards s’étaient portés sur J.-R. Taskinar. Le volumineux personnage en sentait le poids, mais bien plus encore le poids de ces trois millions de dollars, qui semblait l’écraser. Il voulait parler, sans doute, pour surenchérir, il ne le pouvait plus. Il voulait remuer la tête… il ne le pouvait pas davantage.
Enfin sa voix se fit entendre, faiblement, mais suffisamment pour l’engager.
« Trois millions cinq cent mille ! murmura-t-il.
— Quatre millions ! » répondit William W. Kolderup.
Ce fut le dernier coup de massue. J.-R. Taskinar s’affaissa. Le marteau frappa d’un coup sec le marbre de la table…
L’île Spencer était adjugée pour quatre millions de dollars, à William W. Kolderup, de San Francisco.
« Je me vengerai ! » murmura J .-R. Taskinar.
Et, après avoir jeté un regard plein de haine sur son vainqueur, il s’en retourna à Occidental-Hotel.
Cependant, les hurrahs, les « hip » retentissaient par trois fois à l’oreille de William W. Kolderup ; ils l’accompagnèrent jusqu’à Montgomery-Street, et, tel était l’enthousiasme de ces Américains en délire, qu’ils en oublièrent même de chanter le Yankee Doodle.
III
Où la conversation de Phina Hollaney et de Godfrey Morgan est accompagnée au piano
William W. Kolderup était rentré dans son hôtel de la rue Montgomery. Cette rue, c’est le Regent-Street, le Broadway, le boulevard des Italiens de San Francisco. Tout le long de cette grande artère, qui traverse la ville parallèlement à ses quais, est le mouvement, l’entrain, la vie : tramways multiples, voitures attelées de chevaux ou de mules, gens affairés qui se pressent sur les trottoirs de pierre, devant les magasins richement achalandés, amateurs plus nombreux encore aux portes des « bars », où se débitent des boissons on ne peut plus californiennes.
Inutile de décrire l’hôtel du nabab de Frisco. Ayant trop de millions, il avait trop de luxe. Plus de confort que de goût. Moins de sens artistique que de sens pratique. On ne saurait tout avoir.
Que le lecteur se contente de savoir qu’il y avait un magnifique salon de réception, et, dans ce salon, un piano, dont les accords se propageaient à travers la chaude atmosphère de l’hôtel, au moment où y rentrait l’opulent Kolderup.
« Bon ! se dit-il, elle et lui sont là ! Un mot à mon caissier, puis nous causerons tout à l’heure ! »
Et il se dirigea vers son cabinet, afin d’en finir avec cette petite affaire de l’île Spencer et n’y plus penser. En finir, c’était tout simplement réaliser quelques valeurs de portefeuille afin de payer l’acquisition. Quatre lignes à son agent de change, il n’en fallait pas davantage. Puis William W. Kolderup s’occuperait d’une autre « combinaison », qui lui tenait bien autrement au cœur.
Oui ! elle et lui étaient dans le salon : elle, devant son piano ; lui, à demi étendu sur un canapé, écoutant vaguement les notes perlées des arpèges, qui s’échappaient des doigts de cette charmante personne.
« M’écoutes-tu ? dit-elle.
— Sans doute.
— Oui ! mais m’entends-tu ?
— Si je t’entends, Phina ! Jamais tu n’as si bien joué ces variations de l’Auld Robin Gray.
— Ce n’est pas Auld Robin Gray que je joue, Godfrey… c’est Happy moment…
— Ah ! j’avais cru ! » répondit Godfrey d’un ton d’indifférence, auquel il eût été difficile de se méprendre.
La jeune fille leva ses deux mains, laissa un instant ses doigts écartés, suspendus au-dessus du clavier, comme s’ils allaient retomber pour saisir un accord. Puis, donnant un demi-tour à son tabouret, elle resta, quelques instants, à regarder le trop tranquille Godfrey, dont les regards cherchèrent à éviter les siens.
Phina Hollaney était la filleule de William W. Kolderup. Orpheline, élevée par ses soins, il lui avait donné le droit de se considérer comme sa fille, le devoir de l’aimer comme un père. Elle n’y manquait pas.
C’était une jeune personne, « jolie à sa manière », comme on dit, mais à coup sûr charmante, une blonde de seize ans avec des idées de brune, ce qui se lisait dans le cristal de ses yeux d’un bleu noir. Nous ne saurions manquer de la comparer à un lis, puisque c’est une comparaison invariablement employée dans la meilleure société pour désigner les beautés américaines. C’était donc un lis, si vous le voulez bien, mais un lis greffé sur quelque églantier résistant et solide. Certainement elle avait beaucoup de cœur, cette jeune miss, mais elle avait aussi beaucoup d’esprit pratique, une allure très personnelle, et ne se laissait pas entraîner plus qu’il ne convenait dans les illusions ou les rêves qui sont de son sexe et de son âge.
Les rêves, c’est bien quand on dort, non quand on veille.
Or, elle ne dormait pas, en ce moment, et ne songeait aucunement à dormir.
« Godfrey ? reprit-elle.
— Phina ? répondit le jeune homme.
— Où es-tu, maintenant ?
— Près de toi… dans ce salon…
— Non, pas près de moi, Godfrey ! Pas dans ce salon !… Mais loin, bien loin… au-delà des mers, n’est-ce pas ? »
Et machinalement, la main de Phina, cherchant le clavier, s’égara en une série de septièmes diminuées, dont la tristesse en disait long et que ne comprit peut-être pas le neveu de William W. Kolderup.
Car tel était ce jeune homme, tel le lien de parenté qui l’unissait au riche maître de céans. Fils d’une sœur de cet acheteur d’île, sans parents, depuis bien des années, Godfrey Morgan avait été, comme Phina, élevé dans la maison de son oncle, auquel la fièvre des affaires n’avait jamais laissé une intermittence pour songer à se marier.
Godfrey comptait alors vingt-deux ans. Son éducation achevée l’avait laissé absolument oisif. Gradué d’université, il n’en était pas beaucoup plus savant pour cela. La vie ne lui ouvrait que des voies de communication faciles. Il pouvait prendre à droite, à gauche : cela le mènerait toujours quelque part, où la fortune ne lui manquerait pas.
D’ailleurs Godfrey était bien de sa personne, distingué, élégant, n’ayant jamais passé sa cravate dans une bague, et ne constellant ni ses doigts, ni ses manchettes, ni le plastron de sa chemise, de toutes les fantaisies joaillières, si appréciées de ses concitoyens.
Je ne surprendrai personne en disant que Godfrey Morgan devait épouser Phina Hollaney.
Aurait-il pu en être autrement ? Toutes les convenances y étaient. D’ailleurs, William W. Kolderup voulait ce mariage. Il assurait ainsi sa fortune aux deux êtres qu’il chérissait le plus au monde, sans compter que Phina plaisait à Godfrey, et que Godfrey ne déplaisait point à Phina. Il fallait qu’il en fût ainsi pour la bonne comptabilité de la maison de commerce. Depuis leur naissance, un compte était ouvert au jeune homme, un autre à la jeune fille : il n’y avait plus qu’à les solder, à passer les écritures d’un compte nouveau pour les deux époux. Le digne négociant espérait bien que cela se ferait fin courant, et que la situation serait définitivement balancée, sauf erreur ou omission.
Or, précisément, il y avait omission, et peut-être erreur, ainsi qu’on va le démontrer.
Erreur, puisque Godfrey ne se sentait pas encore tout à fait mûr pour la grande affaire du mariage ; omission, puisqu’on avait omis de le pressentir à ce sujet.





























